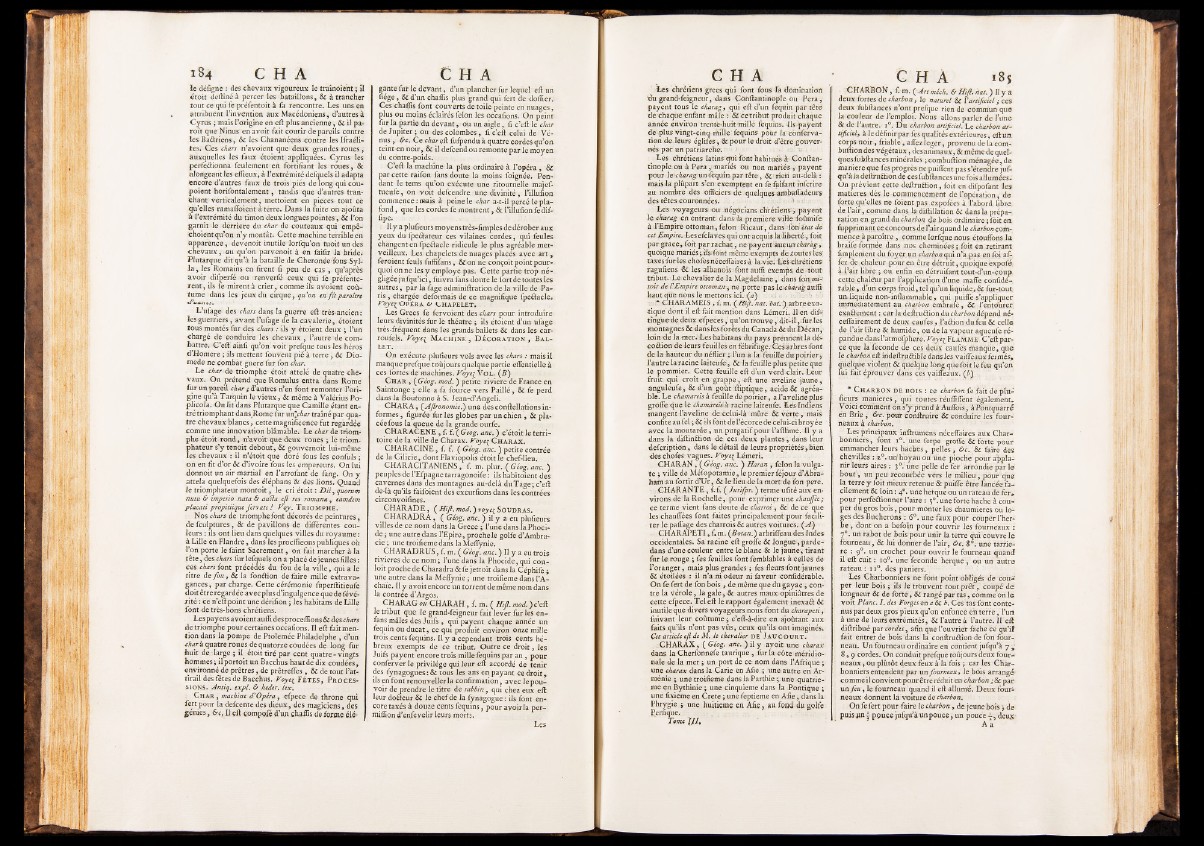
le défigne : des chevaux vigoureux le traînoieht ; il
étoit deftiné à percer les bataillons, & à trancher
tout ce qui fe préfentoit à fa rencontre. Les uns en
attribuent l’invention aux Macédoniens, d’autres à
Cyrüs ; mais l ’origine en eft plus ancienne, & il pa-
roît que Ninus en avoit fait courir de pareils contre
les Baébiens, & les Chananéens contre leslfraéli-
tes. Ges chars n’avoient que deux grandes roues ,
auxquelles les faux étoient; appliquées. •Cyrus les
perfectionna feulement en fortifiant les roues, &
âiongeant les eflieux, à l’extrémité defqueîs il adapta
encore d’autres faux de trois piés de long qui convoient
horifontalement, tandis que d’autres transitant
verticalement, mettoient en pièces tout ce
qu’elles ramaffoierit à terre. Dans la fuite on ajouta
à l’extrémité du timon deux longues pointés, & l ’on
garnit le dérriere du char de couteaux qui empê-
choie'nt qu’on n’y montât; Cette machine terrible en
apparence, devenoit inutile lorfqu’on tuoit un des
chevaux, ou qu’on parvenoit à en faifir la bride.'
Plutarque ditqu?à la bataille de Gheronée'fous Syl-
la , les Romains en firent fi peu de cas , qu’après
avoir difperfé -ou renverfé ceux qui fe préferite-
rent, ils fe mirent à crier, comme ils a voient coutume
dans les jeux du cirque, quon en f it paraître
Vautres.
L ’ufage des chars dans la guerre eft très-ancien:
les guerriers, avant l’ufage de la cavalerie, étoient
tous montés fiir des chars : ils y étoient deux ; l’un
chargé de conduire les chevaux , l’autre 'de combattre.
G’efF ainfi qu’on voit prefque tous les héros'
d’Homere ; ils mettent fouvent pié à terre, & Dio-
mede ne combat guere’ fur fon char.
Le char de triomphe étoit attelé de quatre ché-
vaux. On prétend que Romulus entra dans Rome
fur un pareil char ; d’autres n’en font remonter l’origine
qu’à Tarquin le vieux , & même à Valérius Po-
plicola. On lit dans Plutarque que Camille étant entré
triomphant dans.Rome fur un ’char traîné par quatre
chevaux:blancs, cette magnificence fut regardée
comme une innovation blâmable. Le char de triomphe
étoit rond, n’avoir que deux roues ; le triomphateur
s’y tenoit debout, & gouvernoit lui-même
les chevaux : il n’étoit que doré fous les confuls ;
on en fit d’or & d’ivoire fous les empereurs. On lui
donnoit un air martial en l’arrofant de fang. On y
attela quelquefois des éléphans & des lions. Quand
le triomphateur montoit, le cri étoit : DU, quorum
nutu & imperio nata & aucta eji res romana , eamdem
placati propitiique fervate! Voy. TRIOMPHE.
Nos chars de triomphe font décorés de peintures,
de fculptures, & de pavillons de différentes couleurs
: ils ont lieu dans quelques villes du royaume :
à Lille en Flandre, dans les proclîieons publiques oit
l’on porte le faint Sacrement, on fait marcher à la
tête, des chars fur lefquels on a placé de jeunes filles :
ces chars font précédés du fou de la v ille , qui a le
titre dçfouy&c la fonâion défaire mille extravagances
, par charge. Cette cérémonie fuperftitieufe
doit être regardée avec plus d’ingulgence que de févé^ j
jrité : ce n’eft point une dérifion ; les habitans de Lille
font de très-bons chrétiens.
Les pay ens avoient auffi des procédions & des chars
de triomphe pour certaines occafions. Il eft fait mention
dans la pompe de Ptolemée Philadelphe , d’un
char à quatre roues de quatorze coudées de long fur
huit de large ; il étoit tiré par cent quatre-vingts
hommes; il portoit un Bacchus haut de dix coudées,
environné de prêtres, de prêtreffes , & de tout l’attirail
des fêtes de Bacchus. Voye^ Fêtes , Pro cessions.
Antiq. expi. & heder. Lex.
. C har , machine d'Opéra, efpece de throne qui
fert pour la defeente des dieux, des magiciens, des
génies, &c,\\ çft compofé d’un chaffis de forme élégante
fut le devant, d’un plancher fur lequel eff un
fiége, & d’un chaflis plus grand qui fert de doffier.
Ces chafiis font couverts de toile peinte en nuages,
plus ou moins éclairés félon les occafions. On peint
fur la partie du devant, - ou un aigle, fi c’eft le char
de Jupiter ; ou des colombes, fi c’eft celui de Vénus
, &c. Ce ckar eft fufpendu à quatre cordes qu’on
teint en noir, & il defeend ou remonte parle moyen
du contre-poids.
C ’eft la machine la plus ordinaire à l’opéra , &
par cette raifon fans doute la moins foignée. Pendant
le tems qu’on exécute une ritournelle majef-
tueufe, on voit defeendre. une divinité, l’illufion
commence : mais à peine le char a-t-il percé le plafond
, que les cordes fe montrent, & l’illufion fedif-
fipe.
Il y a plufieurs moyens très-fimples de dérober aux
yeux du fpe&ateur ces vilaines cordes, qui feules
changent en fpe&acle ridicule le plus agréable merveilleux.
Les chapelets de nuages placés avec a r t ,
leroient feuls fuffifans, & on ne conçoit point pourquoi
on ne les y employé pas. Cette partie trop négligée
ju fqu’ic i, fuivra fans doute le fort de toutes les
autres, par la fage adminiftration de la ville de Paris
, chargée déformais de ce magnifique fpeétacle.
V iy c { O péra & C hapelet.
. Les Grecs fe fervoient des chars pour introduire
leurs divinités fur lè théâtre ; ils étoient d’un ufage
très-fréquent dans les grands ballets & dans les car-
roufels. Foyei Ma c h in é , D é c o r a t io n , Ball
e t . ;
On exécute plufieurs vols avec les chars : mais il
manque prefque toujours quelque partie effentielle à
ces fortes de:machines. VoyefWol. (2?)
C har , ( Gèog. mod. ) petite riviere de France en
Saintonge ; elle a fa fource vers Paillé, & fe perd
dans la Boutonne à S. Jean-d’Angeli.
CH AR A , fAflronomiei) une des conftellations informes
, figurée fur les globes par un chien , & placée
fous la queue de la grande ourfe,
CHARACENE, f. f. ( Geog. anc. ) c ’étoit le territoire
de la ville de Charax. Voye^ C h a r a x .
CHARACINE, f. f. ( Géog. anc. ) petite contrée
de la Cilicie,. dont Fia viopolis étoit le chef-lieu.
CHARACITANIENS, f. m. plur. (Géog. anc. )
peuples de l’Efpagne tarragonoife : ils habitoient des
cavernes dans des montagnes au-delà duTage; c ’eft
de-là qu’ils faifoient des excurfions dans les contrées
circonvoifines.
CH ARADE, (HiJl.mod.^voyeiSoVDRAS.
' CHARADRA, ( Géog. anc. ) il y a eu plufieurs
villes de ce nom dans la G rece ; l’une dans laPhoci-
de ; une autre dans l’Epire, proche le golfe d’Ambra-
cie ; une troifieme dans la Meffynie.
CHARADRUS, f. m. ( Géog. anc. ) Il y a eu trois
rivières de ce nom; l’une dans la Phocide, qui cou-
loit proche de Charadra & fe jettoit dans la Céphife ;
uhe autre dans la Meffynie ; une troifieme dansl’À-
chaïe. Il y avoit encore un torrent de même nom dans
la contrée d’Argos.
CHARAG ou CHARAH, f. m. ( ffiji. mod. ) c’eft
le tribut que le grand-feigneur fait lever fur les en-
fans mâles des Juifs , qui payent chaque année un
fequin ou ducat, ce qui produit environ onze mille
trois cents fequins. Il y a cependant trois cents hébreux
exempts de ce tribut. Outre ce droit, les
Juifs payent encore trois mille fequins par an , pour
conferver le privilège qui leur eft accordé de tenir
des fynagogues:& tous les ans en payant ce droit,
ils en font renouveller la confirmation, avec le pouvoir
de prendre le titre de rabbin, qui chez eux eft
leur doûeur & le chef de la fynagogue : ils font encore
taxés à douze cents fequins, pour avoir la per-
miffion d’enfevelir leurs morts.
L es
Les chrétiens grecs qui font fous ik domifiatiô'ft
% grand-feigneur, dans Çônftantinople ou Pera ;
payent tous le charag, qui eft d’un fequin par tête
île'chaque"enfant mâle : & cetribüt produit chaque
année environ trentè-huit millé fequins. Ils payent
de plus vingt-cinq mille fequins pôlif la cônfèrva-
tion de leurs églifes, dt pour le droit d^être gouvernés
par un patriarche; r ■ 5 .
Les chrétiens latins: qui font habitués à Conftan-
tinople.ou à Pera ,>■ mariés ou non mariés , payent
pour le tcÆ«râg unrfeqüm:par tête , & ' rïeti au-delà :
mais la plupart s’en exemptent en fe faifant inferire
au: nombre dès officiers de - quelques ambaffadeurs
des têtes couronnées.
Les voyageurs ou uégocians chrétiens’ y<payent
h charag en entrant dans la première, ville -foûtnife
à . l’Empire ottoman, félon | Ricaut', dans;-‘fon 'état dé
cet Empire. Les efclaves qui ont acquis la liberté-, foit
par grace, foit par rachat, ne payent 'àucv^ckâràg
quoique mariés ; ils;fbht même-exempts de toutes les'
taxesfurles chofes neceffaires-à la-vie. 'LeS chrétiens
ragufiens ■ & les albanois-fpnt auffi exemps de tbut
tribut. : Le: chevalier de là M-agdelaine,' dans Coivmi-'
noir dé IIEmpire, ottomaji^ .ne porte ‘ pas l&chàrag âuffi'
haut qüte nous lè mettons idL (a) .. -d i v
■ je * CHARAMEIS ; fi m. (.Hi/l. nat. 'bot. l) arbre exotique
dont il eft fait mention dans Lémeri. Il en difq
tîngue-de deux efpeces ^ qu ion trouve ,■ d-it^-iï, .furies
montagnes & daiislesforetsdu Canada & duDeèan,
loin-de la mer. Les habitans du pays prénrient la décoction
de leurs feuil les en fébrifuge.1 Gei arbres font
de la hàiiteur dû néflier ; Pim a la feuille du poirier y
l’autre la racine laiteufe, & la feuille plus petite que
le pommier. Cette feuille eft d’un verd clair. Leur
fruit, quï croît en. grappe -, eft une aveline jaune,
anguleufe , & d’un goût ftiptique, acide & agréable.
Le chamareis à feuille de poirier, a l’aveline plus
groffe que lè chamàréUà ■ racine laiteufe. Le's Indiens
mangent l’aveline deoelui-là mûre & verte / mais
confite au fél ■; & ils font dé l’écorce de celui-ci broyée
avec la moutarde, un purgatif pour PaftHnre. il y a
dans la diftinûion de ces? deux plantes !, dans leur
defeription, dans le détail de leurs propriétés1, bien
des chofes vagues. Voye^ Lémeri.
CH ARAN, ( Géog. anc. ) Haran , félon la 1 vülga-
te ; ville de Méfopotamie, le premier féjour-d’Abraham
au fortir d’Ur, & le lieu de la mortde fon pere.
.CH ARANTE, f. f. ( Jurifpr. ) terme ufité aux environs
d e là Rochelle, pour exprimer une chauffée;
ce terme vient fans doute de charroi , &i de ce que
les chauffées font faites principalement pour faciliter
le paffage des charrois & autres voitures. / ^ )
CHARAPETI, f. m. (JBotané) arbriffeau des Indes
occidentales^ Sa racine eft groffe & longue y parde-
dans d’une couleur entre le blanc & le jaune , tirant
fur le rouge ; fes feuilles font femblables à celles dé
l’oranger, mais plus grandes ; fes fleurs font jaunes
& étoilées : il n’a ni odeur ni faveur confidérable.
On fe fert de fon bois , de même que du gayac ; contre
la Vérole, la gale, & autres maux;opiniâtres de
cette efpece. T el eft le rapport également inexaét &
inutile que divers voyageurs nous font du charapeti,
fuivant leur coûtume; ç’eft-à-dire en ajoûtant aux
faits qu’ils n’ont pas vus, ceux qu’ils ont imaginés»
Çet article ejl de M. le chevalier DE Jau COURT.
.CH A R A X , ( Géog. anc. ) il y avoit une charax
dans la Cherfonnefe taurique , .fur la côte méridio-'
paie de la mer ; un port de ce nom dans l’Afrique ;
une charax dans la Carie en Afie. ; une aiitre en Arménie
; une troifieme dans la Parthie ; une quatrième
en Bythinie ; une cinquième dans la Pontique ;
uné fixieme en Crete ; une feptieme en A fie, dans la
Phrygie ; une huitième en Afie, au fond du golfe
Perfique.
Tome /ƒ/,
CHARBON, f. m. ( Art méch. & Hijl. nat. ) Il y a
deux fortes de charbon, le naturel &c Vartificiel ; ces
deux fubftances n’ont prefque rien de commun que
la couleur de l’emploi. Nous allons parler de l’une
& de 1 autre. i°. Du 'charbon artificiel. Le charbon artificiel,
à-le définir par fes qualités extérieures, eft un
corps noir, friable, affezléger, provenu de la corn-
buftion des végétaux, des animaux, de même de quel-*
quesfubftances minérales ; combuftion ménagée, de
maniéré que fes progrès nepuiffent pas s’étendre juf-
qu’à la deftruâion de ces fubftances une fois allumées-
On prévient cette deftruâion, foit en difpofant les
matières 'dès.le commencement de l’opération,' de
forte qu’elles ne foient pas.:expofées à l’abprd libre,
de l’air , comme dansja diftillation & dans la prépa-,
ration en grand du charbon de, bois ordinaire ; fôit en
fupprimant ce concours delJair quand le charbon com-,
mencp à paroître., comme lorfque nous étouffons la
braife formée dans nos cheminées ; foit en retirant
fimplement du foyer un çharbpn qui n’kpas-en foi affez
de çhaleur pour en être détruit, quoique expofé
â. L’-air libre ; ou enfin e,n détruifant tout-d’un-coup
cette, çhalèur par l’application d’une maffe confidé-,
rable, d’un corps froid,tel qu’un liquide^ & fur-tout
un. liquide non-inflammable, qui puiffe s’appliquer
immédiatement au éharboij. èmbrafé, & l’entourer
exaftement : car la deftruriion du charbon dépend né-
ceffairement de deux caufes, l’a&ion du feu & celle
de_l’a.ir libre & humide, ou de la vapeur aqueufe répandue
dansl’atmôfphere. Vôy_e{Flamme- Ç’ëftparce
que la fécondé de cès deux caufes manqué, que
le charbon eft indeftruâible dans les vaiffeaux fermés,
quelque violent & quelque long que foit le feu qu’on
lui fait éprouver dans ces vaiffeaux. (£)
* C h a rbo n de bois • ce charbon,fe(fait de plufieurs
maniérés, qui toutes réuffiffelit également-
Voici comment ôh s’y prend à Auffois, à Pontquàrré
en Brie, &c. jpour conftruire & conduire les fourneaux
à charbon.
Les principaux inftrumens néceffaires aüx Charbonniers,
font ,ra. une ferpe groffe àt forte pour
emmancher leurs hachés, pelles, &c. 6c faire des
chevilles : a°. urf hoyau ou une pioche pour a p la nir
leurs aires : 3°. une pelle de fer arrondie par lé
bout -, un peu recourbée vers le milieu, pour que
la terre y foit mieux retenue & puiffe être lancée facilement
& loin : 4°. une hefque ou lin rateàu de fer,
pouf perfectionner l’aire : 50. une forte hache à couper
du gros bois, pour mônter les chaumières ou loges
dés Bûcherons : 6°. une faux pour couper'l’herb
e , dont on a befoin pour couvrir lés fourneaux :
70. un rabot de bois pour unir la terre qui couvre le
fourneau, & lui donner de l’air, &c. 8°. une tarrie-
re : 90. un crochet pour ouvrir le fourneau quand
il eft cuit ; io°. une fécondé herque , ou un autre
rateau : n ° . des paniers.
Les Charbonniers ne font point obligés de cou-’
per leur bois ; ils le trouvent tout p r ê t c o u p é de
longueur & de forte, & rangé par tas, comme on le
voit Plane. I. des Forgés en a & b. Ces tâs font conte»
nus par deux gros pieux qu’on enfoncé eh terre, Fuit
à une de leurs extrémités, & l’autre à l’autre. Il eft
diftribué par -cordes, afin que l’ouvrier fâche ce .qu’il
fait entrer de bois ‘dans la conftruftion de fon four-,
neau. Un fourneau ordinaire en contient jufqu’à 7 ±
8 ,9 cordes. On conduit prefque toûjours deux four-'
neaux, ou plûtôt deux feux à la fois ; car les Charbonniers
entendent par un fourneau 9 le bois arrangé*
comme il convient pour être réduit en charbon ; & par
un feu , le fourneau quand il eft allumé. Deux fourneaux
donnent là voiture de charbon.
On fe fert pour faire le charbon , de jeune bois de
puis *in t p çuee jufqu’à un pouce, un pouce ^ , deuÿ
À a