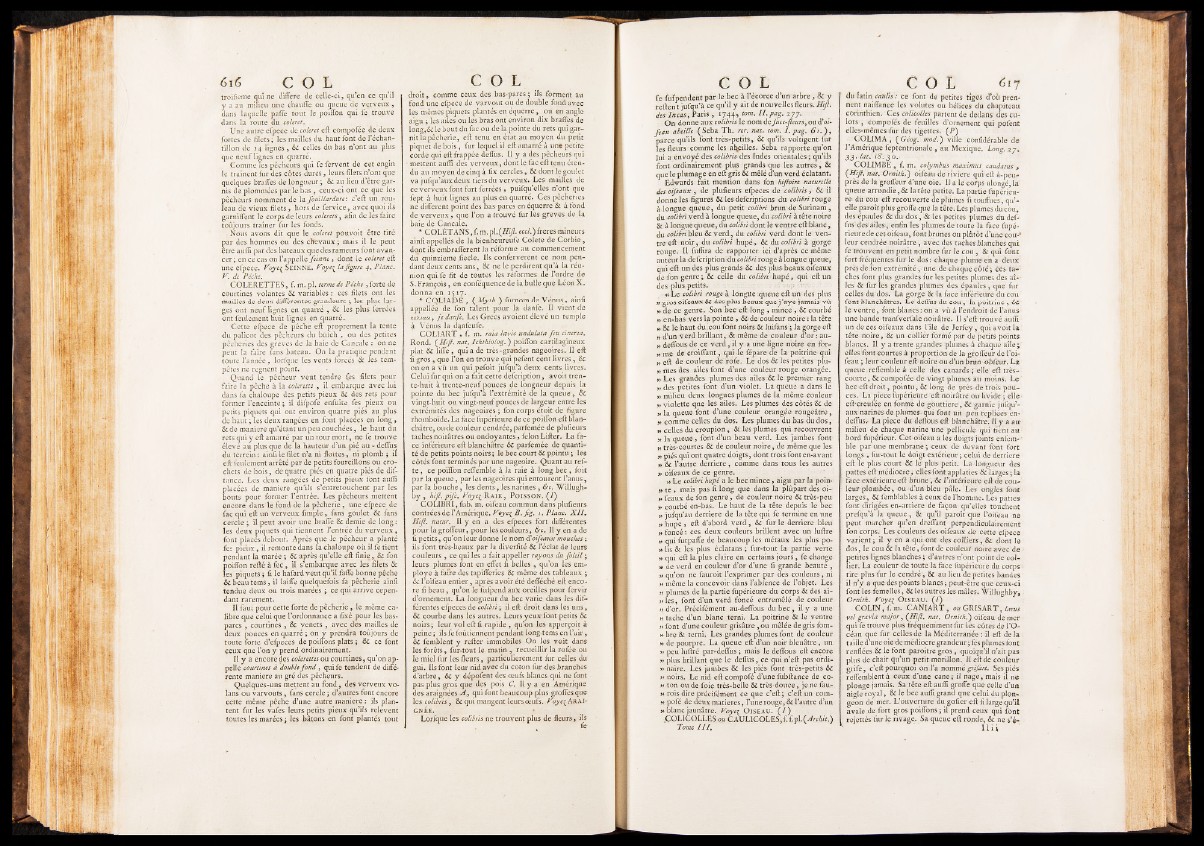
troifieme qui ne différé de celle-ci, qu’en ce qu’ il ]
y a au milieu une chauffe ou queue de v e rv eu x ,
dans laquelle paffe tout le poiffon qui fe trouve
dans la route dii colent.
Üne autre efpece de colent eft compofée de deux
fortes de filets; les mailles du haut font de l’échantillon
de 14 ligne s, 8c celles du bas n’ont au plus
que neuf lignes en quarré.
Comme les pêcheurs qui fe fervent de cet engin
le traînent fur des côtes dures, leurs filets n’ont que
quelques braffes de longueur ; 8c au lieu d’être garnis
de plommées par le bas , ceux-ci ont ce que les
pêcheurs nomment de la fouillardure : c’eft un rou^
leau de vieux filets, hors de fervice, avec quoi ils
garniffent le corps de leurs colerets, afin de les faire
toujours traîner fur les fonds.
• N ous avons dit que le coleret pouvoit être tiré
par des hommes ou des chevaux; mais il le peut
être aufli par des bateaux que des rameurs font avancer
; en ce cas on l’appelle feinne, dont le colent eft
une efpece. Voye{ Seinne. Hrye^ la figure 4. Plane.
V. de Pêche.
C O L E R E T T E S , f. m. pl. terme de Pêche , forte de
courtines volantes 8c variables : ces filets ont les
mailles de deux différentes grandeurs ; les plus larges
ont neuf lignes en quarré , 8c les plus ferrées
ont feulement huit lignes en quarré.
Cette efpece de pêche eft proprement la tente
du palicot des pêcheurs du bûfich , ou des petites
pêcheries des grèves de la baie de Cancale : on ne
peut la faire fans bateau. On la pratique pendant
toute l’année, lorfque les vents forcés & les tempêtes
ne régnent point.
Quand le pêcheur veut tendre fes filets pour
faire la pêche à la colerette , il embarque avec lui
dans fa chaloupe des petits pieux 8c des rets pour
former l’enceinte ; il difpofe enfuite fes pieux ou
petits piquets qui ont environ quatre piés au plus
de haut ; les deux rangées en font placées en long ,
& de maniéré qu’étant un peu couchées , le haut du
rets qui y eft amarré par un tour m ort, ne fe trouve
élevé au plus que de la hauteur d’un pié au - deffus
du terrein : ainfi le filet n’a ni flottes, ni plomb ; il
eft feulement arrêté par de petits fourcillons ou crochets
de b o is, de quatre piés en quatre piés de dif-
tance. Les deux rangées de petits pieux font aufli
placées de maniéré qu’ils s’entretouchent par les
bouts pour former l’entrée. Les pêcheurs mettent
encore dans' le fond de la pêcherie, une efpece de
fac qui eft un verveux Ample, fans goulet 8c fans
cercle ; il peut avoir une braffe 8c demie de long :
les deux piquets qui tiennent l’entrée du v e rv eu x ,
font placés debout. Après que -le pêcheur a planté
fes pieu x, il remonte dans la chaloupe où il fe tient
pendant la marée ; 8c après qu’elle eft finie, 8c fon
poiffon refté à fe c , il s’embarque avec les filets &
les piquets ; fi le hafard veut qu’il faffe bonne pêche
8c beau tems, il laiffe quelquefois fa pêcherie ainfi
tendue deux ou trois marées ; ce qui arrive cependant
rarement.
Il faut pour cette forte de pêcherie, le même c alibre
que celui que l’ordonnance a fixé pour les bas-
parcs , courtines , 8c venets , avec des mailles de
deux pouces en quarré ; on y prendra toujours de
toute forte d’efpeces de poiffons plats ; & ce font
ceux que l’on y prend ordinairement.
Il y a encore des colerettes ou courtines, qu’on appelle
courtines à double fond, quife tendent de différente
maniéré au gré des pêcheurs.
Quelques-uns mettent au fond, des verveux vo-
lans ou v arv ou ts, fans cercle ; d’autres font encore
cette même pêche d’une autre maniéré : ils plantent
fur les vafes leurs petits pieux qu’ils relevent
toutes les marées ; les bâtons en font plantés tout
droit, comme ceux des bas-parcs ; ifs. forment au
fond une efpece de varvout ou de double fond avec
les mêmes piquets plantés en équerre, ou en angle
aigu ; les ailes ou les bras ont environ dix braffes de
long,& le bout du fac ou de la pointe du rets qui garnit
la pêcherie, eft tenu en état au moyen du petit
piquet de b o is, fur lequel il eft amarré à une petite
corde qui eft frappée deffus. Il y a des pêcheurs qui
• mettent aufli des verveux, dont le fac eft tenu étendu
au moyen de cinq à fix cercles,‘ 8c dont le goulet
va jufqu’aux deux tiers du v erveux. Les mailles de
ce verveux font fort ferrées , puifqu’eltes n’ont que
fept à huit lignes au plus en quarré. Ces pêcheries
ne different point des bas-parcs en équerre & à fond
de v e rv eu x , que l’on a trouvé fur les grèves de la
baie de Cancale.
* C O L É TA N S , f. m .p\.{Hifi. eccl.) freres mineurs
ainfi appellés de la bienheureufe Colete de C orb ie ,
dont ils embrafferent la réforme au commencement
du quinzième .fiecle. Ils conferverent ce nom pendant
deux cents an s, 8c ne le perdirent qu a la réunion
qui fe fit de toutes les réformes .de l’ordre de
S. François, en conféquence de la bulle que Léon X .
donna en 1517.
* Ç O L IA D E , ( Myth. ) lurnom de Vén u s, ainfi
appellée de fon talent pour la danfe. Il vient de
Y,oXta.a>, je danfe. Les Grecs avoient élevé un temple
à Vénus la danfeufe.
COLIART , f. m. raia lavis undulata feu cinerea.
Rond. ( Hfi. nat. Ichthiolog. ) poiffon cartilagineux
plat 6c iiffe , qui a de très-grandes nageoires. Il eft
fi g ro s , que l’on en trouve qui pefent cent liv re s, 8c
on en a vu un qui.pefoit jufqu’à deux cents livres.
Celui fur qui on a fait cette defeription, avoit trente
huit à trente-neuf pouces de longueur depuis la
pointe du bec jufqu’à l’extrémité de la queue*, 5c
vingt-huit ou vingt-neuf pouces de largeur entre les
extrémités des nageoires ; fon corps étoit de figure
rhomboïde. L a face fupérieure de ce poiffon eft blanchâtre,
ou de couleur cendrée, parfemée de plufieurs
taches noirâtres ou ondoyantes, félon Lifter. L a face
inférieure eft blanchâtre 8c parfemée de quantité
de petits points noirs ; le bec court & ppintu ; les
côtés font terminés par une nageoire. Quant au ref-
t e , ce poiffon reffemble à la raie à long bec , foit
par la queue, par les nageoires qui entourent l’anus,
par la bouche, les dents, les narines , &c. Willugh—
by , hifi. pife. R a ie , Po i s so n , (ƒ )
COL IBR I, fub. m. oifeau commun dans plufieurs
contrées de l’Amérique. Vsye^ B. fig. 1. Plane. XII.
Hifi. natur. Il y en a des efpeces fort différentes
pour lagroffeur, pour les couleurs, &c. Il y en a de
fi petits, qu’on leur donne le nom dt oifeaux mouches :
ils font très-beaux par la diverfité 8c l’éclat de leurs
couleurs , ce qui les a fait appeller rayons du foleil ;
leurs plumes lônt en effet fi belles , qu’on les employé
à faire des tapifferies 8c même des tableaux ;
. 8c l’oifeau entier, après avoir été defféché eft encore
fi b e au , qu’on le fufpend aux oreilles pour fervir
d’ornement. L a longueur du bec varie dans les différentes
efpeces de colibri ; il eft droit dans les un s,
8c courbe dans les autres. Leurs yeux-'fönt petits 8c
noirs ; leur vol eft fi rapide , qu’on les apperçoit à
peine ; ils fe foûtiennent pendant long-tems en l’a i r ,
8c femblent y refter immobiles On les voit dans
les forêts, fur-tout le matin , recueillir' la rofée ou
le miel fur les fleurs, particulièrement fur celles du
gui. Ils font leur nid avec du coton fur des branches
d’arbre, & y dépofent des oeufs blancs qui ne font
pas plus gros que des pois C. Il y a en Amérique
des araignées A,, qui font beaucoup plus groffes que
les colibris, 8c qui mangent leurs oeufs, Araignée
. *
Lorfque les colibris ne trouvent plus de fleurs, ils
fe
fe fufpendent par le bec à l’écorce d’un arbre , & y
reften t jufqu’à ce qu’il y ait de nouvelles fleurs. Hijh
des incas, Paris , 1744 > tom. II. pag. z j p . - '. j
On donne aux colibris le nom de fuce-fieurs^ ou oifeau
abiille (S e b a Th. rer. nat. tom. I. pag. 6*/. ) ,
parce qu’ils font très-petits, & qu?ils voltigent fur
les fleurs comme les abeilles. Seba rapporte qu’on
lui a envoyé des colibris des Indes orientales ; qu’ils
font ordinairement plus grands que les au tr e s, &
que le plumage en eft gris 8c mêlé d’un verd éclatant;
Edwards fait mention dans fon hifioire naturelle
des oifeaux , de plufieurs efpeces de .colibris y 8c il
donne les figures & les deferiptions du <colibri rouge
à,longue queue, du petit colibri brun de Surinam,
du colibri verd à longue queue, du colibri à tête noire
& à longue queue, du colibri dont le ventre eft-blanc,
du colibri bleu & v e rd , du colibri verd-dont le ventre
eft n oir, du colibri hupé» 8c du colibri à gorge
rouge. Il fuffira de rapporter, ici d’après ce même
auteur la defeription Idu colibri rouge à longue queue,
qui eft un des plus grands & des plus beaux oifeaux
dé fon g enre; 6c celle du colibri • hupé, qui eft un
des p lu s petits.
« L e colibri rouge à longue -queue eft urt- des plus
» gros oifeaux 8c des, plus beaux q u e j’aye jamais'vû
» de ce genre. Son b e c eft long , mince, 6c courbé
» en-sbas .vers la pointe > 6cde couleur noire : la tête
» 8c le haut du.cou font noirs & liiifans-; la gorge eft
s>d ’un Verd brillant, & même de couleur d’o r : au-
» deffoviS.de ce v e rd , il y a une ligne noire en for-
„ me de c roiffant, qui -le fépare de la poitrine qui
» eft de couleur dé rofe. Le dos 8c les petites' plù-
» mes des. aîles font d’une couleur rouge orangée.
« L e s grandes plumes des aîles :8c le premier rang
« des petites font d’un violet. L a queue a dans le
» milieu deux longues plumes de la même couleur
« violette que les aîles. Les plumes des côtés 6c de
» la queue font d’une couleur orangée rougeâtre,
» comme celles du dos. Les plumes du bas du d o s ,
» celles du croupion , 8cdes plumes qui recouvrent
» la queue > font d’un beau verd. Les jambes font
« très-courtes 8c de couleur noire, de même que les
» piés qui ont quatre doigts, dont trois font en-avant
» 6c l’autre derrière, comme dans tous les autres
« oifeaux de ce genre.
» L e colibri hupé a le bec mince , aigu par la poin-
» te , mais pas fi long que dans la plupart des oi-
» féaux de fon genre, de couleur noire 8c très-peu
» courbé en-bas. Le haut de la tête depuis le bec
» jufqu’au derrière de la tête qui fe termine en une
» hupe , eft d’abord v e rd , 8c fur le derrière bleu
» foncé : ces deux couleurs brillent avec un luftre
» qui furpaffe de beaucoup les métaux les plus po-
» lis & les plus éclatans ; fur-tout la partie verte
» qui eft la plus claire en certains jo u rs, fe changé
« de verd en couleur d’or d’une fi grande beaute ,
« qu’on ne fauroit l’exprimer par des couleurs, ni
>» même la concevoir dans l’abfence de l’objet. Les
» plumes de la partie fupérieure du corps & des aî-
» le s, font d’un verd foncé entremêlé de couleur
» d’or. Précifément au-deffous du b e c , il y a une
» tache d’un blanc terni. L a poitrine 6c le ventre
» font d’une couleur grisâtre ,o u mêlée de gris fom-
» bre 8c terni, Les grandes plumes font de couleur
« de pourpre. L a queue eft d’un noir bleuâtre, un
» peu luftré par-deffus ; mais le deffous eft encore
» plus brillant que le deffus, ce qui n’eft pas ordi-
» naire. Les jambes 8c les piés font très-petits 8c
» noirs. Le nid eft compofé d’une fubftance de co-
» ton ou de foie très-belle 8c très-douce, je ne fau-
» rois dire précifément ce que c’eft ; c’eft un com-
« pofé de deux matières, l’une rouge, 6c l’autre d’un
» blanc jaunâtre. Voye{ O iseau. ( / )
.COLICOLLES ou CAUL ICOLES, f. {.fil.{Archit.)
Tome I I I ,
du latiii Caïilts î Ce font de petites tîgés d’où pren*
nent naiffattee les volutes ou hélices du chapiteau
corinthien. Ces colicolles partent de dedans des culots
, compofés de feuilles d’ornement qui pofent
élles-mêmes fur des tigettes. (P )
COLIMA , ( Géog. mod, ) ville Confidérable de
l ’Amérique feptentrionale , au Mexique. Long. 2y .
33- latMSr^ o..
COLIMBE , f. m. colymbus maximus Caudatui ,
{Hifi. ridt. Ornith.') oifeau de riviere qui eft à-peu-
près de la groffeur d’une ôiei II a le corps alongé, la
queue arrondie, 6c la tête petite. La partie fUpérieu*
re dù cou eft recouverte de pliimes fi touffues, qu’ elle
paroîf plus groffe que la tête. Lès plumes du cou,
des épaules 6c du d o s , 8c les petites plumes du deffus1
des'aîles’; ; enfin les plumes de toute la face fupérieure
de cet-oifeau, font brunes ou plùtôt d’une coU-*
leur cendrée noirâtre, avec des taches blanches qui
fe trouvent en petit nombre fur le colt, 8c qui font
fort fréquentes fiir le d os: chaque plume en a-deux
près de-.fon-extrémité-,-Une de chaque c ô té ; ces taches
font plus grandes fur les petites plumes des a i l les
8c fur les grandes plumes des épaules, que fur
cellesRu dos. La gorge 8c la face inférièltré du Cou
font blanchâtres. L e deffus dit c o u , la poitrine, 8c
lê ventre, font b lancs: on a vû à l’endroit de l’anus
une bande tranfverfâle noirâtre. Il s’eft trouvé âuflï
un de ces oifeaux dans l’île de Je r fe y , qui avoit la
tête noire, 8c un collier formé par de petits {joints
blancs. Il y a trente grandes -plumes à chaque a île ;
elles font courtes à proportion de la groffeur de l’oifeau
; leur cô'uleur eÆ-noire ou d’un brun obfCur. L a
queue.reffëmble à celle dés c a n à r d s 4lle' eft très-
courte, 8c compofée de vingt plumes àtt moins; L e
bec eft dro it, pointu; 8c long de près de trois pouces.
”La piece füpérie&re eft noirâtre ou liVidC; elle-
eft-creufée en forme de gouttière, 8c garnie jitfqu’-
aux narines de plumes-qui font un peu repliées én-
deffus* La piece dit déflbus eft blanchâtre. Il y a au-
milieu de chaque narine une pellicule q u i tiènt au
bord fupérieur. Cet oiféâü a les doigts joints ënfem-'
ble par Une membrane ; ceux de devant font fort
longs , fur-tout le doigt extérieur ; celui de derrière
eft lé plus court 8c le plus- petit. La longueur des
pattes eft médiocre ; eUes lbnt applaties 8c -larges ; la
face extérieure eft brune, 8c l 'intérieure eft d e couleur
plombée, ou-d’urt bleu pâle. Les ongles font
larges, 8c femblables à ceux de l’homme. Les pattes
font dirigées en-arriere de façon: qifelles touchent
prefqu’à la queue-, 8c qu’il paroît qu e l’oifeau ne
peut marcher qu’en dreffant perpendiculairement
fon corps.- Les couleurs des oifeaux de cette efpece
varient; il y en a qui ont des collie rs, 8c dont le
dos, le cou 8c la tê te , font de couleur noire avec de
petites lignes blanches ; d’autres n’ont point é e collier.
La couleur de toute la face fupérieure du c o rp s ;
tire plus fur le cendré, 8c au lieu de petites bandes
il n’y a que des points blancs ; peut-être que ceux-ci
font les femelles, 8c les autres les mâles. Willughby,
Ornith. Voye^ OlSEAU. (/)
COL IN , f. m. C A N IA R T , ou G R ISA R T , larui
! vel gravia major, {Hifi. nat. Ornith.') oifeau de mer
qui fe trouve plus fréquemment fur lés côtes de l’Océan
que fur celles de la Méditerranée : il eft de la
taille d’une oie de médiocre grandeur ; fes plumes font
renflées 8c le font paroître g ro s , quoiqu’il n’ait pas
plus de chair qu’un petit morillon. Il eft de couleur
grife, c’eft pourquoi on.l’a nommé grifart. Ses piés
reffemblent à ceux d’une cane; il n age, mais il ne
, plonge jamais. Sa tête eft aufli groffe que celle d’un
; aigle ro y a l, 8c le bec aufli grand que celui du plongeon
de mer. L’ouverture du gofier eft fi large qu’il
avale de fort gros poiffons ; il prend ceux qui font
• rejettés fur le rivage. S a queue eft ronde, 8c ne s’é-
I lii