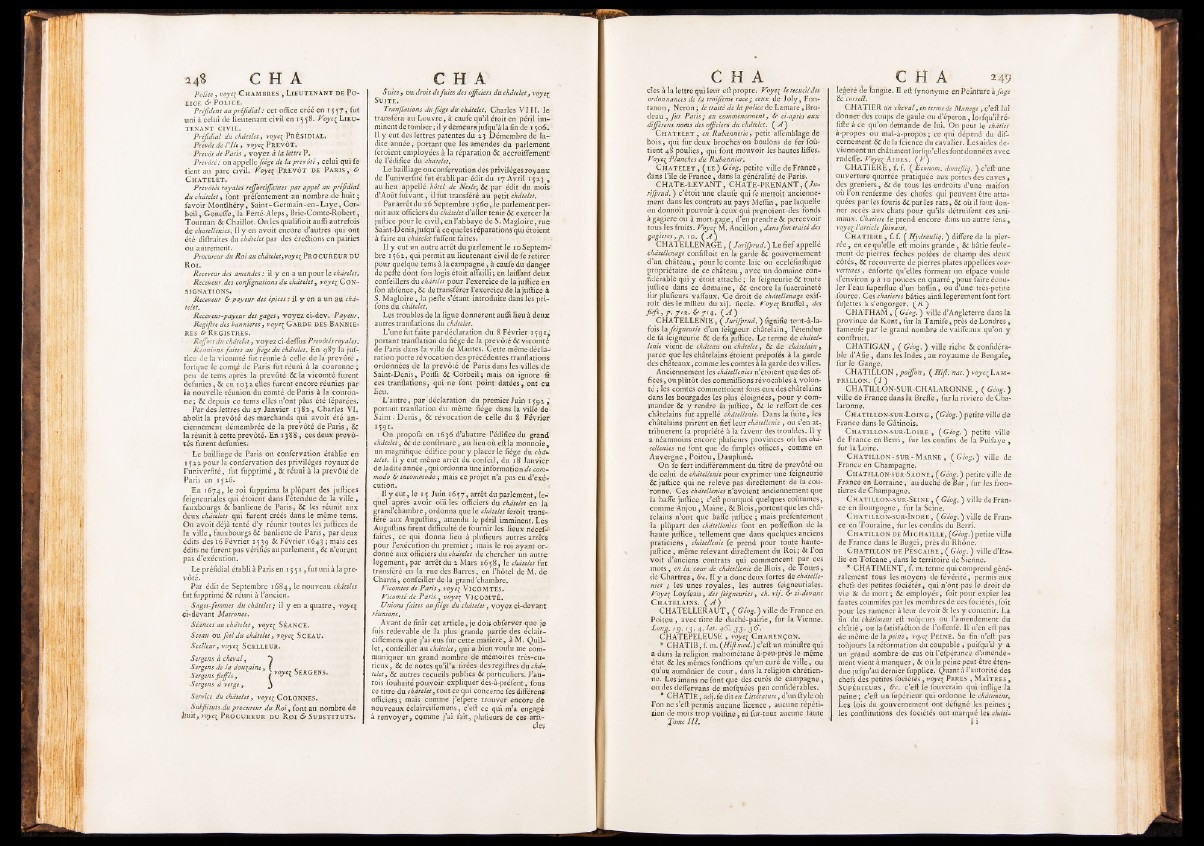
Police 3 voyt{ C hambres , Lieu tenant de Po -
xige & ‘Po l ic e . ’ ^ '■ ' ,l1
Préjident au préjidial: cet office créé en 15 5 7 , fut
«ni à celui de lieutenant civil en 15 58. Voye^ Lieuten
an t c i v i l .
Préjidial du châtelet 3 voyeç PRÉSIDIAL.
Prévôt de l'Ile , voyeç PREVOT.
Prévôt de Paris 3 voyez à la lettre P.
Prévôté: on appelle Jiége de la prévôté f celui qui fe
tient au parc civil. mÊËM Prévôt de Paris y &
C h â te le t .
Prévôtés royales rejfortijfantes par appel au préjidial
du châtelet, font prëfentement au nombre de huit;
favoir Montlhéry, Saint-Germain-en-Laye, Cor-
b eil, Goneffe, la Ferté-Aleps, Brie-Comte-Robert,
Tournan Ôc Chaillot. On les qualifioit auffi autrefois
de châtellenies. Il y en avoit encore d’autres qui ont
été diftraites du châtelet par des éreélions en pairie^
ou autrement.
Procureur du Roi au châtelet yVoye^PROCV-REVRDU
Roi.
Receveur des amendes : il y en a un pour le châtelet.'
Receveur .des conjignations du châtelet , voye£ CONSIGNATIONS.
:
Receveur & payeur des épices : il y en a un au châtelet.
Receveur-payeur des gages3 voyez ci-dev. Payeur.
Regijlre des bannières 3 voyeç GARDE DES BANNIERES
& Reg istres.
Rejfort du châtelet, voyez ci-deffus Prévôtés royales.
Réunions faites au Jiége du châtelet. En 987'l'a juf-
tice de la vicomté fut réunie à celle de la prévôté , ■
lorfquele comté de Paris fut réuni à la couronne ;'
peu de tems apres la prévôté ôc la vicomté- furent
defunies, & en 1031 elles furent encore réunies par
la nouvelle réunion du comté de Paris à la couronn
e ; & depuis ce tems elles n’ont plus été réparées-.'
Par des lettres du 27 Janvier 1382, Charles VI.
abolit la prévôté des marchands qui avoit été anciennement
démembrée de la prévôté de P aris, &
la réunit à cette prévôté. En 1388, ces deux prévôtés
furent defunies.
Le bailliàgé'de Paris ou confervation établie en
15.22 pour la confervation des privilèges royaux de
Funiverfité, fut fupprimé, ôc réuni à la prévôté de
Paris en 1526.
En 1674, le roi fupprima la plupart des juftices
feigneuriales qui étoient dans l’étendue de la v ille ,
fauxbourgs & banlieue de Paris, Ôc les réunit aux
deux châtelets qui furent créés dans le même tems.
On avoit déjà tenté d’y réunir toutes les juftices de
la v ille , fauxbourgs ôc banlieue de Paris, par deux
édits des k.6 Février 1 <39 & Février 1643 » mais ces
édits ne furent pas vérifiés au parlement, Ôc n’eurent
pas d’exécution.
Le préfidial établi à Paris en 15 5 1 , fut uni à la prévôté.
Par édit de Septembre 1684, le nouveau châtelet
fut fupprimé ôc réuni à l’ancien.
Sages-femmes du châtelet ; il y en a quatre, voye%
ci-devant Matrones.
Séances au châtelet, voye^ SÉANCE.
Sceau ou feeldu châtelet, voyeç SCEAU.
Scelleur jvoyé[ SCELLEUR.
Sergens à cheval, .
Sergens de la douzaine. | „
Scrgtns fieffés, .% S£RGENS*®S
Sergens à verge , J
Service du châtelet, voye^ COLONNES.
; Subjlituts ,du procureur du Roi, font au nombre de
hm t,y o y e i Pr o cu reur du R oi & Su b s t it u t s .
Suite3 ou droit de fuite des officiers du châtelet 3 voye£
Su it e . '
Tranjlations du Jiége du châtelet. Charles V I I I . le
transféra au Louvre, à caufe qu’il étoit en péril imminent
de tomber ; il y demeura jufqu’à la fin de 1506. •
Il y eut des lettres patentes du 23 Démembre de ladite
année, portant que les amendes du parlement
feroient employées à la réparation 5c accroiffement
de l’édifice du châtelet.
Le bailliage ou confervation des privilèges royaux
de l’univerfité fut établi par édit du 17 A vril 15 23 ,
au lieu appellé hôtel de Nesle; ôc par édit du mois
d’Aout fuivant, il-fut transféré au petit châtelet.
Par arrêt du 26 Septembre 1-760, le parlement permit
aux officiers du châtelet d’aller tenir 5c exercer la
juftice pour le civil, en l’abbaye de S. Magloire, rue
Saint-Dénis, jufqu’à ce que les réparations qui étoient
à faire au châtelet fuffent faites.
Il y eut un autre arrêt du parlement le 10 Septembre
1562, qui permit au lieutenant civil de fe retirer
pour quelque tems à la campagne, à caufe du danger
de pefte dont fon logis était alfailli; en laiffant deux
confeillers du châtelet pour l’exercice de la juftice en
fon abfence, 5c de transférer l’exercice de la juftice à
S. Magloire, la pefte s’étant introduite dans les pri-
fons du châtelet.
Les troubles de la ligue donnèrent auffi lieu à deux
autres tranfiations du châtelet.
L’une fut faite par déclaration du 8 Février 1591»
portant trartflation du fiége de la prévôté 5c vicomté
de Paris dans la ville de Mantes. Cette même déela-'
ration porte révocation des précédentes tranfiations
ordonnées de la prévôté de Paris dans les villes de
Saint-Denis, Poiffi 5c Corbeïl ; mais on ignore fi
ces tranfiations; qui ne font point datées , ont eu
lieu.
L’autre, par déclaration du premier Juin 1592 ,'
portant tranflation du même fiége dans la ville de
Saint-Denis, 5c révocation de celle du 8 Février;
1591. • jftt ÊÊ Êm | H i
On propofa en 1636 d’abattre l’édifice du grand
châtelet, & de conftruirè, au lieu où eftla monnoie,
un magnifique édifice pour y placer le fiége du chd*‘
telet. Il y eut même arrêt du confeil, du 18 Janvier
de ladite année, qui ordonna une information de com-
modo & incommoda ; mais ce projet n’a pas eu d’exécution.
Il y eut, le 15 Juin 16 57, arrêt du parlementlequel
après avoir oiii les officiers du châtelet en la
grand’chambre, ordonna que le châtelet feroit transféré
aux Auguftins, attendu le péril imminent. Les
Auguftins firent difficulté de fournir les lieux nécef-5
faires, ce qui donna lieu à plufieurs autres arrêts
pour l’exécution du premier ; mais le roi ayant ordonné
aux officiers du châtelet de chercher un autre
logement, par arrêt du 2 Mars 1658, le châtelet fut
transféré en la rue des Barres, en l’hôtel de M. de
Charni, confeiller de la grand’chambre.
Vicomtes de Paris , voyeç V l C O M TES .'
Vicomté de Paris, voyez VlCOMTÉ.
Unions faites auJiége du châtelet y voyez ci-devant
réunions.
Avant de finir cet article, je dois obferver que je
fuis redevable de la plus grande partie des eclair-
ciffemens que j’ai eus fur cette màtiere, à M. Quil- •
let, confeiller au châtelet, qui a bien voulu me communiquer
un grand nombre de mémoires très-curieux,
5c de notes qu’il’a tirées des regiftres du cA*-
telet, Sc autres recueils publics ôc particuliers. J’au-
rois fouhaité pouvoir expliquer dès-à-préfent, fous
ce titre du châtelet, tout ce qui concerne fes différens
officiers ; mais comme j’efpere trouver encore de
nouveaux éclairciffemens, c’eft ce qui m’a engagé
à renvoyer, comme j’ai fait, plufieurs de ces artid
è s à la lettré qui leur eft propre. Voye^ le recueil dès
ordonnances de la trùijieme face-; ceux de Joly, Fon-
tânôn, Néron ; le traité de la police de Larnare, Bro-
deau , fur Paris ; an commencement, & ci-après aux
différens noms des officiers du-châtelet. ( A )
C h aTe l e t , en Rubannerie, petit affemblagê dê
bois, qui fur deux broches ou boulons de fer foû-
tient 48 poulies, qui font mouvoir les hautes liftes.
Voye£ Planches du Rubannier.
C h â te let , ( l e ) Géog. petite ville deFrârtcê,
dans l’île de France, dans la généralité de Paris.
. CHATE-LEVANT, CHATE-PRENANT, (Ju-
rifprud. ) c’étoit une claufe qui fe mettoit anciennement
dans les contrats au pays Meffin, par laquelle
ôn donnoit pouvoir à ceux qui prenoient des fonds
à gagiere ou à mort-gage, d’en prendre 8c percevoir
tous lés fruits. Voye^ M. Ancillon, dans fon traité des
gagieres ,p . 10. ( A )
CH ATELLENAGE, ( Jurifprud. ) Le fief appellé
thâtellenage confiftoit en la garde ôc gouvernement
d ’un château, pour le comte laïc ou eccléfiaftique
propriétaire de ce château, avec un domaine cort-
fidérablè qui y étoit attaché ; la feigneurie ôc foute
juftice dans ce domaine, ôc encore la fuzeraineté
fur plufieurs vaffaux. C e droit de châttllenage exif-
toit dès le milieu du xij. fiecle. Voyt{ Bruffel, des
fiefs; p. J ix . ( f 7 , if. { A )
CHATELLENIE -, ( Jurifprud.. ) fignifie tout-à-la*-
fois la feigneurie d’un leigpeur châtelain, l’étendue
de fa feigneurie 5c de fa juftice. Le terme de châtellenie
vient de château ou châtelet, ôc de châtelain ,
parce que les châtelains étoient prépofés à la garde
des châteaux, comme les comtes à la garde des villes.
Anciennement les châtellenies n’étoient que des offices,
ou plutôt des commiffions révocables à volonté
; les comtes commettoient fous eux des châtelains
dans les bourgades les plus éloignées, pour y commander
ôc y rendre la juftice, ôc le reflort de ces
châtelains fut appellé Châtellenie. Dans la fuite, les
châtelains prirent en fief leur châtellenie , ou s’en attribuèrent
la propriété à la faveur des troubles. Il y
a néanmoins encore plufieurs provinces où les châtellenies
ne font que de fimples offices, comme en
Auvergne, Poitou, Dauphiné.
On le fert indifféremment du titre de prévôté ou
de celui de châtellenie pour exprimer une feigneurie
ôc juftice qui ne releve pas directement de la couronne.
Ces châtellenies n’avoient anciennement que
la baffe juftice ; c’eft pourquoi quelques coutumes ,
comme Anjou, Maine, ôc Blois, portent que les châtelains
n’ont que baffe juftice ; mais préfentement
la plupart des châtellenies font en poffeffion de la
haute juftice, tellement que dans quelques anciens
praticiens, châtellenie fe prend pour toute haute-
juftice, même relevant directement du Roi; ôc l’on
voit d’anciens contrats qui commencent par ces
mots, en la cour de châtellenie de Blois, de T ours,
de Chartres, &c. Il y a donc deux fortes de châtellenies
; les unes royales, les autres feigneuriales^
Voyt^ Loyfeau, des feigneuries3 ch.vij. 6* ci-devant
C hâtelains. J A ' ) '
CHATELLERAUT, ( Géog. ) ville de France en
Poitou, avec titre de duché-pairie, fur la Vienne.
Long. i(). 13. 4. lat. 46. 3$. 3 6 .
CHATEPELEUSE , voye{ C h aRENÇON.
* CHATIB, f. m. (Hijlmod.) c’eft un miniflfe qui
a dans la religion mahométane à-péu-près le même
état ôc les mêmes fondions qu’un curé de ville , ou
qu’un aumônier de cour, dans la religion chrétienne.
Les imans ne font que des curés de campagne,
ou.des deffervans de mofquées peu confidérables.
* CHÂTIÉ, adj. fe dit en Littérature, d’un ftyle oii
Fon ne s’eft permis aucune licence, aucune répétition
de mots trop voifine, ni fur-tout aucune faute
J ’orne ƒƒ/,
Iegéré de langue. Il eft fynonyme en Peinture à fage
ÔC correct.
CH ATIER un cheval eh terme de Manege , c’eft lui
donner des coups dé gaule ou d’éperon, lorfqu’ilré-
fifte à ce qu’on demande de lui. On peut le châtier
à-propos ou mal-à-propos ; ce qui dépend du discernement
Ôc de la fcience du cavalier. Les aides deviennent
un châtiment lorfqti’elles font données avec
rndeffe. Vbye£ A ides. ( V )
CHATIERE, f. f. ( Econom. domeßiq. ) c’eft une
, Ouverture quarfée pratiquée aux portes des caves »
des greniers, ôc de tous les endroits d’une maifon
où l’on renferme des chofes qui peuvent être attaquées
par les fouris ôc par les rats, 5c où il faut donner
accès aux chats pour qu’ils détruifent ces animaux.
Ghatiere fe prend encore dans un autre fens ,
voyeç l'article fuivant.
C hatiere , f. f. ( Hydràuliq-. ) différé de la pier-
rée, en ce qu’elle eft moins grande, ôc bâtie feulement
dê pierres feches pofëes de champ des deux
côtes, ôc recouverte de pierres plates appellées couvertures
3 enforte qu’elles forment un efpace vuide
d’environ 9 à 10 pouces en quarré, pour faire écouler
l’eau fuperflue d’un baflin, Ou d’une très-petite
•fource. Ces chatieres bâties ainfilegerement font fort
fujettes à s’engorger. ( Ä )
GHATHAM, ( Géog. ) ville d’Angleterre dans la
province de Kent, fur la Tamife, près de Londres,
fameufe paT le grand nombre de vaiffeaux qu’on y
eonftruit.
CHATIGAN , ( Géog, ) ville riche 8t cohfidéra-
ble d’A fie, dans les Indes, au royaume de Bengale,
fur le Gange.
CHAT1LLON , poijfoh3 ( Hiß. nat. ) voye^ L am-
pr il lon . ( F )
GHATILLON-SUR-CHALARONNE , ( Géog. )
ville de France dans la Breffe, fur la riviere de Cha-
laronne.
C h atîllo n-suR-Lô în g , (Géog. ) petite ville de
France dans le Gâtinois.
C hâtillon-sur-Lo ir e , (Géog.) petite ville
de France en Berri, fur les confins de la Puifaye ,
fur iâ Loire.
C hATiLLON - sur - Marne , ( Géog. ) ville de
France en Champagne.
C hatillon-sur-Sâone , (Géog\ ) petite ville de
France en Lorraine ; au duché de Bar, fur les frontières
de Champagne.
C h atillo n-sur-SèiNé ; ( Géog. ) ville de France
en Bourgogne , fur la Seinè.
C hatillon-sur-In d re, (Géog*) ville de Fran--
ce en Touraine, furies confins du Berri.
C h atil lon de Mi ch a ille, (Géog.) petite ville
de France dans le Bugéi, près du Rhône.
C h atillo n de Pe sCaire , ( Géog. ) ville d’Ita-*-
li’e en Tofcane, dans le territoire de Sienne. ‘
* CHATIMENT, f. m. terme qui comprend géné-1-
ralement tous les moyens de févérité, permis aux
chefs des petites fôciétés, qui n’ont pas le droit de
Vie & de mört ; & employés, foit pour expier les
fautes commifes par les membres de ces fôciétés, foit
pour les ramener à leur devoir ôc les y contenir. La
fin du châtiment eft toujours ou l’amendement du
châtié , Ou la fatisfaélion de l’offenfé. Il n’en eft pas
1 de même, de la peine, veye[ Peine. Sa fin n’eft pas
; toujours la réformation du coupable, puifqu’il y a
, ùn grand nombre de cas où l’efpérance d’amende-
I ment vient à manquer, ôc où la peine peut être éten-
! due jufqu’au dernier fupplice. Quant à l’autorité des
! chefs des petites fôciétés, voye^ Peres , Maitres ,
Supérieurs, & c. c’eft le fouverain qui inflige la
peine ; c’eft un fupérieur qui ordonne le châtiment.
Les lois du gouvernement ont défigné les peines ;
les conftitutions des fôciétés ont marqué les châti-
l i