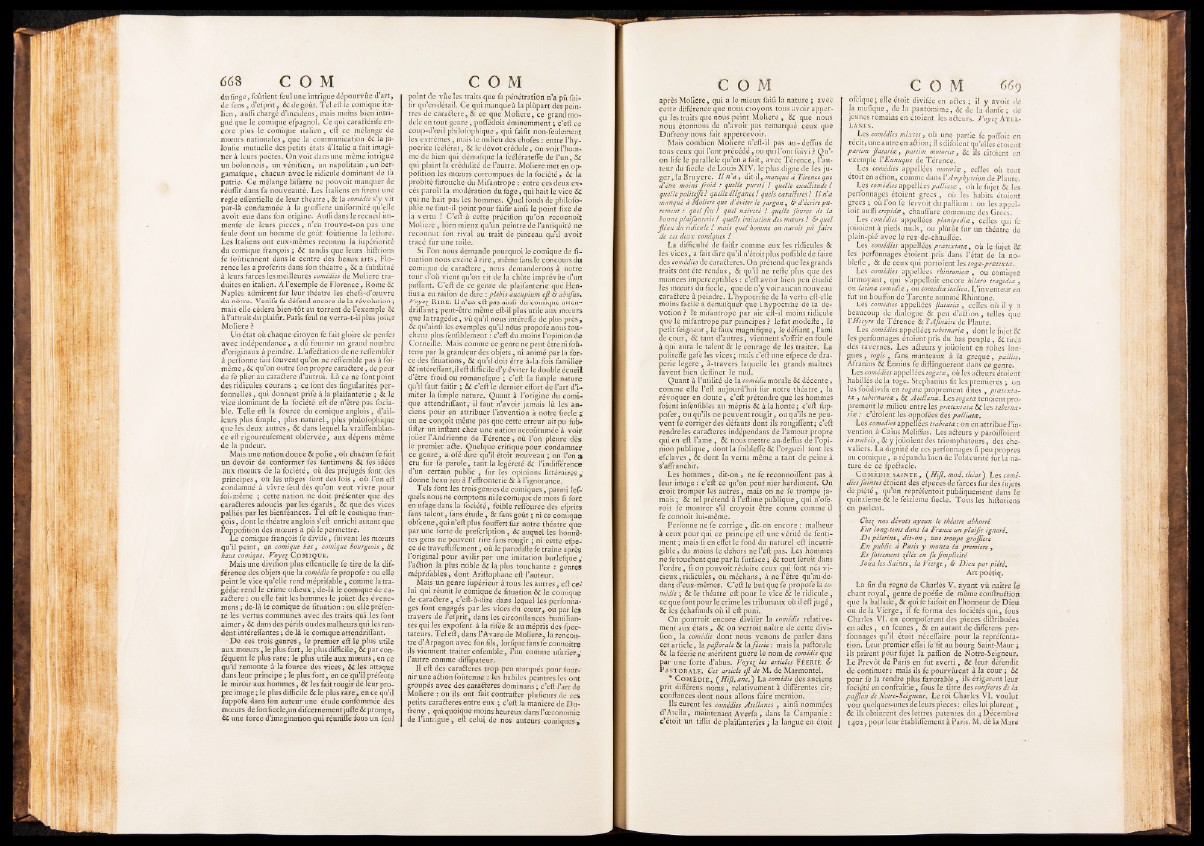
du Ange, foûtient feul une intrigue dépourvue d’art,
de fens , d’efprit, 8c de goût. Te l eft le comique italien
, aufli chargé d’incidens, mais moins bien intrigué
que le comique efpagnol. Ce qui cara&érife encore
plus le comique italien, eft ce mélange de
moeurs nationales , que la communication 6c la ja-
loufie mutuelle des petits états d’Italie a fait imaginer
à leurs poëtes. On voit dans une même intrigue
un bolonnois, un vénitien, un napolitain , un ber-
gamafque, chacun avec le ridicule dominant de fa
patrie. Ce mélange bifarre ne pouvoit manquer de
réuffir dans fa nouveauté. Les Italiens en firent une
réglé eflentielle de leur théâtre, & la comédie s’y vit
par-là condamnée à la grofîiere uniformité qu’elle
avoit eue dans fon origine. Aufli dans le recueil im-
menfe de leurs p iè ce s, n’en trouve-t-on pas une
feule dont un homme de goût foûtienne la leûure.
Les Italiens ont eux-mêmes reconnu la fupériorité
du comique françois ; 8c tandis que leurs hiftrions
fe foûtiennent dans le centre des beaux a r ts, Florence
les a profcrits dans fon théâtre , 8c a fubftitué
à leurs farces les meilleures comédies de Moliere traduites
en italien. A l’exemple de Florence, Rome 8c
Naples admirent fur leur théâtre les chefs-d’oeuvre
du nôtre. Venife fe défend encore de la révolution ;
mais elle cédera bien-tôt au torrent de l’exemple 8c
à l’attrait du plaifir. Paris feul ne verra-t-il plus jouer
Moliere ?
Un état où chaque citoyen fe fait gloire de penfer
avec indépendance, a dû fournir un grand nombre
d’originaux à peindre. L ’affeélation de ne reflembler
à perfonne fait fouvent qu’on ne reflemble pas à foi-
même, 8c qu’on outre fon propre cara&ere, de peur
de fe plier au caraétere d’autrui. Là ce ne font point
des ridicules courans ; ce font des Angularités per-
fonnelles , qui donnent prife à la plaifanterie ; 8c le
v ice dominant de la fociété eft de n’être pas focia-
ble. Telle eft la fource du comique anglois , d’ailleurs
plus Ample, plus naturel, plus philofophique
que les deux autres, 8c dans lequel la vraiffemblan-
ce eft rigoureufement obfervée, aux dépens même
de la pudeur.
Mais une nation douce & po lie , où chacun fe fait
un devoir de conformer fes fentimens 8c fes idées
aux moeurs de la fociété, où des préjugés font des
principes, où les ufages font des lois , où l ’on eft
condamné à vivre feul dès qu’on veut vivre pour
foi-même ; cette nation ne doit préfenter que des
caratteres adoucis par les égards, 8c que des vices
palliés par les bienleances. Te l eft le comique fran-
^ o is , dont le théâtre anglois s’eft enrichi autant que
l’oppoAtion des moeurs a pû le permettre.
L e comique françois fe divife, fuivant les moeurs
qu’il peint, en comique bas , comique bourgeois , ÔC
haut comique. Voyeq_ CpMlQUE.
Mais une diviAon plus eflentielle fe tire de la différence
des objets que la comédie fe propofe : ou elle
peint le vice qu’elle rend méprifable, comme la tragédie
rend le crime odieux ; de-là le comique de ca-
ra&ere : ou elle fait les hommes le joiiet des évene-
mens ; de-là le comique de Atuation : ou elle préfente
les vertus communes avec des traits qui les font
aim e r, 8c dans des périls ou des malheurs qui les rendent
intéreflantes ; de-là le comique attendriflant.
D e ces trois g enres, le premier eft le plus utile
aux moeurs, le plus fo rt, le plus difficile, 8c par con-
féquent le plus rare : le plus utile aux nioeurs, en ce
qu’il remonte à la fource des v ic e s , 8c les attaque
dans leur principe ; le plus fo rt, en ce qu’il préfente
le miroir aux hommes, 8c les fait rougir de leur propre
image ; le plus difficile 8c le plus r a re , en ce qu’il
ïuppofe dans fon auteur une étude confommée des
moeurs defonflede,un difcernementjufte & prompt,
&ç une force d’imagination qui réunifie fous un feul
point de vue les traits que fa pénétration n’a pu fai-
fir qu’en détail. Ce quimanqueà la plûpart des peintres
de c à ra â e re , & ce que Moliere, ce grand modèle
en tout genre , poffédoit éminemment ; c’eft ce
coup-d’oeil philofophique , qui faiflt non-feulement
les extrêmes, mais le milieu des chofes : entre l’hypocrite
fcélérat, 8c le dévot crédule, on v o it l’homme
de bien qui démafque la fcélérateffe de l’un, 8c
qui plaint la crédulité de l’autre. Moliere met en op-
pofttion les moeurs corrompues dè la fociété , & la
probité farouche du Mifantrope : entre ces deux excès
paroît la modération du fag e , qui hait le vice 6c
qui ne hait pas les hommes. Quel fonds de philofo-
phie ne faut-il point pour faiflr ainfl le point fixe de
la vertu ! C ’en: à cette précifion qu’on reconnoît
Moliere , bien mieux qu’un peintre de l’antiquité ne
reconnut fon rival au trait de pinceau qu’il avoit
tracé fur une toile.
Si l’on nous demande pourquoi le comique de fi-
tuation nous excite à rire , même fans le concours du
comique de c araû ere , nous demanderons à notre
tour d’où vient qu’on rit de la chûte imprévue d’un
paflant. C ’eft de ce genre de plaifanterie que Hen-
fius a eu raifon de dire : plebis aucupium ejl & abufus.
Voye^ Rire. Il n’en eft pas ainfi du comique attendriflant
; peut-être même eft-il plus utile aux moeurs
que la tragédie, vû qu’il nous intérefle de plus près ,
& qu’ainfi les exemples qu’il nous propofe nous touchent
plus fenfiblement : c’eft du moins l’opinion de
Corneille. Mais comme ce genre ne peut êtrenifoû-
tenu par la grandeur des objets, ni animé par la force
des fituations, 6c qu’il doit être à-la-fois familier
6i intéreflant,il eft difficile d’y éviter le double écueil
d’être froid ou romanefque ; c’eft la Ample nature
qu’il faut faiAr ; 6c c’eft le dernier effort de l’art d’imiter
la Ample nature. Quant à l ’origine du comi-;
que attendriflant, ' il faut n’avoir jamais lû les anciens
pour en attribuer l’invention à notre flecle
on ne conçoit même pas que cette erreur ait pu fub-
lifter un inftant chez une nation accoutumée à voir,
joiier l’Andrienne de Té ren c e, où l’on pleure dès
le premier aéte. Quelque critique pour condamner
ce genre, a ofé dire qu’il étoit nouveau ; on l’en a
cru fur fa parole, tant la legéreté 6c l’indifférence
d’un certain public , fur les opinions littéraires Lj
donne beau jeu à l’effronterie & à l’ignorance.
Tels font les trois genres de comiques, parmi lef-
quels nous ne comptons ni le comique de mots A fort
en ufage dans la fociété, foible reflource dés efprits
fans talent, fans é tude, 8c fans goût ; ni ce comique
obfcene,quin’eftplus fouffertfur notre théâtre que
par une forte de prefcription, 6c auquel les honnêtes
gens ne peuvent rire fans rougir ; ni cette efpe-:
ce de traveftiffement, où le parodifte fe traîne après
l’original pour avilir par une imitation burlefque ,
l’aétion la plus noble 6c la. plus touchante : genres,
méprifables, dont Ariftophane eft l’auteur.
Mais un genre fupérieur à tous les autres, eft celui
qui réunit le comique de Atuation 6c le comique
de c a r a â e r e , c’eft-à-dire dans lequel les perfonna-
ges font engagés p arle s vices du coeur, ou par les
travers de l’efprit, dans les circonftances humiliantes
qui les expofent à la rifée & au mépris des fpec-
tateurs. T e l e ft, dans l’Avare de Moliere, la rencontre
d’Arpagon avec fon fils, lorfque fansfeeonnoître
ils viennent traiter enfemble, l’un comme ufurier
l’autre comme diflïpateur.
Il eft des cara&eres trop peu marqués pour fournir
une aélion foûtenue : les habiles peintres les ont
groupés avec des carafteres dominans ; c’eft l’art de
Moliere : ou ils ont fait contrafter plnfieurs de ces
petits carafteres entre eux ; c’eft la maniéré de Du-
fren y , qui quoique moins heureux dans l’oeconomie
de l’intrigue, eft celui de nos auteurs comiques j
C O M
après Molîerè, qui a le mieux faifi la naturé ; avôc
cette différence que nous croyons tous avoir apper-
çu les traits que nous peint Moliere , 6c que nous
nous étonnons de n’avoir pas remarqué ceux que
Dufreny nous fait apperCevoir.
Mais combien Moliere n’eft-il pas au - deffus de
tous ceux qui l’ont précédé, ou qui l’ont fuivi ? Qu’on
life le parallèle qu’en a fait, avec Térence, l’auteur
du fiecle de Louis XIV . le plus digne de les ju ger
, la Bruyere. IL n'a , dit-il, manque à Térence que
d'être moins froid : quelle pureté ■! quelle exactitude !
quelle politeffe ! quelle élégance ! quels caractères ! Il ri à
manqué à Moliere que d'éviter le jargon, & £ écrire purement
: quel feu ! quel naïveté ! quelle fource de la
bonne plaifanterie ! quelle imitation des moeurs ! & quel
fléau du ridicule ! mais quel homme on auroit pu faire
de ces deux comiques l
La difficulté de faiAr comme eux les ridicules 8c
les v ic e s, a fait dire qu’il n’étoit plus poflible de faire
des comédies de Carafteres. On prétend que les grands
traits ont été rendus, 8c qu’il ne refte plus que des
nuances imperceptibles : c’eft avoir bien peu étudié
les moeurs du Aecie, que de n’y voir aucun nouveau
cara&ère à peindre. L ’hypocriAe de la vertu eft-elle
moins facile a démafquer que l’hypocriAe de la dévotion
? le mifantrope par air eft-il moins ridicule
que le mifantrope par principes ? le fat modefte, le
petit feigneur, le faux magnifique, le défiant, l’ami
de cour, 6c tant d’autres, viennent s’offrir en foule
à qui aura le talent 8c le courage de les traiter. La
politeffe gafe les vices ; mais c ’eft une efpece de draperie
Iegere , à-travers laquelle les grands maîtres
lavent bien defîïner le nud.
Quant à l’utilité de la comédie morale 8c décente,
comme elle l’eft aujourd’hui fur notre théâtre , la
révoquer en doute, c’eft prétendre que les hommes
foient infenfibles au mépris 8c à la honte ; c’eft fup-
pofer, ou qu’ils ne peuvent rougir, ou qu’ils ne peuvent
fe corriger des défauts dont ils rougiffent ; c’eft
fendre les caraéteres indépendans de l ’amour propre
qui en eft l’ame , ôc nous mettre au-deffus de l’opinion
publique, dont la foiblefle 8c l’orgueil font les
efclaves , 6c dont la vertu même a tant de peine à
s’affranchir.
Les hommes , dit-on , ne fe reconnoiffent pas à
leur image : c’eft ce qu’on peut nier hardiment. On
croit tromper les autres , mais on ne fe trompe jamais
; 6c tel prétend à l’eftime publique, qui n’ofe-
fo it fe montrer s’il croyoit être connu comme il
fe connoît lui-même.
Perfonne ne fe corrige , dit-on encofe i malheur
à ceux pour qui ce principe eft une vérité de fenti-
ment ; mais fi en effet le fond du naturel eft incorrigible
, du moins le dehors ne l’eft pas. Les hommes
ne fe touchent que par la furface ; 6c tout féroit dans
l’ordre, fi on pouvoit réduire ceux qui font nés vicieux
, ridicules, ou méchans, à ne l’être qu’ au-de-
dans d’eux-mêmes. C ’eft le but que fe propofe là co=■
médie ; 6c le théâtre eft pour le vice 6c le ridicule ,
ce que font pour le crime les tribunaux où il eft ju g é ,
6c les échafauds où il eft puni.
On pourroit encore divifer la comédie relativement
aux é ta ts, 6c on verroit naître de cette divi-
fion, la comédie dont nous venons de parler dans
cet article, la pajiorale & la féerie : mais la paftorale
8c la féerie ne méritent guere le nom de comédie que
par une forte d’abus. Voye^ les articles Féerie &
Pastorale. Cet article ef de M. de Marmontel.
* Comédie, ( Hifi.anc. ) La comédie des anciens
prit différens noms , relativement à différentes cirr
confiances dont nous allons faire mention. ,
Ils eurent les comédies Atéllanes , ainfi nommées
d’Atella, maintenant A v e rfa , dans la Campanie :
ç’étoit un tiflii de plajfanteries ? la langue en étoit
C O M 669
ofeique ; elle étoit divifée en a&es ; il y avoit dé
la mufique * de la pantomime, 8c de la danfe ; dé
jeunes romains en étoient les afteurs. Voyez A tellanes.
( Les comédies mixtes, où une partie fe paffoït en
récit, une autre en aélion; il s difoient qu’elles étoient
partim Jiatarice, partim motorix, 8c ils citoient en
exemple l’Eunuque de Térence.
Les comediés appellées motorix , celles où tout
étoit en aélion, comme dans V Amphytrion de Plaute*
Les comédies appellées palliaue , où le fujet 6c les
perfonnages étoient grecs , où les habits étoient
grecs ; où l’on fe fervoit du pallium : on les appel*
loit aufli crepidx, chauffure commune des Grecs.
Les comédies appellées planipedice, celles qui fe
joüoient à pieds nuds, ou plûtôt fur un théâtre de
plain-pié avec le rez-de-chauffée.
Les comédies appellées proetextatat, où le fujet 6c
les perfonnages étoient pris dans l’état de la no*
blefl'e , & de ceux qui portoient les toga-proetextoe.
Les comédies appellées rhintonicce , ou comique
larmoyant, qui s’appelloit encore hilaro tragedia ,
ou latina comedia, ou comedia italica. L’inventeur en
fut un bouffon de Tarente nommé Rhintone.
Les comédies appellées flatarix , celles où il y a
beaucoup de dialogue 8c peu d’a â io n , telles quô
YHecyre de Térence 8c YAfînâire de Plaute.
Les comédies appellées tabernarix , dont le fujet 8c
les perfonnages étoient pris du bas peuple, 6c tirés
des tavernes. Les aéleurs y joüoient en robes longues
, togis, fans manteaux à la g reque, palliis.
Afranius 8c Ennius fe diftinguerent dans ce genre.
Les comédies appellées togatx, où les aéleurs étoient
habillés de la toge. Stephanius fit les premières ; on
les foûdivifa en togatx proprement dites , prxtexta-
tx , tabernarix, 8c Atellanx. Les togatx tenQient proprement
le milieu entre les prxtextatx 8c les tabernarix
: c’éfôient les ôppofées des palliatx.
~Les comédies appellées trabeatx : on en attribue l ’invention
à Caïus Melilfus. Les aéleurs y paroifîbient
in trabeis, 8c y joüoient des triomphateurs, des chevaliers.
La dignité de ces perfonnages fi peu propres
au comique, a répandu bien de l’obfcurité fur la nature
de cé fpeftacle.
CQMÉDIE SAINTE, (Hifl. mod. thiat) Les cômé-
dies faintes étoient des efpeces de farces fur des fuiets
de piété , qu’on repréfentoit publiquement dans le
quinzième 6c le feizieme fiecle. T ou s les hiftoriens
en parlent.
Cke[ nos dévots ayeux le théâtre abhorré
Fut long-tems dans la France un plaijîr ignoré.
De pèlerins, dit-on , uue troupe groffiere
En public à Paris y monta la première ,
Et follement jflée en fa jîmplicite
Joüa les Saints, la Vierge , & Dieu par piété.
Art poétiq.
La fin du régné de Charles V. ayant vû naître lè
chant ro y al, genre de poéfie de même conftruéliori
que la ballade, 8c qui fe faifoit en l’honneur de Dieu
ou de la Vierge, il fe forma des fociétés qu i, fous
Charles VI. èn compoferent des pièces diftribuées
en aétes, en feenes , 8c en autant de différens perfonnages
qu’il étoit néceflaire pour la repréfenta-
tion. Leur premier effai fe’fit au bourg Saint-Maur j
ils prirent pour fujet la paflion de Notre-Seigneur.
Le Prévôt de Paris en fut a v e rti, 6c leur défendit
de continuer : mais ils fe pourvurent à la cour ; 6c
pour fe la rendre plus favorable , ils érigerent leur
fociété en confrairie, fous le titre des confrères de la
paflion de Notre-SeigneUr. Le roi Charles VI. voulut
voir quelques-unes de leurs pièces : elles lui plurent,
8c ils obtinrent des lettres patentes du 4 Décembre
140Z, pour leur établiffement à Paris. M. de la Mare