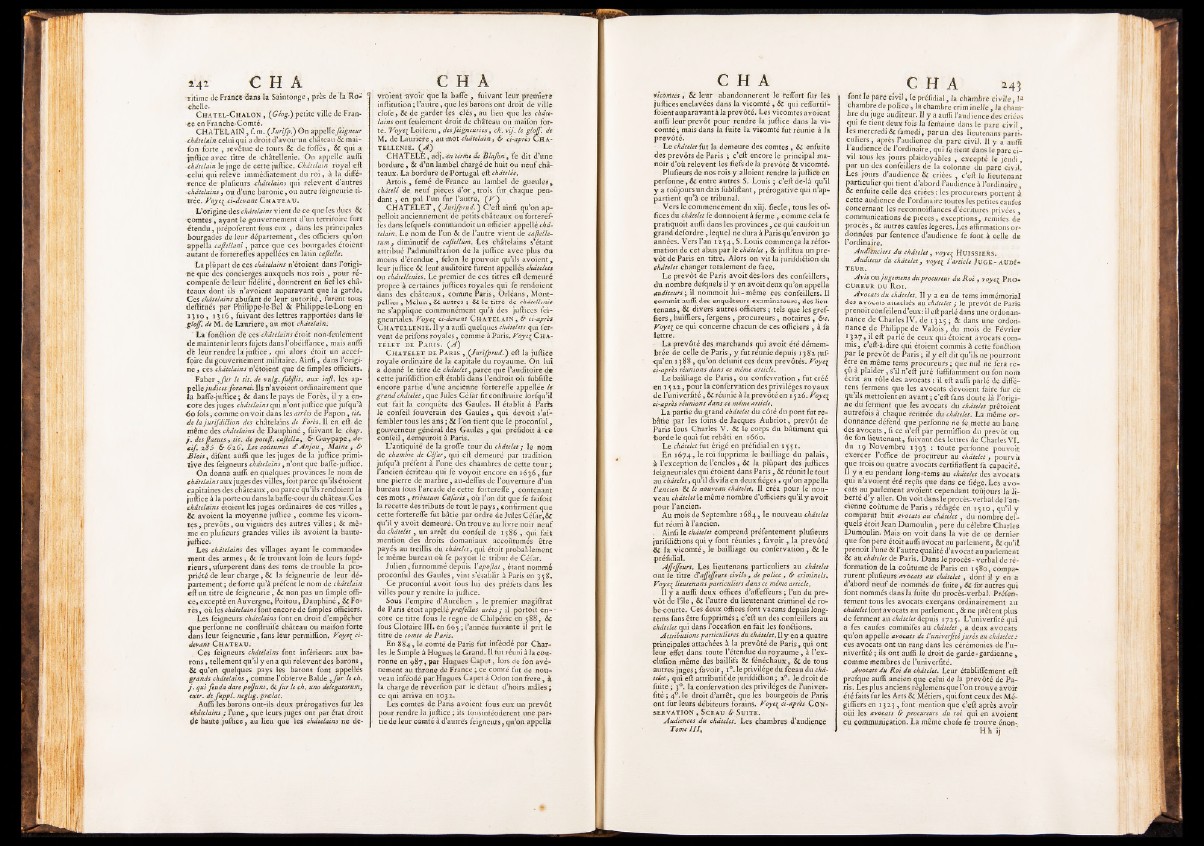
■ TÎtime de France dans la Saintongé, près de la Rochelle.
C hate l-C ha lo n , (Géog.) petite ville de France
en Franche-Comté.
CHATELAIN, f. m. ( -Jurifp.) On appelleyiigvzear
châtelain celui qui a droit d’avoir'un château & maifon
forte , revêtue de tours & de foffés, Sc qui a
juftice avec titre de châtellenie. On appelle auffi
châtelain le juge de cette juftice. Châtelain royal eft
•celui qui relève immédiatement du ro i, à la différence
de- plufieurs -châtelains qui relèvent d’autres
•«châtelains, ou d’ttne baronie, ou autre feigneurie titrée.
Voyt{ ci-devant C h a t e àU.
L’origiite des châtelains vient de ce que les ducs Sc
comtes, ayant le gouvernement d’un territoire fort
étendu, prépoferent fous eux , dans les principales
bourgades de leur département, des officiers qu’on
appella cafleliani, parce que ces bourgades étoiènt
autant de fortereffes appellées en latin cajlellai
La plupart de ces châtelains n’étoient dans l’origine
^que des concierges auxquels nos rois , pour ré-
compenfe de leur fidélité, donnèrent en fief les châteaux
dont ils n’avoient auparavant que la garde.
Ces châtelains abufant de leur autorité, furent tous
deftitués par Philippe-le-Bel & Philippe-le-Lortg en
13 10 , 13 16 , fuivant des lettres rapportées dans le
.gloff. de M. de Lauriere, an nfot châtelain.
' La fonction de ces châtelains étoit non-feulement
de maintenir leurs fujets dans l’obéiffance, mais auffi
dfc leur rendre la juftice , qui alors étoit un accéf-
foire du gouvernement militaire. Ainfi, dans l’origine
, ces châtelains n’étôient que de limples officiers.
Faber ,fur le tit. de vulg.fùhjlit, aux infi. les ap-
pellejudices foranei-.ils n’avoient ordinairement que
la baffe-juftice ; & dans le pays de Forés, il y a encore
des juges châtelains qui n’ont juftice que jufqu’à
<$o fols , comme on voit dans les arrêts de P apon, tit.
de la jurifdiclion des châtelains de Forés. Il en eft de
même des châtelains de Dauphiné, fuivant le chap.
j . des Jlatuts y tit. de potefl. cafiella, & Guypape, de-
cif. 2.85 & €2 6. Les coutumes d Anjou, Maine , &
Blois y difent aüfli que les juges de la juftice primitive
des feigneurs châtelains, n’ont que baffe-juftice.
On donna auffi en quelques provinces le nom de
châtelains aux juges des villes, foit parce qu’ils étoient
capitaines des châteaux, ou parce qu’ils rendoient la
juftice à la porte ou dans la baffe-cour du château .Ces
châtelains étoient les juges ordinaires de ces villes ,
& avoient la moyenne juftice , comme les vicomtes
, prévôts, ou viguiers des autres villes ; & même
en plufieurs grandes villes ils avoient la haute-
juftice.
Les châtelains des villages ayant le commande^
ment des armes, & fe trouvant loin de leurs fupé-
rieurs, ufurperent dans des tems de trouble la propriété
de leur charge, & la feigneurie de leur département
; deforte qu’à préfent le nom de châtelain
eft un titre de feigneurie, & non pas un fimple office,
excepté en Auvergne, Poitou, Dauphiné, Sc Fo^
rès, où les châtelains font encore de fimples officiers.
Les feigneurs châtelains font en droit d’empêcher
que perfonne ne conftruife château ou maifon forte
dans leur feigneurie, fans leur permiffion. Voye^ ci-
devant C h a t e au .
Ces feigneurs châtelains font inférieurs aux barons
, tellement qu’il y en a qui relevent'des barons,
Sc qu’en quelques pays les barons font appellés
grands châtelains, comme l’ôblèrve Balde y fur le ch.
j . qui feuda dare pofjunt, Sc fur le ch. uno delegatorum,
eâtr. de fuppl. neglig. pralat.
Auffi les barons ont-ils deux prérogatives fur les
châtelains ; l’une, que leurs juges ont par état droit
(le haute, juftice, au lieu que les châtelains ne devroient
-avoir que la baffe , fuivant leur première
inftitution ; l’autre, que les barons ont droit de ville
clofe, Sc de garder les clés , au lieu que les châtelains
ont feulement droit de château ou maifon forte
. Voye{ Loi ( eau y des feigneuries, ch. vij. le glojf. de
M. de Lauriere, au mot châtelain, & ci-après C h â te
llenie. ( A )
CH ATELÉ, %£), tn 'térme de Èlafon, fe dit d’itne
bordure, & d’un lambel chargé de huit ou neuf châteaux.
La bordure de Portugal eft châtelet.
Artois, femé de France au lambel dé gueules,
châtelé de neuf .pièces d’o r , trois fur chaque pendant
, en pal l’un fur' l’autre. (V }
CH A TELE T , ( Jurifprùd". ) C ’eft ainfi qu’on ap-
pelloit anciennement de petits châteaux ou forteref-
les dans lefquels commandoit un officier appellé châtelain.
Le nom de l’un & de l ’autre vient de cajlelle-
tum , diminutif de cajlellüm. Les châtelains s’étant
attribué l’adminiftration de la juftice avec plus Ou
moins d’étendue , félon le pouvoir qu’ils avoient,
leur juftice & leur auditoire furent appellés châtelets
ou châtellenies. Le premier de ces titres eft demeuré
propre à certaines juftices royales qui fe rendoient
dans des châteaux, comme Paris, Orléans, Montpellier
, Melun, Sc autres ; Sc le titré de châtellenie
ne s’applique communément qu’à des juftices fei-
gneuriales. Voye^ ci-devant CHATELAIN, & ci-après
C h â te llen ie. Il y a auffi quelques châtelets qui fervent
de prifons royales, comme à Paris. Voye£ C hâte
l e t de Pa r is ! (A )
C hâ te let de Paris , f/urifprud.') eft la juftice
royale ordinaire dé la capitale du royaume. On lui
a donné le. titre de châtelet, parce que l’auditoire de
cette jurifdiftion eft établi dans l’endroit où fubfifte
encore partie d’une ancienne fortereffe appellée le
grand châtelet 3 que Jules Céfar fit conftruirc lorfqu’il
eut fait la conquête des Gaules. Il établit à Paris
le confeil fouverain des Gaules, qui devoit s’af-
fembler tous les ans ; Sc l ’on tient que le proconful,
gouverneur général des Gaules , qui préfidoit à ce
confeil, demeuroit à Paris.
L’antiquité de la greffe tour du châtelet ; le nom
de chambre de Céfar y qui eft demeuré par tradition
jùfqu’à préfent à l’une des chambres de cette tour ;
l’ancien écriteau qui fe voyoit encore en 1636, fur
une pierre de marbre, au-deffus de l’ouverture d’un
bureau fous l’arcade de cette fortereffe , contenant
ces mots , tributum Cafaris, où l’on dit que fe faifoit
la rècette des tributs de tout le pays, confirment que
cette fortereffe fut bâtie par ordre de Jules Céfar,&
qu’il y avoit demeuré. On trouve au livre noir neuf
du châtelet , un arrêt du confeil de 1586 , qui fait
mention des droits domaniaux accoutumés être
payés au treillis du châtelet, qui étoit probablement
le même bureau où fe payoit le tribut de Céfar.
Julien , furnommé depuis Vapojlat, étant nommé
proconful des Gaules, vint s’établir à Paris en 358.
Ce proconful avoit fous lui des préfets dans les
villes pour y rendre la juftice.
Sous l’empire d’Aurélien , le premier magiftrat
de Paris étoit appellé proefeclus urbis ; il portoit en- ■
core ce titre fous le régné de Chilpéric en 588, Sc
fous Clotaire III« en 665 ; l’année luivante il prit le
titre de comte de Paris.
En 884, le comté de Paris fut inféodé par Charles
le Simple à Hugues le Grand. Il fut réuni à la couronne
en 987, par Hugues Capet, lors de fon avènement
au throne de France ; ce comté fut de nouveau
inféodé par Hugues Capet à Odon Ion frere, à
la charge de réverfion par le défaut d’hoirs mâles ;
ce qui arriva en 1032.
Les comtes de Paris avoient fous eux un prévôt
pour rendre la juftice ; ils fousinféoderent une partie
de leur comté à d’autres feigneurs, qu’on appelU
viednités 3 Si leur abandonnèrent le feffort fttr lêS
juftices enclavées dans la vicomté , Sc qui reffortif-
Ibient auparavant à la prévôté. Les vicomtes avoient
auffi leur prévôt pour rendre la juftice dans la vicomté
; mais dans la fuite la vikomté fut réunie à la
prévôté.
Le châtelet fut la demeure des comtes , Sc enfuite
des prévôts de Paris ; c’eft encore le principal manoir
d’où relevent les fiefs de la prévôté & vicomté.
Plufieurs de nos rois y alloient rendre la juftidfe en
perfonne, & entre autres S. Louis ; c’eft dedà qu’il
y a toujours un dais fubfiftant, prérogative qui n’appartient
qu’à ce tribunal.
Vers le commencement du xiij. fiecle, tous les offices
du châtelet fe donnoient à ferme , comme cela fe
pratiquoit auffi dans les provinces, ce qui caufoit un
grand defordre, lequel ne dura à Paris qu’environ 30
années. Vers l’an 1254,8. Louis commença la réformation
de cet abus par le châtelet, & inftitua un prévôt
de Paris en titre. Alors on vit la jurifdi&ion du
châtelet changer totalement de face.
Le prévôt de Paris avoit dès-lors des confeillers,
du nombre defquels il y en avoit deux qu’on appella
auditeurs \ il nommoit lui-même ces confeillers. Il
commit auffi des enquêteurs-examinateurs, des lieu-
tenans, Sc divers autres officiers ; tels que les greffiers
, huiffiers, fergens, procureurs, notaires, &c.
Voye^ ce qui concerne chacun de ces officiers , à fa
lettre.
La prévôté des marchands qui avoit été démembrée
de celle de Paris, y fut reunie depuis 1382 juf-
■ qu’en 1388, qu’on defunit ces deux prévôtés. Voyeç
ci-après réunions dans ce même article.
Le bailliage de Paris, ou confcvvation, fut créé
en 15 22, pour la confervation des privilèges royaux
de l’univerfité, & réunie à la prévôté en 15 26. Voye£
ci-après réunions dans ce même article.
La partie du grand châtelet du côté du pont fut rebâtie
par les foins de Jacques Aubriot, prévôt de
Paris fous Charles V . & le corps du bâtiment qui
borde le quai fut rebâti en 1660.
Lz châtelet fut érigé en préfidial en 1551.
En 1674, le roi fupprima le bailliage du palais,
à l’exception de l’enclos , & la plupart des juftices
feigneuriales qui étoient dans Paris, & réunit le tout
au châtelet 3 qu’il divifa en deuxfiéges, qu’on appella
Vancien & le nouveau châtelet. Il créa pour le nouveau
châtelet le même nombre d’officiers qu’il y avoit
pour l’ancien.
Au mois de Septembre 1684, le nouveau châtelet
fut réuni à l’ancien.
. Ainfi le châtelet comprend préfentement plufieurs
jurifdi&ions qui y font réunies ; favoir , la prévôté
& la vicomté, le bailliage ou confervation, & le
préfidial.
AJfeffeurs. Les lieutenanS particuliers au châtelet
ont le titre d’ajjejjeurs civils > de police , & criminels,
Voyez lieutenans particuliers dans ce même article.
Il y a auffi deux offices d’affeffeurs ; l’uh du prévô
t de l’î le , & l’autre du lieutenant criminel de robe
courte. Ces deux offices font vacans depuis long-
tems fans être fupprimés ; c ’eft un des conlèillers au
châtelet qui dans l’occafion en fait les fonctions.
Attributions particulières du châtelet. Il y en a quatre
principales attachées à la prévôté de Paris, qui ont
leur effet dans toute l’étendue du royaume, à l’ex-
clufion même des baillifs & fénéchaux, & de tous
autres juges ; favoir, i° . le privilège du fceau du châtelet
y qui eft attributif de jurifdiûion; 20. le droit de
fuite ; 30. la confervation des privilèges de l’univer-
fité ; 40. le droit d’arrêt, que les bourgeois de Paris
ont fur leurs débiteurs forains. Voye{ ci-après C onservation
, Sceau & Suite.
Audiences du châtelet. Les chambres d’audiençe
Tome I I I ,
font lé pàŸC c iv il, lé préfidial, la chàrtlbrê c ivile , la
chambre de police, la chambre criminelle, la chant-
bre du juge auditeur. II y a auffi l’audience des criées
qui fe tient deux fois la femame dans le parc c iv i l,
les mercredi Sc famedi, par un des lieutenans particuliers
, après l’audience du parc civil. Il y a auffi
I audience de l’ordinaire, qui fe tient dans le parc civil
tous les jours plaidoyables , excepté le jeudi,
par un des confeillers de la colonne du parc civil.
Les jours d’audience & criées , c’eft le lieutenant
particulier qui tient d abord l’audience à l’ordinaire,
& enfuite celle des criées : les procureurs portent à
cette audience de l’ordinaire toutes les petites caufes
concernant les reconnoiffances d’écritures privées ,
communications de pièces, exceptions, remifes de
procès, & autres caufes Iegeres. Les affirmations ordonnées
par fentence d’audience fe font à celle de
l’ordinaire.
Audimciers du châtelet, voye^ HUISSIERS*
Auditeur du châtelet, voye{ l'article JUGE - AUDI*
TEUR.
Avis ou jugemens du procureur du Roi , voyez PROCUREUR
du R o i.
Avocats du châtelet. Il y a eu de tems immémorial
des avocats attachés au châtelet ; le prévôt de Paris
prenoit cônfeilen d’eux: il eft parlé dans une ordônan-
nance de Charles IV. de 13 2 5 ; & dans une ordonnance
de Philippe de Valois, du mois de Février
I317> il parlé dé ceux qui étoient avocats commis
, c’eft-à-dire qui étoient commis à cetté fonéfioii
par le prévôt de Paris ; il y eft dit qu’ils ne pourront
être en même tems procureurs ; que nul ilê fera reçu
à plaideur , s’il n’eft juré fuffifamment ou fon nom
écrit au rôle des avocats : il eft auffi parlé de diffé-
rens fermens que les . avocats dévoient faire fur ce
qu ils mettoienten avant ; c’eft fans doute là l’origine
du ferment que les avocats du châtelet prêroient
autrefois à chaque rentrée du châtelet. La même ordonnance
défend que perfonne né fe mette au banc
dés avocats , fi ce n’eft par permiffion dii prévôt ou
de fon lieutenant, fuivant des lettres de Charles VJ.
du 19 'Novembre 1393 : toute perfonne pouvoir
exercer l’office de procureur au châtelet, pourvu
que trois ou quatre avocats certifiaffent fa capacité.
II y a eu pendant long-tems au châtelet des avocats
qui n’avoien,t été reçûs que dans ce fiége. Les avocats
au parlement avoient cependant toujours la liberté
d’y aller. On voit dans le procès-vetbal de l’ancienne
coutume de Paris * rédigée en 1510 , qu’il y
comparut huit avocats ait châtelet , du nombre desquels
étoit Jean Dumoulin, pere du célébré Charles
Dumoulin. Mais on voit dans la vie de ce dernier
que fon pere étoit auffi avocat au parlement, & qu’il
prenoit l’une & l’autre qualité d’avocat au parlement
Sc au châtelet de Paris. Dans le procès-verbal de réformation
de la coûtume de Paris en 1580, comparurent
plufieurs avocats au châtelet, dont’ il y en a
d’abord neuf de nommés de fuite, & fix autres qui
font nommés dans'la fuite du procès-verbal. Préfentement
tous les avocats exerçans ordinairement au
châtelet font avocats au parlement, & ne prêtent plus
de ferment au châtelet depuis 1725. L’univerfité qui
a fes caufes commifes au châtelet, a deux avocats
qu’on appelle avocats de Uuniverfité jurés au châtelet;
ces avocats ont un rang dans les cérémonies de l’u -
niverfité ; ils ont auffi le droit de garde-gardienne ,
comme membres de l’univerfité.
• Avocats du Roi du châtelet. Leur établiffement eft
prefque auffi ancien que celui de la prévôté de Paris.
Les plus anciens.réglemens que l’on trouve avoir
été faits fur les Arts Sc Métiers, qui font ceux des Mé-
giffiers en 1323 , font mention que c’eft après avoir
oui les avocats & procureurs du roi qui en avoient
eu communication, La même chofe fe trouve énom
Hh ij