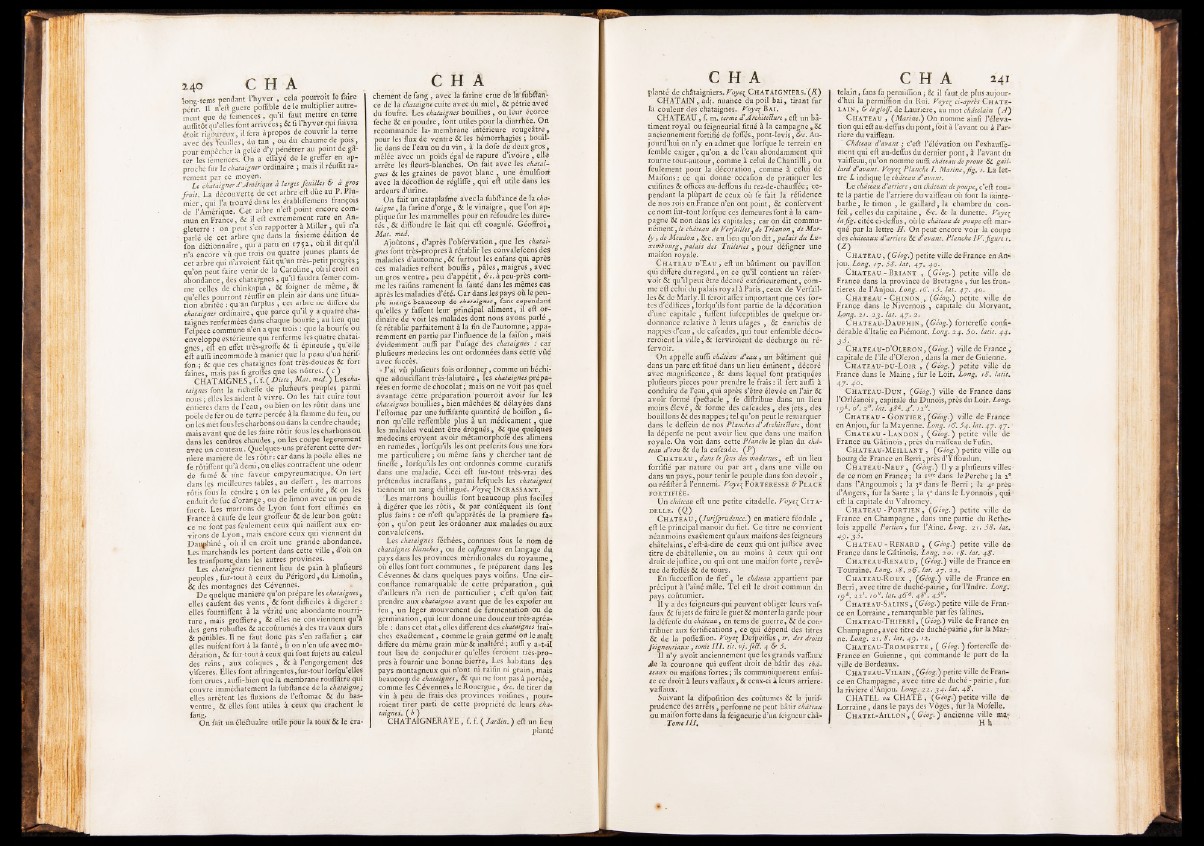
Sone-tems pendant Thyver , cela pourroit le faire
périr II n’eft guere poffible de le multiplier autrement
que dé femences, qu’il faut mettre en terre
auffitôt qu’elles fout arrivées ; & fi l’hyver qui fuivra
étoïf rigduréux, il fera à propos de Couvtir la terre
avec dès ’feuiîles, du tan > gu dU chaume do puis .
pour empêcher la gelée d’y pénétrer au point dé. g î ter
lêS fementes. OU a effàjie dé lé greffer en ap-
proche fur Ië chataigner ordinaire ; mais ilréuflit rarement
par ce moyen. , ,
Le chataigner d'Amérique a larges feuilles G* a gros
fruit. La découverte de cet arbre eft due au P. Plumier,
qui l’a trouvé dans lesetabliffemens françois
de l’Amérique. Cet arbre n’eft point encore commun
en France, & il eft extrêmement rare en Angleterre
: on peut s,’én rapporter à Miller , qui n a
parlé de cet arbre que dans la fixieme édition de
ion dictionnaire, qui a paru en 1 7 5 1 , où il dit qu’il
n’a encore vu que trois ou quatre jeunes plants de
cet arbre qui n’a voient1 fatit qü’un très-petit progrès ;
qu’on peut faire venir de la Caroline, oîmI croit en
abondance, des châtaignes , qu’il faudra femër comme
celles de chinkapin, 8c foigner de meme, &
qu’elles pourront réuflïr en plein air dans une fitua-
tion abritée : qu’au furplus , cet arbre ne différé du
chataigner ordinaire, que parce qu il y a quatré châtaignes
renfermées dans chaque bourle ; au lieu que
l’elpéce commune n’èn a que trois : que la bourfe ou'
enveloppe extérièure qui renferme les quatre châtaignes,
eft en effet très-groffe 8c fi épineufe , quelle
eft aufli incommode à manier que la peau d’un hérif-
fon-; 8c que ces châtaignes font très-douces 8c fort
faines, mais pas fi groffês que les nôtres. ( c )
CHATAIGNES, f. f. ( Dicte, 'Mat. med. ) LêS châtaignes
font la richeffe de plufieurs peuples parmi
nous ; elles les aident à vivre. On les fait cuire fout
entières dans de l’eau , ou bien on les rôtit dans une
poêle de fer ou de terre percée à la flamme du feu, ou
on les met fous les charbons ou dans la cendre chaude;
mais avant que de les faire rôtir fous les charbons ou
dans les cendres chaudes , on les coupe legerement
avec un coùteau. Quelques-uns préfèrent cette dernière
maniéré de les rôtir : car dans la poêlé elles ne
fe rôtiffent qu’à demi, ou elles contraient une odeur
de fumé & une faveur empyreumatique. On fert
dans les meilleures tables, au deffert, les marrons
rôtis fous la cendre ; on lés pèle enfuite , 8c on les
enduit de fuc d’orange, ou de limon avec un peu de
fucrè. Les marrons de Lyon font fort eftimes en
France à caufe de leur groffeur & de leur bon goût :
ce ne font pas feulement ceux qui naiffent aux environs
de Lyon, mais encore ceux qui viennent du
Daiçihiné, où il en croît une grande abondance.
Les marchands les portent dans cette v ille , d’où on
les tranfporte dans les autres provinces.
Les châtaignes tiennent lieu de pain à plufieurs
peuples, fur-tout à ceux dù Périgord, du Limofin,
& dès montagnes des Cévennes.
De quelque maniéré qu’on prépare les châtaignes,
elles caufent des vents, &fon t difficiles à digérer :
elles fourniffent à la vérité une abondante nourriture
, mais groffiere, & elles ne conviennent qu’à
des gens robuftes 8c accoûtumés à des travaux durs
& pénibles. Il ne faut donc pas s’en raffafièr ; car
elles nuifent fort à la fanté, fi on n’en ufe avec modération,
8c fur-tout à ceux qui font fujets au calcul
des reins, aux coliques , 8c à l’engorgement des
vifeeres. Elles font aftringentes,fur-tout lorfqu’elles
font crues ,auffi-bien que là membrane rouffâtre qui
couvre immédiatement la fubftance de la châtaigne;
elles arrêtent les fluxions de l’eftomac & du bas-
ventre, 8c elles font utiles à ceux qui crachent le
fang. | H B H
On fait un élêcluaîre Utile pour la tôùx 8c le crachement
de fang , avec la farine crue de la'nibftàh-
ce de la châtaigne cuite avec du miel, & pétrie aved
du foufre. Les châtaignes bouillies, où lêur écofcë
féche 8c en poudre, font utiles pour la diarrhée. Ori
recommande' la* membrane intérieure rougeâtre .
pour les flux de ventre 8c les hémorrhagies ; bouillie
dans de l’éau ou du v in , à la dofe de deux gros,
mêlée avec un poids égal de rapure d’iv'ôire , elle
arrête les fleurs-blarichès. On fait avec les châtaignes
& les graines de pâvot blanc , une émulfioif
avec la déco&ion de regliffe, qui eft utile dans les
ardeurs d’iirine.
On fait un cataplafme avec la fubftance de la chai-
tdignè, la farine d’orgë, & le vinaigre, que l’on applique
fur les1 mammellés pour en réfoudre lès duretés
, & diffoudre le lait qui eft coagulé. Géoffroi,
Mat. med.
Ajoutons, d’après l’obfervation, que les châtaignes
font très-proprés à rétablir les convalefcëns des
maladies d’automne ,8c fiirtout les enfans qui après
ces maladies reftèrit bouffis , pâles, maigres, avec
un gros ventre, pèu d’appétit , &c. àpeu-près comme
les raifins ramènent la fanté dans les mêmes cas
après lés maladies d’été. Car dans les pays où le peuple
mangé be'aücoup de châtaignes, fans cependant
qu’elles y faffent leur principal aliment^ il eft ordinaire
de Voir les malades dont nous avons parlé ,
fe rétablir parfaitement à la fin de l’automne ; apparemment
en partie par l’influence de la faifon, mais
évidemment auffi par l’ufagé des châtaignes : car
plufieurs médecins les ont ordonnées dans cette vue
avec fùcçès'.
• J’ai vû plufieurs fois ordonner, comme un béchi-
que adouciffant très-falutairè, les châtaignes préparées
ën formé dè chocolat ; mais on ne voit pas quel
avantage Cè‘tfe préparation ’pourroit avoir fur les!
châtaignes bouillies, bien mâchées 8c délayées dans
l’eftomac par une fuffifante quantité de boiffon , linon
qu’elle reffemble plus à un médicament, que
les malades veulent être drogués, & que quelques
medécîhs croyent avoir métamorphofe des alimens
en remèdes, lorfqffils les ont preferits fous une forme
particulière ; ou même fans y chercher tant de
fineffe , lorfqu’ils les ont ordonnés comme curatifs
dans une maladie. Ceci eft fur-tout très-vrai des
prétendus incraffans , paimi lefquels les châtaignes
tiennent un rang diftingué. Voyé{ In cra ssan t.
'Les marrons bouillis font beaucoup plus faciles
à digérer que les rôtis, & par conféqüént ils font
plus fains : ce n’èft qu’apprêtés de la première façon
, qu’ori peut les ordonner aux malades ou aux
cohvàlefcens.
Les châtaignes féchées, connues fous le nom de
châtaignes blanches, ou de caftagnous en langage du
pays dans lès provinces méridionales du royaume „
où ellès font fort communes , Té préparent dans les
Cévennes & dans quelques pays voifins. Une cir-
conftance remarquable de cette préparation, qui
d’ailleurs n’a rien de particulier ; c’eft qu’on fait
prendre aux châtaignes avant que de les expofer au
feu , un leger mouvement de fermentation ou de
germination, qui leur donne une douceur très-agréable
: dans cet état, elles different des châtaignes fraîches
ëxaâement, comme le grain germé ou le malt
diffère du même grain mûr& inaltéré ; auffi y a-t-il
tout lieu de conjecturer qu’elles feroient très-propres
à fournir une bonne bierre, Les habitans des
pays montagneux qui n’ont ni raifin ni grain, mais,
beaucoup de châtaignes, 8c qui ne font pas à portée,
comme les Ç évennes, le Rouergue, &c. de tirer du
vin à peu de frais des provinces voifines, pour-
roient tirer parti de cette propriété de leurs cha-
1 tàïghei. (b )
CHATAIGNËRAYË , f. f. ( Jardin. ) eft un lieii
planté
planté de châtaigniers. Voyt{ C h â ta ign ier s . (/C)
CHATAIN, ad j. nu an c e du poil b a i , tirant fur
la c o u le u r d é s châ ta ign e s. Voye{ B a i .
CHATEAU, f. m. terme <PArchitecture , eft un bâtiment
roÿal ou feigneurial fitiié à la campagne
anciennement fortifié de foffés, pont-levis, &c. Aujourd'hui
on n’y en admet que lorfque le terrein en
femble exiger, qu’on.a de l’eau abondamment qui
tourne tout-autour, comme à celui de Chàntilli > ou
feulement pour la décoration, comme à celui de
Maifons : ce qui donne ôccàfion de pratiquer les
cuifines & offices au-dèffoiis du rez-de-chauffée ; cependant
la plupart de ceux où fe fait la réfiderice
de nos rois en France n’en ont point, 8c confervent
ce nom fur-tout lorfque ces demeures font à la campagne
& non dans les capitales ; car on dit communément
, le château de Verfailles, de Trianon, de Marty
, de Meudon, &c. au lieu qu’on d it, palais du Luxembourg
, palais des Tuileries ,p o u r défigner Une
maifon royale.
C hateau d’Eau , eft un bâtiment ou ’ pavillon
qui diffère du regard, en ce qu’il contient un réfèr-
voir 8c qu’iTpëut être décoré extérieurement, comme
eft celui du palais royal à Paris, ceux de Verfail-
les 8c de Marly.il feroit affez important que ces fortes
d’édifices, lorfqu’ils font partie de la décoration
d’une capitale , fuffent fufceptibleS de quelque or- '
donnance relative à leurs ufages , 8c enrichis de
nappes d’eau, de cafcades, qui tout enfemble déco-
reroient la ville, & fervirôient de décharge au réfer
voir. . ;i
On appelle auffi château d'eau, un bâtiment qui
dans un parc eft fitué dans un lieu éminent, décoré
a v e c 1 magnificence, & dans lequel font pratiquées
plufieurs pièces pour prendre le frais : il fert auffi à
conduire de l’eau, qui après s’être élevée en l’air 8c
avoir formé fpeâaclë , fe diftribue dans Un lieu
moins élevé, & forme dès cafcades, des jets, des
bouillons 8c des nappes ; tel qu’on peut le remarquer
dans le deffein de nos Planches d'Architecture, dont
la dépenfe ne peut avoir lieu que dans une maifon
royale. On voit dans cette Planche le plan du château
d'eau 8c de la cafcade. (P)
CHATEAU , dans le fens des modernes, eft un lieu
fortifié par nature ou par a r t , dans une ville ou
dans un pays, pour tenir le peuple dans fon devoir,
ou réfifter à l’ennemi. Voye^ Forteresse & Pla ce
FORTIFIÉE.
Un château eft une petite citadelle. Voye^ C it a delle.
(Q )
C h a t e a u , (’Jurifprudence.) en matière féodale ,
çft le principal manoir du fief. Ce titre ne convient
néanmoins exafrement qu’aux maifons des feignèurs
châtelains, c’eft-à-dire de ceux qui ont juftice avec
titre de châtellenie, ou au moins à ceux qui ont
droit de juftice, ou qui ont une maifon forte, revêtue
de foffés 8c de tours.
En fucceffion de f ie f , le château appartient par
préciput à l’aîné mâle. Tel eft le droit commun du
pays, coutumier.
Il y a des feigneurs qui peuvent obliger leurs vaf-
faux 8c fujets de faire le guet 8c monter la garde pour
la défenfe du château, en tems de guerre, 8c de contribuer
aux fortifications , ce qui dépend des titres
8c de la poffeffion. Voye^ Deipeifîès, tr. des droits
feigneuriajix , tonie I II. tit.yj. fect. 4 6* 5.
Il n’y avoit anciennement que les grands vaffaux
ü e la couronne qui euffent droit de bâtir des châteaux
ou maifons fortes ; ils communiquèrent enfuite
ce droit à leurs vaffaux, & ceux-ci à leurs arriere-
yaffaux.
Suivant la difijofition des coûtumes 8c la jurifprudence
des arrêts, perfonne ne peut bâtir château
qu maifon forte dans la feigneurie d’un feigneur châ-
Tome III»
telain, fans fa permiffion ; 8c il faut de plus aujourd’hui
la permiffion du Roi. Voye£ ci-aprhs C h â te lain
, & le\glo(f. de Lauriere, au mot châtelain (A )
C hate au , (Marine.') On nomme ainfi l’élévation
qui eft au-deffus du pont, foit à l’avant ou à l’ar-
riere duvaiflèau.
Château d'avant ; c’eft l’élévation ou l’exhauffe-
ment qui eft au-deffus du dernier pont, à l’avant du
vaiffeau, qu’on nomme auffi château de proue 8c gaillard
d'avant. Voye^ Planche I. Marine, fig. 1. La lettre
L indique le château d'avant.
Le château d'arriéré , ou château de poupe, c’eft toute
la partie de l’arriere du vaiffeau où font la fainte-
barbe, le timon , le gaillard, la chambre du con- •
fe il, celles du capitaine, &c. & la dunette. Voye^
la fig. citée ci-deffus, où le château de poupe eft marqué
par la lettre H. On peut encore voir la coupe
des châteaux d'arriéré 8c d'avant. Planche If^. figure 1,
C h a t e au , (Géog.) petite ville deFrance en An*
jou. Long. ry. 58. lat. 4/. 40.,
C hate au - Briant , ( Giog.) petite ville de
France dans la province de Bretagne , fur les frontières,
de l’Anjou. Long, ifi'. i t . lat. 47. 40.
C h a te au - C hinon , ( Géog.) petite ville de
France dans le Nivernois , capitale du Morvant.
Long, 21. 23. lat. 47. 2.
C h a te au -Da u ph in , (Géog.) fortereffe confi-
dérable d’Italie en Piémont. Long. 24. 60. latit. 44. ESH. ' . .. ... C h a te au -d’Oleron , (Géog.) ville de France
capitale de l’île d’OIeron, dans la mer de Guienne.
C h a te au -du-Loir , (Géog.) petite ville de
France dans le Maine., fur le Loir. Long, 18. latit.
47-'4fi.
C h a te au -D un , (Géog.) ville de France dans
l’Orléanois, capitale du Dunois, près du Loir. Long.
rpd. of. 2", lat. 4<?d. 4'. 12".
C hate au - G ontier , (Géog.) ville de France
en Anjou, fur la Mayenne. Long. 16.5 4. lat. 47* 4 7 . -
C hateau - L andon , (Géog. ) petite ville de
France au Gâtinois ,près du ruiffeau deFufin.
Ch a te au -Meil lant , (Géog.) petite ville ou
bourg de France en Berri, près d’Yffoudun.
C h a teAÙ-Neuf , (Géog.) Il y a plufieurs villes*
de ce nom en France; la i e/e dans le Perche ; la z*.
dans l’Angoumois ; la 3e dans le Berri ; la 4e près !
d’Angers, fur la Sarte ; la 5e dans le Lyonnois , qui ’
eft la capitale du Valromey.
C hate au -P ortien , (Géog.) petite ville de
France en Champagne, dans une partie du Rethe-
lois appellé Portien, fur l’Aine. Long. 21. 58. lat.
49; j i . '
C h a t e au - Renard , (Géog.) petite ville de
France dans le Gâtinois. Long. 20. 18. lat. 48.
C h a te au -Ren au d , (Géog.) ville de France en
Touraine. Long. 18 .26 . lat. 47. 22.
C hateau-Roux , (Géog.) ville de France en
Berri, avec titre de duché-pairie, fu r l’Indre. Long
K)d. 2 i '. tb". lat. 4(?d. 4 8 .4 5 " .
C hateau-Salins-, (Géog.) petite ville de France
en Lorraine, remarquable par fes falines.
C hate au -Thierri , (Géog.) ville de France en
Champagne, avec titre de duché-pairie, fur la Marne.
Long. 2i. 8. lat, 4g. 12.
C hateau-Trompette , ( Géog. ) fortereffe de-
France en Guienne, qui commande le port de la
ville de Bordeaux.
C hate au -V ila in , (Géog.) petite ville deFrance
en Champagne, avec titre de duché - pairie, fur
lariviere d’Anjou. Long. 22. 34. lat. 48.
CHATEL ou CHATÉ , (Géog.) petite ville de
Lorraine, dans le pays des Vôges, fur la Mofelle.
C hatel-Aillon , ( Géog. ) ancienne ville ma-
H h