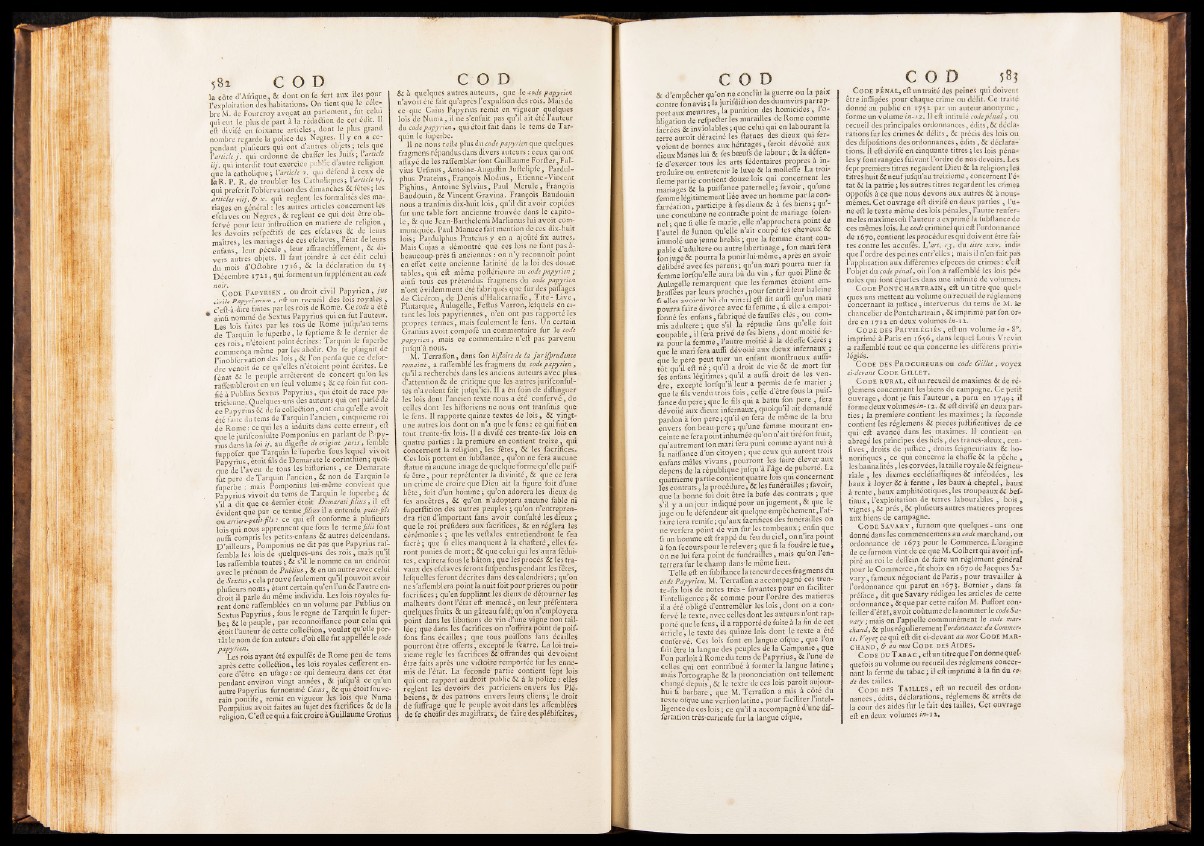
la côte d’Afrique, & dont on fe fert aux îles pour
l’exploitation des habitations. On tient que le cele-
breM. de Fourcroy avocat au parlement, fut celui
qui eut le plus de part à la reda&ion de cet edit. Il
eft divifé en foixante articles, dont le plus grand
nombre regarde la police des Negres. Il y en a cependant
plufieurs qui ont d’autres objets ; tels que
F article j . qui ordonne de chaffer les^ Juifs ; \ article
iij. qui interdit tout exercice public d’autre religion
que la catholique ; l’article v. qui défend a ceux de
la R. P. R. de troubler les Catholiques; Varticle vj.
qui prefcrit l’obfervation des dimanches & fetes; les
articles vïij. & x. qui règlent les formalites des ma- _
riages en général : les autres articles concernent les
efclaves ou Negres, & règlent ce qui doit être ob-
ferv é pour leur inftruaion en matière de religion,
les devoirs refpeûifs de ces efclaves & de leurs
maîtres, les mariages de ces efclaves, l’état de leurs
enfans, leur pécule , leur affranchiffement, & divers
autres objets. Il faut joindre à cet édit celui
du mois d’Oadbre 1 716, & la déclaration du 15 %
Décembre 1721, qui forment un fupplément au code
noir.-
C o d e P a p y r i e n , ou droit civil Papyrien, ju s
civile P a p y r ia n um , eft un recueil des lois royales ,
c’eft-à-dire faites parles rois de Rome. C e code a été
0 ainfi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l’auteur.
Les lois faites par les rois de Rome jüfqu’au tems
de Tarquin le l'uperbe, le feptieme & le dernier de
H n'étoieni point écrites : Tarquin le fuperbe
commença même par les abolir. On fe plaignit de
l ’inobfervation des fo is , & l’on penfa que ce défendre
venoit de ce qu’elles n’étoiènt point écrites. Le
fénat & le peuple arrêtèrent de concert qu’bu les
raffembiéroiten un feul volume ; & ce foin fut Confié
à Publius Sextus Papyrius, qui étoit de race paç
triciênne. Quelques-Uns des auteurs qui ont parie de
ce Papyrius & de l'a collection, ont cru qu’elle avoit
été faite du teins de Tarquin l'ancien, cinquième rpi
de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur, eft
que le jurifconfulte Pomponius en parlant del Papyrius
dans la lo i i j . au digefte de origine ju r i s , femble
fuppofer que T arquin le’fuperbe fous lequel vivoit
Papyrius, étoit fils de D emarate le Corinthien ; quoique
de Tavéu de tous les hiftorïens , ce Demarate
fût pere de Tarquin l’âncién, & non de Tarquin le
fuperbe : niais Pomponius lui-même convient que
Papyrius vivoit du tems de Tarquin le fuperbe; &
s’il a dit que ce dernier étoit D em o r a t i f il im , il eft
évident que par ce terme filius il a entendu pitié-fils
ou arricrt-petirifils : ce qui eft conformé à plufieurs
lois qui nous apprennent que fous le terme f i h i font
aufli compris les petits-enfans & autres defcèndans.
D ’ailleurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius raf-
fembla les fois de quelques-uns des ro is , mais -qu’il
las raffembla toutes ; & s’il le nomme en un endroit
avec le prénom de Publius, & en un autre avec celui
de Sextus, cela prouve feulement qu’il pouvoit avoir
plufieurs noms, étant certain qu’en l’un & l’autre endroit
il parle du même individu. Les lois royales furent
donc raffemblées en un volume par Publius ou
Sextus P apyrius, fous le régné de Tarquin le fuperbe
; & le peuple, par recônnoifiance pour celui qui
éto’it l’auteur de cette colleflion, voulut qu’elle portât
le nom de fon auteur : d’où elle fut appellée le code
papyrien.
Les rois ayant été expulfés de Rome peu de tems
après cette colleôion, les lois royales cefferent encore
d’être en ufage : ce qui demeura dans cet état
pendant environ vingt années, & jufqu’à ce qu’un
autre Papyrius furnommé Càius, & qui étoit fouve-
rain pontife, remit en vigueur tes lois que Numa
Pompilius avoit faites au fujet des facrifices & de la
religion, C’eft ce qui a fait croire à Guillaume Grotius
& à quelques autres, auteurs, que 1 e code papyrien
n’avoit été fait qu’après l’expulfion des rois. Mais de
ce que Caïus Papyrius remit en vigueur quelques
lois de Numa, il ne s’enfuit pas qu’il ait été l’auteur
du code papyrien, qui étoit fait dans le tems de Tarquin
le fuperbe.
Il ne nous refte plus du code papyrien que quelques
fragmens répandus dans divers auteurs : ceux qui ont
affayé de les raffembler font Guillaume Forfter,Ful-
vius Urfinus, Antoine-Auguftin Juftelipfe, Pardul-
phus Prateius, François Modius, Etienne-Vincent
Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, François
Baudouin, & Vincent Gravina. François Baudouin
nous a tranfmis dix-huit lois, qu’il dit avoir copiées
fur une table fort ancienne trouvée dans le capito-
le , & que Jean-Barthelemi Marlianus lui avoit communiquée.
Paul Manuce fait mention dé cès dix-huit
lois ; Pardulphus Prateius y en a ajouté fix autres.
Mais Cujas a démontré que ces lois ne font pas à-
beaucoup-près fi anciennes : on n’y reconnoît point
en effet cette ancienne latinité de la loi des douze
tables, qui eft même poftérieure au codepapyrien;
ainfi tous ces prétendus* fragmens du code papyrien
n’ont évidemment été fabriqués que fur des paffages
de Cicéron , de Denis d’Halicarnaffe, T ite - L iv e ,
Plutarque, Aulugelle, Feftus Varron,lefquels én citant
les lois papyriennes, n’en ont pas rapporté les
propres termes, mais feulement leTens. Un certain
Granius avoit compofé un commentaire fur le code
papyrien, mais ce commentaire n’eft pas parvenu
jufqu’à nous.
M. Terraffon, dans fon hifioire de la jurifprudence
romaine, a raffemblé les fragmens du code papyrien ,
qu’il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus
d’attention & de critique que les autres jurifconful-
tés n’avoient fait jufqu’ici. Il a èu foin de diftinguer
les lois dont l’ancien texte nous a été confervé, de
celles dont les hiftoriens ne nous ont tranfmis que
le fens. Il rapporte quinze textes de lois, & vingt-
une autres lois dont on n’a que le fens : ce qui fait en
tout trente-fix lois. Il a divifé ces trente-fix lois en
quatre parties : la première en contient treize, qui
concernent la religion, les fêtes, & les facrifices.
Ces lois portent en fubftance, qu’on ne fera aucune
ftatue ni aucune image de quelque forme qu’elle puifi
fe être, pour repréfenter la divinité, & que ce fera
un crime de croire que Dieu ait la figure foit d’une
bête, foit d’un homme ; qu’orj adorera les dieux de
fes ancêtres, & qu’on n’adoptera aucune fable ni
fuperftition des autres peuples ; qu’on n’entreprendra
rien d’important fans avoir confulté les dieux ;
que le roi préfidera aux facrifices, & en réglera les
cérémonie s ; que les veftales entretiendront le feu
facré ; que fi elles manquent à la chafteté, elles feront
punies de mort; & que celui qui les'aura fédui-
tes, expirera fous le bâton ; que les procès & les travaux
des efclaves feront fufpendus pendant les fêtes,
lefquelles feront décrites dans des calendriers ; qu’on
ne s’affemblera point la nuit foit pour prières Ou pour
facrifices ; qu’en fuppliant les dieux de détourner les
malheurs dont l’état eft menacé, on leur préfentera
quelques fruits & un gâteau falé; qu’on n’employera
point dans les libations de vin d’une vigne non taillée
; que dans les facrifices on n’offrira point de poif-
fons fans écailles; que tous poiffons fans écailles
pourront être offerts, excepté le fearre. La loi treizième
règle' les facrifices & offrandes qui dévoient
être faits après une viûoire remportée fiir les ennemis
de l’état. La fécondé partie contient fept lois
qui Ont rapport au droit public &: à la policé : elles
règlent les devoirs des patriciens envers les Plébéiens
, & des patrons envers leurs die iis ; le droit
de fuffrage que le peuple avoit dans les affemblées
de fe choifir des magiftrats-, de faire desplébifcites,
& d’empêcher qu’on ne conclût la guerre ôu la paix
contre fon avis ; la jurifdiftion des duumvirs par rapport
aux meurtres, la punition des homicides , 1 o -
bligation de refpefter les murailles de Rome comme
facrées & inviolables ; que celui qui en labourant la
terre auroit déraciné les ftatuès des dieux qui fer-
voient de bornes aux héritages, feroit dévoué aux
dieux Mânes lui & fes boeufs de labour ; & la defen-
fe d’exercer tous les arts fedentaires propres à introduire
ou entretenir le luxe & la molleffe La troisième
partiç contient douze lois qui concernent les
mariages & la puiffance paternelle; favoir, qu’une
femme légitimement liée avec un homme par la con-
farréation, participe à fes dieux & à fés biens ; qu -
une concubine ne contrarie point de mariage folen-
nel ; que fi elle fe marie, elle n’approchera point de
l ’autel de Junon qu’elle n’ait coupé fes cheveux &
immolé une jeune brebis ; que la femme étant coupable
d’adultere ou autre libertinage, fon mari fera
fon juge & pourra la punir lui-même, après en avoir
délibéré avec fes parens; qu’un mari pourra tuer fa
femme lorfqu’elle aura bû du vin , fur quoi Pline oc
Aulugelle remarquent que les femmes etoient em-
braffees par leurs proches, pour fentir à leur haleine
fi elles avoient bû du vin : il eft dit aufli qu’un mari
pourra faire divorce avec fa femme, fi elle a empoi-
fonné fes enfans, fabriqué de fauffes clés, ou commis
adultéré ; que s’il la répudie fans qu elle foit
coupable, il fera privé de fes biens, dont moitié le-
ra pour la femme, l’aiitre moitié à la déeffe Ceres ;
que le mari fera aufli dévoiié aux dieux infernaux ;
que le pere peut tuer un enfant monftrueux auflï-
tôt qu’il eft né ; qu’il a droit de vie & de mort fur
fes enfans légitimes ; qu’il a aufli droit de les vendre
, excepte lorfqü’il leur a permis de fe marier ;
que le fils vendu trois fois, ceffe d’être fous la puiffance
du pere ; que le fils qui a battu fon pere , fera
dévoiié aux dieux infernaux, quoiqu’il ait demande
pardon à fon pere ; qu’il en fera de meme de la bru
envers fon beau-pere ; qu’une femme mourant enceinte
ne fera point inhumée qu’on n’ait tire fon fruit,
qu’autrement fon mari fera puni comme ayant nui à
la naiffance d’un citoyen ; que ceux qui auront trois
enfans mâles v ivan s, pourront les faire elever aux
dépens de la république jufqu’à l’âge de puberte. La
quatrième partie contient quatre lois qui concernent
les contrats , la procédure, & les funérailles ; favoir,
que la bonne foi doit être la bafe des contrats ; que
s’il y a un jour indiqué pour un jugement, & que le
juge ou le défendeur ait quelque empêchement,l’affaire
fera remife ; qu’aux facrifices des funérailles on
ne verfera point de vin fur les tombeaux ; enfin que
fi un homme eft frappé du feu du ciel, on n’ira point
à fon fecourspour le relever ; que fi la foudre le tue,
on ne lui fera point de funérailles, mais qu’on l’enterrera
fur le champ dans-le même lieu.
Telle eft en fubftance la teneur de ces fragmens du
code Papyrien. M. Terraffon a accompagné ces trente
fix lois de notes très - favantes pour en faciliter
l’intelligence ; & comme pour l ’ordre des matières
il a été obligé d’entremêler les lois, dont on a con-
fervé le texte, avec celles dont les auteurs n’ont rapporté
que le fens, il a rapporté de fuite à la fin de cet
article, le texte des quinze lois dont le texte a été
confervé. Ces lois font en langue ofque, que l’on
fait être la langue des peuples de la Campanie, que
l’ on parloit à Rome du tems de Papyrius, & l’une de
celles qui ont contribué à former la langue latine ;
mais l’orto^raphe & la prononciation ont tellement
changé depuis, & le texte de ces lois paroît aujour-
hui fi barbare, que M. Terraffon a mis à côté du
texte ofque une verfion latine, pour faciliter l’intelligence
de ces lois ; ce qu’il a accompagné d’une dif-
fertation très-curieufe fur la langue ofque.
C ode PÉNAL, eft un traité des peines qui doivent
être infligées pour chaque crime ou délit. Ce traité
donné au public en 1752. par un auteur anonyme *
forme un volume in-12. Il eft intitulé code pénal, ou
recueil des principales ordonnances, édits, & déda*
rations fur les crimes & délits, & précis des lois ou
des difpofitions des ordonnances, édits, & déclarai
tions. Il eft divifé en cinquante titres ; les lois pénales
y font rangées fuivant l’ordre de nos devoirs. Les
fept premiers titres regardent Dieu & la religion; les
titres huit & neuf jufqu’au treizième, concernent l’é“
tat & la patrie ; les autres titres regardent les crimes
■ oppofés à ce que nous devons aux autres & à nous-
mêmes. C et ouvrage eft divifé en deux parties , l’une
eft le texte même des loisipénales, l’autre renferme
les maximesoîi l’auteur a exprimé la fubftance de
ces mêmes lois. Le code criminel qui eft l’ordonnance
de 1670, contient les procédures qui doivent être fai«
tes contre les accufés. art. r j. du titre xxv. indi«
que l’ordre des peines entr’elles ; mais il n’en fait pas
l’application aux différentes efpeces de crimes : c’eft
l’objet du code pénal, où l’on a raffemblé les lois péri
nales qui font éparfes dans une infinité de volumes.
C ode Po n t c h a r t r a in , eft un titre que quelques
uns mettent au volume ou recueil de réglemens
concernant la juftice, intervenus du tems de M. le
chancelier de Pontchartrain, & imprimé par fon ordre
en 1712 en deux volumes in-12.
C ode des Pr iv ilég iés , eft un volume in - 8°*
imprimé à Paris en 1656, dans lequel Louis Vrevin
a raffemblé tout ce qui concerne les différens privilégiés.
C ode des Procureurs ou code Gillet, voyez
ci-devant C ode Gil l e t .
C ode rural, eft un recueil de maximes & de ré*
glemens concernant les biens de campagne. Ce petit
ouvrage^ dont je fuis l’auteur, a paru en 1749 ; il
forme deux volumes i«* 12. & eft divifé en deux parties
; la première contient les maximes ; la fécondé
contient les réglemens & pièces juftificatives de ce
qui eft avancé dans les maximes. Ii contient en
abrégé les principes des fiefs, des francs-aleux, cen- *
fives , droits de juftice , droits feigneuriaux & honorifiques
, ce qui concerne la chaffe &: la pêche ,
les bannalités, les corvées, la taille royale ôefeigneu-*
r ia le , les dixmes eccléfiaftiques & inféodées, les
baux à loyer & à ferme , les baux à cheptel, bau*
à rente, baux amphitéotiques,les troupeaux & bef-
tiaux, l’exploitation de terres labourables , bois *
vignes, & prés, & plufieurs autres matières propres
aux biens de campagne.
C ode Sa v a r y , nirnom que quelques - uns ont
donné dans les commencemens au code marchand, ou
ordonnance de 1673 pour le Commerce. L ’origine
de ce furnom vint de ce que M. Colbert qui avoit inf*
piré au roi le deffein de faire un réglement général
pour le Commerce, fit choix en 1670 de Jacques Savary
, fameux négociant de Paris, pour travailler à
l’ordonnance qui parut en 1673. Bornier, dans fa
préface, dit que Savary rédigea les articles de cette
ordonnance, & que par cette raifon M. Puffort con-
feiller d’état, avoit coûtume de la nommer le code Sa*
vary; mais on l’appelle communément le code marchand,
& plus régulièrement l’ordonnance du Commer*
ce. Foyei ce qui eft dit ci-devant au mot C ode march
an d , & du mot C ode des A ides.
C ode du T a b a c , eftun titre que l’on donne quelquefois
au volume ou recueil des réglemens concernant
la ferme du tabac ; il eft imprimé à la fin du code
des tailles.
C ode des T ailles , eft un recueil des ordonnances
édits, déclarations, réglemens & arrêts de
la cour des aides fur le fait des tailles. Cet ouvrage
eft en deux volumes in-12,