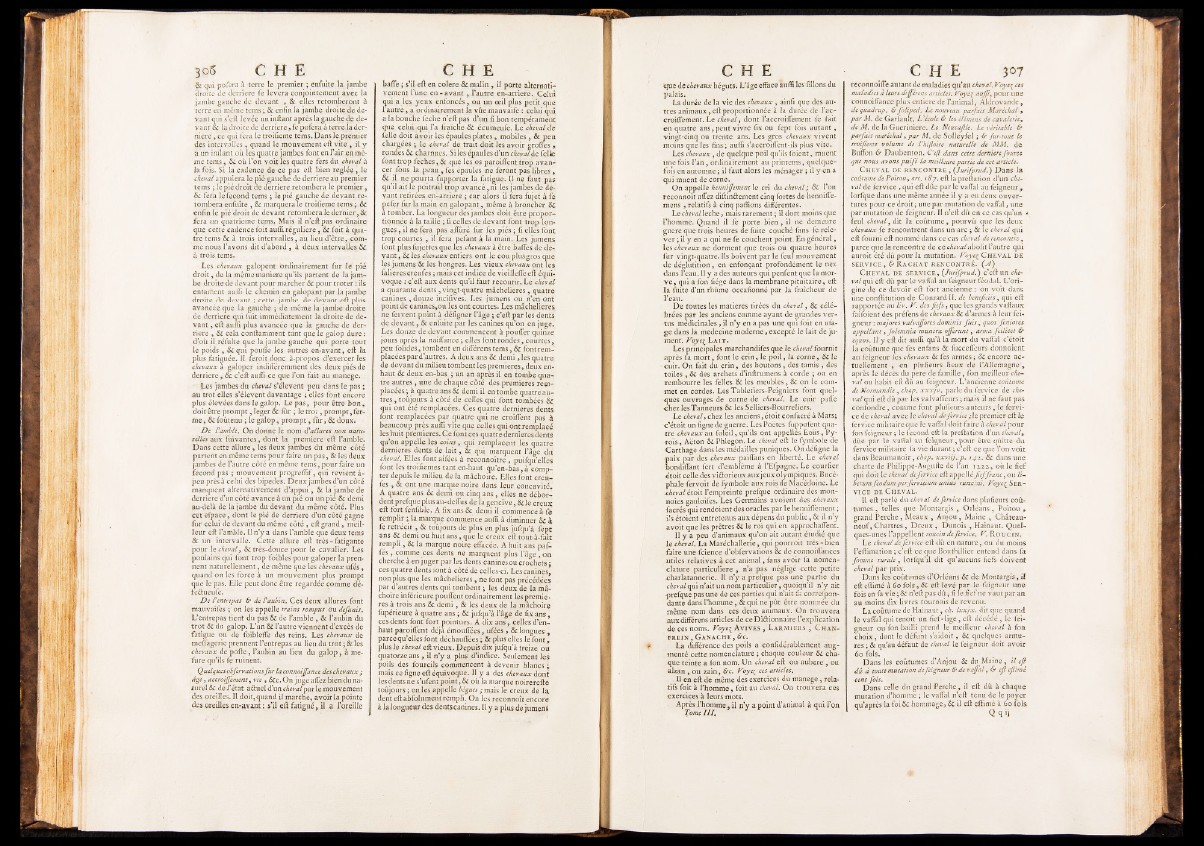
3o5 C H E
•$t qui pofera à terre le premier ; enfuite la jambe
clroite de derrière fe lèvera conjointement avec la
jambe gauche de devant , & elles retomberont à
terre en même tems ; & enfin la jambe droite de devant
quis’eft levée un inftant après la gauche de devant
8c la droite de derrière, fe pofera à terre.la dernière
, ce qui fera le troifieme tems. Dans le premier
des intervalles , quand le mouvement eft vite , il y
a un inftant où les quatre jambes font en l’air en même
tems, & où l’on voit les quatre fers du cheval à
la fois. Si la cadence de ce pas eft bien réglée, le
cheval appuiera le pié gauche de derrière au premier
tems ; le pié droit de derrière retombera le premier,
8c fera le fécond tems ; le pié gauche de devant retombera
enfuite , 8c marquera le troifieme tems ; 8c
•enfin le pié droit de devant retombera le dernier, &
fera un quatrième tems. Mais il n’eft pas ordinaire
que cette cadence foit aufli régulière , & foit à quatre
tems & à trois intervalles, au lieu d’être, comme
nous l’ayons dit d’abord , à deux intervalles 8c
à trois tems,.
Les chevaux galopent ordinairement fur le pié
droit, de la même maniéré qu’ils partent de la jambe
droite dé devant pour marcher 8c pour troter : ils
entament aufli le chemin en galopant par la jambe
droite de devant ; cette jambe de devant eft plus
avancée que la gauche ; de même la jambe droite
de derrière qui luit immédiatement la droite de devant
, eft aufli plus avancée que la gauche de derrière
, 8c cela conftamment tant que le galop dure :
d’où il réfulte que la jambe gauche qui porte tout
le poids , 8c qui poulie les autres en-avant, eft la
plus fatiguée. Il feroit donc à-propos d’exercer les
chevaux a galoper indifféremment des deuxpiésde
derrière, 8c c’eft aufli ce que l’on fait au manege.
■ Les jambes du cheval s’élèvent peu dans le pas ;
au trot elles s’élèvent davantage ; elles font encore
plus élevées dans le galop. Le pas, pour être bon,
doit être prompt, leger & fur ; le t ro t, prompt, ferme
, 8c foûtenu ; le galop, prompt, fur, 8c doux* •
De l ’amble. On donne le nom à!allures non naturelles
aux fuivantes, dont la première1 eft l’amble.
Dans cette allure , les deux jambes du même côté
partent en.même tems pour faire un pas, & les deux
jambes de l’autre côté en même tems, pour faire un
fécond pas ; mouvement progreflîf, qui revient à-
peu-prèsà celui des bipedes. Deux jambes d’un côté
manquent alternativement d’appui, & la jambe de
derrière d’un côté avance à un pié ou un pié 8c demi
au-delà de la jambe du devant du même côté. Plus
cet efpace, dont le pié de derrière d’un côté gagne
fur celui de devant du même côté , eft grand, meilleur
eft l’amble. Il n’y a dans l’amble que deux tems
& un intervalle. Cette allure eft très - fatigante
pour 1 q cheval 9 & très-douce pour le cavalier. Les
poulains qui font trop foibles pour galoper là prennent
naturellement, de mê,me que les chevaux ufés ,
quand on les force à un mouvement plus prompt
que le pas. Elle peut donc être regardée comme dé-
feûueufe.
De l'entrepas & de Üaubin. Ces deux allures font
mauvaifes ; on les appelle trains rompus ou défunts.
L’entrepas tient du pas 8c de l’amble , & l’aubin du
trot 8c du galop. L’un 8c l’autre viennent d’excès de
fatigue ou de foibleffe des reins. Les chevaux de
meffagerie prennent l’entrepas au lieu du trot ; & les
chevaux de pofte, l’aubin au lieu du galop, à me-
fure qu’ils fe ruinent.
Quelques obfervations fur la connoiffance des chevaux ;
agi, accroiffement, vie, 8cc. On juge affez bien du naturel
& de l’ état aétuel d’un cheval par le mouvement
des oreilles. 11 doit,quand il marche, avoir la pointe
des oreilles en-avant: s’il eft fatigué, il a l’oreille
baffe ; s’il eft en colere 8c m alin, il porte alternat!*
vement l’une en - a v a n t , l’autre en-arriere. Celui
qui a les yeux enfoncés, ou un oeil plus petit que
l’autre, a ordinairement la vûe.mauvaife : celui qui
a la bouche feche n’eft pas d’un fi bon tempérament
que celui qui l’a fraîche 8c écumeufe. Le cheval de
felle doit avoir les épaules plates, mobiles , & peu
chargées ; le cheval de trait doit les avoir groffes ,
rondes 8c charnues. Si les épaules d’un cheval de felle
font trop feches, & que les os paroiffent trop avancer
fpqs la peau , fes épaules ne feront pas libres,
8c il ne pourta fupporter la fatigue. Il ne faut pas
qu’il ait le poitrail trop avancé, ni les jambes de devant
retirées en-arriere ; car alors il fera fujet à fe
pefer fur la main en galopant, même à broncher 8c
à tomber. La longueur des jambes doit être proportionnée
à la taille ; fi celles de devant font trop Içn-
gués, il ne fera pas afluré fur fes piés ; fi elles font
trop courtes , il fera pefant à la main. Les jumens
font plus fujettes que les chevaux à être baffes de devant
, 8c les chevaux entiers ont le cou plusgros que
les jumens & les hongres. Les vieux chevaux ont les
falieres qreufes ; mais cet indice de vieillefle eft équivoque
: c’eft aux dents qu’il faut recourir. Le cheval
a quarante dents , vingt-quatre mâchelieres , quatre
canines , douze incifives. Les jumens ou n’en ont
point de canines,ou les ont courtes. Les mâchelieres
ne fervent point à défigner l’âge ; c’eft par les dents
de devant, & enfuite par les canines qu’on en juge.
Les douze de devant commencent à pouffer quinze
jours après la naiffance ; elles font rondes, courtes,
peu folides, tombent en différens tems, 8c font remplacées
par d’autres. A deux ans 8c demi, les quatre
de devant du milieu tombent les premières, deux en-
haut 8c deux en-bas ; un an après il en tombe quatre
autres, une de chaque côté des premières remplacées;
à quatre ans 8c demi il en tombe quatre autres
, toûjours à côté de celles qui font tombées 8c
qui ont été remplacées. Ces quatre dernieres dents
font remplacées par quatre qui ne croiffent pas à
beaucoup près aufli v ite que celles qui ont remplacé
les huit premières. Ce font ces quatre dernieres dents
qu’on appelle les coins, qui remplacent lès quatre
dernieres dents de la it , & qui marquent l’âge du
cheval. Elles font aifées à reconnoître , puifqu’elles
font les troifiemes tant en-haut qu’en-bas, à compter
depuis le milieu de la mâchoire. Elles font creu-
fes , & ont une marque noire dans leur concavité.
A quatre ans 8c demi ou cinq ans , elles ne débordent
prefque plus au-deflus de la gencive, 8c le creux
eft fort fenfible. A fix ans 8c demi il commence à fe
remplir ; la marque commence aufli à diminuer 8c à
fe rétrécir , & toujours de plus en plus jûfqu’à fept
ans 8c demi ou huit ans, que le creux eft tout-à-fait
rempli, 8c la marque noire effacée. A huit ans paf-
fé s , comme ces dents ne marquent plus l’âge , on
cherche à en juger par les dents canines ou crochets ;
ces quatre dents lont à côté de celles-ci. Les canines,
non plus que les mâchelieres, ne font pas précédées
par d’autres dents qui tombent ; les deux de la mâchoire
inférieure pouffent ordinairement les premie*
res à trois ans 8c demi, & les deux de la mâchoire
fupérieure à quatre ans ; 8c jufqu’à l’âge de fix ans,
ces dents font fort pointues. A dix ans, celles d’en-
haut paroiffent déjà émouffées, ufées, 8c longues ,
parce qu’elles font déchauffées ; & plus elles le font,
plus le cheval eft vieux. Depuis dix jufqu’à treize ou
quatorze ans, il n’y a plus d’indice. Seulement les
poils des fourcils commencent à devenir blancs i
mais ce ligne eft équivoque. Il y a des chevaux dont
les dents ne s’ufent point, & où la marque noirerefte
toûjours ; on les appelle béguts ; mais le creux de la
dent eft abfolument rempli. On les reconnoît encore
à lalongueur des dents canines. Il y a plus de jumens
que de chevaux béguts. L’âge efface aufli les filions du
palais.
La durée de la vie des chevaux , ainfi que des autres
animaux, eft proportionnée à la durée de l’ac-
croiffement. Le cheval, dont l’accroiflement fe fait
en quatre ans, peut v ivre fix ou fept fois autant,
vingt-cinq ou trente ans. Les gros chevaux vivent
moins que les fins; aufli s’accroiffent-ils plus vîte.
Les chevaux, de quelque poil qu’ils foient, muent
une fois l’an , ordinairement au printems, quelquefois
én automne ; il faut alors les ménager ; il y en a
qui muent de corne.
On appelle henniffement le cri du cheval; 8c l’on
reconnoît affez diftinâement cinq fortes de henniffe-
mens , relatifs à cinq pallions différentes.
Lec/ievÆ/leche, mais rarement ; il dort moins que
l’homme. Quand il fe porte bien, il ne demeure
guere que trois heures de fuite couché fans fe relever
; il y en a qui ne fe couchent point. En général,
les chevaux ne dorment que trois ou quatre heures
fur vingt-quatre. Ils boivent par le feul mouvement
de déglutition, en enfonçant profondément le nez
dans l’eau. Il y a des auteurs qui penfent que la morv
e , qui a fon fiége dans la membrane pituitaire, eft
la fuite d’un rhume occafionné par la fraîcheur de
l’eau.
De toutes les matières tirées du cheval, 8c célébrées
par les anciens comme ayant de grandes vertus
médicinales, il n’y en a pas une qui foit en ufa-
ge dans la medecine moderne, excepté le lait de j(u-
menf. Voye^ L a i t .
Les principales marchandifes que le cheval fournit
après la mort, font le crin, le poil, la corne, 8c le
■ cuir. On fait du crin, des boutons, des tamis , des
toiles , 8c des archets d’inftrumens à corde ; on en
rembourre les felles 8C les meubles, & on le commet
en cordes. LesTabletiers-Peigniers font quelques
ouvrages de corne de cheval. Le cuir paffe
chez les Tanneurs Sc les Selliers-Bourreliers.
Le cheval, chez les anciens,étoit confacré à Mars;
c’étoit un ligne de guerre. Les Poètes fuppofent quatre
cAevtf«* au foleil, qu’ils ont appelLés E oüs, Py-
TOÏS-, Aëton 8c Phlegon. Le cheval eft le fymbole de
Carthage dans les médailles puniques. Ondéfigne la
■ paix par des chevaux paiffans en liberté. Le cheval
bondiffant fert d’emblème à PEfpagne. Le courfier
étoit celle des victorieux aux jeux olympiques. Bucé-
phale fervoit de fymbole aux rois de Macédoine. Le
cheval étoit l’empreinte prefque ordinaire des mon-
noies gauloifes. Les Germains avoient des chevaux
facrés qui rendoient des oracles par le henniffement ;
ils étoient entretenus aux dépens du public, 8c il n’y
avoit que les prêtres 8c le roi qui en approchaffent.
II y a peu d’animaux qu’on ait autant étudié que
le cheval. La Maréchallerie, qui pourroit très - bien
faire une fcience d’obfervations 8c de connoiffances
utiles relatives à cet animal, fans avoir fa nomenclature
particuliere , n’a pas négligé cette petite
charlatannerie. Il n’y a prefque pas une partie du
cheval qui n’ait un nom particulier, quoiqu’il n’y ait
prefque pas -une de ces parties qui n’ait fa correspondante
dans l’homme, & qui ne pût être nommée dû
même nom dans ces deux animaux. On trouvera
aux différens articles de ce Dictionnaire l’explication
de ces noms. Voye^ A v i v e s , L a r m i e r s , C h a n f
r e i n , G a n a c h e , &c.
La différence des poils a eonfidérablement augmenté
cette nomenclature ; chaque couleur 8c chaque
teinte a fon nom. Un cheval eft ou aubere , ou
alzan , ou zain, &c. Voyei ces articles.
, Il en eft de même des exercices du manege, relatifs
foit à l’homme, foit au cheval. On trouvera ces
exercices à leurs mots.
Après l’homme, il n’y a point d’animal à qui l’on
Tome I II,
reconnoiffe autant de maladies qu’au cheval. Voye[ ces
maladies à leurs différens articles, foyer aufli, pour une
connoiffance plus entière de l’animal, Àldrovande,
de quadrup. & foliped. Le nouveau parfait Maréchal >
par M. de Garfault. L'école & les élémens de cavalerie,
de M. de la Gueriniere. Le Neucaflle. Le véritable &
parfait maréchal, par M. de Solleyfel ; & fur-tout le
troifieme volume de 1'hi (loire naturelle de MM. de
Buffon & Daubenton. C’efl dans cette derniere fource
que nous avons puifé la meilleure partie de cet article.
C h e v a l d e r e n c o n t r e , ( Jurifprud.) Dans la.
coutume de Poitou, art. i8 j. eft la preftation d’un cheval
do fervice , qui eft due par le vaffal au feigneur ,
lorfque dans une même année il y a eu deux ouvertures
pour ce droit; une par mutation de vaffal, une
par mutation de feigneur. Il n’eft dû en ce cas qu’un *■
feul cheval, dit la coutume, pourvû que les deux
chevaux fe rencontrent dans un arc ; 8c le cheval qui
eft fourni eft nommé dans ce cas cheval de rencontre,
parce que la rencontre de ce cheval abolit l’autre qui
auroit été dû pour la mutation. Voyeç C h e v a l d e
s e r v i c e , & R a c h a t r e n c o n t r é . (\A )
C hev al de se r v ic e , (JuriJprudl) c’eft un cAe-
val qui eft dû par le vaffal au feigneur féodal. L’origine
de ce devoir eft fort ancienne : on voit dans
une conftitution de Conrard II. de beneficiis, qui eft
rapportée au liv. V. des fiefs, que les grands vaffaux
faifoient des préfens de chevaux & d’armes à leur feigneur
: majores valvajfores dominis fuis , quos feniores
appellant, Jolemnia munera offerunt, arma feilicet &
equos. I l y eft dit aufli qu’à la mort du vaffal c’étoit
la coûtume que fes enfans 8c fucceffeurs donnoient
au feigneur les chevaux 8c fes armes ; & encore actuellement
, en plufieurs lieux de l’Allemagne ,
après le décès du pere de famille, fon meilleur cheval
ou habit eft dû au feigneur. L ’ancienne coutume
de Normandie, chap, xxxjv. parle du fervice de cheval
qui eft dû par les valvaffeurs ; mais il ne faut pas
confondre, comme font plufieurs auteurs, le fervice
de cheval avec le cheval defervice ;le premier eft le
fervice militaire que le vaffal doit faire à cheval pour
fon feigneur ; le fécond eft la preftation d’un cheval,
due par le vaffal au feigneur, pour être quitte du
fervice militaire fa vie durant ; c’ eft ce que l’on voit
dans Beaumanoir, chap, xxviij. p. / q.-x. .& dans une
charte de Philippe-Augufte de l’an m z , où le fief
qui doit le cheval defervice eft appelle fie f franc, ou liberum
feodum perfervitium unius runcini. Voyez SERV
IC E d e C h e v a l .
Il eft parlé du cheval de fervice dans plufieurs coutumes
, telles que Montareis , Orléans, Poitou ,
grand Perche , Meaux , Anjou, Maine , Château-
neuf, Chartres, Dreux , Dunois , Hainaut. Quelques
unes l’appellent roucin de fervice. V. R o u c i n .
Le cheval de fervice eft dû en nature, ou du moins
l’eftimation ; c’eft ce que Bouthillier entend dans fa
fomme rurale , lorfqu’il dit qu’aucuns fiefs doivent
cheval par prix.
Dans les coûtumes d’Orléans & de Montargis, il
eft eftimé à 6o fols, & eft levé par le feigneur une
fois en fa vie ; & n’eft pas dû, fi le fief ne vaut par an
au moins dix livres tournois de revenu.
La coûtume de Hainaut, ch. Ixxjx. dit que quand
le vaffal qui tenoit un fief-lige, eft décédé , le feigneur
ou fon bailli prend le meilleur cheval à fon
choix, dont le défunt s’a idoit, & quelques armures
; & qu’au défaut de cheval le feigneur doit avoir
6o fols.
Dans les coûtumes d’Anjou & du Maine , il efi
dû à toute mutation de feigneur & de vaffal, <S* efi: efiimé
cent fols.
Dans celle du grand Perche, il eft dû à chaque
mutation d’homme ; le vaffal n’eft tenu de le payer
qu’après la foi & hommage, 8c il eft eftimé à 6o fols
<2 q îj