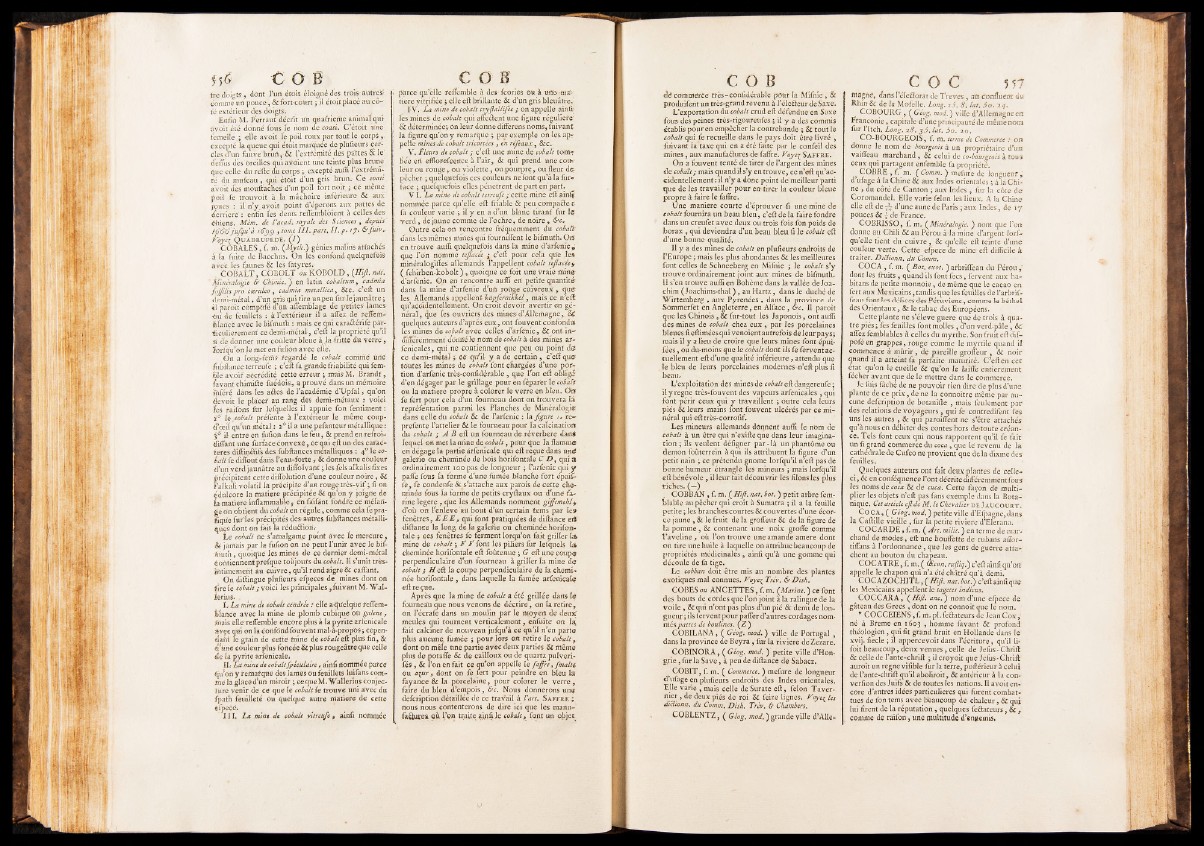
fig C Ô B
tre doigts1, dont l?un étoit éloigné des trois-autres' .
comme un pouce, Sc fortcoùrt ; il étoit placé au côté
extérieur dés doigts; . _. • . '
Enfin M. Permit' décrit un quatrième animal qui-
ayoit. été donné fous le nom de coati. C ’étoit itne; j
témeile, ; -elle avoit le poil roux par tout le corps .
excepté la queue qui étoit marquée de plufieiirs cer- ;
Clés d’un fauv e'bfiul,& l’exfrémité des pa'ttes 8t le \
de fuis dés Oreilles qui avoient une teinte plus brune ^
que celle du relié du corps ; excepté aufti l’extrémi- !
ré du mufeau , qui étoit d'un gris brun.- Ce coati ,
avoit des mouftachés d’un poil fort noir ; cé même
jboil fe trouvoit à la mâchoire inferieure Sc aux ;
joues- : il n’y_ avoit- point d’éperons aux pattes de ;
derrière' : enfin les dents reflemblôient à celles des-
Chiens. Mém. de l'acad. royale des Sciences , depuis )
ïGàê'jufqü'à r€c,g , ïome III. part. II. p. 17. &fuiv, j
r o y é i Quadrupède (/) . ;
COB ALES, f. m. (Myth.) génies malins atfaches ;
à la fuite de Bacchus. On les confond quelquefois- r
avec les faunes & lés fatyr'éS.- __
CO BA L T , CÖBOLT 6u K O BO LD , (Hiß. mit. i
jMinéralogie & Chimie. en latin cobaltum, cadmia ;
foßilis pro' toeruleo, cadmia metallica, &c. e’eft üri ;
demi-métal, d’un gris qui- tire un-peu fur le jaunâtre ;
il parent cornpofé d’ün aftemBlage dé petites- lames
CÉ de feuillets : à l’ extérieur i f a affez de reffe m-
Bfaricè avec le bïfmuth :• mais ce qui caractérife particulièrement
ce demrimétal, c’eft la propriété qu’il
a de donner une coûleiïr bleue à la fritte du verre,
ïorfqu’on le met en fufion avec elle'.
On ä lorig-téïÏÏS- regardé le cobalc com'rné ürîé
Arbflance terreufe ; c’eil fa grande friabilité qui fem-
Èlé av-oif accrédité cette erreur ; maisM. Brandt,
/avant ehimifté füédoisÿ a prouvé dans un mémoire
inféré dans les aftes de l’académie d’Üpfal, qu’on
devoit le placer au rang dés demi-métaux î voici
fes raifôns fur lefquelles il appuie fon fentiment :
i ô i t eobait préfente à l’extérieur le même coup-
d’ceil qu’un métal : zô il a une pefanteur métallique :
y6 il entre en fufion-dans le feu, St prend enrefroi-
diffanf une furfaCeéonvexé, ce qui eft un- des caractères
dlftinûifs des fubftances métalliques : 40 le co-
lait fe diffout dans ï’eau-forte , & donne une couleur
d’un yerd jaunâtre au diffoïvant ; lés fels aïlâlis fixes
précipitent cette diffolution d’une couleur noire, &
l ’al-kali volatil la précipite d’un rouge très-vif ; fi on
édulcore la matière précipitée & qu’on ÿ joïgfîe de
la matière inflammable^ e'n faifänt fondre ce mélange
6'n obtient du cobalt en régule, comme cela fe pratique
fur'les précipités des-autres fubftances métalü-
qùeà dont on fait la réduéfiôri.- ^
Lé cobalt ne S^atnalgam.e point avec le mercure,
èi jamais par la fufion on ne peut l’unir avec le bif-
inuth, quoique' les mines de ce dernier demi-métal
Contiennent prefque toujours du cobalt. Il s’unit très-
intimement au cuivre, qu’il rend aigre Sc caftant.
On diftingue plufieurs efpeces de mines dont on
tiré le cobalt ; voici les principales ,/uivant M. ‘V a l-
leriu& ,
î.- La mine de cobalt céhdrle i elle aqUelqUé feflem-“
blance avec la mine de plomb cubique ou paient,
ihais ëllé'reflemble encore plus à la pyrite arlenicale
âvçé qüi On la conföndfouvent mal-à-pr©p‘os ; cependant
le grain de cette mine de cobalt efl plus fin, &
éiÉne couleur plus foncée & plus rougeâtre que celle
dé la pyrite arfenicale.
IL Ld ihint de cobdltfpecülairè , âîrifi nontmee patee
qu’on y reniafqtie des lames Ou feuillets luifans comme
la glace d’un miroir ; eequéM.tyallérius Conjecture
venir de ce qué ië cobalt fe trouve uni avec du
fpath feuilleté ou quelque autre matière de cette
efpecéï
1 1 Ii La mine de cobalt vitreufe , ainft nommée
C O B
parce qu’elle reflemble à desfeories ou à uno ma’-'
tiere vitrifiée ; elle eft brillante 8t d’un gris bleuâtre.
I-V. La mine de cobalt cryjlallijee ; on appelle ainfi'
lés mines de cobalt qui affeétent line figure régulière;
Sc déterminée;- on leur donne differens noms, lùivanç
la figure qn’ôn y remarque ; par exemple on les ap--
pelie mines de cobalt tricottees x en réfeaux, & c.
V. f liurs die cobalt ; c’eft une mine de cobalt totalti
fiée ert efflorefceiïce à l’air, 8c qui prend une coupleur
ou fouge,,où v iolette, ou pourpre* ou fleur des
pécher ; quelquefois ces couleurs ne font qu’à la fur-
face ; quelquefois elles pénètrent dé part eh part.
V I . - La mine de cobalt terreufe / cette miné eft- ainf|'
nommée parce qu’elle eft friable & peu compa&e e
fa couleur varie ; il y en a d’un blanc tirant' fur Iç
■ yercl, de jaune comme de l’ocnre , de noire, &c-.
Outre cela on rencontre fréquemment du cobalt
dans les mêmes mines qui fourniflent le bifmuth. Orfc
en trouvé aufti quelquefois dans la mine d’arfenic 9
que l’on nomme tcjîacee ; c’eft pour cela que les-
minéralogiftes allemands l’appellent cobalt tejl'aciïey
( fehirben-kobolt ) , quoique ce foit une vraie mine-
d’arfenic. On en rencontre aufti en petite quantité:
dans la mine d’arfenic d’ufi roiige' cuivreux , que
les Allemands appellent hâpfernikkel, mais ce n’efE
qu’acGidentellément. On croit devoir avertir en g é'
néral , que les ouvriers des mines d’ All'erfiagne * SC
quelques auteurs d’après eux* ont fou vent confondus
les mines de cobalt avec Celles d’àrféhic, & ont in--
dïffèrémménf doiiffé le nom dé cobalt à des mirfes ar-
fenicales, qui ne contiennent que peu ou point des
ce demi-métal ; ce qu’il- y a de certain, c’eft que:
toutes lès mines de cobalt font ehafgées d’une portion
d’arfenic très-confidérable , que l’on eft obligé’
d’en dégager par le grillage pour en féparer le' cobalt
où la matière propre à colorer le verre en bleu. On
fe fert pour cela d’un fourneau dont on trouvera là
repréfentation parmi les Planches de Minéralogie
dans celle du cobalt & de l’arfenic : la figure 1 > re-
prefente l’aftelier & le fourneau pouf la caïcinatiofi
du cobalt ; A B eft ün fourneau de réverbéré dam*
lequel o n met la mine de cobalt, pour que la flamme
en dégage la partie arfenicale qui eft reçue dans une
galerie ou cheminée de bois horifontale C Z>, qui a
ordinairement 100 pas de longueur ; l’arfénic qui y
pafté fous la forme d’une fumée blanche fort epaif-
fe , fe condenfe s’attache aux pafoïs de cette cheminée
fous la forme de petits cryftaux ou d’une farine
legere * que les Allemands nomment gifitmekl*
d’où on l’enleve ail bout d’un certain tems par le»
fenêtres, E E E ? qui font pratiquées de diftance eri
diftanee le long de la galerie ou cheminée horifontale
; Ges fenêtres fe ferment Iorqu’on fait griller ht
mine de cobalt ; f F font les piliers fur lefquels lat
cheminée horifontale eft foûtenué ; G eft une coupes
perpendiculaire d’un fourneau à griller la mine de
cobalt} H eft la coupe perpendiculaire de la chemi*
née horifontale, dans laquelle la fumée arfenicale
eft reçue.
Après que la mine de cobalt a été grillée dans le
fourneau que nous venons de décrire, on la retire,
on l’écrafe dans un moulin par le moyen de demç
meules qui tournent verticalement, enfuite on la
fait calciner de nouveau jufqu’à ce qu’il n’en parte
plus aucune, fumée ; pour lors on retire le cobalt 7.
dont oh mêle une partie avec deux parties & même
plus de potafle & de cailloux ou de quartz pulveri-
fés , & l’on en fait ce qu’on appelle le f offre, fmalt$
ou a^ur f dont on fe fert pour peindre en bleu la
fayance & la porcelaine, pour colorer le verre ,
faire du bleu d’empois, &c. Nous donnerons une
defeription détaillée de ce traVail à l'art. S a f f r e ;
nous nous contenterons de dire ici que les manu-
faûurea où l’on traite ainft le cobalt> font un objet
C O B
dé commerce très-confidérable pour la Mifnie, &
produifent un très-grand revenu à-l’élefteur deSaxe.
L’exportation du cobalt crud eft défendue en Saxe
fous des peines très-rigoufeufes ; il y a des commis
établis pour en empêcher la contrebande ; & tout le
cobalt qui fe recueille dans le pays doit être livré ,
fuivant la taxe qui en a été faite par le confeil des
mines, aux manufactures de faffre. l'o y e z S a f f r e .
On a fouvent tenté de tirer de l’argent des mines
de cobalt ; mais quandil s’y en trouve, ce n’eft qu’ac-
cidentellement : il n’y a donc point de meilleur parti
que de les travailler pour en- tirer la couleur bleue
propre à faire le faffre.
Une maniéré courte d’éprouver f i une mine de
cobalt fournira un beau bleu, c’eft de la faire fondre
dans un creufet avec deux ou trois fois fon poids de
borax , qui deviendra d’un beau bleu fi le cobalt eft
d’une bonne qualité.
51 y a des mines de cobalt en plufieurs endroits de
l’Europe ; mais les plus abondantes & les meilleures
font celles de Schneeberg en Mifnie ; le cobalt s’y
trouve ordinairement joint aux mines de bifmuth.
11 s’en trouve aufti en Bohème dans la vallée de Joachim
( Joachims-thal ) , au Hartz, dans le duché de
Wirtemberg , aux Pyrénées , dans la province de
Sommerfet en Angleterre, en Alface, o-c. Il paroît
que les Chinois , & fur-tout les Japonois, ont aufti
des mines de cobalt chez eux , par les porcelaines
bleues fi eftiméesqui venoient autrefois de leur pays;
mais il y a lieu de croire que leurs mines font épui-
fées, ou du-moins que le cobalt dont ils fe fervent actuellement
eft d’une qualité inférieure , attendu que
le bleu de leurs porcelaines modernes ^n’eft plus fi
beau.
L’exploitatxOn des mines de cobalt eft dangereufe ;
il y regne très-fouvent des vapeurs arfenicales , qui
font périr ceux qui y travaillent ; outre cela leurs
piés Sc leurs mains font fouvent ulcérés par ce minéral
qui eft très-corrofif.
Les mineurs allemands donnent aufti le nom de
cobalt à un être qui n’eXifte que dans leur imagination
; ils veulent défigner par - là un phantôme ou
démon foûterrein à qui ils attribuent la figure d’un
petit nain ; ce prétendu gnome lorfqu’il n’eft pas de
bonne humeur étrangle les mineurs ; mais lorfqu’il
eft bénévole , il leur fait découvrir les filons les plus
riches. (—)
, COBBAN, f. m. ( Hiß. nat. bot. ) petit arbre fem-
blable au pêcher qui croît à Sumatra ; il a la feuille
petite ; les branches courtes & couvertes d’une écorce
jaune , 8t le fruit de la groffeur & de la figure de
la pomme, & contenant une noix groffe comme
l ’aveline, où l’on trouve une amande amere dont
on tire une huile à laquelle on attribue beaucoup de
propriétés médicinales , ainfi qu’à une gomme qui
découle de fa tige.
Le cobban doit être mis au nombre des plantes
exotiques mal connues. Hoye^ Trév. & Disk.
COBES ou ANCETTES, f. m. (Marine. ) ce font
des bouts de cordes que l’on joint a la ralingue de la
v o ile , & qui n’ont pas plus d’un pié 8c demi de longueur
> ils fervent pour paffer d’autres cordages nommés
pattes de boulines. (Z )
COBILANA, ( Gèogi mod. ) ville de Portugal ,
dans la province de B e yra, fur la riviere de Zezare.
COBINORA, ( Gcog. mod. ) petite ville d’Hongrie
, fur la Save, à peu de diftance de Sabacz.
CO BIT , f. m. ( Commerce. ) mefure de longueur
d’ufage en plufieurs endroits des Indes orientales.
Elle varie , mais celle de Surate eft, félon Taver-
nier , de deux piés de roi & feize lignes. Hoye^ les
diclionn. du Comrn. Dish. Trév. & Chambers.
COBLENTZ, ( Géog, mod, ) grande ville d’Alle-
C O C 5 57
magné, dans Péleéîorât de Treves , att Confluent du
Rhin & de la Mofelle. Long. 2S. 8. lat. So. 24.
COBOURG , ( Géog. mod.') ville d’Allemag ne en
Franconie, capitale d’une principauté de même nom
fur l’Itch. Long. 2.8. j S. lat. So. 20.
CO-BOURGEOIS, f. m. terme de Commerce : on
donne le nom de bourgeois à un propriétaire d’un
vaiffeau marchand, 8c celui de co-bourgeois à tous
ceux qui partagent ènfemble fa propriété.
} COBRE , f. m. ( Comm. ) mefure de longueur,’
d’ufage à ja Chine & aux Indes orientales ; à là Chine
, au côté de Canton ; aux Indes i fur la côte de
Coromandel. Elle varie félon les lieux. A la Chine
elle eft. de d’une aune de Paris ; aux Indes, de 17
pouces & j de France.
COBRISSO, f. m. (Minéralogie. ) nom que l’on
donne au Chili & au Pérou àTa mine d’argent lorf-
qu’elle tient du cu ivre, & qu’elle eft teinte d’une
couleur verte. Cette efpece de mine eft difficile à
traiter. Diclionn. du Comm.
CO CA , f. m. ( Bot. exot. ) arbrifleau du Pérou
dont les fruits , quand ils font fecs, fervent aux ha-
bitans de petite monnoie, de même que le cacao en
fert aux Mexicains, tandis que les feuilles de l’arbrif-
feau font les délices des Péruviens, comme le béthel
des Orientaux, & le tabac des Européens.
Cette plante ne s’élève guere que de trois à quatre
piés ; fes feuilles font molles , d’un verd-pâle, Sc
aflez femblables à celles du myrthe. Son fruit eft dif-
poféen grappes, rouge comme le myrtile quand il
commence à mûrir, de pareille groflèur , & noir
tjnand il a atteint fa parfaite maturité. C ’eft en cet
état qu’on le cueille & qu’on le laifle entièrement
fecher avant que de le mettre dans le commerce.
Je fuis fâché de ne pouvoir rien dire de plus d’une
plante de ce prix, de ne la connoître même par aucune
defeription de botanifte , mais feulement par
des relations de voyageurs , qui fe contredifent tes
uns les autres , & qui paroiflent ne s’être attachés
qu’à nous en débiter des contes hors de-toute créance.
Tels font ceux qui nous rapportent qu’il le fait
un fi grand commerce du coca, que lé revenu de la
cathédrale de Cufco ne provient que de la dixme desfeuilles.
Quelques auteurs ont fait deux plantes de celle-
ci, & en conféquence l’ont décrite différemment fous
les noms de coca & de cuca. Cette façon de multiplier
les objets n’eft pas fans exemple dans la Botanique.
Cet article eßde M. le Chevalier DE JAUCOURT.
C o G A, ( Géog. mod. ) petite ville d’Efpagne, dans
la Caftille vieille, fur la petite riviere d’Elerana.
CO C A R D E , f. m. ( Art. milit. ) en terme de marchand
de modes, eft une bouffette de rubans affor-
tiflans à l’ordonnance, que les gens de guerre attachent
au bouton du chapeau.
CO C ATR E, f. m. ( OEcon. rufiiq.) c’eft ainfi qu’on
appelle le chapon qui n’a été châtré qu’à demi.
CO CAZOCHITL, ( Hifi. nat. bot.) c’eft ainfi que
les Mexicains appellent le tagetes indicus.
CO C C A R A , ( Hiß. anc. ) nom d’une elpece de
gâteau des Grecs , dont on ne connoît que le nom.
* COCCEIENS, f. m. pl. feftateurs de Jean Cox
né à Breme en 1603 > homme favant Sc profond
théologien, qui fit grand bruit en Hollande dans le
xvij. fiecle ; il appercevoit dans l’écriture, qu’il li-
foit beaucoup, deux venues, celle de Jefus-Chrift
Sc celle de l’ante-chrift ; il croyoit que Jefus-Chrift
auroit un regne vifible fur la terre, poftérieur à celui
de l’ante-chrift qu’il aboliroit, & antérieur à la con-
verfion des Juifs 8c de toutes les nations. Il avoit encore
d’antres idées particulières qui furent combattues
de fon tems avec beaucoup de chaleur, Sc quj
lui firent de la réputation, quelques fe&ateurs, Sc ,
comme de raifon, une multitude d’ennemis.