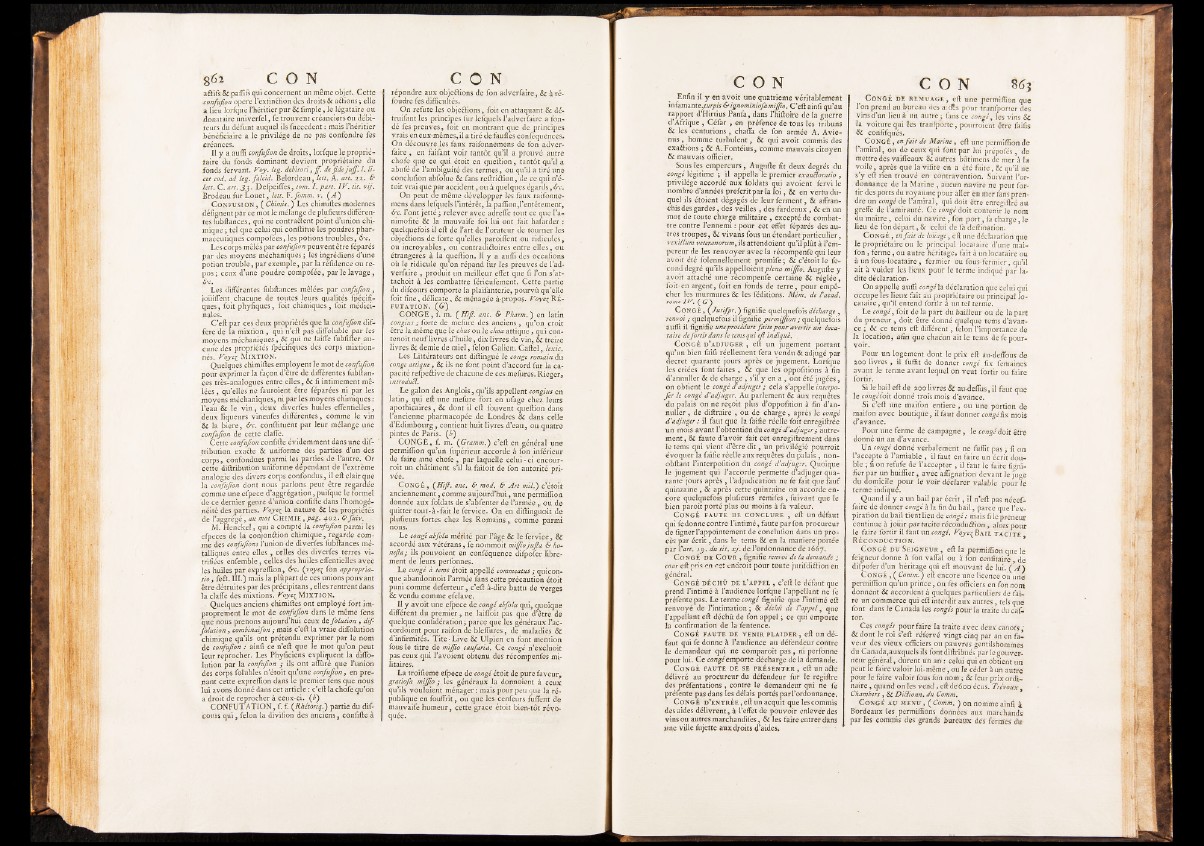
aâifs 6c paffifs qui concernent un même objet. Cette
.confufion opéré l’extinâion des droits & attions ; elle
a lieu lorfque l’héritier pur & fimple, le légataire ou
donataire univerfel, fe trouvent créanciers ou débiteurs
du défunt auquel ils fuccedent : mais l’héritier
bénéficiaire a le privilège de ne pas confondre fes
créances.
Il y a aufli confufion de droits, lorfque le propriétaire
du fonds dominant devient propriétaire du
fonds fervant. Voy. leg. debitori, fi. de fidejuff. L. li-
çet cod. ad leg. falcid. Belordeau, lett. A. art. 22. &
lut. Ç. art. J j . Defpeiffes, tom. I. part. IV. tit. vij.
Brodeau fur L ouet, lut. F.fomm. y. ÇA)
C onfusion , ( Chimie. ) Les chimiftes modernes
défignent par ce mot le mélange de plufieurs différentes
fubftances, qui ne contractent point d’union chimique
; tel que celui qui conftitue les poudres pharmaceutiques
compofées, les potions troubles, &c.
Les corps mêlés par confufion peuvent être féparés
par des moyens méchaniques ; les ingrédiens d’une
potion trouble, par exemple, par la refidence ou repos
; ceux d’une poudre compofée, par le lavage,
Les différentes fubftances mêlées par confufion,
joiiiffent chacune de toutes leurs qualités fpécifi-
ques, foit phyfiques, foit chimiques , foit médicinales.
.
C’eft par ces deux propriétés que la confufion différé
de la mixtion , qui n’eft pas diffoluble par les
moyens méchaniques, & qui ne laiffe fubfifter aucune
des propriétés fpécifiques des corps mixtion-
nés. Voye%_ Mix t io n .
Quelques chimiftes employent le mot de confufion
pour exprimer la façon d’etre de différentes fubftances
très-analogues entre elles, 6c fi intimement mêlées
, qu’elles ne fauroient être féparées ni par les
moyens méchaniques, ni par les moyens chimiques :
l’eau & le v in , deux diverfes huiles effentielles,
deux liqueurs vineufes différentes, comme le vin
& la biere, &c. conftituent par leur mélange une
confufion de cette claffe.
Cette confufion confifte évidemment dans une dif- '
tribution exaâe & uniforme des parties d’un des
corps, confondues parmi les parties de l’autre. Or
cette diftribution uniforme dépendant de l’extrême
analogie des divers corps confondus, il eft clair que
la confufion dont nous parlons peut être regardée
comme une efpece d’aggrégation, puifque le formel
de ce dernier genre d’union confifte dans l’homogénéité
des parties. Voye^ la nature 6c les propriétés
de l’aggrégé, au mot C him ie , pag. 402. & fuiv.
M. Henckel, qui a compté la confufion parmi les
efpeces de là conjonction chimique, regarde comme
des confufions l’union de diverfes fubftances métalliques
entre elles , celles des diverfes terres vitrifiées
enfemble, celles des huiles effentielles avec
les huiles par expreffion, &c. Çvoyc{ fon appropria-
tio, fe£t. III.) mais la plupart de ces unions pouvant
être détruites par des précipitans, elles rentrent dans
la claffe des mixtions. Voye[ Mix t io n .
Quelques anciens chimiftes ont employé fort improprement
le mot de confufion dans le même fens
que nous prenons aujourd’hui ceux de folution, dif-
folution y combînaifon ; mais ç’eft la vraie diffolution
chimique qu’ils ont prétendu exprimer par le nom
de confufion ; ainfi ce n’eft que le mot qu’on peut
leur reprocher. Les Phyficiens expliquent la diffolution
par la confufion ; ils ont affûré que l’union
des corps folubles n’étoit qu’une confufion , en prenant
cette expreffion dans le premier fens que nous
lui avons donné dans cet article : c’eft la chofe qu’on
a droit de reprocher à ceux-ci. Çb)
CONFUTATION, f. f. ÇRhétoriq.) partie du dif-
cours qui, félon la divifion des anciens, confifte à
répondre aux objections de fon adverfaire, & à réfoudre
fes difficultés.
. On réfuté les objections, foit en attaquant 6c dé-
truifant les principes fur lefquels l’adverfaire a fondé
fes preuves, foit en montrant que de principes
vrais en eux-mêmes, il a tiré de fauffes conféquences.
On découvre les faux raifonnemens de fon adverfaire
, en faifant voir tantôt qu’il a prouvé autre
chofe que ce qui étoit en queftion, tantôt qu’il a
abufé de l’ambiguité des termes, ou qu’il a tiré une
conclufion abfolue 6c fans reftriCtion, de ce qui n’étoit
vrai que par accident, ou à quelques égards, &c.
On peut de même développer ies faux raifonne-
mens dans lefquels l’intérêt, la paffion,l’entêtement,
&c. l ’ont jetté ; relever avec adreffe tout ce que l’a-
nimofité 6c la mauvaife foi lui ont fait hafarder :
quelquefois il eft de l’art de l’orateur de tourner les
ob j eft ions de forte qu’elles paroiffent ou ridicules,
ou incroyables, ou contra diftoires entre elles, ou
étrangères à la queftion. Il y a aufli des occafions
où le ridicule qu’on répand fur les preuves de l ’ad-
verfaire , produit un meilleur effet que fi l’on s ’at-
tachoit à les combattre férieufement. Cette partie
du difcours comporte la plaifanterie, pourvu qu’elle
foit fine, délicate, & ménagée à-propos. Voye{ R éfutation.
ÇG)
CO N G E , l'.'m. ÇHift. anc. & Pharm.) en latin
congius ; forte de mefure des anciens , qu’on croit
être la même que le chus ou le choa attique, qui con-
tenoit neuf livres d’huile , dix livres de vin, 6c treize
livres & demie de miel, félon Galien. Caftel, lexic.
Les Littérateurs ont diftingué le conge romain du
conge attique, 6c ils ne font point d’accord fur la capacité
refpeftive de chacune de ces mefures. Rieger,
introduit.
Le galon des Anglois, qu’ils appellent congius en
latin, qui eft une mefure fort en ufage chez leurs
apothicaires, 6c dont il eft fouvent queftion dans
l’ancienne pharmacopée de Londres 6c dans celle
d’Edimbourg, contient huit livres d’eau, ou quatre
pintes de Paris. (£)
CO N G É , f. m. ÇGramm.) c’eft en général une
permiffion qu’un fupérieur accorde à fon inférieur
de faire *une chofe , par laquelle celui - ci encour-
roit un châtiment s’il la failoit de fon autorité privée.
CONGÉ, ÇHifi. anc. & niod. & Art mil.) c’étoit
anciennement, comme aujourd’hui, une permiffion
donnée aux foldats de s’abfenter de l’armée, ou de
quitter tout-à-fait le fervice. On en diftinguoit de
plufieurs fortes chez les Romains., comme parmi
nous.
Le congé abfolu mérité par l’âge 6c le fervice, &
accordé aux vétérans, fe nommoit mißiojufla & ho-
nefia; ils pouvoient en conféquence difpofer librement
de leurs perfonnes.
Le congé à tems étoit appellé commeatus ; quiconque
abandonnoit l’armée fans cette précaution étoit
puni comme deferteur, c’eft à-dire battu de verges
6c vendu comme efclavé.
Il y avoit une efpece de congé abfolu qui, quoique
différent du premier, ne laiffoit pas que d’être de
quelque considération; parce que les généraux l’ac-
cordoient pour raifon de bleffures, de maladies 6c
d’infirmités. Tite - Live 6c Ulpien en font mention
fous le titre de miffio caufaria. Ce congé n’exduoit
pas ceux qui l’avoient obtenu des récompenfes militaires.
La troifieme efpece de congé étoit de pure faveur,
gratiofa miffio ; les généraux la donnoient à ceux
qu’ils vouloient ménager : mais poiir peu que la république
en fouffrît, ou que les cenfeurs fufferiï de
mauvaife humeur, cette grâce étoit bien-tôt révoquée.
Enfin il y en avoit une quàtrieme véritablement
infamante,turpis & ignominiofamiffio. C ’eft ainfi qu’au
rapport d’Hirtius Panfa, dans l’hiftoire de la guerre
d’Afrique , Céfàr , en préfence de tous les tribuns
& les centurions, chaffa de fon armée A. A vie-
nus, homme turbulent, & qui avoit commis des
exaftions ; & A. Foritéius, comme mauvais citoyen
& mauvais officier.
Sous les empereurs, Auguftë fit deux degrés du
congé légitime ; il appella le premier exaucloratio ,
privilège accordé aux foldats qui avoient fervi le
nombre d’années prefcritparla lo i , & en vertu duquel
ils étoient dégagés de leur ferment, & affranchis
des gardes, des veilles , des fardeaux , & en un
mot de toute charge militaire , excepté de combattre
contre l’ennemi : pour cet effet féparés des autres
troupes, & vivans fous un étendart particulier,
yexiltum veteranorum, ils attendoient qu’il plût à l’empereur
de les renvoyer avec la récompenfe qui leur
avoit été folennellement promife; & c’étoit le fécond
degré qu’ils appclloientplena miffio. Augufte y
avoit attaché une récompenfe certaine & réglée,
foit-en argent, foit en fonds de terre, pour empêcher
les murmures 6c les féditions. Mém. de Cacad.
tome IV. ( G }
CONGÉ, ÇJurifpr.) fignifie quelquefois décharge ,
renvoi ; quelquefois il fignifie permiffion; quelquefois
aufli il fignifie une procédure faite pour avertir un locataire
defor tir dans le tems qui efi indiqué. .
C ongé d’adjuger , eft un jugement portant
qu’un bien faifi réellement fera vendu & adjugé par
decret quarante jours après ce jugement. Lorfque
les criées font faites , 6c que les oppofitions à fin
d’annuller & de charge , s’il y en a , ont été jugées,
on obtient le congé (Tadjuger ; cela s’appelle interpo-
fer le congé d'adjuger. Au parlement 6c aux requêtes
du palais on ne reçoit plus d’oppofition à fin d’an-
nullér, de diftraire , ou de charge, après le congé
d'adjuger : il faut que la faifie réelle foit enregiftrée
un mois avant l’obtention du congé d'adjuger ; autrement
, & faute d’avoir fait cet enregiftrement dans
le tems qui vient d’être d it , un privilégié pourroit
évoquer la faifie réelle aux requêtes du palais , non-
obftant l’interpofition du congé d'adjugzr. Quoique
le jugement qui l’accorde permette d’adjuger quarante
jours après , l ’adjudication ne fe fait que fauf
quinzaine , & après cette quinzaine on accorde encore
quelquefois plufieurs remifes , fuivant que le
bien paroît porté plus ou moins à fa valeur.
C ongé faute de co nc lur e , eft un défaut
qui fe donne contre l’intimé, faute par fon procureur
de ligner l’appointement de conclufion dans un procès
par écrit, dans le tems 6c en la maniéré portée
par l'art. ic). du tit. x j. de.l’ordonnance de 1667.
CONGÉ de C our , fignifie renvoi'de la demande ;
cour eft prie en cet endroit pour toute jurifdiCtiort en
général.
C ongé d éch û de l’appel , c’eft le défaut que
prend l’intimé à l’audience lorfque l’appellant ne fe
préfente pas. Le terme congé lignifié que l’intimé eft
renvoyé de l’intimation; & déchû de l'appel, que
l’appellant eft déchû de fon appel ; ce qüi emporte
la confirmation de la fentence.
C ongé faute dé venir plaider^ eft un défaut
qui fe donne à l’audience au défendeur contre
le demandeur qui ne comparoît pas., rti perfonne
pour lui. Ce congé emporte décharge de la demandé.
C ongé faute de se p r é s en t e r , eftuna&e
délivré au procureur du défendeur fur le regiftre
des préfentations , contre le demandeur qui ne fe
préfente pas dans les délais portés parrordonnance.
C ongé d’entrée , eft un acquit que les commis
des aides délivrent, à l’effet de pouvoir enlever des
vins ou autres marchandifes, & les faire entrer dans
«ne ville fujette aux droits d’aides.
t C o n g é dé reMu a g e , eft une permiffion que
1 on prend au.bureau des a:d£s pour tranfporter des
vins d’un lieu à un autre ; fans ce con<*é les vins &
la voiture qui les tranfpôrte, pourroient être faifis
& confifqués.
C ongé , en fait de Marine, eft une permiffion de
l’amiral, ou de ceux qui font par lui prépofés , de
mettre dés vaîffeaux & autres bâtimens de mer à la
voile, après que là vifitè en a été faite, 6c qu’il ne
s’y eft rien trouvé en contravention. Suivant l’ordonnance
de la Mariné , aucun navire ne peut for-
tir des ports du royaume pour aller en mer fans prendre
un congé de l’amiral, qui doit être enregiftré au
greffe de l’amirauté. Ce congé doit contenir le nom
du maître , cehii du navire , fon port, fa charge, le
liéu de fon départ, & celui de fâ deftinarion.
C ongé , en fait de louage, èft une déclaration que
le propriétaire ou le principal locataire d’une mai-
fon, ferme, ou autre héritage, fait à un locataire ou
à un fous-locataire , fermier ou fous-fermier, qu’il
ait à vuider lés lieux pour le terme indiqué par ladite
déclaration.
On appelle aufli congé là déclaration que celui qui
occupe les lieux fait au propriétaire ou principal locataire
, qu’il entend fortir à un tel terme.
Le congé, foit delà part du bailleur ou de la part
du preneur , doit être donné quelque tems d’âvan-
ce ; & ce tems eft différent, félon l’importance de
la location, afin que chacun ait le tems de fé pourvoir.
Pour un logement dont le prix eft àu-deffous de
zoo livres, il fufiit de donner congé fix ferhaines
avant le terme avant lequel ôn veut fortir ou faire
fortir.
Si le bail eft de zoo li vres & au-deflus, il faut que
le congé foit donné trois mois d’avance.
Si c’eft une maifem entière, ou Une portiôh de
maifon avec boutique, il faut donner corigéfxx mois
d’ avance.
Pour une ferme de campagne, le congé doit être
donné un an d’avance.
Uti congé donné verbalement ne fuffit pas ; fi on
l’accepte à l’amiable , il faut en faire un écrit double
; fi on refufe de l’accepter , il faut le faire figni-
fier par un huiflier, avec aflignation devant le juge
du domicile pour le Voir déclarer vàlable pour le
terme indiqué.
Quand il y a un bail par éc rit, il n’eft pas rtécef-
faire de donner congé à la fin du bail, parce que l’ex-
piratiôn du bail tient lieu de congé : mais fi le preneur
continue à joiiir par tacite réconduâion , alors pour
le faire fortir il faut un congé. V’oyeffiwi. t a c it e
R é co n dü c t io n .
C ongé du Seigneur , eft la perniiflion que le
feigneur donne à fon vaffal ou à fon cenfitaire de
difpofer d’un héritage qui eft mouvant de lui. ( A )
C ongé , ( Commi) eft encofe une licence où une
pérmiflion qu’un prince, ou fes officiers en fon nom
donnent 6c accordent à quelques particuliers de faire
uff commerce qui eft interdit aux autres, tels que
font dans le Canada les congés pour la traite du ca fter.
Ces congés pour faire la traite avec deux canots,'
& dont le foi s’eft réfiervé vingt-cinq par an en faveur
des vieux officiers ou pauvres gentilshommes
du Canada,auxquels ils fontdiftribnés p'ar le gouverneur
général, durent un an : celui qui en obtient un
peut le faire' vafoir lui-même, ou le céder à un autre
pour le faire valoir fous fon nom ; & leur prix ordinaire
, quand on les v e n d , eft dê 600 éCus. Trévoux *
Chambers, & Diclionn. du Conini.
C ongé au menu , ( Cotnrn. ) on nomme ainfi à
Bordeaux les permiflîons données aux marchands
par les commis des grands bureaux des fermes du