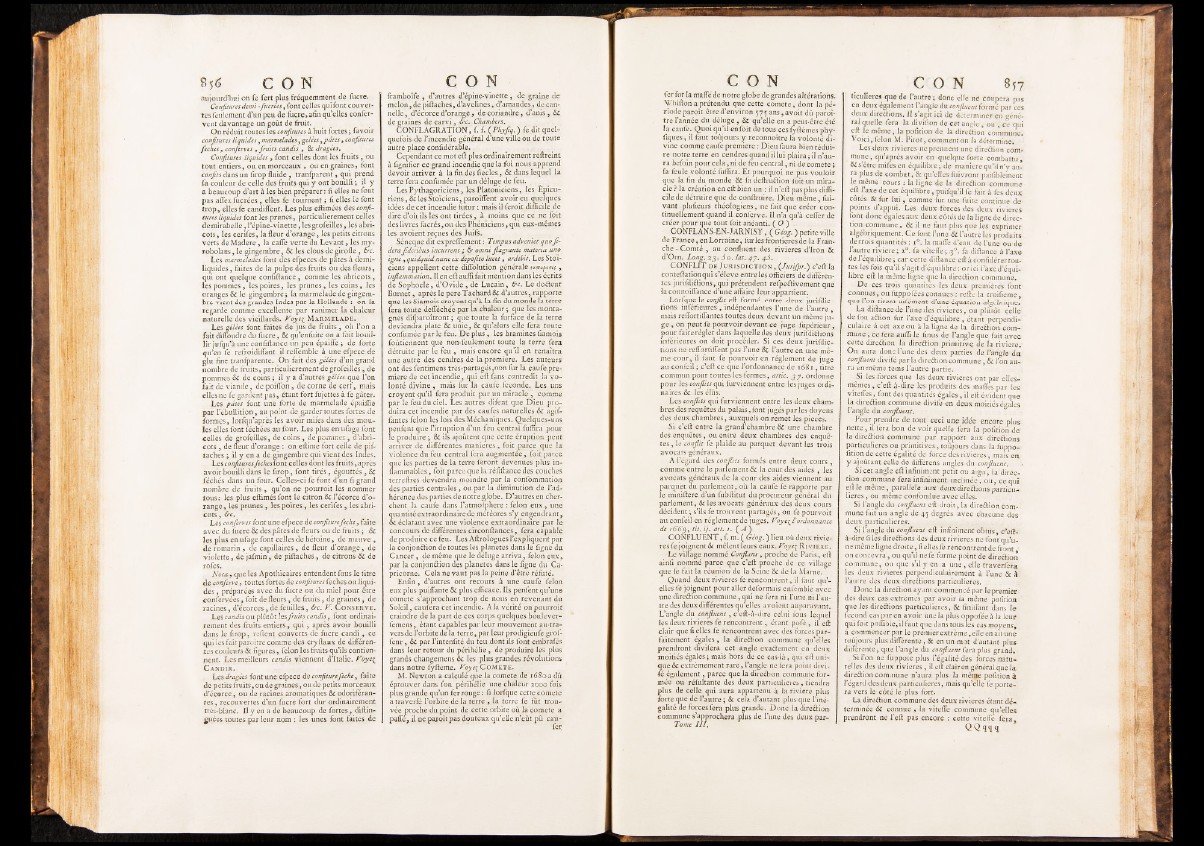
aujourd’hui on fe fert plus fréquemment cle fucre.
Confitures demi -fucrees, font celles qui font couvertes
feulement d’un peu de fucre, afin qu’elles confer-
vent davantage un goût de fruit.
On réduit toutes les confitures à huit fortes ; favoir
confitures liquides, marmelades, gelées, pâtes , confitures
fiches, conferves , fruits candis , & dragées.
Confitures liquides , font celles dont les fruits , ou
tout entiers, ou en morceaux , ou en graines, font
confits dans un firop fluide , tranfparent, qui prend
fa couleur de celle des fruits qui y ont bouilli ; il y
a beaucoup d’art à les bien préparer : fi elles ne font
pas affez fucrées, elles fe tournent ; fi elles le font
trop, elles fe candiffent. Les plus eftimées des confitures
liquides font les prunes, particulièrement celles
de mirabelle, l’épine-vinette, lesgrofeilles, les abricots,
les cerifes, la fleur d’orange, les petits citrons
verts de Madere, la caffe verte du Levant, les my-
robolans, le gingembre, & les clous de girofle , bc.
Les marmelades font des efpeces de pâtes à demi-
liquides , faites de la pulpe des fruits ou des fleurs,
qui ont quelque confiftance, comme les abricots,
les pommes, les poires, les prunes, les coins, les
oranges & le gingembre ; la marmelade de gingembre
vient des grandes Indes par la Hollande : on la
regarde comme excellente par ranimer la chaleur
naturelle des vieillards. Voye£ Marmelade.
Les gelées font faites de jus de fruits, où l’on a
Fait difloudre du fucre, & qu’enfuite on a fait bouillir
jufqu’à une confiflance un peu épaiffe ; de forte
qu’en fe refroidiffant il reffemble à une efpece de
glu fine tranfparente. On fait des gélées d’un grand
nombre de fruits, particulièrement de grofeilles, de
pommes & de coins ; il y a d’autres gélées que l’on
fait de viande, de poiflon , de corne de cerf, mais
elles ne fe gardent pas , étant fort fujettes à fe gâter.
Les pâtes font une forte de marmelade épaiflie
par l’ébullition, au point de garder toutes fortes de
formes, lorfqu’après les avoir miles dans des moules
elles font léchées au four. Les plus enufage font
celles de grofeilles, de coins, de pommes, d’abricots
, de fleur d’orange : on eftime fort celle de pif-
taches ; il y en a de gingembre qui vient des Indes.
Les confitures fechesiont celles dont les fruits, après
avoir bouilli dans le firop, font tirés, égouttés , &
féchés dans un four. Celles-ci fe font d’un fi grand
nombre de fruits , qu’on ne pourroit les nommer
tous : les plus eflimés font le citron & l’écorce d’orange,
les prunes , les poires, les cerifes, les abricots
, &c.
Les conferves font une efpece déconfiturefeche, faite
avec du fucre & des pâtes de fleurs du de fruits ; &
les plus en ufage font celles de bétoine, de mauve ,
de romarin, de capillaires, de fleur d’orange, de
violette, de jafmin, de piftaches, de citrons &c de
rofes.
Nota} que les Apothicaires entendent fous le titre
de conferve, toutes fortes de confitures feches ou liquides
, préparées avec du fucre ou du miel pour être
confervées, foit de fleurs, de fruits, de graines, de
racines, d’écorces, de feuilles, &c. K. C onserve.
Les candis ou plutôt les fruits candis, font ordinairement
des fruits entiers , q u i, après avoir bouilli
dans le firop, relient couverts de fucfe candi, ce
qui les fait paroître comme des cryftaux de différentes
couleurs & figures, félon les fruits qu’ils contiennent.
Les meilleurs candis viennent d’Italie. Voye^
C andir.
Les dragées font une efpece de confiture feche, faite
de petits fruits, ou de graines, ou de petits morceaux
d’éc®rce, ou de racines aromatiques & odoriférantes
, recouvertes d’un fucre fort dur ordinairement
très-blanc. Il y en a de beaucoup de fortes, diftin-
gnées toutes par leur nom : les unes font faites de
framboife , d’autres d’épine-vinette , de graine de
melon, de piftaches, d’avelines, d’amandes, de cannelle,
d’écorce d’orange , de coriandre, d’anis , &c
de graines de ea rvi, &c. Chambers.
CONFLAGRATION, f. f. ( Phyfiq. ) fe dit quelquefois
de l’incendie générai d’une ville ou de toute
autre place confidérable.
Cependant ce mot eft plus ordinairement reftreint
à lignifier ce grand incendie que la foi nous apprend
devoir arriver à la fin des fiecles, & dans lequel la
terre fera confumée par un déluge de feu.
Les Pythagoriciens, les Platoniciens, les Épicuriens,
& les Stoïciens, paroiffent avoir eu quelques
idées de cet incendie futur : mais il feroit difficile de
dire d’oü ils les ont tirées , à moins que ce ne foit
des livres facrés,ou des Phéniciens, qui eux-mêmes
les avoient reçues des Juifs.
Séneque dit expreffement : Tempus adveniet quo fédéra
fldcribus incurrent j & omni flagrante materia uno
igné, quidquid nunc ex dçpofitô lücet, ardébit. Les Stoïciens
appellent cette diffolution générale aimpotnc ,
inflammation. Il en eft auffi fait mention dans les écrits
de Sophocle, d’Ovide , de Lucain, &c. Le doCteur
Burnet, après le pere Tachard & d’autres , rapporte
que les Siamois croyent qu’à la fin du monde la terre
fera toute defféchée par la. chaleur ; que les montagnes
difparoîtront ; que toute la furface de la terre
deviendra plate & unie, & qu’alors elle fera toute
confumée parle feu. De p lus, les bramines fiamois
foûtierinent que non-feulement toute la terre fera
détruite par le feu , niais encore qu’il en renaîtra
une autre des cendres de la première. Les auteurs
ont des fentimens très-partages,non fur la caufe.pre-
miere de cet incendie, qui eft fans contredit la vo lonté
divine , mais fur- la caufe fécondé. Les uns
croyent qu’il fera produit par un miracle , comme
par le feu du ciel. Les autres difent que Dieu produira
cet incendie par des caufes naturelles & agif-
fantes félon les lois desMéchaniques. Quelques-uns
penfent que l’irruption d’un feu central fuffira pour
le produire ; & ils ajoutent que cette éruption peut
arriver de différentes maniérés, foit parce que la
violence du feu central fera augmentée, foit parce
ue les parties de la terre feront devenues plus in-
ammables, foit parce que la réfiftance des couches
terreftres deviendra moindre par la confommation
des parties centrales , ou par la diminution de l’adhérence
des parties de notre globe. D ’autres en cherchent
la caufe dans l’atmolphere : félon eu x, une
quantité extraordinaire de météores s’y engendrant,
éc éclatant avec une violence extraordinaire par le
concours de différentes circonftances, fera capable
de produire ce feu. Les Aftrologues l’expliqüènt par
la conjonction de toutes les planètes dans le figne du
Cancer , de même que le déluge arriva, félon eux,
par la conjonction des planètes dans le figne du Capricorne.
Cela ne vaut pas la peine d’être réfuté.
Enfin, d’autres ont recours à une caufe félon
eux plus puiffante & plus efficace. Ils penfent qu’une
comete s ’approchant trop de nous en revenant du
Soleil, caufera cet incendie. A la vérité on pourroit
craindre de la part de ces corps quelques boulever-
femens, étant capables par leur mouvement au-tra-
vers de l’orbite de la terre, par leur prodigieufe grof-
feur, & par l’intenfité du feu dont ils font embrafés
dans leur retour du périhélie, de produire les plus
grands changemens & les plus grandes révolutions
dans notre fyftème. P'oyei C omete.
M. Newton a calculé que la comete de 1680 a dû
éprouver dans fon périhélie une chaleur 2000 fois
plus grande qu’un fer rouge : fi lorfque cette comete
a traverfé l’orbite de la terre , la terre fe fut trouvée
proche du point de cette orbite où la comete a
paffé, U ne paraît pas douteux qu’elle n’eût pû eaufer
fur la maffé de notre globe de grandes altérations.
Whifton a prétendu que cette comete, dont la période
paroît être d’environ 575 ans, avoit du paroître
l’année du déluge , & qu’elle en a peut-être été
la caufe. Quoi qu’il en foit de tous ces fyftèmes phy-
fiques, il faut toujours y reconnoître la volonté divine
comme caufe première : Dieu faura bien réduire
notre terre en cendres quand il lui plaira ; il n’aura
befoin pour cela, ni de feu central, ni de comete ;
fa feule volonté fuffira. Et pourquoi ne pas vouloir
que la fin du monde & ’fa deftruCtion foit un miracle
? la création en eft bien un : il n’eft pas plus difficile
de détruire que de conftrnire. Dieu même, fui-
vant plufieurs théologiens, ne fait que créer continuellement
quand il conferve. Il n’a qu’à ceffer de
créer, pour que tout foit anéanti. ( O )
CONFLANS-EN-JARNISY, ( Géog.) petite ville
de France, en Lorraine, fur les frontières de la Franche
- Comté , au confluent .des rivières d’Iron &
d’Orn. Long. 23. 5 o.lat. 47. 46.
CONFLIT de Jurisdiction, (Jurifpr.) c’eft la
conteftatiônqui s’élève entre les officiers de différentes
jurifdiCtions, qui prétendent refpe&iventent que
la connoiffance d’une affaire leur appartient.
Lorfque le conflit eft formé entre deux jurifdic-
tions inférieures , indépendantes l’une de l’autre
mais reffortiffantes toutes deux devant un même juge
, on peut fe pourvoir devant ce juge fupérieur,
pour fairerégler dans laquelle des deux jurifdiCtions
inférieures on doit procéder. Si ces deux jurifdic-
tions ne reffortiffent pas l’une & l’autre en une même
cour, il faut fe pourvoir en réglement de juge
au confeil ; c’eft ce que l’ordonnance de 1681, titre
commun pour toutes les fermes, artic. jy . ordonne
pour les conflits qui furviennent entre les juges ordinaires
& les élûs.'
Les conflits qui furviennent entre les deux chambres
des requêtes du palais, font jugés parles doyens
des deux chambres, auxquels on remet les pièces.
Si c’eft entre la grand’chambre & une chambre
des enquêtes, ou entre deux chambres des enquêtes
, le conflit fe plaide au parquet devant les trois
avocats généraux.
A l’égard des conflits formés entre deux cours ,
comme entre le parlement & la cour, des aides , les
avocats généraux de la cour des aides viennent au
parquet du parlement, où la caufe fe rapporte par
le miniftere d’un fubftitut du procureur général du
parlement, & les avocats généraux des deux cours
décident ; s’ils fe trouvent partagés, on fe pourvoit
au confeil en réglementée juges. Voye^Vordonnance
de tit. ij. art. 1. ( A }
CONFLUENT, f. m. ( Géog. ) lieu où deux rivières
fe joignent & mêlent leurs eaux. Voye^ Riviere.
Le village nommé Conflans, proche de Paris, eft
ainfi nommé parce que c’eft proche de ce village
que fe fait la réunion de la Seine & de la Marne. .
Quand deux rivières fe rencontrent, il faut qu’elles
fe joignent pour aller déformais enfemble avec
une direction commune, qui ne fera ni l’une ni l’autre
des deux différentes qu’elles avoient auparavant.
L’angle du confluent, c’eft-à-dire celui tous lequel
les deux rivières fe rencontrent, étant pofé , il eft
clair que fi elles fe rencontrent avec des forces par- ;
faitement égales, la direction commune qu’elles
prendront divifera cet angle exactement en deux
moitiés égales; mais hors ae ce cas-là, qui,eft unique
& extrêmement rare, l’angle ne fera point divi-
fé également. parce que la direction commuée formée
ou réfultante des deux particulières, tiendra
plus de celle qui aura appartenu à la riviere plus
forte que de l’autre ; & cela d’autant plus que l’inégalité
de forces fera plus grande. Donc la direction
commune s’approchera plus de l’une des deux par-
Tome I II,
‘ ticulieres que de l’autre ; donc elle né coupera pas
en deux egalement l’angle du confluent forme par ces
deux directions. Il s agit ici de déterminer en général
quelle fera la divifion de cet angle , ou , ce qui
eft le même, la pofition de la direâion commune.
Voici, félon M. Pitot, comment on la détermine.
Les deux rivieres ne prennent une direction corn-
mune, qu’après avoir en quelque forte combattu,
& s’être mifes en équilibre; de maniéré qu’il n’y aura
plus de combat, & qu’elles fuivront paifiblement
le meme cours : la ligne de la direction commune
eft l’axe de cet équilibre, puifqu’il fe fait à fes deux
cotés & fur lu i , comme fur une fuite continue de
points d’appui. Les deux forces des deux rivières
font donc égales aux deux côtés de la ligne de direction
commune , & il ne faut plus que les exprimer
algébriquement. Ce font l’une & l’autre les produits
de trois quantités: 1°. la maffe d’eau de l’une ou de
l’autre riviere ; z°. fa vîteffe ; .3°. fa diftance à l’axe
de l’équilibre ; car cette diftance eft à confidérer toutes
les fois qu’il s’agit d’équilibre : or ici l’axe d’équilibre
eft la même ligne que la direction commune.
De ces trois quantités les deux premiérés font
connues, ou fuppofées connues : refte la troifieme,
que l’on tirera aifément d’une équation algébrique.
La diftance de l’une des rivières, ou plutôt celle
de Ion aCtion fur l’axe d’équilibre , étant perpendiculaire
à cet axe ou à la ligne de la direction commune,
ce fera auffi le finus de l’angle que fait avec
cette direction la direction primitive de la riviere.
On aura donc l’une des deux parties de l’angle du
confluent divifé par la direction commune, & l’on aura
en même tems l’autre partie.
Si les forces que les deux rivières ont par elles-
mêmes , c’eft-à-aire les produits des maffes par les
vîteffes, font des quantités égales , il eft évident que
la direction commune divife en deux moitiés égales
l ’angle du confluent.
Pour prendre de tout ceci une idée encore plus
nette, il fera bon de voir quelle fera la pofition de
la direction commune par rapport aux directions
particulières ou primitives, toujours dans la fuppo-
fition de cette égalité de force des rivières, mais en
y ajoùtant celle de différens angles ,du .confluent.
Si cet angle eft infiniment petit ou aigu, la direction
commune fera infiniment, inclinée, ou , ce qui
eft le même, parallèle aux deux directions particulières
, ou même confondue avec elles.
Si l’angle du confinent eft droit, la direction com-
mune fait un angle de 45 degrés avec chacune des
deux particulières.
Si l’angle du confluent eft infiniment obtus, c’eft-
à-dire fi les directions clés deux rivières ne font qu’une
même ligne droite, fi elles fe renconrrent de front '
on concevra, ou qu’il ne fe forme point de direction
commune, ou que s’il y en a une , elle traverfera
les deux rivières perpendiculairement à l’une & h
l’autre des deux directions particulières.
Donc la direction ayant commencé par le premier
des deux cas extrêmes par avoir la même pofition
que les directions particulières, & finiffant dans le
fécond cas par en avoir une la plus oppofée à la leur
qui foit poffible,il faut que dans tous les cas moyens,'
à commencer par le premier extrême, elle en ait-une
toûjours plus différente, & en un mot d'autant plus
differente, que l’angle du confluent fera plus grand.
. Si l’on ne fuppofe plus l’égalité des forces naturelles
des deux rivières, il elt clair en général que la
direction commune n’aura plus la même pofition à
l’égard des deux particulières, mais qu’elle fe portera
vers le côté le plus fort.
La direction commune des deux rivières étant déterminée
& connue , la vîteffe commune qu’elles
prendront ne l’eft pas encore. : cette vîteffe fera,
Q Q q q q