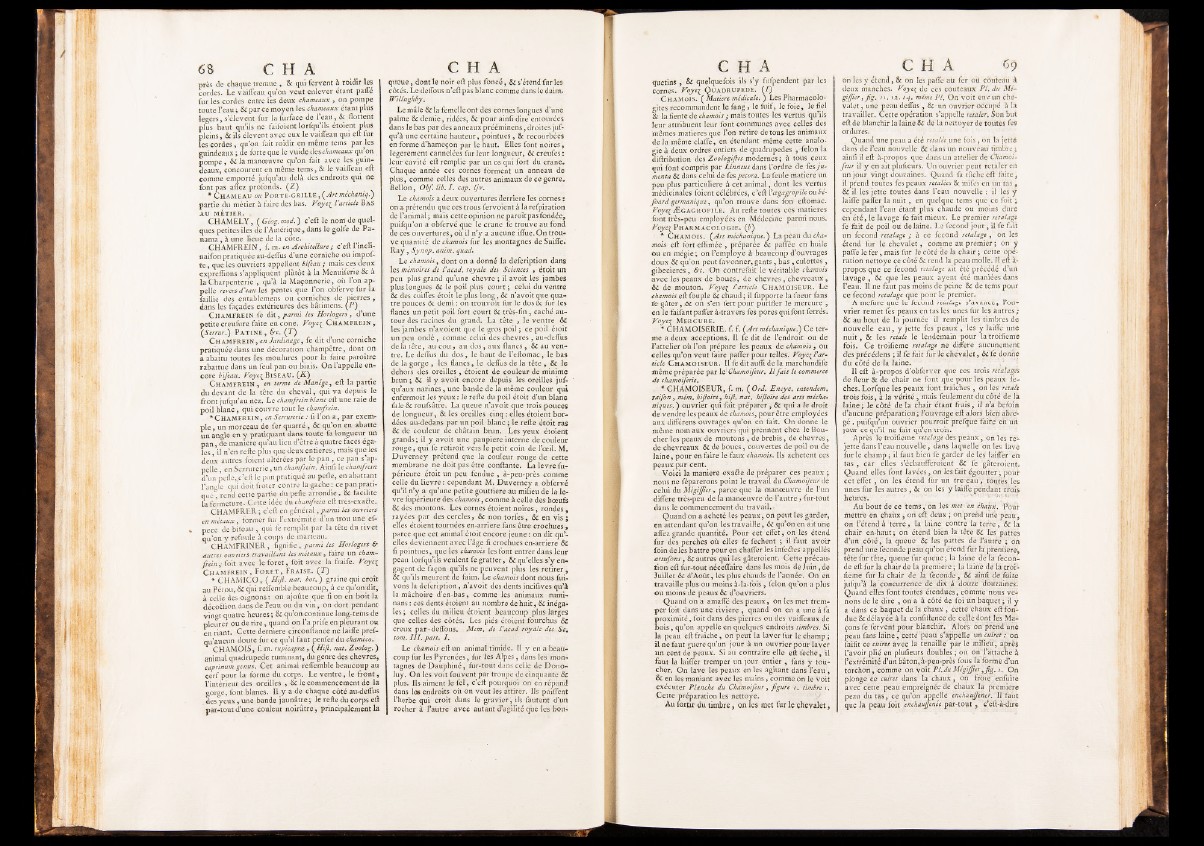
près de chaque tremue , & qui fervent à roidir les
cordes. Le vàiffeau qu’on veut enlever étant paffé
fur les cordes entre les deux chameaux , on pompe
toute l’eau ; & par ce moyen les chameaux étant plus
légers, s’élèvent fur la mrface de l’eau, & flottent
plus haut qu’ils ne faifoient lorfqu’ils étoient plus
pleins, & ils élevent avec eux le vaiffeau qui eft fur
les cordes, qu’on fait roidir en même tems par les
guindeaux ; de forte que le vuide des chameaux qu’on
pompe, & la manoeuvre qu’on fait avec les guindeaux,
concourent en même tems, & le vaiffeau eft
comme emporté jufqu’au delà des endroits qui ne
font pas affez profonds. (Z )
* C hameau ou Po rte-g r il l e , {Art méchaniq.)
partie du métier à faire des bas. Voyeç l'article Bas
AU MÉTIER. .
CHAMELY, ( Géog. mod. ) c’eft le non* de quelques
petites îles de l’Amérique, dans le golfe de Panama
, à une lieue de la côte.
CHAMFREIN, f. m. en Architecture ; c’eft l’incli-
naifon pratiquée au-deffus d’une corniche ou impof-
t e , que les ouvriers appellent hifeau ; mais ces deux
expreflions s’appliquent plutôt à la Menuiferie & à
la Charpenterie , qu’à la Maçonnerie, où l’on appelle
revers-d'eau les pentes que l’on obferve fur la
faillie des entablemens ou corniches de pierres ,
dans les façades extérieures des bâtimens. ( P)
C h amfrein fe dit, parmi les Horlogers, d’une
petite creufure faite en cône. Voye^ C hamfrein ,
(,Serrur.) PATINE, &c. (T )
C h am fr e in , en Jardinage, fe dit d’une corniche
pratiquée dans une décoration champêtre, dont^on
a abattu toutes les moulures pour la faire paroître
rabattue dans un feul pan ou biais. On l’appelle encore
hifeau. Voye^ BlSEAU. (X)
C hamfrein , en terme de'Manège, eft la partie
du devant de la tête du cheval, qui va depuis le
front jufqu’au nez. Le chamfrein blanc eft une raie de
poil blanc, qui couvre tout le chamfrein.
* C h am frein , en Serrurerie: fi l’on a , par exemple
, un morceau de fer quarré, ôc qu’on en abatte
un an®le en y pratiquant dans toute fa longueur un
pan, de maniéré qu’au lieu d’être à quatre faces égales
il n’en refte plus que deux entières, mais que les
deux autres foient altérées par le pan , ce pan s’appelle
, en Serrurerie, un chamfrein. Ainfi le chamfrein
d’un pefle, c’eft le pan pratiqué au pelle, en abattant
l’angle qui doit froter contre la gâche : ce pan pratiqué
, rend cette partie du pefle arrondie, & facilite
la fermeture. Cette idée du chamfrein eft très-exafre.
CHAMFRER ; c’eft; en général, parmi les ouvriers
en métaux, former fur l’extrcmité d’un trou une ef-
pece de bil'eau , qui fe remplit par la tête du rivet
qu’on y refoule à coups de marteau.
CHAMFRINER , lignifie , parmi les Horlogers &
-autres ouvriers travaillant les métaux, faire un chamfrein
,■ foit avec le foret, foit avec la fraife. Voye^
C h am f r e in , Fo r e t , Fraise. (T )
* CHAMICO,. ( Hifl. nat. bot.) graine qui croît
au Pérou, & qui relfemble beaucoup, à ce qu’ondit,
à celle des oignons : on ajoute que fi on en boit la
décoüion dans de l’eau ou du v in , on dort pendant
vinot-quatre heures ; & qu’on continue long-tems de
pleurer ou de rire, quand on l’a prife en pleurant ou
en riant. Cette derniere circonftance ne laiffe pref-
qu’aucun doute fur ce qu’il faut penfer du chamico.
" CHAMOIS, f. m. rupicapra , ( Hiß. nat. Zoolog. ).
animal quadrupède ruminant, du genre des chevres,
caprinum genus. Cet animal relfemble beaucoup au
cerf pour la forme du corps. Le ventre, le front,
l’intérieur des oreilles , & le commencement de la
gorge, font blancs. Il y a de chaque côté au-deffus
des y e u x , une bande jaunâtre ; le refte du corps eft
par-tout d’une couleur noirâtre, principalement la
queue, dont le noir eft plus foncé, & s’étend fur les
côtés. Le delfous n’eft pas blanc comme dans le daim.
Willughby.
Le mâle & la femelle ont des cornes longues d’une
palme & demie, ridées, & pour ainfi dirè entourées
dans le bas par des anneaux prééminens, droites juf-
qu’à une certaine hauteur, pointues, & recourbées
en forme d’hameçon par le haut. Elles font noires,
legerement cannelées fur leur longueur, & creufes:
leur cavité eft remplie par un os qui fort du crâne.
Chaque année ces cornes forment un anneau de
plus, comme celles des autres animaux de ce genre.
Bellon, Obf.lib.I. cap. Ijv.
Le chamois a deux ouvertures derrière les cornes :
on a. prétendu que ces trous fervoient à la refpiration
de l’animal; mais cette opinion ne paroît pas fondée,
puifqu’on a obfervé que le crâne le trouve au fond
de ces ouvertures, où il n’y a aucune ifliie.On trouv
e quantité de chamois fur les montagnes de Suilfe.'
R a y , Synop. anim. quad.
Le chamois, dont on a donné la defeription dans
les mémoires de l'acad. royale des Sciences , étoit un
peu plus grand qu’une chevre ; il avoit les jambes
plus longues & le poil plus court ; celui du ventre
& des cuiffes étoit le plus long, & n’avoit que quatre
pouces & demi : on trouvoit fur le dos& fur les
flancs un petit poil fort court & très-fin, caché autour
des racines du grand. La tête , le ventre ÔC
les jambes n’avoient que le gros poil ; ce poil étoit
un peu ondé , comme celui des chevres , au-delfus
delà tête, au c o u , au dos, aux flancs , & au ventre.
Le defliis du dos , le haut de l’eftomac ; le bas
de la gorge , les flancs, le deftus de la tête , & le
dehors des oreilles , étoient de couleur de minime
brun ; & il y avoit encore depuiis les oreilles juf-
qu’aux narines, une bande de la même couleur qui
enfermoit les yeux : le refte du poil étoit d’un blanc
fale & roufsâtre. La queue n’avoit que trois pouces
de longueur, & les oreilles cinq : elles étoient bordées
au-dedans par un poil blanc ; le refte étoit ras
& de couleur de châtain brun. Les yeux étoient
grands ; il y avoit une paupière interne de couleur
rouge, qui fe retiroit vers le petit coin de l’oeil. M.
Duverney prétend que la couleur rouge de cette
membrane ne doit pas être confiante. La levre fu-
périeure étoit un peu fendue , à-peu-près comme
celle du lievre : cependant M. Duverney a obfervé
qu’il n’y a qu’une petite gouttière au milieu de la levre
fupérieure des chamois, comme à celle des boeufs
& des moutons. Les cornes étoient noires, rondes ,
rayées par des cercles, & non torfes, & en vis ;
elles étoient tournées en-arriere fans être crochues ,
parce que cet animaf étoit encore jeune : on dit qu’elles
deviennent avec l’âge fi crochues en-arriere &
fi pointues, que les chamois les font entrer dans leur
peau lorfqu’ils veulent fe gratter, & qu’elles s?y engagent
de façon qu’ils ne peuvent plus les retirer,
& qu’ils mçurent de faim. Le chamois dont nous fui-
vons la defeription, n’avoit des dents incifives qu’à
la mâchoire d’en-bas, comme les animaux rumi-
nans : ces dents étoient au nombre de huit, & inégales;
celles du milieu étoient beaucoup plus larges
que celles des côtés. Les pies étoient fourchus &
creux par-deffous. Mern. de l'acad royale des Sc.
tom. I I I . part. I.
Le chamois eft un animal timide. Il y en a beaucoup
fur les Pyrénées, fur les Alpes , dans les montagnes
de Dauphiné, fur-tout dans celle de Donô-
! luy. On les voit fouvent par troupe de cinquante &
plus. Ils aiment le fe l, c’eft pourquoi on en répand
dans les endroits où on veut les attirer. Ils paiflent
l’herbe qui croît dans le gravier, ils fautent d’un
rocher à l’autre avec autant d’agilité que les bonqùetins
, & quelquefois ils s’y fufpendent par les
cornes. Voye^ Q uadrupède. (/)
C hamois. ( Matière médicale. ) Lés Pharmacolo-
gites recommandent le fang, le fuif, le foie, le fiel
& la fiente de chamois ; mais toutes les vertus qu’ils
leur attribuent leur font communes avec celles des
mêmes matières que l’on retire de tous les animaux
d e là même claffe, en étendant même cette analogie
à deux ordres entiers de quadrupèdes , félon la
diftribution des Zoologifles modernes ; à tous ceux
qui font compris par Linneusdans l’ordre de fes ju-
menta & dans celui de fes pecora. La feule matière un
peu plus particulière à cet animal, dont les vertus
médicinales foient célébrées, c ’eft \'(zgagropile ou bé-
Jbard germanique, qu’oh trouve dans fon eftomac.
Voye^ Æ g ag ro p il e . Au refte toutes ces matières
font très-peu employées en Médecine parmi nous.
Voye^ P h a rm a co lo g ie , (b)
* C h amo is. {Art méchanique.) La peau du chamois
eft fort eftimée , préparée & paffée en huile
ou en mégie ; on l’employe à beaucoup d’ouvrages
doux & qu’on peut favonner, gants , bas , culottes ,
gibecières, &c. On contrefait le véritable chamois
avec les peaux de boucs, de chevres , chevreaux,
& de mouton. Voye^ l'article C h àMOISÉUR. Le
chamois eft fou pie & chaud; il fupporte la fueur fans
fe gâter, .& on s’en fert pour purifier le mercure ,
en le faifant paffer à-travers fes pores qui font ferrés.
Voye^ Mercure.
* CHAMOISERIE. f. f. {Art méchaniqUe.') Ce terme
a deux acceptions. Il fe dit de l’endroit ou de
l’attelier où l’on prépare les peaux de chamois , Ou
celles qu’on veut faire paffer pour telles. Vbye[ l }article
C h am o iseur. Il fe ditaufli de la marchandife
même préparée par 1 éChamoifeur. I l fait le commercé
de chamoiferie.
. * CHAMOISEUR, f. m. {Ord. Encyc. entendem.
raifon, mém. hifloire, hifl. nat. hifloire des arts mècha*
niques, ) ouvrier qui fait préparer, & qui a le droit
de vendre les peaux de chamois, pour être employées
aux différens ouvrages qu’on en fait. On donne le
même nom aux ouvriers qui prennent chez le Boucher
les peaux dé moutons , de brebis, de chevres,
de chevreaux & de boucs, couvertes de poil ou de
laine, pour en faire le faux chamois. Ils achètent ces
peaux par cent.
Voici la maniéré exafte de préparer ces peaux ;
nous ne féparerons point le travail du Chamoijéùr de
celui du Mégiffler, parce que la manoeuvre de l’un
différé très-peu de la manoeuvre de l’autre , fur-tout
dans: le commencement du travail, f
Quand on a acheté les peaux, ori peut les garder,
en attendant qu’on les travaille, & qu’on en ait une
affez grande quantité. Pour cet effet, omles étend
fur des perches où elles fe fechent ; il faut avoir
foin de les battre pour en chaffer les infe&es appellés
artufons, & autres qui les gâteroient. Cette précaution
eft fur-tout néceffaire dans les mois de Juin, de
Juillet & d’Août, les plus chauds de l’année. On en
travaille plus ou moins à-Ia-fois , félon qu’on a plus
ou moins de peaux & d’ouvriers.
Quand on a amaffé des peaux, on les met tremper
foit dans une riviere , quand on en a une à fa
proximité, foit dans des pierres ou des vaiffeatix de
b o is , qu’on appelle en quelques endroits timbres. Si
la peau eft fraîche, on peut la laver fur le champ ;
il ne faut guère qu’un jour à un ouvrier pour laver
un cent de peaux. Si au contraire elle eft lèche, il
faut la laiflèr tremper un jour entier , farts y toucher.
On lave les peaux en les agitant dans l’ea u ,
& en les maniant avec les mains, comme on le voit
exécuter Planche du Chamoifeur, figure i. timbre /.
Cette préparation les rtettoye.
Au ibrtir du timbre, on les met fur le chevalet,
on les y étend, & on les paffe au fer ou couteaü à
deux manches. Voye^ de ces couteaux PI. du Mé-
giffierffig. n . 12.14. même PI. On voit enr un chevalet
, une peau deffus , & un ouvrier occupé à là
travailler. Cette opération s’appelle retaler. Son but
eft de blanchir la laine & dé la nettoyer de toutes fes
ordures.
Quand une peau a été tetalée une fois $ bn là jetté
dans de l’eau nouvelle & dans un nouveau timbre ;
ainfi il eft à-propos que dans un attelier de Çhamoi-
J'eur il y en ait plufieurs. Un ouvrier peut retaler en
un jour vingt douzaines. Quand fa tâche eft faite,
il prend toutes fes peaux retalées & mifes en Un tas ,
& il les jette toutes dans l’eau nouvelle : il les y
laiffe paffer la nu it, en quelque tems que ce foit ;
cependant l’eau étant plus chaude ou moins dure
en é té, le lavage fe fait mieux. Le premier retalagé
fe fait de poil ou de laine. Le fécond jour, il fe fait
un fécond retalage ; à ce fécond retalage , on les
étend ftir le chevalet, comme au premier ; on y
paffe le fe r , mais fur le côté de la chair ; Cette opération
nettoye ce côté & rend la peau molle. Il eft à-
propos que ce fécond retalage ait été précédé d’un
lavage , & que les peaux ayent été maniées dans
l’eau. Il ne faut pas moins de peine & de tertis pour
ce fécond retalage que pour le premier.
A mefure que le fécond retalage s’avâncè, l’ouvrier
remet fes peaux en tas les unes fur les autres }
& au bout de la journée il remplit les timbres de
nouvelle eau, y jette fes peaux , les y laiffe une
n u it, & les retale le lendemain pour latroifieme
fois. Ce troifieme retalage ne différé aucunement
dès précéderts ; il fé fait furie chevalet, Ôc'fe donrie
du côté de la laine.
Il eft à-propos d’obferver que ces trois réialagès
de fleur & de chair në font que pour les peaux feches.
Lorfque les peaux foht fraîches , cin les retale
trôis fois, à la vérité, niais feulement du côté de là
laine ; le côté de la chair étant frais, il n’a befoin
d’aucune préparation; l’ouvrage eft alors bien abrégé
, puifqu’un ouvrier pburroit prèfque faite éh uri
jour ce qu’il ne fait qû’en tr’qis.
Après le troifièmé retalage des peâux, on les re*-
jette dans l’eau nouvelle, dans laquelle on les lave
furie champ ; il faut bieri fé garder de les laiffer en
tas , car elles s’échaufferoient & fe gâteroient.
Quand elles font lavées, ori les fait égoutter; pouf
cet effet , on les étend fur üri trerèàify fontes les
unes fur les autres, & on les y laiffe pendant trois
hérités.
Aii bout de ce tems ,'on les met en éhakà. PoUt
riiettrè èn çhaùx ; ori eft deux ; ôn prend urtè péâti,
on l’éténd à terre, la laine contre la terre , & la
chair en-haut ; on étend bien la tête & les pattes
d’un .côté , la queue 8c les pattes de l’autfë ';!ofi
prend urie féconde pèàu.qu’bn étend fur la: première^
têfè fur tête, queue fur queue; la laine dé là fécondé
eft fur la chair de la première ; la laine de là tfor-
fieme fur la chair dé là fécondé, 8C âirifi de fuite
jufqu’à la'concurrence de dix à douze douzaines!
Quand elles font toutes étendues, comme' nous veinons
de le dire , on a à côté de foi un baquet ; il y
a dans ce baquet dé la chaux , cëtté chaux eft fondue
& délayée à la cortfiftence de celle dont les Maçons
fe fervént pour blanchir. À lofs ôn'pfènd une
peau fans laine, cette‘ peau s’appellé urt ètt/fff;. on
îaifit ce ciiiret avec là tenaille par lé milie'u'i après
l’avoir plié en plufieurs doubles ; ou oif l’attache à
l’extrémité d’un bâton, à-peu-près fous là forriiè d’un
torchon, comme on vbit Pl.duMégiJJieryfig. 1. On
plonge ce cuiret dans la chaux,' ori froté'enfuite
avec cette peau emprèignée de chaux la première
peau du tas, ce qu’on appelle enchaujfener. Il faut
que la peau foit enchauffenée par-tout, c’eft-à-dire