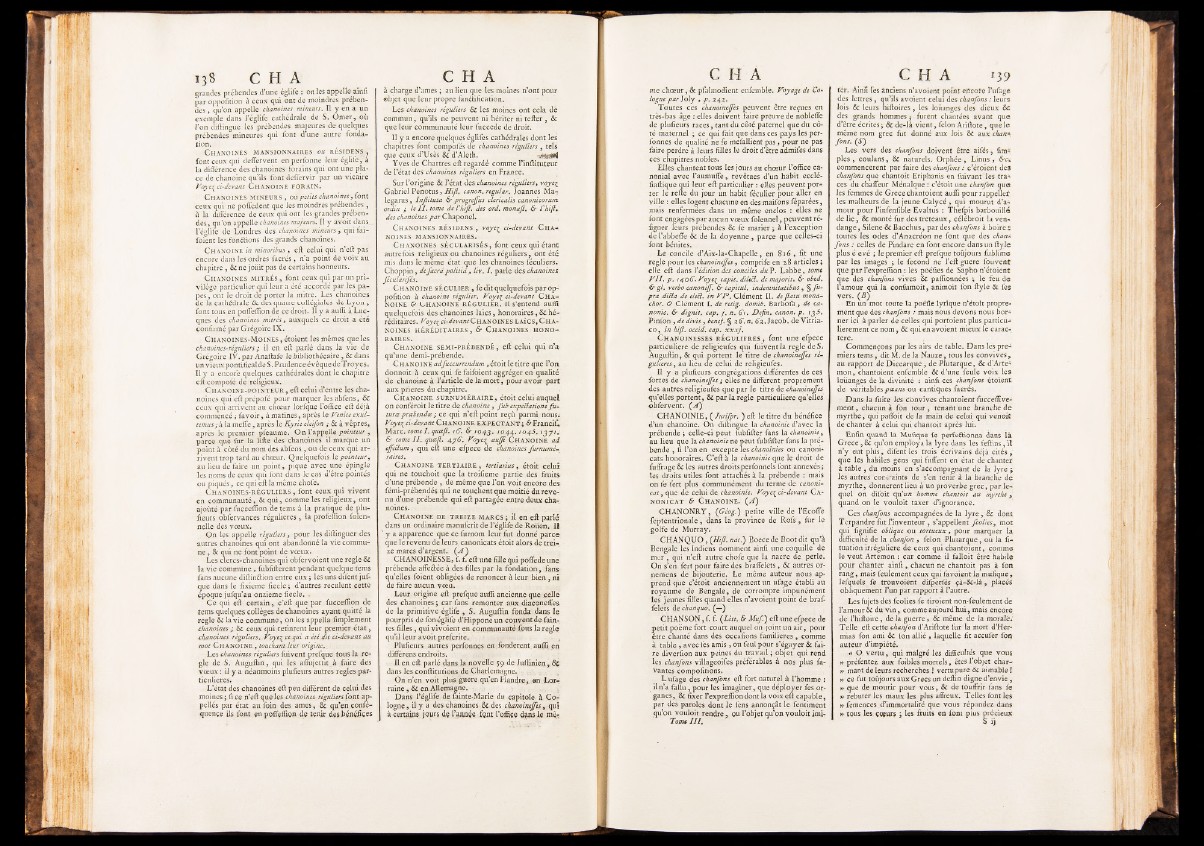
grandes prébendes d’une églife : on les appelle ainfi
par oppofition à ceux qui ont de moindres prébendes
, qu’on appelle chanoines mineurs. Il y en a un
exemple dans l’églife cathédrale de S, Orner, ou
l’on diftingue les prébendes majeures de quelques
prébendes mineures qui font d’une autre fondation.
C hanoines mansionnaires ou résidens , '
font ceux qui deffervent en perfonne leur églife, à
la différence des chanoines forains qui ont une place
de chanoine qu’ils font deffervir par un vicaire
Voye{ ci-devant CHANOINE FORAIN.
C hanoines mineurs , ou petits chanoines, font
ceux qui ne poffedent que les moindres prébendes ,
à la différence de ceux qui ont les grandes prébendes,
qu’on appelle chanoines majeurs. Il y avoit dans_,
l’églife de Londres des chanoines mineurs , qui fai-
foient les fondions des grands chanoines.
C hanoine in minoribus, eft celui qui n’eft pas
encore dans les ordres facrés , n’a point de voix au
chapitre , & ne jouit pas de certains honneurs.
C hanoines mitres , font ceux qui par un privilège
particulier qui leur a été accordé par les papes
, ont le droit de porter la mitre. Les chanoines
de la cathédrale & des quatre collégiales de Lyon ,
font tous en poffeffion de ce droit. Il y a aufli à Luc-
ques des cTianoines mitres, auxquels ce droit a été
confirmé par Grégoire IX.
C hanoines-Moines , étoient les mêmes que les
chanoines-réguliers ; il en eft parlé dans la vie de
Grégoire IV. par Anaftafe le bibliothécaire, & dans
un vieux pontifical de S. Prudence évêque de Troyes.
Il y a encore quelques cathédrales dont le chapitre
eft compofé de religieux.
C hanoine-pointeur , eft celui d’entre les chanoines
qui eft prépofé pour marquer les abfens, &
ceux qui arrivent au choeur lorfque l’office eft déjà
commencé ; favoir, à matines, après le Fmite exul-
temus; à la meffe, après le Kyrie eleifon ; & à vêpres,
après le premier pfeaume. On l’appelle pointeur ,
parce que fur la lifte des chanoines il marque un
point à côté du nom des abfens , ou de ceux qui arrivent
trop tard au choeur. Quelquefois le pointeur,
au lieu de faire un point, pique avec une épingle
les noms de ceux qui font dans le cas d’être pointés
ou piqués, ce qui eft la même chofe..
C hanoines-réguliers , font ceux qui vivent
en communauté, & qui, comme les religieux, ont
ajoûté par. fucceffion de tems à la pratique de plu-
fieurs obfervances régulières, la profefïion folen-.
nelle des voeux.
On les appelle réguliers, pour les diftinguer des.
autres chanoines qui ont abandonné la vie commun
e , & qui ne font point de voeux.
Les clercs-chanoines qui obfervoient une réglé &
la vie commiine, fublifterent pendant quelque tems
fans aucune diftinûion entre eux ; les uns difent juf-
que dans le fixieme fiecle ; d’autres reculent cette
époque jufqu’au onzième fiecle. .
Ce qui eft certain, c ’eft que par fucceffion de
tems quelques collèges de chanoines ayant quitté la
réglé 6c la vie commune, on les appella Amplement
chanoines ; 6c ceux qui retinrent leur premier, état,
chanoines réguliers. Foye^ ce,qui a été.dit ci-devant au
mot CHANOINE , touchant leur origine, .
Les chanoines réguliers fuivent prefque tous la réglé
de S. Auguftin, qui les affujettit à faire des
voeux : il y a néanmoins plufieurs autres réglés particulières.
L ’état des chanoines eft peu différent de celui des
moines ; fi ce n’eft que les chanoines réguliers font ap-
pellés par état au foin des âmes, & qu’en.confe-
qucnçe ils font en poffeffion de tenir des bénéfices
à charge d’ames ; au lieu que les moines n’ont pour
©bjet que leur propre fanéîification.
Les chanoines réguliers 6c les moines ont cela de
commun, qu’ils ne peuvent ni hériter ni tefter , &
que leur communauté leur fuccede de droit.
Il y a encore quelques églifes cathédrales dont les
chapitres font compofés de chanoines réguliers , tels
que ceux d’Usès & d’Aleth.
Yves de Chartres eft regardé comme l’inftituteuf
de i’état des chanoines réguliers en France.
Sur l’origine & l’état des chanoines réguliers, voye%
Gabriel Penotus, Hijl, canon, regular. Joannes Ma-
legarus , Inflituta & progrejfus clericalis canonicorum
ordin ; le II . tome de l'hlfl. des ord. monajl. & !hift*
des chanoines par Chaponel.
C hanoines résidens , voye^ ci-devant C hanoines
MANSIONNAIRES.- .
C hanoines s é cu la r isé s , font ceux qui étant
autrefois religieux ou chanoines réguliers, ont été
mis dans le même état que les chanoines féculiers.
Choppin, de facrâ politiâ , liv. I. parle des chanoines.
fècularifés.
C hanoine séculier , fe dit quelquefois parop-
pofition à chanoine régulier. Foyeç ci-devant CHANOINE
& C hanoine r ég u l ie r . Il s’entend auffi
quelquefois des chanoines laïcs, honoraires, & héréditaires.
Foye^ci-devantC hanoines LAÏCS,Chanoines
HÉRÉDITAIRES , & CHANOINES HONO-.
RAIRES.
C hanoine semi-prébendê , eft celui qui n’a
qu’une demi-prébende.
C hanoine adfuccurrendum, étoit le titre que l’ont
donnoit à ceux qui fe failbient aggréger en qualité
de chanoine à l’article de la mort, pour avoir part
aux prières du chapitre.
C hanoine surnum éraire, étoit celui auquel
on conféroit le titre de chanoine , fub expeclatione fu tures
prabendoe ; ce qui n’eft point reçû parmi nous*
Foye^ci-devant C hanoine e x p e c t a n t ; & Francif.
Marc, tome I. quoefl. -i G. & 1043. 10 44..1046. ijy / J
& tome I I . quoefl. 4jG . Foyeç aufji CHANOINE ad
ejfeclum , qui eft une efpece de chanoines furnumé
raires.
C hanoine t e r t ia ir e , tertiarius, étoit celui
qui ne touchoit que la troifieme partie des fruits
d’une prébende , de même que l’on voit encore des
fémi-prébendés qui ne touchent que moitié du revenu
d’une prébende qui eft partagée entre deux chanoines.
C hanoine de tr e ize m a r c s ; il en eft parlé
dans un ordinaire manuferit de l ’églife de Roiien. Il
y a apparence que ce furnom leur fut donné parce
que le revenu de leurs, canonicats étoit alors de trei-,
ze marcs d’argent. ÇA )
CHANOINESSE, f. f. eft une fille qui poffedeune
prébende affe&ée à des filles par la fondation, fans
qu’elles foient obligées de renoncer à leur bien, n ï
de faire aucun voeu.
Leur origine eft prefque auffi ancienne que .celle
des chanoines; car fans remonter aux diaconeffes
de la primitive églife , S. Auguftin fonda dans le
pourpris de fon églife d’Hippone un couvent defain-
tes filles, qui vivoient en communauté fous la réglé
qu’il leur avoit preferite. < . • ,
Plulieiirs autres perfonnes en fondèrent, auffi en
différens endroits.
Il en eft parlé dans la novelle 59 de Juftinien, 6ç
dans les conftitutions de. Charlemagne. •_ t-
On n’en voit plus guere qu’en Flandre, en Lorraine
, & en Allemagne.
Dans l’églife de fainte-Marie du capitole à Cologne
, il y a des chanoines 6c des chanoinejfes, qui
à certains jours dç l’année font l’office dans le mê.-*
me choeur, & pfalmodient enfcmble. Voyage de Cologne
par Joly , p. 242.
Toutes ces chanoinejfes peuvent être reçues en
très-bas âge : elles doivent faire preuve de nobleffe
de plufieurs races, tant du côté paternel que du côté
maternel ; ce qui fait que dans ces pays les perfonnes
de qualité ne fe mefallient pas, pour ne pas
faire perdre à leurs filles le droit d’être admifes dans
ces chapitres nobles»
Elles chantent tous les jours au choeur l’office canonial
avec l’aumuffe, revêtues d’un habit ecclé-
fiaftique qui leur eft particulier : elles peuvent por*
ter le refte du jour un habit féculier pour aller en
ville : elles logent chacune en des maifons féparées,
mais renfermées dans un même enclos : elles ne
font engagées par aucun voeux folennel, peuvent re-
figner leurs prébendes & fe marier ; à l’exception
de l’abbeffe 6c de la doyenne , parce que celles-ci
font bénites.
Le concile d’Aix-la-Chapelle, en 816 , fit une
regle pour les chanoinejfes , comprife en 28 articles ;
elle eft dans Sédition des conciles du P. Labbe, tome
V II. p. 140G. Foye£ capit. dilect. de majorité & obed.
& gl. verbo canonijf. & capital, indemnitatibus, § fu-
pra dicta de elecl. in FI°. Clément II. deflatu mona-
chor. & Clément I. de relig. domib. Barbofa, de ca-
nonic. & dignit. cap. j . n. Gu Defin. canon» p. -,
Pinfon, de divis, benef. § xG.n. Gx. Jacob, de Vitria-
c o , in hiß. occid. cap. x x x j,
C hanoinesses régulières j font une efpece
particulière de religieufes qui fuivent la regle de S»
Auguftin, & qui portent le titre de chanoinejfes régulières,
au lieu de celui de religieufes.
Il y a plufieurs congrégations différentes de ces
fortes de chanoinejfes ; elles ne different proprement
des autres religieufes que par le titre de chanoinejfes
qu’elles portent, & parla regle particulière qu’elles
©bfervent» ÇA')
CHANOINIE, ÇJurifpr. ) eft le titre du bénéfice
d’un chanoine. On diftingue la chanoinie d’avec la
prébende ; celle-ci peut lubfifter fans la chanoinie,
au lieu que la chanoinie ne peut fubfifter fans la prébende
, fi l’on en excepte les chanoinies ou canonicats
honoraires. C ’eft à la chanoinie que le droit de
fuffrage & les autres droits perfonnels font annexés ;
les droits utiles font attachés à la prébende : mais
on fe fert plus communément du terme de canoni-
cat, que de celui de, chanoinie. Fjye^ ci-devant Ca *
n o n ic a t & C hanoine. ÇA)
CHANONRY, ÇGéog.) petite ville de l’Ecoffô
feptentrionale , dans :Iâ province de Rofs , fur le
golfe de Murray.
CHANQUO, ÇJlifl. nat.) Boece de Éoot dit qu’à
Bengale les Indiens nomment ainfi une coquille de
mer , qui n’eft autre chofe que la naefe de perle.
On s’en fert pour faire des braffelëts , & autres or-
nemens de bijouterie. Le même auteur nous apprend
que c’étoit anciennement un ufage établi au
royaume de Bengale, de corrompre impunément
les jeunes filles quand elles n’avoient point de braf-
felets de chanquo. Ç—)
CHANSON, f. f. ÇLitt. & Muß) eft une efpece de
petit poème fort court auquel on joint un a ir, pour
être chanté dans des occafions familières, comme
à table , avec les amis , ou feul pour s’égayer & faire
diverfion aux peines du travail ; objet qui rend
les ckanfons villageoifes préférables à nos plus fa-
vantes compofitions,
L ufage des chanfons eft fort naturel à l’homme :
il n’a fallu, pour les imaginer, que déployer fes organes,
& fixer l’expreffiondontla voix eft capable,
par des paroles dont le fens annonçât le fentiment
qu’on vouloit rendre, ou l’objet qu’on vouloit imi-
Tome I I I ,
ter. Ainfi lès anciens n’avoient point efleofé l’ufagd
des lettres, qu’ils avoient celui des chanfons : leurs
lois & leurs niftoires, les louanges des dieux Ô£
des grands hommes ; furent chantées avant que
d’être écrites ; & de-là vient, félon Ariftote, que le
même nom grec fut donné aux lois & aux chan*
fons. ÇS)
Les vers des chanfons doivent êtré aifés, fimf
pies , coulans, & naturels. Orphée , Linus, &cx
commencèrent par faire des chanfons : c’étoient des
chanfons que chantoit Eriphanis en füivant les traces
du chafleur Ménalque : c’étbit une chanfon que
les femmes de Grece chantoient auffi pour rappelle^,
les malheurs de la jeune Calycé , qui mourut d’amour
pour l’infenfible Evaltus : Thefpis barbouillé
de lie ; & monté fur des tréteaux, célébroit la vendange
, Silene & Bacchus ; par des chanfons à boire s
toutes les odes d’Anacréon ne font que des chan*
fons : celles de Pindare en font encore dans un ftyle
plus é evé ; le premier eft prefque toujours fublime
par les images ; le fécond ne l’eft guere fou vent
que par l’expreffiôn : les poéfies de Sapho n’étoient
que des chanfons vives 8c paffionnées ; le feu de
l’amour qui la confumoit, animoit fon ftyle & fes
vers. ÇB)
En un mot toute la poéfie lyrique n*étoit proprement
que des chanfons : mais nous devons nous bor*
ner ici à parler de celles qui portoient plus particu-»
lierement ce nom, & qui en avoient mieux le caractère.
Commençons par les airs de table. Dans les preJ
miers tems, dit M. de la Nauze, tous les convives,
au rapport deDicearque ; de Plutarque, & d’Arte-
mon, chantoient enfemble & d’une feule voix les
louanges de la divinité : ainfi ces chanfons étoient
de véritables poeans ou cantiques facrés.
Dans la fuite Ids eonvives chantoient fucceffive-
ment, chacun à fon tour, tenant une branche de
myrthe, qui paffoit de la main de celui qui venoit
de chanter à celui qui chantoit après lui»
Enfin quand la Mufique fe përfeftionna dans là
G re ce, St qu’on employa la lyre dans les feftins, il
il’y eut plus, difénties trois écrivains déjà c ité s,
que les habiles gens qui fuffent en état de chanter
à table , du moins en s’accompagnant de la lyre ;
les autres contrainte de s’eri tenir à la branche de
myrthe, donnèrent lieii à un proverbe grec, par lequel
On difoit qu’«« ho/hme chantoit àti myrthe,
quand on le vouloit taxer d’ignorance.
Ces chanfons accompagnées de la ly r e , & dont
Terpandre fut l’inventeur , s’appellent f olies, mot
qui fignifie oblique ou tortueux, pour marquer la
difficulté de la chanfon , félon Plutarque, ou la fi-
tuation irrégulière de ceux qui chantoient, comme
ie veut Artemon : car comme il falloit être habile
pour chanter ainfi, chacun ne chantoit pas à fon
rang, mais feulement ceux qui favôient la mufique,
lefquels fe trouvoient difperfés çà -& - là , placés
obliquement l’un par rapport a l’autre.
Les füjets des feolics fe tiroient non-feulement de
l’amour & du v in , comme aujourd'hui, mais encore
de l’hiftoire, de la guerre * & même de la morale*
Telle eft cette chanfon d’Ariftote fur la mort d’Her-
mias fon ami & fon allié , laquelle fit accufer fon
auteur d’impiété.
« O. vertu, qui malgré les difficultés que vous
» préfentez aux foibles mortels, êtes l’objet char-
» mant de leurs recherches î vertu pure 6c aimable!
» ce fut toûjours aux Grecs un deftin digne d’envie ,
» que de mourir pour vous ; & de lbufirir fans le
» rebuter les maux les plus affreux. Telles font les
» femences d’immortalité que vous répandez dans
» tous les coeurs ; les fruits en font plus précieux