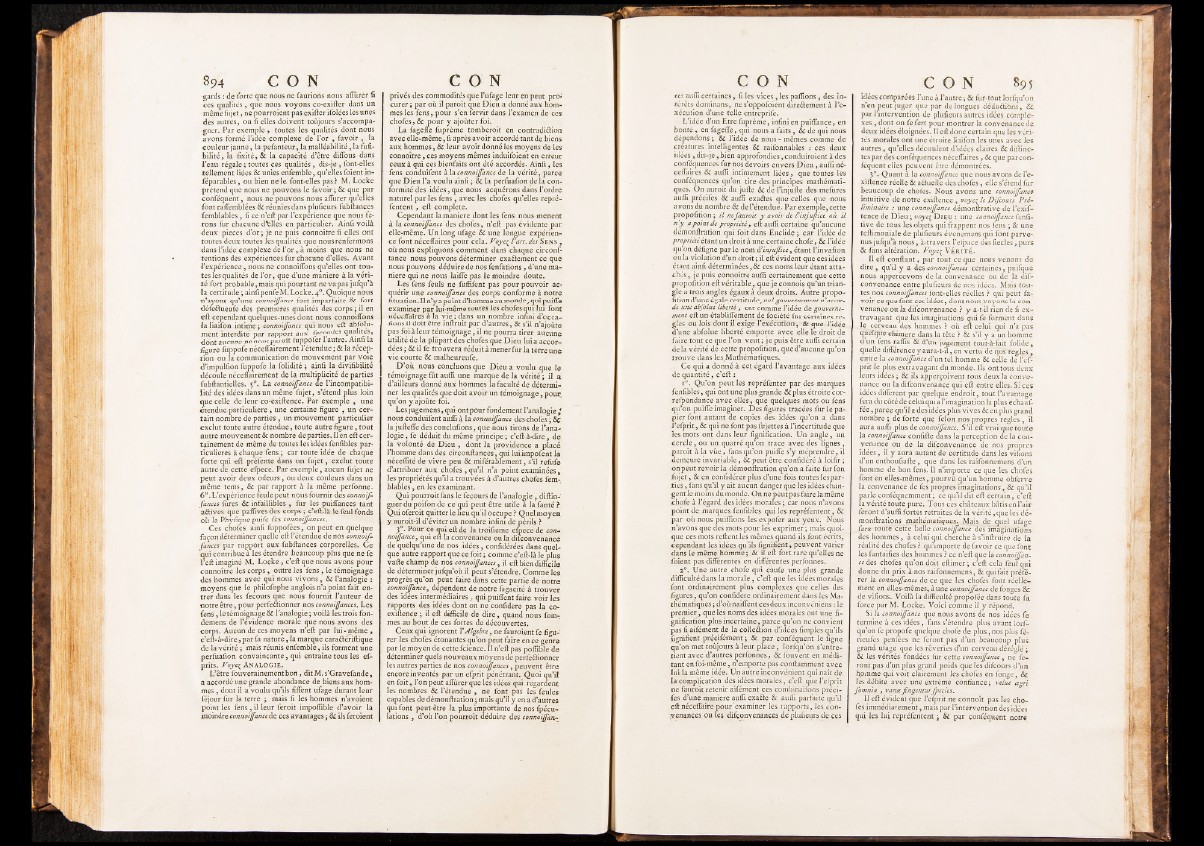
gards : de forte que nous ne faurions nous aflurer fi
ces qualités, que nous voyons co-exifter dans un
même fujet, ne pourroient pas exifter ifolées les unes
des autres, ou fi elles doivent toujours s’accompagner.
Par exemple, toutes les qualités dont nous
avons formé l ’idée complexe de l’or , favoir , la
couleur jaune, la pefanteur, la malléabilité, la fufi-
bilité, la fixité, & la capacité d’être diffous dans
l ’eau régale ; toutes ces qualités, dis-je, font-elles
tellement liées & unies enfemble, qu’elles foient in-
féparables, ou bien ne le font-elles pas? M. Locke
prétend que nous ne pouvons le favoir ; & que par
conféquent, nous ne pouvons nous aflurer qu’elles
font raffemblées & réunies dans plufieurs fubftances
femblables , fi ce n’eft par l’expérience que nous ferons
fur chacune d’ëlles en particulier. Ainfi voilà
deux pièces d’or ; je ne puis connoître fi elles ont
toutes deux toutes les qualités que nous renfermons
dans l’idée complexe de l’o r , à moins que nous ne
tentions des expériences fur chacune d’elles. Avant
l ’expérience, nous ne connoiffons qu’elles ont toutes
les qualités de l’or, que d’une maniéré à la vérité
fort probable, mais qui pourtant ne va pas jufqu’à
la certitude ; ainfipenfe M. Locke. 40. Quoique nous
m’ayons qu’une connoijfance fort imparfaite & fort
défeftueufe des premières qualités des corps ; il en
eft cependant quelques-unes dont nous connoiffons
la liaifon intime ; connoijfance qui nous eft âbfolu-
ment interdite par rapport aux fernndes quahtes,
dont aucune ne non« paxolt iuppoler 1 autre. Ainfi la
figure fuppofe néceffairement l’étendue ; & la réception
ou la communication de mouvement par voie
d’impulfion fuppofe la folidité ; ainfi la divifibilité
découle néceffairement de la multiplicité de parties
fubftantielles. 50. La connoijfance de l’incompatibilité
des idées dans un même fujet, s’étend plus loin
que celle de leur co-exiftence. Par exemple , une
etendue particulière, une certaine figure , un certain
nombre de parties , un mouvement particulier
exclut toute autre étendue, toute autre figure, tout
autre mouvement & nombre départies. lien eft certainement
de même de toutes les idées fenfibles particulières
à chaque'fens ; car toute idée de chaque
forte qui eft préfente dans un fujet, exclut toute
autre de cette efpece. Par exemple, aucun fujet ne
peut avoir deux odeurs, ou deux couleurs dans un
même tems, & par rapport à la même perfonne.
6°. L’expérience feule peut nous fournir des connoif-
fances fûres & infaillibles , fur les puiffances tant
aftives que pafïives des corps ; c’eft-là le feul fonds
oii la Phyfique puiCe fes connoijfances.
Ces chofes ainfi fuppofées, on peut en quelque
façon déterminer quelle eft l’étendue de nos connoif-
fances par rapport aux fubftances corporelles. Ce
qui conrribue à les étendre beaucoup plus que ne fe
l ’eft imaginé M. Locke, c’eft que nous avons pour
connoître les corps, outre les fens, le témoignage
des hommes avec qui nous vivons, & l’analogie :
moyens que le philofophe anglois n’a point fait entrer
dans les fecours que nous fournit l’auteur de
notre être, pour perfectionner nos connoiffances, Les
fens, le témoignage & l’analogie ; voilà les trois fon-
demens de l’évidence morale que nous avons des
corps. Aucun de ces moyens n’eft par lui - même ,
c’eft-à-dire, par fa nature, la marque cara&ériftique
de la vérité ; mais réunis enfemble, ils forment une
perfuafion convaincante, qui entraîne tous les ef-
prits. Voye{ A n a l o g i e .
L’être fouverainementbon, dit M.‘ s’Gravefande,
a accordé une grande abondance de biens aux hommes
, dont il a voulu qu’ils fiffent ufage durant leur
féjour fur la terre ; mais fi les hommes n’avoient
point les fens, il leur feroit impofllble d’avoir la
moindre connoijfance de ces avantages ; & ils feroient
privés des commodités que l’ufage leur en peut pro»'
curer ; par où il paroît que Dieu a donné aux hommes
les fens, pour s’en fervir dans l’examen de ces
chofes, & pour y ajouter foi.
La fageffe fuprème tomberoit en contradiction
avec elle-même, fi après avoir accordé tant de biens
aux hommes, & leur avoir donné les moyens de les
connoître, ces moyens mêmes induifoient en erreur
ceux à qui ces bienfaits ont été accordés. Ainfi, les
fens conduifent à la connoijfance de la vérité, parce
que Dieu l’a voulu ainfi ; & la perfuafion de la conformité
des idées, que nous acquérons dans l’ordre
naturel par les fens , avec les chofes qu’elles repré-
fentent, eft complété.
Cependant la maniéré dont les fens nous mènent
à la connoijfance des chofes, n’eft pas évidente par
elle-même. Un long ufage &c une longue expérience
font néceffaires pour cela. Voye{ l'art, des Sens ,
où nous expliquons comment dans chaque circonf-
tance nous pouvons déterminer exactement ce que
nous pouvons déduire de nos fenfations , d’une maniéré
qui ne nous laiffe pas le moindre doute.
Les fens feuls ne fuffifent pas pour pouvoir acquérir
une connoijfance des corps conforme à notre
fituation. Il n’y a point d’homme au monde, qui puiffe
examiner par lui-même toutes les chofes qui lui font
néccflaires à la vie ; dans un nombre infini d’occa-
iîons il doit être inftruit par d’autres, & s’il n’ajoûte
pas foi à leur témoignage, il ne pourra tirer aucune
utilité de la plupart des chofes que D ieu lui a accordées
; & il fe trouvera réduit à mener fur la terre une
vie courte & malheureufe.
D ’o\i nous concluons que Dieu a voulu que le
témoignage fût aufli une marque de la vérité ; il a
d’ailleurs donné aux hommes la faculté de détermi-,
ner les qualités que doit avoir un témoignage, pour,
qu’on y ajoute foi.
Les jugemens, qui ont pour fondement l’analogie ^
nous conduifent aufli à la connoijfance des chofes ; &C
la jufteffe des conelufions, que nous tirons de l’analogie
, fe déduit du même principe ; c’eft- à-dire, de
la volonté de Dieu , dont la providence a placé
l’homme dans des circonftances, qui luiimpofent la
néceflité de vivre peu & miférablement, s’il refufe
d’attribuer aux chofes , qu’il n’a point examinées ,
les propriétés qu’il a trouvées à d’autres chofes femblables
, en les examinant.
Qui pourroitfans le fecours de l’analogie, diftin-
guer du poifon de ce qui peut être utile à la fanté ?
Qui oferoit quitter le lieu qu’il occupe ? Quel moyen
y auroit-il d’éviter un nombre infini de périls ?
3°- Pour ce qui eft de la troifieme efpece de c<wz-
noiJfance9 qui eft la convenance ou la difconvenancô
de quelqu’une de nos idées, confidérées dans quelque
autre rapport que ce foit ; comme c’eft-là le plus
vafte champ de nos connoijf ances, il eft bien difficile
de déterminer jufqu’où il peut s’étendre. Comme les
progrès qu’on peut faire dans cette partie de notre
connoijfance, dépendent de notre fagacité à trouver
des idées intermédiaires, qui puiffent faire voir les
rapports des idées dont on ne confidere pas la co-
exiftence ; il eft difficile de dire, quand nous femmes
au bout de ces fortes de découvertes.
Ceux qui ignorent Y Algèbre, ne fauroient fe figurer
les chofes étonantes qu’on peut faire en ce genre
par le moyen de cette fcience. Il n’eft pas poflïble de
déterminer quels nouveaux moyens de perfeélionner
les autres parties de nos connoijfances, peuvent être
encore inventés par un efprit pénétrant. Quoi qu’il
en foit, l’on peut aflurer que les idées qui regardent
les nombres & l’étendue , ne font pas les feules
capables de démonftration ; mais qu’il y en a d’autres
qui font peut-être la plus importante de nos fpécu-
lations , d’où l’on pourroit déduire des connoijfan-
B ü H h H h H
C O N
ces aufli certaines, fi les v ice s, les paflions, des intérêts
dominans, ne s’oppofoient dire&ement à l ’exécution
d’une telle entreprife.
L’idée d’un Etre fuprème, infini en puiffance, en
bonté , en fageffe, qui nous a faits, Sc de qui nous
dépendons ; & l’idée de nous - mêmes comme de
créatures intelligentes & raifonnables : ces deux
idées , dis-je, bien approfondies, conduiroient à des
conféquences fur nos devoirs envers D ieu , aufli néceffaires
& aufli intimement liées , que toutes les
conféquences qu’on tire des principes mathématiques.
On auroit du jufte & de l’injufte des mefures
aufli précifes & aufli exa&es que celles que nous
avons du nombre & de l’étendue. Par exemple, cette
propofition ; il ne fauroit y avoir de l'injujlice ou il
n'y a point de propriété, eft aufli certaine qu’aucune
démonftration qui foit dans Euclide ; car l’idée de
propriété étant un droit à une certaine chofe, & l’idée
qu’on défigne par le nom à'injujiice, étant l’invafion
ou la violation d’un droit ; il eft évident que ces idées
étant ainfi déterminées, & ces noms leur étant attachés
, je puis connoître aufli certainement que cette
propofition eft véritable, que je connois qu’un triangle
a trois angles égaux à deux droits. Autre propofition
d’une égale certitude, nul gouvernement n'accorde
une abfolue liberté , car comme l’idée de gouvernement
eft un établiffement de fociété fui certaines réglés
ou lois dont il exige l’exécution, & que l’idée
d’une abfolue liberté emporte avec elle le droit de
faire tout ce que l’on veut; je puis être aufli certain
delà vérité de cette propofition, que d’aucune qu’on
trouve dans les.Mathématiques.
Ce qui a donné à cet égard l’avantage aux idées
de quantité, c’eft :
i° . Qu’on peut les repréfenter par des marques
fenfibles, qui ont une plus grande & plus étroite cor-
refpondance avec elles, que quelques mots ou fens
qu’on puiffe imaginer. Des figures tracées fur le papier
font autant de copies des idées qu’on a dans
l ’efprit, & qui ne font pas fujettes à l’incertitude que
les mots ont dans leur lignification. Un angle, un
ce rcle, ou un quarré qu’on trace avec des lignes ,
paroît à la vu e , fans qu’on puiffe s’y méprendre, il
demeure invariable, & peut être confidéré à loifir ;
on peut revoir la démonftration qu’on a faite fur fon
fujet, & en confidérer plus d’une fois toutes les parties
, fans qu’il y ait aucun danger que les idées changent
le moins du monde. On ne peut pas faire la même
chofe à l’égard des idées morales ; car nous n’avons
point de marques fenfibles qui les repréfentent., &
par où nous puiflions les expofer aux yeux. Nous
n’avons que des mots pour les exprimer ; mais quoique
ces mots relient les mêmes quand ils,font écrits,
cependant les idées qu’ils fignifient, peuvent varier
dans le même homme ; & il eft fort rare qu’elles ne
foient pas différentes en différentes perfonnes.
20. Une autre chofe qui càufe une plus grande
difficulté dans la morale, c’eft que les idées morales
font ordinairement plus complexes que celles des
figures, qu’on confidere ordinairement dans les Mathématiques
; d’oùnaiffent ces deux inconvéniens : le
premier, que les noms des idées morales ont une lignification
plus incertaine, parce qu’on ne convient
pas fi aifément de la collection d’idées fimples qu’ils
lignifient prçcifément ; & par conféquent le ligne
qu’on met toujours à leur place, lorfqu’on s’entre-
tient avec d’autres perfonnes, & fouyent en méditant
en fobmême, n’emporte pas conftamment avec
lui la même idée. Un autre inconvénient qui naît de
la complication des idées morales, c’eft que l’efprit
ne fauroit retenir aifément ces combinaifons précifes
d’une maniéré aufli exafte & aufli parfaite qu’il
eft néceffaire pour examiner les rapports, les contenances
ou les difçonvenances de plufieurs de ces
idées comparées l’une à l’autre; & fur-tout lorfqu’on
n’en peut juger que par de longues dédudibns, &
par l’intervention de plufieurs autres idées complexes
, dont on fe fort pour montrer la convenance de
deux idées éloignées. Il eft donc certain que les vérités
morales ont une étroite liaifon les unes avec les
autres, qu’elles découlent d’idées claires & diftinc-
tes par des conféquences néceffaires, & que par conféquent
elles peuvent être démontrées.
3°. Quant à la connoijfance que nous avons de l’e-
, xiftence réelle & aétuelle des chofes, elle s’étend fur
beaucoup de chofes. Nous avons une connoijfance
intuitive de notre exiftence , voyez le Difcours Préliminaire
: une connoijfance clémonftrative de l’exif-
tence de Dieu; voyeç Dieu : une connoijfance fonfi-
tive de tous les objets qui frappent nos fens ; & une
teftimoniale de plufieurs évenemens qui font parvenus
jufqu’à nous, à-travers l’efpace des fiecles, purs
& fans altération. Voye{ Vérité.
Il eft confiant, par tout ce que nous venons de
dire , qu’il y a des connoijfances certaines, puifque
nous appercevons de la convenance ou de la dif—
; convenance entre plufieurs de nos idées. Mais toutes
nos connoijfances font-elles réelles } qui peut favoir
ce que font ces idées, dont nous.voyons la convenance
ou la difconvenance ? y a-t-il rien de fi extravagant
que les imaginations qui fe forment dans
» iL,cer-veau. des hommes ? où eft celui qui n’a pas
quelque chimere dans la tête ? Sc s’il y a un homme
d un fens raffïs & d^un jugement tout-à-fait folide,
quelle différence y aura-t-il, en vertu de nos regies ,
entre la connoijfance d’un tel homme & celle de l’ef-
prit le plus extravagant du monde. Ils ont tous deux
leurs idées ; & ils apperçoivent tous deux la convenance
ou la difconvenance qui eft entre elles. Si ces
idées different par quelque endroit, tout l’avantage
fera du côté de celui qui a l’imagination la plus échauffée
, parce qu’il a des idées plus vives & en plus grand
nombre ; de forte que félon nos propres regies , il
aura aufli plus de connoijfance. S ’il eft vrai que toute
la connoijfance confifte dans la perception de la convenance
ou de la difconvenance de nos propres
idées, il y aura autant de certitude dans les vifions
d’un enthoufiafte , que dans les raifonnemens d’un
homme de bon fens. Il n’importe ce que les chofes
font en elles-mêmes , pourvu qu’un homme obferve
la convenance de fes propres imaginations, & qu’il
parle conféquemment ; ce qu’il dit eft certain, c’efl:
la vérité toute pure. Tous ces châteaux bâtis en l’air
feront d’aufli fortes retraites de la v érité, que les dé-
monftrations mathématiques. Maisjde quel ufage
fera toute cette belle connoijfance déTïmaginations
des hommes, à celui qui cherche à s’inftruire de la
réalité des chofes ? qu’importe de favoir ce que font
les fantaifies des hommes ? ce n’eft que la connoijfance
des chofes qu’on doit eftimer ; c’eft cela foui qui
donne du prix àmos raifonnemens, & qui fait préférer
la connoijfance de ce que les chofes font réelle-
rùent en elles-mêmes, à une connoijfance de fonges &
de vifions. Voilà la difficulté propofée dans toute fa
' force par M. Locke. Voici comme il y répond.
Si la connoijfance que nous avons de nos idées fe
termine à ces idées, fans s’étendre plus avant lorfqu’on
fe propofe quelque chofe de plus, nos plus fé-
rieufes penfées ne feront pas d’un beaucoup plus
grand ufage que les rêveries d’un cerveau déréglé ;
& les vérités fondées fur cette connoijfance , ne feront
pas d’un plus grand poids que les difcours d’un
hpmme qui voit clairement les chofes en fonge, &
les débite avec une extrême confiance; velut oegri
fomnia , vance Jingentur fpecies.
Il eft évident que l’efprit ne connoît pas les cho-
fos immédiatement, mais par l’intervention des idées
qui les lui repréfentent ; & par conféquent notre