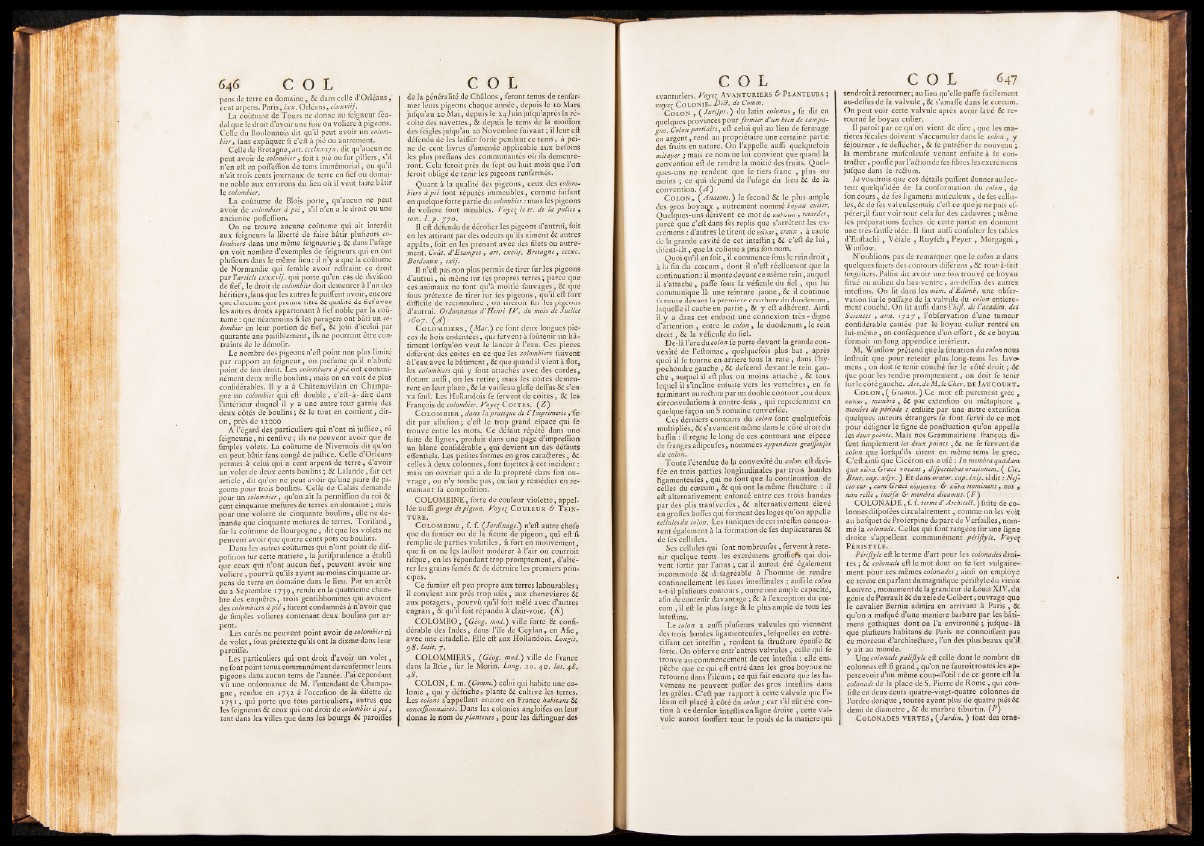
646 C O L
pens de terre en domaine, 6c dans celle d’Orléans ,v
cent arpens. Paris, Ixx. O rléans, clxxviij.
La coutume de Tours ne donne au feigneur féodal
que le droit d’avoir une fuie ou voliere à pigeons.
Celle du Boulonnois dit qu’il peut avoir un colombier,
fans expliquer fi c’eft à pié ou autrement.
Celle de Bretagne, art. ccclxxxjx. dit qu’aucun ne
peut avoir de colombier, foit à pié ou fur piliers, s’il
n’en eft en poffeffion de tems immémorial, ou qu’il
n’ait trois cents journaux de terre en fief ou domaine
noble aux environs du lieu où il veut faire bâtir
le colombier.
L a coûtume de Blois po rte , qu’aucun ne peut
avoir de colombier à pié, s’il n’en a le droit ou une
ancienne poffeffion.
On ne trouve aucune coûtume qui ait interdit
aux feigneurs la liberté de faire bâtir plufieurs colombiers
dans une même feigneurie ; 6c dans l’ufage
on voit nombre d’exemples de feigneurs qui en ont
plufieurs dans le même lieu : il n’y a que la coûtume
de Normandie qui femble avoir reftraint ce droit
p ar Y article cxxxvij. qui porte qu’en cas de divifion
de fief, le droit de colombier doit demeurer à l’un des
héritiers,fans que les autres le puiffent avoir, encore
que chacune part prenne titre 6c qualité de fief avec
les autres droits appartenant à fief noble par la coûtume
: que néanmoins fi les paragers ont bâti un colombier
en leur portion de n e f, 6c joui d’icelui par
quarante ans paifiblement, ils ne pourront être contraints
de le démolir.
L e nombre des pigeons n’eft point non plus limité
par rapport au feigneur, on préfume qu’il n’abufe
point de fon droit. Les colombiers à pié ont communément
deux mille boulins ; mais on en voit de plus
confidérables. Il y a à Châteauvilain en Champagne
un colombier qui eft double, c’eft-à-dire dans
l’intérieur duquel il y a une autre tour garnie des
deux côtés de boulins; 6c le tout en contient, dit-
on , près de 12000
A l’égard des particuliers qui n’ont ni juftice, ni
feigneurie, ni cenfive ; ils ne peuvent avoir que de
fimples volets. La coûtume de Nivernois dit qu’on
en peut bâtir fans congé de juftice. Celle d’Orléans
permet à celui qui a cent arpens de te rre , d’avoir
un volet de deux cents boulins ; & Lalande, fur cet
article, dit qu’on ne peut avoir qu’une paire de pigeons
pour trois boulins. Celle de Calais demande
pour un colombier, qu’on ait la permiflion du roi 6c
cent cinquante mefures de terres en domaine ; mais
pour une voliere de cinquante boulins, elle ne demande
que cinquante mefures de terres. Torifan d,
fur la coûtume de Bourgogne, dit que les volets ne
peuvent avoir que quatre cents pots ou boulins.
Dans les autres coûtumes qui n’ont point de dif-
pofition fur cette matière, la jurifprudence a établi
que ceux qui n’ont aucun fie f, peuvent avoir une
v o lie re , pourvû qu’ils ayent au moins cinquante arpens
de terre en domaine dans le lieu. Par un arrêt
du 2 Septembre 1739 > rendu en la quatrième chambre
des enquêtes, trois gentilshommes qui avoient
des colombiers à pié , furent condamnés à n’avoir que
de fimples volières contenant deux boulins par ar-
pent.
Les curés ne peuvent point avoir de colombier ni
de v o le t, fous prétexte qu’ils ont la dixme dans leur
paroiffe.
Les particuliers qui ont droit d’avoir un v o le t,
ne font point tenus communément de renfermer leurs
pigeons dans aucun tems de l’année. J ’ai cependant
v û une ordonnance de M. l’intendant de Champag
n e , rendue en 1752 à l’occafion de la difette de
1 7 5 1 , qui porte que tous particuliers, autres que
les feigneurs & ceux qui ont droit de colombier à pié ,
tant dans les villes que dans les bourgs & paroiffes
C O L
de la généralité de Châlons, feront tenus de renfermer
leurs pigeons chaque année, depuis le 10 Mars
jufqu’au 20 Ma i, depuis le 24 Juin jufqu’àprès la récolte
des navettes, & depuis le tems de la moiffon
des feigles jufqu’au 20 Novembre fuivant ; il leur eft
défendu de les laiffer fortir pendant ce tems, à peine
de cent livres d’amende applicable aux befoins
les plus preffans des communautés où ils demeureront.
Cela feroit près de fept ou huit mois que l’on
feroit obligé de tenir les pigeons renfermés.
Quant à la qualité des pigeons, ceux des colombiers
à pié font réputés immeubles, comme faifant
en quelque forte partie du colombier; mais les pigeons
de voliere font meubles. Voye^ le tr. de la police ,
tom. I. p. 770'. '
Il eft défendu de dérober les pigeons d’autrui, foit
en les attirant par des odeurs qu’ils aiment 6c autres
appâts, foit en les prenant avec des filets ou autrement.
Coût. d’Etampes , art. cxciij. Bretagne , cccxc.
Bordeaux, cxij.
Il n’eft pas non plus permis de tirer fur les pigeons
d’autrui, ni même fur fes propres terres ; parce que
ces. animaux ne font qu’à moitié fau v ag e s, 6c que
fous prétexte de tirer lur fes pigeons, qu’il eft fort
difficile de reconnoître , on tireroit fur les pigeons
d’autrui. Ordonnance d’Henri IF. du mois de Juillet
160y. (A)
Colombiers , (Mar.) ce font deux longues pièces
de bois endentées, qui fervent à foûtenir un bâtiment
lorfqu’on veut le lancer à l’eau. Ces pièces
different des coites en ce que les colombiers fuivent
à l’eau avec le bâtiment, 6c que quand il vient à flot,
les colombiers qui y font attachés avec des cordes,
flotant aufli, on les retire ; mais les coites demeurent
en leur p lace , 6c le vaiffeau gliffe deffus 6c s’en
v a feul. Les Hollandois fe fervent de coite s, 6c les
François de colombier. Voye[ C oites. (Z )
COLOMBIER, dans la pratique de l'Imprimerie , "fe
dit par allufion ; c’eft le trop grand efpace qui fe
trouve entre les mots. Ce défaut répété dans une'
fuite de lignes, produit dans une page d’impreffion
un blanc confidérable, qui devient un des défauts
effentiels. Les petites formes en gros caratteres, &:
celles à deux colonnes, font fujettes à cet incident :
mais un ouvrier qui a de la propreté dans fon ouvrage
, ou n’y tombe pas, ou fait y remédier en remaniant
fa compofition.
COLOMBINE, forte de couleur v iolette, appel-
lée aufli gorge de pigeon. Voye^ Couleur & T einture.
COLOMBINE, f. f. ([Jardinage.) n’eft autre chofe
que du fumier ou de la fiente de pigeon, qui eft fi
remplie de parties volatiles, fi fort en mouvement,
que fi on ne les laiffoit modérer à l’air on courroit
rifque, en les répandant trop promptement, d’altérer
les grains femés 6c de détruire les premiers principes.
Ce fumier eft peu propre aux terres labourables ;
il convient aux prés trop ufés ; aux chenevieres &
aux potagers, pourvû qu’il foit mêlé avec d’autres
engrais, & qu’il foit répandu à clair-voie. (A )
COLOMBO, (Géog. mod.) ville forte 6c confidérable
des Indes, dans l’île de C eylan ,. en Afie,
avec une citadelle. Elle eft aux Hollandois. Longit.
c)8. latit. 7 .
COLOMMIERS, {Géog. mod.) ville de France
dans la B rie , fur le Morin. Long. 20. 4 0 . lat. 48.
4^’ V
COLO N , f. m. {Comm.y celui qui habite une colonie
, qui y défriche, plante 6c cultive les terres.
Les colons s’appellent encore en France habitans 6c
concejjionnaires. Dans les colonies angloifes on leur
donne le ilom de planteurs , pour les diftinguer des
C O L
avanturiers. Voye1 Avanturiers & PLANTEURS ;
voyei Colonie. Dict. de Comm.
C olon , ( Jurijpr. ) du latin colonus , fe dit en
quelques provinces pour fermier d’un bien de campagne.
Colon partiaire, eft celui qui au lieu de fermage
en argent, rend au propriétaire une certaine partie
des fruits en nature. On l’appelle aufli quelquefois
métayer ; mais ce nom ne lui convient que quand la
convention eft de rendre la moitié des fruits. Quelques
uns ne rendent que le tiers franc , plus ou
moins ; ce qui dépend de l’ufage du lieu 6c de la
convention. (A )
C olon, ( Anatom.) le fécond & le plus .ample
des gros boyaux , autrement nommé boyau culier.
Quelques-uns dérivent ce mot de Kuhltm , retarder,
parce que c’eft dans fes replis que s’arrêtent les ex-
crémens : d’autres le tirent de ^o/Xot», creux , à caulè
de la grande cavité de cet inteftin ; 6c c ’eft de lu i ,
difent-ils, que la colique a pris fon nom.
Quoi qu’il en foit, il commence fous le rein d ro it,
à la fin du cæ cum , dont il n’eft réellement que la
continuation : il monte devant ce même rein, auquel
il s’attache, paffe fous la véficule du f i e l , qui lui
communique là une teinture jaune, 6c il continue
fa route devant la première courbure du duodénum,
laquelle il cache en partie, & y eft adhérent. Ainfi
il y a dans cet endroit une connexion très - digne
d’attention , entre le colon, le duodénum, le rein
d r o it , 6c la véficule du fiel.
De-là l’arc du colon fe porte devant la grande convexité
de l’eftomac, quelquefois plus bas , après
quoi il fe tourne en-arnere fous la rate , dans l’hy-
pochondre gauche , 6c defcend devant le rein gauche
, auquel il eft plus ou moins attaché , 6c fous
lequel il s’incline enfuite vers les vertebres, en fe
terminant au reéhim par un double contour, ou deux
circonvolutions à contre-fens , qui repréfentent en
quelque façon un S romaine renverfée.
Ces derniers contours du colon font quelquefois
multipliés, 6c s’avancent même dans le côté droit du
baffin : il régné le long de ces contours une efpece
de franges adipeufes, nommées appendices graiffeufes
du colon. .
Toute l’étendue de 1r convexité du colon eft divi-
féè en trois parties longitudinales par trois bandes
Kgamenteufes , qui ne font que la continuation de
celles du cæcum , & qui ont la même ftruéhire : il
eft alternativement enfoncé entre ces trois bandes
par des plis tranfverfes , 6c alternativement élevé
en groffes boffes qui forment des loges qu’on appelle
cellules du colon. Les tuniques de cet inteftin concourent
également à la formation de fes duplicatures 6c
de fes cellules.
Ses cellules qui font nombreufes , fervent à retenir
quelque tems les excrémens groflieft qui doivent
fortir par l’anus ; car il auroit été également
incommode 6c de l'agréable à l’homme de rendre
continuellement les feces inteftinales : aufli le colon
a-t-il plufieurs contours , outre une ample capacité,
afin de contenir davantage ; 6c à l’exception du cæ cum
, il eft le plus large & le plus ample de tous les
inteftins.
Le colon a aufli plufieurs valvules qui viennent
des trois bandes ligamenteufes, lefquelles en retré-
ciffant cet inteftin , rendent fa ftruélure épaiffe &
forte. On obferve entr’ autres v a lvu le s, celle qui fe
trouve au commencement de cet inteftin : elle empêche
que ce qui eft entré dans les gros boyaux ne
retourne dans l’iléum ; ce qui fait encore que les la-
vemens ne peuvent paffer des gros inteftins dans
les grêles. C ’eft par rapport à cette v alvule que l’iléum
eft placé à côté du colon ; car s’il eût été continu
à ce dernier inteftin en ligne droite , cette vai-
yule auroit fouffert tout le poids de la matière qui
C O L 6 4 7
tendroît à retourner; au lieu qu’elle paffe facilement
au-deffus de la valvule , & s’amaffe dans le cæcum.
On peut voir cette valvule après avoir lavé & retourné
le boyau culier.
Il paroît par ce qu’on vient de dire , que les matières
fécales doivent s’accumuler dans le colon , y
féjourner , fe deffécher, & fe putréfier de nouveau ;
la membrane mufculeufe venant enfuite à le con-
traéler, pouffe par l’aétion de fes fibres les excrémens
jufque dans le reâu m.
Je voudrois que ces détails puffent donner au lecteur
quelqu’idée de la conformation du colon, de
fon c ou rs, de fes ligamens mufculeux, de fes cellules,
6c de fes valvules:mais c’eft ce que je ne puis ef-
pérer;il faut voir tout cela fur des cadavres ; même
les préparations feches de cette partie en donnent
une très-faufle idée. Il faut aufli confultcr les tables
d’Euftachi , Véfale , R u y fch , Peyer , Morgagni,
'Wïnflow.
N’oublions pas de remarquer que le colon a dans
quelques fujets des contours différens , 6c tout-à-fait
finguliers. Palfin dit avoir une fois trouvé ce boyau
fitué au milieu du bas-ventre, au-deffus des autres
inteftins. On lit dans les mém. d’Edimb. une obfer-
vation fur le paffage de la valvule du colon entièrement
couché. On lit aufli dans Yhijl. de l’académ. des
Sciences , ann. r j2 j ,. l’obfervation d’une tumeur
confidérable caulée par le boyau culier rentré en
lui-même, en conféquence d’un effort, 6c ce boyau
formoit un long appendice intérieur. .
M. Winflow prétend que la fituation du colon nous
inftruit que pour retenir plus long-tems les lave*
mens , on doit fe tenir couché fur le côté droit ; 6c
que pour les rendre promptement, on doit fe tenir
fur le côté gauche. Art.deM.leChev. de Jaucourt,
Colon , ( Gramm. ) C e mot eft purement grec ,
KuXm,: membre , 6c par extenfion ou métaphore ,
membre de période : enfuite par une autre extenfion
quelques auteurs étrangers fe font fervi de ce mot
pour défigner le ligne de ponéhiation qu’on appelle
les deux points. Mais nos Grammairiens françois di-
fent fimplement les deux points , 6c ne fe fervent ;de
colon que lorfqu’ils .citent en même tems le grec.
C ’eft ainfi que Cicéron en au fé : In-membra quadam
quce nuXa. Graci vocant , difpertiebat orationem. f Cic.
Brut. cap. xljv. ) E td ans orator. cap. Ixij.. il.dk : Jtfef-
cio cur , cum Graci KoppueraL & kuKcl nominent, nos ,
non reclé , incifa & membra dicamus. ( F )
CO LO N A D E , f. f. terme d’Architecl. ) fuite de colonnes
difpolées circulairement, comme on les voit
au bofquet de Proferpine du parc de Verfailles, nommé
la colonade. Celles qui font rangées fùr une ligne
droite s’appellent communément périjlyle. Voyeç
PÉRISTYLE.
Périjlyle eft le terme d’art pour les colonades droites
; 6c colonade eft le mot dont on fe l'ert vulgairement
pour ces mêmes colonades ; ainfi on employé
ce terme en parlant du magnifique périftyle du vieux
L o u v re , monument de la grandeur de Louis XIV , du
génie de Perrault & du zele de Colbert ; ouvrage que
le cavalier Bernin admira en arrivant à Paris , &
qu’on a mafqué d’une maniéré barbare par les bâti—
mens gothiques dont on l’a environné ; jufque-là
que plufieurs habitans de Paris ne connoiffent pas
ce morceau d’archite&ure, l’un des plus beaux qu’il
y ait au monde.
Une colonade palijlyle eft celle dont le nombre de
colonnes eft fi g rand, qu’on ne fauroit toutes les ap-
percevoir d’un même coup-d’æ il : de ce genre eft la
colonade de la place de S. Pierre de R om e , qui con-
fifte en deux cents quatre-vingt-quatre colonnes de
l’ordre dorique , toutes ayant plus de quatre piés 6c
demi de diamètre, 6c de marbre tiburtin. (P )
C olonades ver t es * (Jardin. ) font des orne