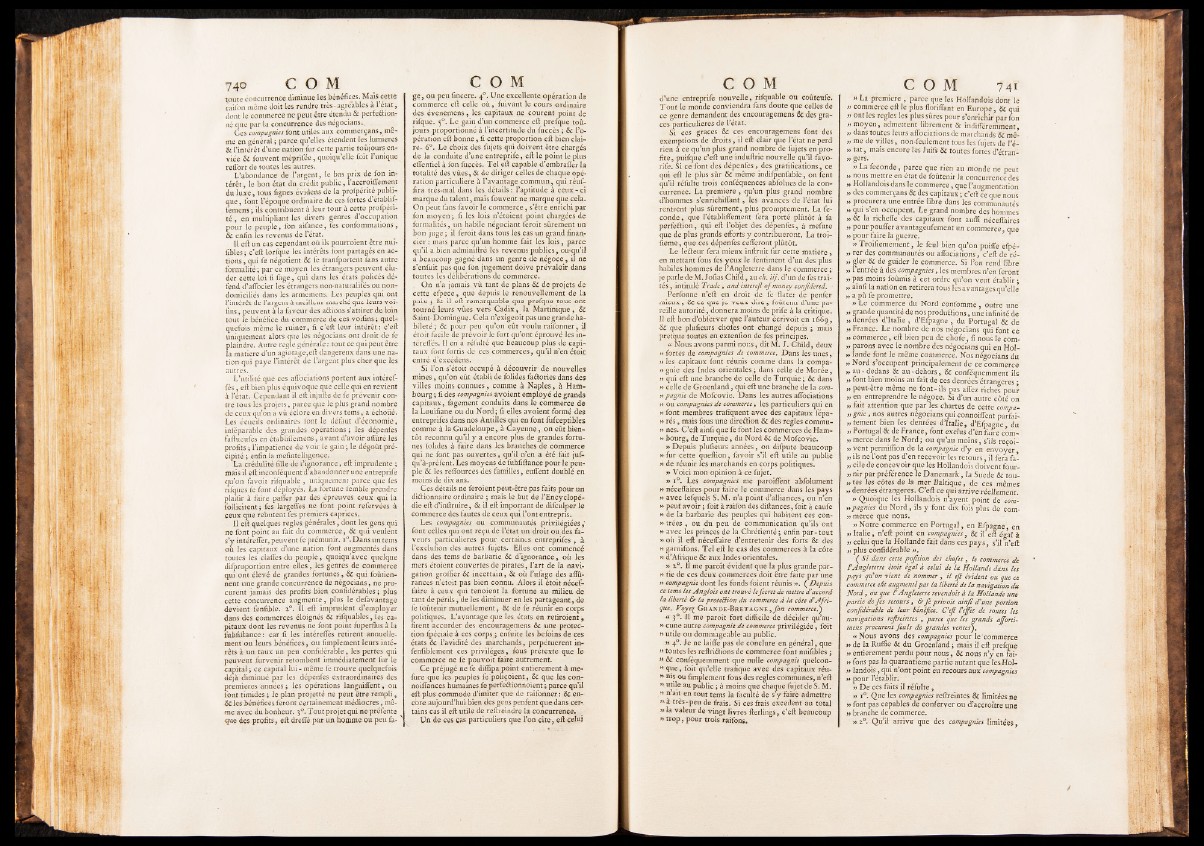
toute concurrence diminue les bénéfices. Mais cette
raifon même doit les rendre très-agréables à l’état,
dont le commerce ne peut être étendu & perfeâion-
né que par la concurrence des négocians..
Ces compagnies font utiles aux commerçans, même
en général ; parce qu’elles étendent les lumières
& l’intérêt d’une nation fur cette partie toujours enviée
6c fouvent méprifée, quoiqu’elle foit 1 unique
refforr de toutes les autres.
L’abondance de l’argent, le bas prix de fon intérêt
, le bon état du crédit public, l’accroiffement
du luxe, tous lignes évidens de la prolpérite publique
, font l’époque ordinaire de ces fortes d’établif-
i'emens ; ils contribuent à leur tour à cette profperi-
t é , en multipliant les divers genres d’occupation
pour le peuple, fon aifance, les confommations,
6c enfin les revenus de l’état.
Il eft un cas cependant où ils pourroient être nui-
fibles; c’eft lorfque les intérêts font partagés en actions
, qui fe négotient 6c fe tranfportent fans autre
formalité; par ce moyen les étrangers peuvent éluder
cette loi li fage, qui dans les états policés défend
d’affocier les étrangers non-naturalilés ou non-
domiciliés dans les armemens. Les peuples qui ont
l’intérêt de l’argent à meilleur marché que leurs voi-
lins, peuvent à la faveur des aftions s’attirer de loin
tout le bénéfice du commerce de ces voifins ; quelquefois
même le ruiner, fi c ’eft leur intérêt: c’eft
uniquement alors que les négocians ont droit de fe
plaindre. Autre réglé générale : tout ce qui peut être
la matière d’un agiotage,eft dangereux dans une nation
qui paye l’intérêt de l’argent plus cher que les
autres.
L ’utilité que ces affociations portent aux intéref-
fé s , eft bien plus équivoque que celle qui en revient
à l’état. Cependant il eft injufte de fe prévenir contre
tous les projets, parce que le plus grand nomhre
de ceux qu’on a vû éclore en divers tems, a échoiié.
Les écueils ordinaires font le défaut d’économie,
inféparàble des grandes opérations ; les dépenfes
faftueufes en établiflemens, avant d’avoir affùré les
profits ; l’impatience de voir le gain ; le dégoût précipité
; enfin la mefmtelligence.
La crédulité fille de l’ignorance, eft imprudente ;
mais il eft inconféquent d’abandonner une entreprife
qu’on favoit rifquable , uniquement parce que fes
rifques fe font déployés. La fortune l'emble prendre
plaifir à faire palier par des épreuves c.eux qui la
follicitent; fes largeffes ne font point refervées à
ceux que rebutent fes premiers caprices.
Il eft quelques réglés générales, dont les gens qui
ne font point au fait du commerce, 6c qui veulent
s’y intérelfer, peuvent fe prémunir. i°. Dans un tems
où les capitaux d’une nation font augmentés dans
toutes les clalfes du peuple, quoiqu’avec quelque
difproportion entre elles, les genres de commerce
qui ont élevé de grandes fortunes, 6c qui foûtien-
nent une grande concurrence de négocians, ne procurent
jamais des profits bien confidérahles ; plus
cette concurrence augmente, plus le defavantage
devient fenfible. i° . Il eft imprudent d’employer
dans des commerces éloignés 6c rifquables, les capitaux
dont les revenus ne font point fuperflus à la
fubliftance : car fi les intéreffés retirent annuellement
ou leurs bénéfices , ou Amplement leurs intérêts
à un taux un peu confidérable, les pertes qui
peuvent furvenir retombent immédiatement fur le
capital ; ce capital lui - même fe trouve quelquefois
déjà diminué par les dépenfes extraordinaires des
premières années ; les opérations languiffent, ou
font timides ; le plan projetté ne peut être rempli,
&c les bénéfices feront certainement médiocres, même
avec du bonheur. 30. Tout projet qui ne préfente
que des profits, eft dreffé par un homme ou peu fage,
ou peu fincere. 40. Une excellente opération de
commerce eft celle o ù , fuivant le cours ordinaire
des évenemens, les capitaux ne courent point de
rifque. 50. Le gain d’un commerce eft prefque toujours
proportionné à l’incertitude du fuccès ; 6c l’opération
eft bonne, fi cette proportion eft bien claire.
6°. Le choix des fujets qui doivent être chargés
de la conduite d’une entreprife, eft le point le plus
effentiel à fon fuccès. Tel eft capable d’embraffer la
totalité des vûes, & de diriger celles de chaque opération
particulière à l’avantage commun, qui réuf-
fira très-mal dans les détails : l’aptitude à ceux - ci
marque du talent, mais fouvent ne marque que cela.
On peut fans favoir le commerce, s’être enrichi par
fon moyen ; fi les lois n’étoient point chargées de
formalités, un habile négociant feroit sûrement un
bon juge ; il feroit dans tous les cas un grand financier
: mais parce qu’un homme fait les lois, parce
qu’il a bien adminiftré les revenus publics, ou*qu’il
a beaucoup gagné dans un genre de négoce, il ne
s’enfuit pas que fon jugement doive prévaloir dans
toutes les délibérations de commerce.
Qn n’a jamais^vû tant de plans 6c de projets de
cette efpece, que depuis le renouvellement de la
paix ; 6c il eft remarquable que prefque tous ont
tourné leurs vûes vers Cadix, la Martinique, 6c
Saint Domingue. Cela n’exigeoit pas une grande habileté
; 6c pour peu qu’on eût voulu raifonner, il
étoit facile de prévoir le fort qu’ont éprouvé les in-
térefles. Il en a réfulré que beaucoup plus de capitaux
font fortis de ces commerces, qu’il n’en étoit
entré d’excédens.
Si l’on s’étoit occupé à découvrir de nouvelles
mines, qu’on eût établi de ïolides faftories dans des
villes moins connues, comme à Naples, à Hambourg
; fi des compagnies avoient employé de grands
capitaux, fagement conduits dans le commerce de
la Louifiane ou du Nord; fi elles avoient formé des
entreprifes dans nos Antilles qui en font fufceptibles
comme à la Guadeloupe, à Cayenne, on eût bientôt
reconnu qu’il y a encore plus de grandes fortunes
ïolides à faire dans les branches de commerce
qui ne font pas ouvertes, qu’il n’en a été fait juf-
qu’à-préfent. Les moyens de fubfiftance pour le peuple
& les reffources des familles, euffent doublé en
moins de dix ans.
Ces détails ne feroient peut-être pas faits pour un
di&ionnaire ordinaire ; mais le but de l’Encyclopédie
eft d’inftruire, & il eft important de difculper le
commerce des fautes de ceux qui l’ont entrepris.
Les compagnies ou communautés privilégiées,’
font celles qui ont reçu de l’état un droit ou.des faveurs
particulières pour certaines entreprifes , à
l ’exclufion des autres fujets. Elles ont commencé
dans des tems de barbarie 6c d’ignorance, où les
mers étoient couvertes de pirates, l’art de la navigation
groiïïer 6c incertain, & où l’ufage des aflu-
rances n’étoit pas bien connu. Alors il étoit nécef-
faire à ceux qui tenoient la fortune au milieu de
tant de périls, de les diminuer en le$ partageant, de
fe loûtenir mutuellement, 6c de fe réunir en corps
politiques. L’avantage que les. états en retiroient,
firent accorder des encouragemens 6c une protection
fpéciale à ces corps ; enfuite les befoins de ces
états 6c l’avidité des marchands, perpétuèrent in-
fenfiblement ces privilèges, fous pretexte que le
commerce ne 1e pouvoit faire autrement.
Ce préjugé ne fe diffipa point entièrement à me-
fure que les peuples fepoliçoient, 6c que les con.-
noiffances humaines fe perfe&ionnoient ; parce qu’il
eft plus commode d’imiter que de raifonner : & encore
aujourd’hui bien des gens penfent que dans certains
cas il eft utile de reftreindre la concurrence.
Un de ces cas particuliers que l’on cite, eft celui
d’une entreprife nouvelle, rifquable ou coûteufe.
Tout le monde conviendra fans doute que celles de
ce genre demandent des encouragemens 6c des grâces
particulières de l’état.
Si ces grâces 6c ces encouragemens font des
exemptions de droits, il eft clair que l ’état ne perd
rien à ce qu’un plus grand nombre de fujets en profite,
puifque c’eft une induftrie nouvelle qu’il favo-
rife. Si ce font des dépenfes, des gratifications, ce
qui eft le plus sûr 6c même indifpenfable, on fent
qu’il réfulte trois conféquences abfolues de la concurrence.
La première, qu’un plus grand nombre
d’hommes s’enrichiffant, les avances de l’état lui
rentrent plus sûrement, plus promptement. La fécondé
, que l’établiffement fera porté plûtôt à fa
perfection, qui eft l’objet des dépenfes, à mefure
que de plus grands efforts y contribueront. La troi-
fieme, que ces dépenfes cefferont plûtôt.
Le leCteur fera mieux inftruit fur cette matière,
en mettant fous fes yeux le fentiment d’un des plus
habiles hommes de l’Angleterre dans le commerce ;
je parle de M. Jofias Child, au ch. iij. d’un de fes traités
, intitulé T rade , and intereji o f money confidered.
Perfonne n’eft en droit de fe flater de penfer
mieux ; 6c ce que je veux dire, foûtenu d’une pa-'
reille autorité, donnera moins de prife à la critique.
Il eft bon d’obferver que l’auteur écrivoit en 1669,
6c que plufieurs choies ont changé depuis ; mais
prelque toutes en extenfion de fes principes.
« Nous avons parmi nous, dit M. J. Child, deux
>* fortes de compagnies de commerce. Dans les unes,'
» les capitaux font réunis comme dans la compa-
» gnie des Indes orientales,; dans celle de Morée,
» qui eft une branche de celle de Turquie; 6c dans
» celle de G roenland, qui eft une branche de la com-
» pagnie de Mofcovie. Dans les autres affociations
» ou compagnies de commerce , les particuliers qui en
» font membres trafiquent avec des capitaux fépa-
» rés, mais fous une direction 6c des réglés commu-
» nés. C ’eft ainfi que fe font les commerces de Ham-
» bourg, de Turquie, du Nord 6c de Mofcovie.
» Depuis plufieurs années, on difpute beaucoup
» fur cette queftion, favoir s’il eft utile au public
» de réunir les marchands en corps politiques.
» Voici mon opinion à ce fujet.
» i° . Les compagnies me paroiffent abfolument
» néceffàires pour faire le commerce dans les pays
» avec lefquels S. M. n’a point d’alliances, ou n’en
»• peut avoir ; foit à raifon des diftances, foit à caufe
» de la barbarie des peuples qui habitent ces con-
» trées , ou -du peu de communication qu’ils ont
» avec les princes de la Chrétienté; enfin par-tout
»où il eft néceffaire d’entretenir des forts 6c des
« garnifons. T el eft le cas des commerces à la côte
« d’Afrique 6c aux Indes orientales.
» z°. Il me paroît évident que la plus grande par-
» tie de ces deux commerces doit être faite par une
» compagnie dont les fonds foient réunis ». ( Depuis
ce tems les Anglois ont trouvé le fecret de mettre d'accord
la liberté & la protection du commerce à la côte d'Afrique.
Voyc^ Grande-Bretagne ,fon commerce.)
« 30. Il me paroît fort difficile de décider qu’au-
» cune autre compagnie de commerce privilégiée, foit
»utile ou dommageable au public.
» 40. Je ne laiffe pas de conclure en général, que
» toutes les reftriétions de commerce font nuifibles ;
» 6c conféquemment que mille compagnie quelcon-
» que, foit qu’elle trafique avec des capitaux réu-
» nis ou fimplement fous des réglés communes, n’eft
». utile au public ; à moins que chaque fujet de S. M.
» n ait en tout tems la faculté de s’y faire admettre
» à très-peu de frais. Si ces frais excédent au total
» la valeur de vingt livres fterlings, e’eft beaucoup
» trop, pour trois raifons.
» La première , parce que les Hollandois dont le
» commerce eft le plus floriffant en Europe, 6c qui
» ont les réglés les plus sûres pour s’enrichir par fon
»moyen, admettent librement & indifféremment,
» dans toutes leurs affociations de marchands 6c mê-
» me de villes, non-feulement tous les fujets de l’é-
» tat, mais encore les Juifs 6c toutes fortes d’étran-
» gers.
» La fécondé, parce que rien au monde ne peut
» nous mettre en état de foutenir la concurrence des
>» Hollandois dans le commerce, que l’augmentation
» des commérçans 6c des capitaux ; c’eft ce que nous
» procurera une entrée libre dans les communautés
» qui s’en occupent. Le grand nombre des hommes
» 6c la richeffe des capitaux font auffi néceffàires
» pour pouffer avantageufement un commerce, que
» pour faire la guerre.
» Troifiemement, le feul bien qu’on puiffe efpé-
» rer des communautés ou affociations, c’eft de ré-
» gler & de guider le commerce. Si l’on rend libre
» 1 entree a des compagnies, les membres n’en feront
» pas moins foûmis à cet ordre qu’on veut établir ;
» ainfi la nation en retirera tous les avantages qu’elle
» a pû fe promettre.
» Le commerce du Nord confomme, outre une
» grande quantité de nos produ&ions, une infinité de
» denrées d’Italie , d’Efpagne , du Portugal 6c de
» France. Le nombre de nos négocians qui font ce
» commerce, eft bien peu de chofé, fi nous le com-
» parons avec le nombre des négocians qui en Hol-
» lande font le même commerce. Nos négocians du
» Nord s’occupent principalement de ce commerce
»au-dedans & au-dehors, 6c conféquemment ils
» font bien moins au fait de ces denrées étrangères ;
» peut-être même ne font-ils pas affez riches pour
» en entreprendre le négoce. Si d’un autre côté on
» fait attention que par les chartes de cette compati
gnie , nos autres négocians qui connoiffent parfai-
»tement bien les denrées d'Italie, d’Efpagne, du
» Portugal & de France, font exclus d’en faire com-
» merce dans le Nord ; ou qu’au moins, s’ils reçoi-
» vent permiflion de la compagnie d’y en envoyer,
» ils ne l’ont pas d’en recevoir les retours, il fera fa-
» cile de concevoir que les Hollandois doivent four-
» nir par préférence le D anemark, la Suede 6c tou-
» tes les côtes de la mer Baltique, de ces mêmes
» denrées étrangères. C ’eft ce qui arrive réellement.
» Quoique les Hollandois n’ayent point de com-
» pagnies du Nord, ils y font dix fois plus de com-
» merce que nous.
»Notre commerce en Portugal, en Efpagne, en
» Italie, n’eft point en compagnies, 6c il eft égal à
» celui que la Hollande fait dans ces p a ys, s’il n’eft
» plus confidérable
( Si dans cette pojîtion des chofes , le commerce de
PAngleterre étoit égal à celui de la Hollande dans les
pays qu'on vient de nommer, il eft évident ou que ce
commerce eût augmenté par la liberté de la navigation du
Nord, ou que l'Angleterre revendoit à la Hollande une
partie de fes retours , & fe privoit ainfi d'une portion
confidérable de leur bénéfice. C'efi Ceffet de toutes les
navigations reftreintes , parce que les grands afforti-
mens procurent feuls de grandes ventes) .
«Nous avons des compagnies pour le'commerce
» de la Ruffie & du Groenland ; mais il eft prefque
» entièrement perdu pour nous, 6c nous n’y en fai-
» fons pas la quarantième partie autant que les.Hol-
» landois, qui n’ont point eu recours aux compagnies
» pour l’établir.
» De ces faits il réfulte,
» i°. Que les compagnies reftreintes & limitées ne
» font pas capables de conferver ou d’accroître une
» branche de commerce.
». x°. Qu’il arrive que des compagnies limitées,