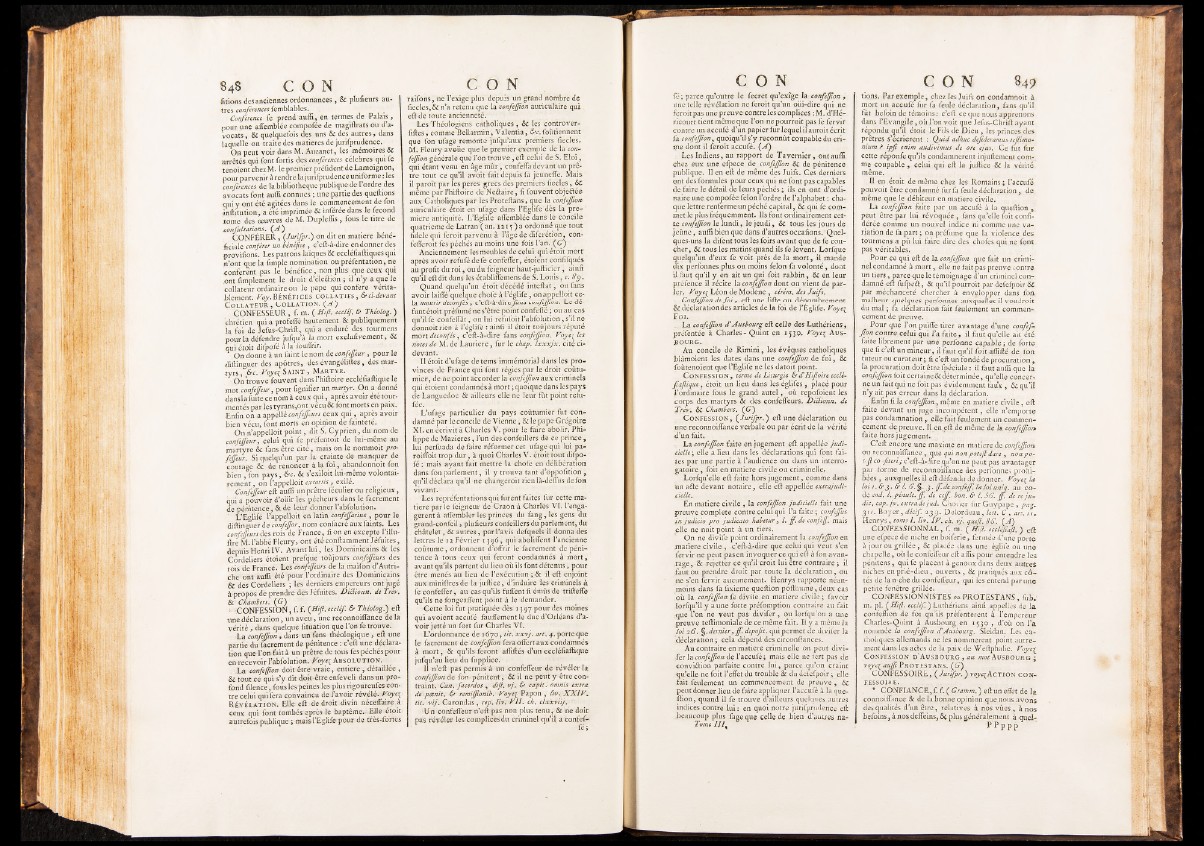
8 4S C O N
fitions des anciennes ordonnances, & plufieurs autres
conférences femblables.
Conférence fe prend'auffi, en termes de Palais,
pour une affemblée compofee de magiftrats ou d a-
vocats, & quelquefois des uns & des autres, dans
laquelle on traite des matières de jurifprudence.
On peut voir dans M. -Auzanet, les mémoires &
arrêtés qui font fortis des conférences célébrés qui fe
tenoient chez M. le premier préfident de Lamoignon,
pour parvenir à rendre la jurifprudence uniforme : les
conférences de la bibliothèque publique de l’ordre des
avocats font auffi connues ; une partie des queftions
qui y ont été agitées dans le commencement de fon
•inftitution, a été imprimée & inférée dans le fécond
tome des oeuvres de M, Duplelfis , fous le titre de
£onfultationS\ ( A ) ; (
CONFÉRER, (Jurifpr.') on dit en matière bénéf
ic ia i conférer un bénéfice , c’eft-à-dire en donner des
provifions. Les patrons laïques & eccléfiaftiques qui
n’ont mie la fimple nomination ou préfentation, ne
confèrent pas le bénéfice, non plus que ceux qui
.ont Amplement le droit d’éleftion ; il n’y a que le
collateur ordinaire ou le pape qui conféré véritablement.
Voy.Bénéfices co l l a t if s , 6*ci-devant
C ollateur , C o l la t io n . { A )
CONFESSEUR, f. m. ( Hifi. eccléf & Théolog.)
chrétien qui a profefle hautement & publiquement
la foi de Jefus-Chrift, qui a enduré des tourmens
pour-la défendre jufqu’à la mort exclufivement, &
qui étoit dùpofé à la fouffrir.
On donne à un faint le nom de confejfeur, pour le
diftinguer des apôtres, des évangéliftes, des marty
r s , &c. Voye{ Saint , Ma r t y r . ^
On trouve fouvent dans l’hiftoire eccléfiaftique le
mot confejfeur, pour fignifier un martyr. On a donné
dans la fuite ce nom à ceux qui, apres avoir ete tourmentés
par les tyrans,ont v ecu& font morts en paix.
Enfin on a z^elléconfeffiurs ceux q ui, apres avoir
bien vécu, font morts en opinion de faintçté.
On n’appelloit point, dit S. Cyprien, du nom de
confejfeur, celui qui fe préfentoit de lui-même au
martyre & fans être c ité , mais on le nommoit pro-
fejfeur. Si quelqu’un par la crainte de manquer de
courage & de renoncer à la fo i, abandonnoit don
bien , fon pays, &c. 8t s’exiïoit lui-même volontairement
, on l’appelloit extorris, exile.
Confejfeur eft aufli un prêtre féculier ou religieux,
qui a pouvoir d’oiiir les pécheurs dans le facrement
de pénitence, & de leur donner l’abfolution.
L’Églifé l’appelloit en latin confeffarius , pour le
diftinguer àeconfeÿor, nom confacré aux faints. Les
confeÿeur s des rois de France, fi on en excepte Pillu-
ftre M. l’abbé Fleury, ont été conftamment Jéfuites,
depuis Henri IV. Avant lui , les Dominicains & les
Cordeliers étoient prefqiie toujours confèffèurs des
rois de France. Les confèffèurs de la maifon d’Autriche
ont aufli été pour l’ordinaire des Dominicains
& dés Cordeliers ; les derniers empereurs ont jugé
à-propos dè prendre dès Jéfuites. Diclionn. de Trév.
& : Charniers. (G)
! -CONFESSION, f. f. (Hift. eccléf. & Theolog.) eft
une déclaration, un aveu , une reconnoiflance de la
vérité , dans quelque fituation que l’on fe trouve.
La confeffion, dans unfens théologique , eft une
partie du facrement de pénitence : c’eft une déclaration
que l’on fait à un prêtre de tous fes péchés pour
en recevoir l’àbfolution.7 ^>y«L Ab so lu t io n .
La confeffion doit être vraie, entière , détaillée ,
& tout ce qui s’y dit doit-être enfeveli dans un profond
filence , fous lespeines les plus rigoureufes contre
celui qui fera cphvaincu del’avoir rév,élé * Voy e^
R é v é la t io n . Elle eft de droit divin nécèffaire à
Céux qui fo n t fombés après le baptême.: .Elle étoit
autrefois publique; mai$’l’Eglife pour de très-fortes
C O N
raifons, né l’exige plus depuis un grand nombre de
fiecles,&n’a retenu que la confeffion auriculaire qui
eft de toute ancienneté.
Les Théologiens catholiques , & les controver-
fiftes , Comme Bellarmin , Valéntia, &c. foûtiennent
que fon ufage remonte jufqu’aux premiers fiecles.
M. Fleury avoue que le premier è'xemple de la confeffion
générale que l’on trouve, eft celui de S. Eloi,
qui étant venu en âge mûr, cônfeffa devant un prêtre
tout ce qu’il avoit fait depuis fà jeuneffe. Mais
il paroît par les perès grecs des premiers fiecles, &
même par l’hiftoire de Neétaire, fi fouvent objeâée
aux Catholiques par les Proteftans, que la confeffion
auriculaire étoit en ufage dans l’Eglife dès la première
antiquité. L’Eglife affemblée dans le concile
quatrième de Latran'(an. i i i 5 ) a ordonné que tout
fidele qui feroit parvenu à l’âge de difcrétïon, con-
fefferoit fes péchés au moins une fois l ’an. (G)
Anciennement les meubles de celui qui étoit mort
après avoir refufé defé confefler, étoient confifqués
au profit du roi , 011 du feigneur haut-jufiieier, ainfi
qu’il eft dit dans les établiffemens de S. Louis, c. 8$
Quand quelqu’un étoit décédé inteftat , ou fans
avoir laiffé quelque chofe à l’églife, onappelloit cela
mourir deconfés, c?éft-à-dire fans confeffion. Le défunt
étoit préfùmé ne s’être point confefle ; ou au cas
qu’il fe Confeffât, on lui refufoit l’abfolution, s’il ne
donnoit rien à l’églife : ainfi il étoit toujours réputé
mort déconfés, c’eft-à-dire fans cônfeffion. Voyc^ les
notes de M. de Lauriere, fur le chap. Ixxxjx. cité ci-
devant.
Il étoit d’ufage detems immémorial dans les provinces
de France qui font régies par le droit coutumier,
de ne point accorder la confeffion aux criminels
qui étoient condamnés à mort ; quoique dans les pays
de Languedoc & ailleurs elle ne leur fût point refu-
i fée. ’ " '
L’ufage particulier du pays coûtumièr fut condamné
par le concile de Vienne -, & le pape Grégoire
XI. en écrivit à Charles V . p'Our le faire abolir. Phi-
. lippe de Mazieres, l’un des confeillefs de ce prince ,
lui perfuada de faire réformer cet ufage qui lui pa-
roiffoit trop dur, à quoi Charles V. étoit tout difpo-
fé : mais ayant fait mettre la chofe en délibération
dans fon parlement, il y trouva tant d’oppofition ,
qu’ildéclara qu’il ne chàngërôit rien là-dèflïis defon
vivant.
Les repréfentations qui furent faites fur cette matière
par le feigneur de Craon à Charlës VI. l’engagèrent
à affembler les princes du fang, les gens du
grand-confeil, plufieurs confeillers du parlement, du
châtelet, & autres, par l’avis defquéls il donna des
lettres le 11 Février 1396, qui aboliffent l’ancienne
coûtume, ordonnent d’offrir le facrement de pénitence
à tous ceux qui feront condamnés à mort,
avant qu’ils partent du lieu où ils font détenus, pour
être menés au lieu de l’exécution^& il eft enjoint
aux miniftresde la juftice, d’induire les criminels à
fe confefler, au cas qu’ils fuflent fi émus de triftefle
qu’ils ne fongeaffent point à le demander.
Cette loi fut pratiquée dès 1397 pour des moines
qui avoient aceufé fauffement le duc d’Orléans d’avoir
jetté un fort fur Charles VI.
L’ordonnance de 1670 , tic. xxvj. art. 4. porte que
le facrement de cotifeffion fera offert aux condamnés
à mort, & qu’ils feront affiliés d’un eccléfiaftique
jufqu’au lieu du fupplice.
Il n’eft pas permis à Un cOnfeffeur de révéler la
confeffion de fon-pénitent, & il ne peut y être contraint.
Can. facerdos , difi. vj. & capit.' ômnis extra
de potnit. & remiffionïb. Voye^ Papon , liv. X X IV .
Mi :vij. Carondas, rep\ liv* VII. ch. clxxviij:—
Un confeffeur n’eft pas non plus tenu, & ne doit
pas révéler les complices du criminel qu’il a confef-
C O N
fê ; parce qu’outre le fecret qu’exîge la confeffion,
une telle révélation ne feroit qu’un oiii-dire qui ne
feroit pas une preuve contre les complices : M. d’Hé-
ricourt tient même que l’on ne pourroit pas fe fervir
contre un accufé d’un papier fur lequel il auroit écrit
fa confeffion, quoiqu’il s’y reconnût coupable du crime
dont il feroit accufé. (A)
Les Indiens, au rapport de Tavernier , ont auffi
chez eux une efpece de confeffion & de pénitence
publique. II en eft de même des Juifs. Ces derniers
pnt des formules pour ceux qui ne font pas capables
de faire le détail ae leurs péchés ; ils en ont d’ordinaire
une.compofée félon l’ordre de l’alphabet : chaque
lettre renferme un péché capital, & qui fe commet
le plus fréquemment. Ils font ordinairement cette
eqnfefjion le lundi, le jeudi, & tous les jours de
.jeûne, auffi bien que dans d’autres occafions.*Quelques
uns la difent tous les foirs avant que de fe cou-
çher, & tous les matins quand ils fe lèvent. Lorfque
quelqu’un d’eux fe voit près de la mort, il mande
dix perfonnes plus ou moins félon fa volonté, dont
il faut qu’il y en ait un qui foit rabbin, & en leur
préfence il récite la confeffion dont on vient de parler.
Koyeç Léon de Modene , cérém, des Juifs.
■ Confeffion de foi f eft une lifte ou dénombrement
& déclaration des articles de la foi de l’Églife. Voye^
Eoi.
. La confeffion d’Ausbourg eft celle des Luthériens,
préfentée à Charles - Quint en 1530. Voye^ Aus-
BOURG.
Au concile de Rimini, les évêques catholiques
blâmoient les dates dans une confeffion dit foi, &c
foûtenoient que l’Eglife ne les datoit point.
CONFESSION, terme de Liturgie & (C Hifloire ecclé-
Jiajlique, étoit un lieu dans les églifes , placé pour
l’ordinaire fous le grand autel, où repofoient les
corps des martyrs & des confèffèurs. Diciionn. de
Trév. & Chambers. (G)
C onfession, ( Jurifpr.) eft une déclaration ou
une reconnoiflance verbale ou par écrit de, la vérité
d’un fait.
La confeffion faite en jugement eft appellte judi-
cielle ; elle a lieu dans les déclarations qui font faites
par une partie à l’audience ou dans un interrogatoire
, foit en matière civile ou criminelle.
Lorfqu’elle eft faite hors jugement, comme dans
un a été devant notaire, elle eft appellée extrajudi-
cielle.
En matière civile , la confeffion judicielle fait une
preuve complété contre celui qui l’a faite ; confeffus
in judicio pro judicato habetur , l. ff.de confeff. mais
elle ne nuit point à un tiers.
On ne divîfe point ordinairement la confeffion en
matière civile , • ç’eft-à-dire que celui qui veut s’en
fervir ne peut pas en invoquer ce qui elt à fon avantage,
& rejetter ce qu’il croit lui être contraire ; il
faut ou prendre droit par toute la déclaration, ou
ne s’en fervir aucunement. Henrys rapporte néanmoins
dans fa fixieme queftion pofthume, deux cas
.où la confeffion fe divife en matière civile ; favoir
lorfqu’il y a une forte préfomption contraire au fait
;que l’on ne veut pas divifer, ou lorfqu’on a une
preuve teftimoniale de ce même fait. Il y a même la
loi z 6 . § . dernier, ff. depofit. qui permet de divifer la
déclaration ; cela dépend des circonftances.
Au contraire en matière criminelle on peut diviser
la confeffion de l’accufé ; mais elle ne fort pas de
convittion parfaite contre lui, parce qu’on craint
qu’elle ne foit l’effet du trouble & du defofpoir ; elle
fait feulement un cohimencement de preuve , &
peut'donner lieu de faire appliquer l’accufé.à là queftion,
quand il fe trouve d’ailleurs quelques autres
indices contre lui : en quoi notre jurifprudence eft
beaucoup plus fage que celle de bien d’autres na-
Tome /ƒƒ,
C O N 849
tions. Par exemple, chez les Juifs on condafnnoit à
mort un accufé fur fa feule déclaration, fans qu’il
fût befoin de témoins : c’eft ce que nous apprenons
dans l’Evangile, où l ’on voit que Jefus-Chrift ayant
répondu qu’il étoit le Fils de Dieu , les princes des
prêtres s’ecrierent : Quid adhuc defiderarnus tcflimo-
nium ? ipfi enim audivimus de ore ejus. Ce fut fur
cette réponfe qu’ils condamnèrent injuftement comme
coupable, celui qui eft la juftice & la vérité
même.
Il en ,çtoit de même chez les Romains ; l’accufé
pouvoit être condamné fur fa feule déclaration, de
même que le débiteur en matière civile.
La confeffion foiite par un accufé à la queftion ,
peut être par lui révoquée , fans qu’elle foit confi-
dérée comme un nouvel indice ni comme une variation
de fa part ; on préfume que la violence des
tourmens a pû lui faire dire des chofes qui ne font
pas véritables.
Pour ce qui eft de la confeffion que fait un criminel
condamné à m ort, elle ne fait pas preuve contre
un tiers, parce que le témoignage d’un criminel condamné
eft fufpeél, & qu’il pourroit par defefpoir ÔC
par méchanceté chercher à envelopper dans fon
malheur quelques perfonnes auxquelles il voudroit
du mal ; fa déclaration fait feulement un commencement
de preuve.
Pour que l’on puiffe tirer avantage d’une confeff
fion contre celui qui l’a faite, il faut qu’elle ait été
faite librement par une perfonne capable ; de forte
que fi c’eft un mineur, il faut qu’il foit affifté de fon
tuteur ou curateur ; fi c’eft un fondé de procuration y
la procuration doit être fpéciale : il faut auffi que la
confeffion loit certaine8cdéterminée, qu’elle concerne
un fait qui ne foit pas évidemment faux , & qu’il
n’y ait pas erreur dans la déclaration.
Enfin fi la confeffion., même en matière civile , eft
faite devant un juge incompétent, elle n’emporte
pas condamnation r elle fait feulement un commencement
de preuve. Il enreftde même de la confeffion
faite hors j ugement.
C ’eft encore une maxime en matière de confeffion
ou reconnoiflance,. que qui non potefl dare , non po-
ufl co fiteri; c’eft-à-dire qu’on ne peut pas avantager
par forme de reconnoiflance des perfonnes prohibées
, auxquelles il eft défendu de donner. Voye{ la
loi /. . & l. S. ^. ff.de confeff. laloiuniq. au code
eod. I. pénult. ff. de ceff. bon. & 1. 56. ff. de re ju -
dic, cap. jv. extrade jud. Chorier fur Guypape , pag.
3//.B0) re r , dècif. 23g . Delordeau, lett. C , art. //.
Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. qutfi. 86. (A)
CONFESSIONNAL, fi m. (H lfi eccUfiaJl.) eft
une efpece de niche en boiferie, fermée d’une porte
à jour ou grillée, & placée dans une églife ou une
chapelle, où le confeffeur eft affis pour entendre les
pénitens, quife placent à genoux dans deux autres
niches en prié-dieu , ouverts , & pratiqués aux côtés
de la nfohe du confefleur, qui les entend par une
petite fenêtre grillée.
CONFES.SIONNISTES ou PROTESTA N S , fub.’
m. pl. ( Hifi. eccléf. ) Luthériens ainfi appelles de la
confeffion de foi qu’ils préfenterent à l’empereur
Charles-Quint à Ausbourg en 1530 , d’où on l’a
nommée la confeffion d?Ausbourg. Sleidan. Les catholiques.
allemands ne le.s nommèrent point.autrement
dans,les ailes .de la paix de Weftphalie. Voye£
Confession d’Ausbourg , au mot Ausbourg ;
voy C{ auffi PROTEST ANS, (6 )
CONFESSOIRE, (Jurifpr.') voye^kcTion con-
F,ESSOIKE.
* CONFIANCE, f. f . .( Gramm. ) eft un effet de la
connoiflance & de la bonne opinion que nous avons
des qualités d’un être, relatives à nos vues., à nos
befoins, à nos deffeins, ôc plus généralement à quel-
p p P P E
i t H r
m