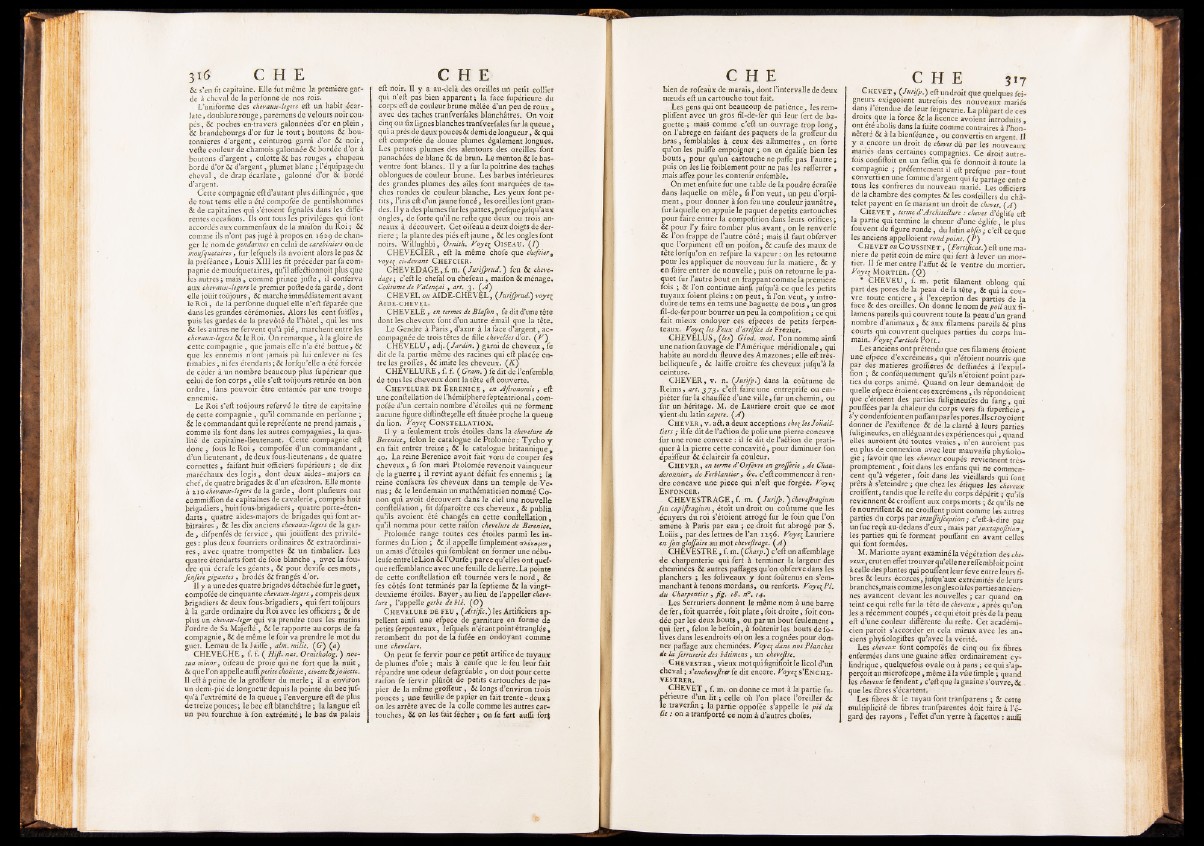
& s’en fit capitaine. Elle fut même la première garde
à cheval de la perfonne de nos rois.
L’uniforme des chevaux-legers eft un habit écarlate,
doublure rouge, paremens de velours noir coupés
, & poches en-travers galonnées d’or en plein,
& brandebourgs d’or fur le tout ; boutons & boutonnières
d’argent, ceinturon garni d’or & noir,
vefte couleur de chamois galonnée & bordée d’or à
boutons d’argent, culotte & bas rouges , chapeau
bordé d’or & d’argent, plumet blanc ; l’équipage du
ch eval, de drap écarlate, galonné d’or & bordé
d’argent.
Cette compagnie eft d’autant plus diftinguée, que
de tout tems elle a été compofée de gentilshommes
& de capitaines qui s’étoient fignalés dans les différentes
occafions. Ils ont tous les privilèges qui font
accordés aux commenfaux de la maifon du Roi ; &
comme ils n’ont pas jugé à propos en 1629 de changer
le nom de gendarmes en celui de carabiniers ou de
moufquctaires , fur lefquels ils avoient alors le pas &
la préféance, Louis X III les fit précéder par fa compagnie
de moufquetaires, qu’il affe&ionnoit plus que
les autres ; mais, comme prince jufte, il conferva
aux chevaux-legers le premier pofte de fa garde , dont
elle joitit toujours, & marche immédiatement avant
le R o i, de la perfonne duquel elle n’eft féparée que
dans les grandes cérémonies. Alors les cent fuiffes,
puis les gardes de la prévôté de l’hôtel, qui les uns
& les autres ne fervent qu’à p ié , marchent entre les
chevaux-legers & le Roi. On remarque, à la gloire de
cette compagnie, que jamais elle n’a été battue, &
que les ènnemis n’ont jamais pû lui enlever ni fes
timables, ni fes étendarts ; & lorfqu’elle a été forcée
de céder à un nombre beaucoup plus fupérieur que
celui de fon corps , elle s’eft toujours retirée en bon
ordre, fans pouvoir être entamée par une troupe
ennemie.
Le Roi s’eft toujours refervé le titre de capitaine
de cette compagnie , qu’il commande en perfonne ;
& le commandant qui le repréfente ne prend jamais ,
comme ils font dans les autres compagnies, la qualité
de capitaine-lieutenant. Cette compagnie eft
donc , fous le Roi , compofée d’un commandant,
d’un lieutenant, de deux fous-lieutenans , de quatre
cornettes , faifant huit officiers fupérieurs ; de dix
maréchaux des logis, dont deux aides-majors en
chef, de quatre brigades & d’un efcadron. Elle monte
à 110 chevaux-legers de la garde, dont plufieurs ont
commiffion de capitaines de cavalerie, compris huit
brigadiers, huit fous-brigadiers, quatre porte-éten-
darts, quatre aides-majors de brigades qui font arbitraires
, & les dix anciens ckevaux-legers de la garde
, difpenfés de fervice, qui joiiiffent des privilèges
: plus deux fourriers ordinaires & extraordinaire
s , avec quatre trompettes & un timbalier. Les
quatre étendarts font de foie blanche , avec la foudre
qui écrafe les géants, & pour devife ces m ots,
fenfere gigantes , brodés & frangés d ’or.
Il y a une des quatre brigades détachée fur le guet,
compofée de cinquante chevaux-legers , compris deux
brigadiers & deux fous-brigadiers, qui fert toûjours
à la garde ordinaire du Roi avec les officiers ; & de
plus un chevau-leger qui va prendre tous les matins
l’ordre de Sa Majefté , & le rapporte au corps de fa
compagnie, & de même le foir va prendre le mot du
guet. Lemau de la Jaiffe, alm. rnilit. (G) (a)
CHEVECHE, f. f. ( Hifi. nae. Ornitholog. ) noc-
tua minor, oifeau de proie qui ne fort que la nuit,
& que l’on appelle auffipetite chouette, civette & joiiette.
Il eft à peine de la groffeur du merle ; il a environ
un demi-pié de longueur depuis la pointe du bec juf-
qu’à l’extrémité de la queue ; l’envergure eft de plus
de treize pouces; le bec eft blanchâtre ; la langue eft
un peu fourchue à fon extrémité; le bas du palais
eft noir. Il y a au-delà des oreilles un petit collier
qui n’eft pas bien apparent ; la face fupérieure du
corps eft de couleur brune mêlée d’un peu de rou x,
avec des taches tranfverfales blanchâtres. On voit
cinq ou fix lignes blanches tranfverfales fur la queue,
qui a près de deux pouces & demi de longueur, & qui
eft compofée de douze plumes également longues.
Les petites plumes des alentours des oreilles font
panachées de blanc & de brun. Le menton &c le bas-
ventre font blancs. Il y a fur la poitrine des taches
oblongues de couleur brune. Les barbes intérieures
des grandes plumes des ailes font marquées 4e taches
rondes de couleur blanche. Les yeux font petits
, l’iris eft d’un jaune foncé, les oreilles font grandes.
Il y a des plumes fur les pattes, prefquejufqu’aux
ongles, de forte qu’il ne refte que deux ou trois anneaux
à découvert. Cet oifeau a deux doigts de derrière
; la plante des piés eft jaune , & les ongles font
noirs. Willughbi, Ornith. Voye{ OiSEAU. (/)
CHEVECIER , eft la même chofe que chefcier ,
voye£ ci-devant CHEFCIER.
CHEVEDAGE , ƒ. m. ( Jurifprud. ) feu & cheve-
dage\ c’eft le chefal ou chefeau, maifon & ménage.
Coutume de Valençai , art. 3 . (A )
CHEVEL ou A IDE-CHEVEL, (Jurifprud.) voye^
Aide-ch e v e l .
CHEVELÉ , en termes de Blafon, fe dit d’une tête
dont les cheveux font d’un autre émail que la tête.
Le Gendre à Paris, d’azur à la face d’argent, accompagnée
de trois têtes de fille chevelées d’or. (V )
CHEVELU, adj. ( Jardin. ) garni de cheveux, fe
dit de la partie même des racines qui eft placée entre
les groffes, & imite les cheveux. (K )
CHEVELURE, f. f. ( Gram. ) fe dit de l’enfemble,
de tous les cheveux dont la tête eft couverte.
C hevelure de Bérénice , en Afironomie, eft
une conftellation de l’hémifphere feptentrional, com-
pôfée d’un certain nombre d’étoiles qui ne forment
aucune figure diftintte;elle eft fituée proche la queue
du lion, Voye^ C o n ste l la t io n .
Il y a feulement trois étoiles dans la chevelure de
Bérénice, félon le catalogue dePtolomée: Tycho y
en fait entrer treize ; & le catalogue britannique,
40. La reine Bérénice avoit fait vceu de couper fes
cheveux, fi fon mari Ptolomée revenoit vainqueur
de la guerre ; il revint ayant défait fes ennemis ; la
reine confacra fes cheveux dans un temple de-Ve-
nus ; &c le lendemain un mathématicien nommé C a non
qui avoit découvert dans le ciel une nouvelle
conftellation, fit difparoître ces cheveux, & publia
qu’ils avoient été changés en cette conftellation,
qu’il nomma pour cette raifon chevelure de Bérénice.
Ptolomée range toutes ces étoiles parmi les informes
du Lion ; & il appelle fimplement ttxÔku/jmv ,
un amas d’étoiles qui femblent en former une nébu-
leufe entre le Lion & l’Ourfe ; parce qu’elles ont quelque
reffemblance avec une feuille de lierre. La pointe
de cette conftellation eft tournée vers le nord, &
fes côtés font terminés par la feptieme & la vingt-
deuxieme étoiles. Bayer, au lieu de l’appeller chevelure
, l’appelle gerbe ae blé. (O)
C hevelure de feu , (Artific.) les Artificiers ap.
pellent ainfi une efpece de garniture en forme de
petits ferpenteaux, lefquels n’étant point étranglés,
retombent du pot de la fufée en ondoyant comme
une chevelure.
On peut fe fervir pour ce petit artifice de tuyaux
de plumes d’oie ; mais à caufe que le feu leur fait
répandre une odeur defagréable, on doit pour cette
raifon fe fervir plutôt de petits cartouches de papier
de la même groffeur, & longs d’environ trois
pouces ; une feuille de papier en fait trente - deux;
on les arrête avec de la colle comme les autres cartouches,
& on les fait fécher ; on fe fert auffi for;
bien de rofeaùx de marais, dont l’intervalle de deux
noeuds eft un cartouche tout fait.
Les gens qui ont beaucoup de patience, les rem-
pliffent avec un gros fil-de-fer qui leur fert de baguette
; mais comme c ’eft un ouvrage trop long,
on l’abrege en faifant des paquets de la groffeur du
bras, femblables à ceux des allumettes , en forte
qu’on les puiffe empoigner ; on en égalife bien les
bouts, pour qu’un cartouche ne pafle pas l’autre ;
puis on les lie foiblement pour ne pas les refferrer ,
mais affez pour les contenir enfemble.
On met enfuite fur une table de la poudre écrafée
dans laquelle on mêle, fi l’on v eu t, un peu d’orpiment,
pour donner à fon feu une couleur jaunâtre,
fur laquelle on appuie le paquet de petits cartouches
pour faire entrer la compofition dans leurs orifices ;
& pour l’y faire tomber plus avant, on le renverfe
& l’on frappe de l’autre côté ; mais il faut obferver
que l’orpiment eft un poifon, & caufe des maux de
tête lorfqu’on en refpire la vapeur : on les retourne
pour les appliquer de nouveau fur la matière, & y
en faire entrer de nouvelle ; puis on retourne le paquet
fur l’autre bout en frappant comme la première
fois ; & l’on continue ainfi jufqu’à ce que les petits
tuyaux foient pleins : on peut, fi l’on v eut, y introduire
de tems en tems une baguette de bois, un gros
fil-de-fer pour bourrer un peu la compofition ; ce qui
fait mieux ondoyer ces efpeces de petits ferpenteaux.
Voye[ les Feux d'artifice de Frczier.
CHEVELUS, (les) Gèod. mod. l’on nomme ainfi
une nation fauvage de l’Amérique méridionale, qui
habite au nord du fleuve des Amazones ; elle eft très-
belliqueufe, & laiffe croître fes cheveux jufqu’à la
ceinture.
CHEVER, v . n. (Jurifp.) dans là coûtume de
Reims, art. 3 73 . c’eft faire une entreprife ou empiéter
fur la chauffée d’une v ille , fur un chemin, ou
fur un héritage. M. de Lauriere croit que ce mot
vient-du latin capere. (A )
C hever , v . ad. a deux acceptions che^ les JoiiaiU
liers ; il fe dit de l’aftion de polir une pierre concave
fur une roue convexe : il fe dit de l’adion de pratiquer
à la pierre cette concavité, pour diminuer fon
épaiffeur & éclaircir fa couleur.
C hever , en terme d?Orfèvre en grofferie , de Chau-
deronnier, de Ferblantier, &c. c’eft commencer à rendre
concave une piece qui n’eft que forgée. Vcyei
Enfoncer.
CHEVESTRAGE, f. m. ( Jurifp. ) cheveflragium
Jeu capifiragium, étoit un droit ou coûtume que les
écuyers du roi s’étoient arrogé fur le foin que l’on
amene à Paris par eau ; ce droit fut abrogé par S.
Loiiis, par des lettres de l’an 1256. Voyc{ Lauriere
en fon glojfaire au mot chevefirage. (A )
. CHEVESTRE, f. m. ( Ckarp.) c ’eft un affemblage
de charpenterie qui fert à terminer la largeur des
cheminées & autres pafl'ages qu’on obfervedans les
planchers ; les foliveaux y font foûtenus en s’emmanchant
à tenons mordans, ou renforts. Voye\Pl.
du Charpentier , fig. 18. n°. 14.
Les Serruriers donnent le même nom à une barre
de fer, fôit quarrée, foit plate, foit droite, foit coudée
par les deux bouts, ou par un bout feulement,
qui lert, félon lebefoin, à foûtenir les bouts de fo-
lives dans les endroits oîi on les a rognées pour donner
paffage aux cheminées. Voye^ dans nos Planches
de la ferrurerie des bâtimens , un chevejlre.
C hevestre , vieux mot qui fignihoit le licol d’un
cheval ; s'enchevefirtr fe dit encore, Voye^ s’En ch e -
VESTRER.
CH E V E T , f. m. on donne ce mot à la partie fu-
perieure d’un lit ; celle où l’on place l’oreiller &
le traverfin ; la partie oppofée s’appelle le pié du
lit : on a tranfporté ce nom à d’autres çhofes*
C hev et , (Jurifp.) eft undroit que quelques fei-
gneurs exigeoient autrefois des nouveaux mariés
dans l ’étendue de leur feigneurie. La plupart de ces
droits que la force & la licence avoient introduits ,
ont ete abolis dans la fuite comme contraires à l'hon-
nêtete & à la bienféance, ou convertis en argent. Il
y a encore un droit de chevet dû par les nouveaux
maries dans certaines compagnies. Ce droit autrefois
confiftoit en un feftin qui fe donnoit à toute la
compagnie ; prefentement il eft prefque par-tout
converti en une fomme d’argent qui fe partage entre
tous les confrères du nouveau marié. Les officiers
de la chambre des comptes & les confeillers du châtelet
payent en fe mariant un droit de chevet. (A )
C he v e t , terme d'Architecture : duvet d’églife eft
la partie qui termine la choeur d’une églife, le plus
fouvent de figure ronde, du latin abfis; c ’eft ce que
les anciens appelaient rond point. (P )
C he v e t ou C o ussine t , (Fortifient.) eft une maniéré
de petit coin de mire qui fert à lever un mortier.
Il fe met entre l’affût & le ventre du mortier.
Voye^ Mo rtier. (Q)
* CHEVEU, f. m. petit filament oblong qui
part des pores de la peau de la t ê te , & qui la couvre
toute entière, à l’exception des parties de la
face & des oreilles. On donne le nom de poil aux fi-
lamens pareils qui couvrent toute la peau d’un grand
nombre d’animaux, & aux filamens pareils & plus
courts qui couvrent quelques parties du corps humain.
Voye^Ûarticle Po il .
Les anciens ont prétendu que ces filamens étoient
une efpece d’excrémens, qui n’étoient nourris que
par des matières groffieres & deftinées à l’expul-
fion ; & conféquemment qu’ils n’étoient point parties
du corps anime. Quand on leur demandoit de
quelle efpece étoient ces excrémens, ils répondoient
que c’étoient des parties fuligineufes du fang, qui
pouffees par la chaleur du corps vers fa fuperficie ,
s’y condenfoient en paflantparles pores. Ils croyoient
donner de l’exiftence & dé la clarté à leurs parties
fuligineufes, en alléguantdes expériences qui, quand
elles auroient été toutes vraies, n’en auroient pas
eu plus de connexion avec leur mauvaife phyfiolo-
gie ; favoir que les cheveux coupés reviennent très-
promptement , foit dans les enfans qui ne commencent
qu’à végéter, foit dans les vieillards qui font
prêts à s’eteindre ; que chez les étiques les cheveux
croiffent, tandis que le refte du corps dépérit ; qu’ils
reviennent ôc croiffent aux corps morts ; & qu’ils ne
fe nourriffent & ne croiffent point comme les autres
parties du corps par intuffufeeption; c’eft-à-dire par
un fuc reçû au-dedans d’eu x, mais par juxtapofition y
les parties qui fe forment pouffant en avant celles
qui font formées.
M. Mariotte ayant examiné la végétation des cheveux
y crut en effet trouver qu’elle ne reffembloit point
à celle dés plantes qui pouffent leur feve entre leurs fibres
& leurs écorces, jufqu’aux extrémités de leurs
branches,mais comme les ongles où les parties anciennes
avancent devant les nouvelles ; car quand on
teint ce qui refte fur la tête de cheveux , après qu’on
les a récemment coupés, ce qui étoit près de la peau
eft d’une couleur différente du refte. Cet académicien
paroît s’accorder en cela mieux avec les anciens
phyfiologiftes qu’avec la vérité.
Les .cheveux font compofés de cinq ou fix fibres
enfermées dans une guaine affez ordinairement cy lindrique
, quelquefois ovale ou à pans ; ce qui s’ap-
perçoit au microfcope, même à la vue fimple ; quand
les cheveux fe fendent, c’eft que la guaine s’ouvre, Sc
que les fibres s’écartent.
Les fibres & le tuyau font tranfparens ; & cette
multiplicité de fibres tranfparentes doit faire à l’égard
de$ rayons, l’effet d’un verre à facettes : auiïi