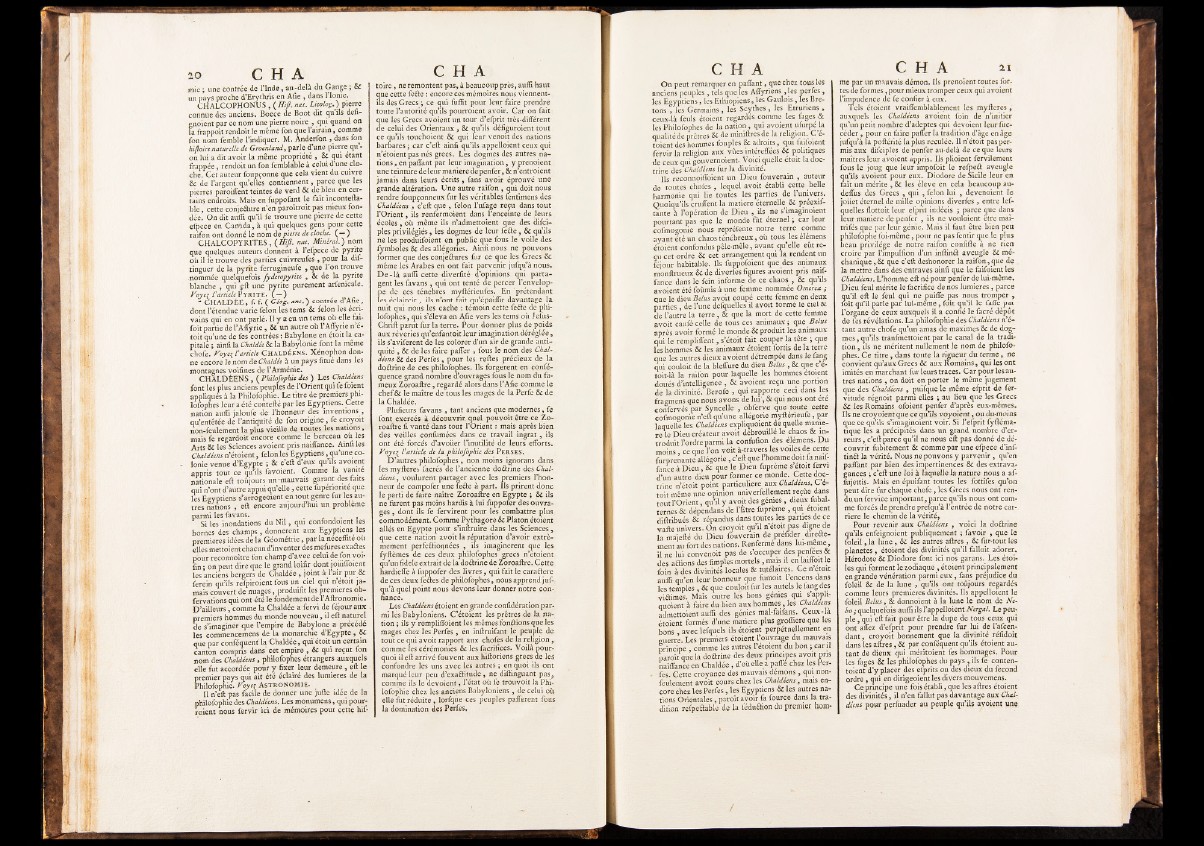
mie ; une contfée de l’Inde, au-delà du Gange ; 8c
un pays proche d’Erythris en Afie , dans 1 Ionie.
CHALCOPHONUS , (Hift. nat. Litolog. ) pierre
connue des anciens. Boece de Boot dit qu’ils defi-
gnoient par ce nom une pierre noire , qui quand on
la frappoit rendoit le même fon que l’airain, comme
fon nom femble l’indiquer. M. Anderfon , dans ion
hifloirc naturelle de Groenland, parle d’une pierre qu -
on lui a dit avoir la même propriété , 8c qui étant
frappée, rendoit un fon femblabie à celui d une cloche.
Cet auteur foupçonne que cela vient du cuivre
& de l’argent qu’elles contiennent, parce que les
pierres paroiffent teintes de verd 8c de bleu en certains
endroits. Mais en fuppofant le fait incontefta-
b le , cette conjeéture n’en paroitroit pas mieux fondée.
On dit aufli qu’il fe trouve une pierre de cette
efpece en Canùda, à qui quelques gens pour cette
raifon ont donné le nom de pierre de cloche. ( —)
CHALCOPYRITES , (Hijl. nat. Minéral.) nom
que quelques auteurs donnent à l’efpece de pyrite
où il fe trouve des parties cuivreufes , pour la distinguer
de la pyrite ferrugineufe , que l ’on trouve
nommée quelquefois fyderopyrite , & de la pyrite
blanche , qui gft une pyrite purement arfenicale.
Voye^ Varticle PYRITE. ( —)
* CHALDÉE, f. f. ( Géog.anc.) contrée d’A fie,
dont l’étendue varie félon les tems 8c félon les écrivains
qui en ont parlé. Il y a eu un tems ou elle fai- ;
foit partie de l’Affyrie, 8c un autre où l’Aflyrie n e-
toit qu’une de fes contrées : Babylone en étoit la capitale
; ainfi la Chaldée 8c la Babylonie font la meme
chofe. Voye^Varticle C haldÉENS. Xénophon donne
encore le nom de Chaldée à un pays fitue dans les .
montagnes voifines de l’Arménie. f
CHALDÉENS , ( Philofophie des ) Les Chaldeens
font les plus anciens peuples de l’Orient qui fe foient
appliqués à la Philofophie. Le titre de premiers phi-
lofophes leur a été contefté par les Egyptiens. Cette
nation aufli jaloufe de l’honneur des inventions ,
qu’entêtée de l’antiquité de fon origine, fe croyoit
non-feulement la plus vieille de toutes les nations,
mais fe regardoit encore comme le berceau ou les
Arts 8c les Sciences avoient pris naiffance. Ainfi les
Chaldéens n’étoient, félon les Egyptiens, qu’une colonie
venue d’Egypte ; & c’eft d’eux qu’ils avoient
appris tout ce qu’ils favoient. Comme la vanité
nationale eft toujours un-mauvais garant des faits
qui n’ont d’autre appui qu’eUe, cette fupérionte que
les Egyptiens s’arrogeoient en tout genre fur les au-
tres nations , eft encore aujourd’hui un problème
parmi les favans. .
Si les inondations du N il, qui confondoient les
bornes des champs , donnèrent aux Egyptiens^ les
premières idées de la Géométrie, par la neceflite ou
elles mettoient chacun d’inventer des indurés exaftes
pour reconnoître fon champ d’avec celui de fon voi-
iin; on peut dire que le grand loilir dont joüilïbienî
lés anciens bergers de Ghaldee, joint à 1 air pur &
ferein qu’ils refpiroient fous un ciel qui n’etoit ja-
mais couvert de nuages, produilit les premières ob-
fervations qui ont été le fondement de l’Aftronomie.
D ’ailleurs, comme la Chaldée a fervi de fejour aux
premiers hommes du monde nouveau, il ell naturel
de s’imaginer que l’empire de Babylone a précède
les commencemens de la monarchie d’Egyp te, &
que par confécjuent la Chaldée, qui’étoit un certain
canton compris dans' cet empire , & qui reçut fon
nom des Chaldéens , philofophes étrangers auxquels
elle fut accordée pour y fixer leur demeure, eft le
premier pays qui ait été éclairé des lumières de la
Philofophie. fqyq; Astr o n om ie . ^
Il n’eft pas facile de donner une jufte idée de la
philofophie des Chaldéens. Les monumens, qui pour-
roient nous fervir ici de mémoires pour cette hiftoire,
ne remontent pas, à beaucoup près, aufli haut
que cette fefte : encore ces mémoires nous viennent-
ils des Grecs ; ce qui fuflit pour leur faire prendre
toute l’autorité qu’ils pourroient avoir. Car on fait
que les Grecs avoient un tour d’efprit très-différent
de celui des Orientaux , 8c qu’ils défiguroient tout
ce qu’ils touchoient & qui leur venoit des nations
barbares ; car c’eft ainfi qu’ils appelaient ceux qui
n’étoient pas nés grecs. Les dogmes des autres nations
, en paflant par leur imagination, y prenoient
une teinture de leur maniéré de penfer, & n’entroient
jamais dans leurs écrits, fans avoir éprouvé une
grande altération. Une autre raifon , qui doit nous
rendre foupçonneux fur les véritables fentimens des
Chaldéens , c’eft que , félon l’ufage reçu dans tout
l’Orient, ils renfermoient dans l’enceinte de leurs
écoles y où même ils n’admettoient que des difei-
ples p rivilégiés, les dogmes de leur fette, & qu’ils
ne les produifoient en public que fous le voile des
fymboles 8c des allégories. Ainfi nous ne pouvons
former que des conjettures fur ce que les Grecs 8c
même les Arabes en ont fait parvenir jufqu’à nous.
D e - là aufli cette diverfité d’opinions qui partagent
les favans , qui ont tenté de percer l’enveloppe
de ces ténèbres myftérieufes. En 'prétendant
les éclaircir , ils n’ont fait qu’épaiflir davantage la
nuit qui nous les cache : témoin cette fe&e de philofophes
, qui s’éleva en A,fie vers les tems où Jelus-
Chrift parut fur la terre. Pour donner plus de poids
aux rêveries qu’enfantoit leur imagination déréglée,
ils s’aviferent de les colorer d’un air de grande antiquité
, 8c de les faire palier , fous le nom des Chai-,
déens & des Perfes, pour les reftes précieux de la
doârine de ces philofophes. Ils forgèrent en confé-
quence grand nombre d’ouvrages fous le nom du fameux
Zoroaftre, regardé alors dans l’Afie comme le
chef 8c le maître de tous les mages de la Perfe 8c de
la Chaldée.
Plufieurs favans , tant anciens que modernes, fe
font exercés à découvrir, quel pouvoit être ce Zoroaftre
fi vanté dans tout l’Orient : mais après bien
des veilles confumées dans ce travail ingrat, ils
ont été forcés d’avouer l’inutilité de leurs efforts.
Voye{ l'article de la philofophie des Perses.
D ’autres philofophes , non moins ignorans dans
les myfteres facrés de l’ancienne do&rine des Chaldéens
, voulurent partager avec les premiers l’honneur
de compofer une fe&e à part. Ils prirent donc
le parti de faire naître Zoroaftre en Egypte ; 8c ils
ne furent pas moins hardis à lui fuppofer des ouvrages
, dont ils fe fervirent pour les combattre plus
commodément. Comme Pythagore 8c Platon étoient
allés en Egypte pour s’inftruire dans les Sciences ,
que cette nation avoit la réputation d’avoir extrêmement
perfeôiorçnées , ils imaginèrent que les
fyftèmes de ces deux philofophes grecs n’étoient
qu’un fidele extrait de la do&rine de Zoroaftre. Cette
nardiefle à fuppofer des livres, qui fait le carattere
de ces deux fettes de philofophes, nous apprend jufqu’à
quel point nous devons leur donner notre confiance.
Les Chaldéens étoient en grande confidération parmi
lés Babyloniens. C ’étoient les prêtres de la nation
; ils y rempliffoient les mêmes fondions que les
mages chez les Perfes , en inftruifant le peuple de
tout ce qui avoit rapport aux chofes de la religion ,
comme les cérémonies 8c les facrifices. Voilà pourquoi
il eft arrivé fouvent aux hiftoriens grecs de les
confondre les uns avec les autres ; en quoi ils ont
marqué leur peu d’exaftitude, ne diftinguant pas,
comme ils le dévoient, l’état où fe trouvoit la Philofophie
chez les anciens Babyloniens , de celui où
elle fut réduite, lorfqûe ces peuples pafferent fous
la domination des Perfes.
On peut remarquer en paflant, que chez tous lés
anciens peuples , tels queles Affyriens ,les perfes ,
les Egyptiens , les Ethiopiens, les Gaulois, les Bretons
, les Germains , les Scythes , les Etruriens »
.ceux-là feuls étoient regardés comme les feges &
les Philofophes de la nation, qui avoient ufurpe la
qualité de farêtres 8c de miniftresde la religion. C ’étoient
des hommes fouples Sc adroits, qui faifoient
fervir la religion aux vîtes intéreffées 8c politiques
dc ceux qui gouvernoient. Voici quelle étoit la doctrine
des Chaldéens fur la divinité.
Ils reconnpiflbient un Dieu fouyerain , auteur
de toutes choies , lequel avoit établi cette belle
harmonie qui lie toutes, les parties de l’univers.
Quoiqu’ils cruffent la matière éternelle 8c préexif-
tante à l’opération de Dieu , ils ne s’imaginoient
pourtant pas que. le moi|§s iïit éternel ; car leur
cofmogonie nous repréfente, notre: terre comme
ayant été un chaos ténébreux, oit tous les élémens
étoient confondus pêle-mêle, avant qu’elle eut reçu
cet ordre.8c cet arrangement qui la rendent un
féjoür habitable. Us fuppofoient que des animaux
monftrueux 8c de diverfes figures avoient pris naif-
fance dans le fein informe de ce chaos ? 8c qu ils
avoient été fournis à une femme nommée Omerca ;
que le dieu Seins avoit coupé cette femme en deux
parties , de l’une defquelles il avoit formé le ciel 8c
de l’autre la terre, 8t que la mort de cette femme
avoit calrfé celle de tous ces animaux ; que Belles
apres avoir formé le monde 8c produit les animaux
qui le rempliffent, s’étoit fait couper la tête ; que
les hommes 8c les animaux étoient fortis de la terre
que lès autres dieux avoient détrempée dans le fan£
qui couloit de la bleffure du dieu Belles , 8c que c’é-
toit-là la raifon pour laquelle les hommes étoient
doués d’intelligence , 8c avoient reçu une portion
de la divinité. Berofe , qui rapporte ceci dans les
fragmens que nous avons de lui1,8c qui nous ont ete
confervés par Syncelle , obferve que toute cette
cofmogonie n’eft qu’une allégorie myftérieufe, par
laquelle les Chaldeens expliquoient de quelle maniéré
le D ieu créateur avoit débrouillé le chaos 8c introduit
l’ordre parmi la confufion des elemens. Du
moins, ce que l’on voit à-travers les voiles de cette
furprenante allégorie, c’eft que l’homme doit fanatf-
fance à D ieu , Sc que le Dieu fuprème s’étoit fervi
d’un autre dieu pour former ce monde. Cette doctrine
n’étoit point particulière aux Chaldeens. G é -
toit même une opinion univerfellement reçue dans
tout l’Orient, qu’il y avoir des génies, dieux fubal-
ternes 8c dépendans de l’Etre fuprème., qui croient
diftribués 8c répandus dans toutes les parues de ce
vafte univers. On croyoit qu’il n’étoit pas digne de
la majefté du Dieu fouverain de prefider directement
au fort des nations. Renfermé dans lui-même,
il ne lui convenoit pas de s’occuper des penfees &
des aftions des fimples mortels , mais il en laiffoit le
foin à des divinités locales 8c tutélaires. Ce n’etoit
aufli qu’en leur honneur que fumoit l’encens dans
les temples , 8c que couloit fur les autels le fang des
victimes. Mais outre les bons génies qui s’appli-
quoient à faire du-bien aux hommes, les Chaldeens
admettaient aufli des génies mal-faifans. Ceux-là
étoient formés d’une matière plus grofliere que les
bons , avec lefquels. ils étoient perpétuellement en
guerre. Les premiers étoient l’ouvrage du mauvais
principe , comme les autres l’étoient du bon ; car il
paraît que la doftrine des deux principes avoit pris
naiffance en Chaldée, d’où elle a paffé chez les Per-
■ fes. Cette croyance des mauvais démons , qui non-
feulement avoit cours chez les Chaldéens., mais encore
chez les Perfes, les Egyptiens 8c les autres nations
Orientales , paraît avoir fa- fource dans la tradition
refpeCtable de la leduClion du premier homme
par un mauvais démon. Ils prenoient toutes fortes
de formes, pour mieux tromper ceux qui avoient
l’impudence de fe confier à eux.
Tels étoient vraiflemblablement les myfteres ,
auxquels les Chaldéens avoient foin de n’initier
qu’un petit nombre d’adeptes qui dévoient leur fuc-
céder , pour en faire pafler la tradition d’âge en âge
jufqu’à la poftérité la plus reculée. Il n’étoit pas permis
aux difciples de penfer au-delà de ce que leurs
maîtres leur avoient appris. Ils plioient fervilement
fous le joug que leur impofoit le refpeâ aveugle
qu’ils avoient pour eux. Diodore de Sicile leur en
fait un mérite , & les éleve en cela beaucoup au-
deffus des Grecs , qui , félon lui , devenoient le
jouet éternel de mille opinions diverfes , entre lesquelles
flottoit leur efprit indécis ; parce que dans
leur maniéré de penfer , ils ne vouloient être maî-
trifés que par leur génie,. Mais il faut être bien peu
philofophe foi-même, pour ne pas fentir que le plus
beau privilège de notre raifon confifte à ne rien
croire par l’impulfion d’un inftinft aveugle & mé-
chanique, 8c que c’eft deshonorer la raifon, que de
la mettre dans des entraves ainfi que le faifoient les
Chaldéens. L’homme eft né pour penfer de lui-même.
Dieu feul mérite le facrifice de nos lumières, parce
qu’il eft le , feul qui ne puifle pas nous tromper ,
foit qu’il parle par lui-même, foit qu’il le fafle par
l’organe de ceux auxquels il a confié le facré dépôt
de les révélations. La philofophie des Chaldéens n’é-^
tant autre chofe qu’un amas de maximes 8c de dogmes
, qu’ils tranfmettoient par le canal de la tradition
, ils ne méritent nullement le nom de philofo*
phes. C e titre, dans toute la rigueur du terme, ne
convient qu’aux Grecs 8c aux Romains, qui les ont
imités en marchant fur leurs traces. Car pour les autres
nations , on doit en porter le même jugement
que des Chaldéens , puifque le même efprit de fer-
vitude régnoit parmi elles ; au lieu que les Grecs
8c les Romains ofoient penfer d’après eux-mêmes.
Ils ne croyoientqiie ce qu’ils voyoient, ou du-moins
que ce qu’ils s’imaginoient voir. Si l’efprit fyftéma-
tique les a précipités dans un grand nombre d’erreurs
, c’eft parce qu’il ne nous eft pas donné de découvrir
fubitement 8c comme par une efpece d’ink
tinû la vérité. Nous ne pouvons y parvenir , qu’en
paflant par bien des impertinences 8c des extravagances
; c’eft une loi à laquelle la nature nous a af-
lujettis. Mais en épuifant toutes les fottifes qu’on
peut dire fur chaque chofe, les Grecs nous ont rendu
un fervice important., parce qu’ils nous ont comme
forcés de prendre prefqu’à l ’entrée de notre car-,
riere le chemin de la vérité,
Pour revenir aux Chaldéens , voici la do firme
qu’ils enfeignoient publiquement ; favoir , que le
foleil, la lune, 8c les autres aftres , 8c fur-tout les
planètes, étoient des divinités qu’il falloit adorer.
Hérodote 8c Diodore font ici nos garans. Les étoiles
qui forment le zodiaque , étoient principalement
en grande vénération parmi eu x , fans préjudice du
foleil 8c de la lune , qu’ils ont toujours regardés
comme leurs premières divinités. Ils appelloient le
foleil Belus, 8c donnoient à la lune le nom de Ne-
bo; quelquefois aufli ils l’appelloient Nergal. Le peu^
p ie , qui eft fait pour être la dupe de tous ceux qui
ont allez d’efprit pour prendre fur lui de l’afcen-
dant, croyoit bonnement que la divinité réfidoit
dans les aftres, 8c par conféquent qu’ils étoient autant
de dieux qui méritoient fes hommages. Pour
les fages 8c les philofophes du pays , ils fe conten-
toient d ’y placer des efprits ou des dieux du fécond
ordre, qui en dirigeoient les divers mouvemens.
Ce principe une fois établi, que les aftres étoient
des divinités, il n’en fallut pas davantage aux Chaldéens
pour perfuader au peuple qu’ils avoient une
j