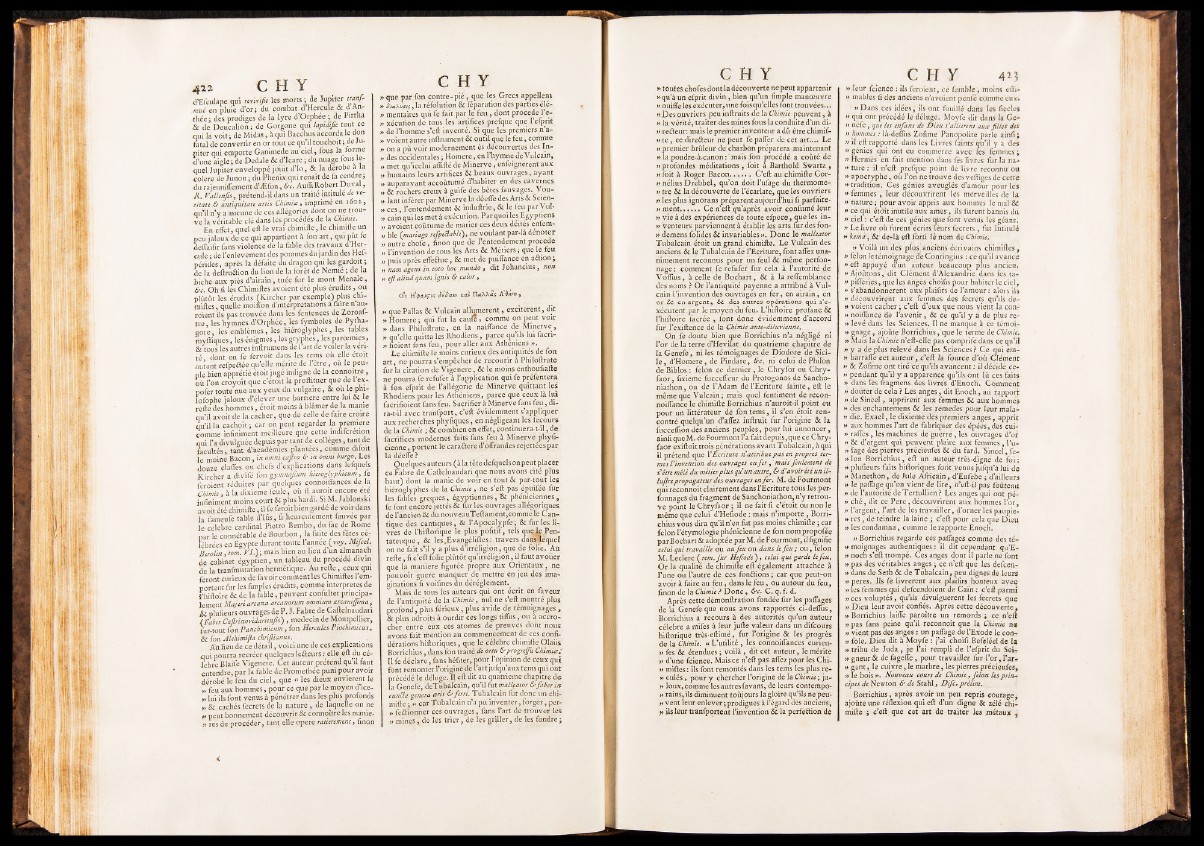
d’Efculape qui revivifie les morts; de Jupiter tranf-
,mué ©n pluie d’or; du combat d’Hercule & d An-
4hée; des prodiges de la lyre d’Orphée ; de Pirxha
.& de Deucalion ; de Gorgone qui lapidifie tout ce
■ qui la voit ; de Midas, à qui Bacchus accorda le don
iatal de convertir en or tout ce qu’il touchoit ; de Jupiter
qui emporte Ganimede mr ciel, fous la forme
,d’une aigle; de Dedale & d’Icare ; du nuage tous^lequel
Jupiter enveloppé jouit d’Io, & la dérobe a la
colere de Junon ; du Phénix qui renaît de fa cendre ;
-du rajeuniffement d’Æfon-, &c. Audi Robert Duva ,
R. VaLlenfis, prétend-il dans un traité intitule de ve-
■ ritate & antiquitate artis Chimia, imprime en 1602.,
•qu’il n’y a aucune de ces allégories dont on ne trouve
la véritable clé dans les procédés de la Chimie.
En effet, quel eft le vrai chimifte, le chimifte un
peu jaloux de ce qui appartient à fon art, qui pût fe
deffaifir fans violence de la fable des travaux d’Hercule
; de l’enlevement des pommes du jardin des Hef-
pérides, après la défaite du dragon qui les gardoit ;
rie la deftruâion du lion de la foret de Nemie ; de la
hiche aux piés d’airain, tuée fur le mont Menai«,
&c. Oh fi les Chimiftès avoient été plus érudits » oit
plutôt les érudits (Kircher par exemple) plus chi-
mifieSi quelle moiffon d’imerprétaitlans à faire n’au.
roietit ils pas trouvée dans les fentençes de. Zoroaf-
tre , les hymnes d’Orphée, les fymboles de Pytha-
gore, les emblèmes, les .hiéroglyphes, les tables
myftiques, les énigmes , lesgrÿphes,les paroemies,
& tops les autres inftrumens de l’art de voiler la vérité
dont on fe fervoit:daqs les tems . oh.elle étoit
autant relpeélée qu’elle mérité de 1 e tre, ou le peuple
bien apprétié étoit juge indigne de la connoitre,
où l’on croyoit que c’étoit la proflituer que de l’ex-.
pofer toute nue aux y eu x du vulgaire, & où le phi-
lofophe jaloux d’élever une barrière entre lui & le
refie des hommes, étoii moins à blâmer de la manie
qu’il ayoit de la cacher, que de celle de faire, croire
qu’il la jcachoit; car on peut regarder la première
comme infiniment meilleure que cette indii'ctction
qui l’ a divulguée depuis par tant de collèges., tant de
facultés, tant d’académies plantées.,, comme dtlott
le moine Bacon, in omni cajlrn & in omni iurgo. Les
douze claffeS: ou chefs d'explications dans lefqûels
Kircher a divifé fon ey.”i"njînm /‘Ic-'iiglyphUnm >
feroient réduites par quelques connoiffances de là
C h im > h la dixième feule , auroit encqre.etp -
infiniment moins court & plus hardi. Si M . Jablonski
avoir .été chimifte, il fe feroit bien garde de voir dans
la fameufe table d’Ifis,,fi .heureulement fauvee par
le célébré cardinal Pietro Bemhq.) du fae de Rome
par le .connétable de Bourbon, la fuite des fêtes célébrées
en Egypte durant toute l’année ( tioy. Mifcclc
Stroïiii f.tom. jÇV.); ntaisjsien au. lieu d’un almanach
de cabinet égyptien, un tableau du procédé divin
de la tranfmutation hermétique. Au refte 1 ceux qui
feront curieux de favoir comment les Chimiftès l'emportent
fur les ftmples érudits, comme interprètes de
Vhiftoixe & dé la fable., peuvent çonfultet principa-
leinent Mnjeri arcana arcanorum ornnium arccmiffima,
& plufieurs ouvrages de P. J.Eabre de Caftelnaudari
( Fabtf&ajiriimidanmfis') , medeçin de Montpellier,
lur-tout fon PanéiiniçumI fon Hercules Pioebimicùs,
& {ôn 'siichimïfla chrijlianus.^ . . ■
Ail lieu de ce détail, voici une de ces explications
qui pourra recréer quelques lecteurs : elle eft du célébré
Blaifo Vigenere, Cet auteur prétend qu’il faut
entendre, par la fable de Promethée puni pour avoir
dérobé le feu du c iel, que « lés,dieux envierent le
» feu aux hommes, pour ce que par le moyen d’ice-
„ lui ils font venus à pénétrer dans les plus profonds
& cachés feefets de la nature , de laquelle .on ne
» peut bonnement découvrir 8c connoitre les rnanie-
» res de procéder, tant elle opéré raàcrcmcni, finon
» que par fon contre-pié, que,les Grecs appellent
» S'iaxi<rn, la réfolution Sc féparation des parties élé-
» mentaires qui fe fait par le feu , dont procédé l’e-
» xécution de tous les artifices prefque que l’efprit
» de l’homme s’eft inventé. Si que les premiers n’a-
» voient autre infiniment Sc outil que le feu, comme
» on a pu voir modernement ès découvertes des In-
» des occidentales ; Homere, en l’hymne de Vulcain,
» met qu’îcelui affilié de Minerve, enfeignerent aux
„ humains leurs artifices & beaux ouvrages, ayant
» auparavant accoûtuhié d’habiter en des cavernes
» & rochers creux à guife des bêtes fauvages. Vou-
» lant inférer par Minerve la déeffe des Arts & Scien-
» ces, l’entendement Sc induftrie, & le feu parVul-
» cain qui les met à exécution. Par quoi les Egyptiens
» avoient coutume de marier ces deux déités enfem-
» ble (mariage refpeciable), ne voulant par-là dénoter
» autre chofe, finon que de l’entendement procédé
» l’invention de tous les Arts Sc Métiers ; que le feu
» puis après effeftue, Sc met de puiffance en aftion;
» nam agens in toto hoc mundo 3 dit Johancius , non
» efi aliud quam ignis & calor ,
Ç>% H*ip«t/^oç S'ctw Kcti TlaXXaç A ôm'» ,
» que Pallas & Vulcain allumèrent, excitèrent, dit
» Homere ; qui fut la cautë, comme on peut voir
» dans Philoftrate, en la naiffance de Minerve ,'
» qu’elle quitta les Rhodiens, parce qu’ils lui facri-,
» fioient fans feu., pour aller aux Athéniens^».
Le chimifte.le moins curieux des antiquités de fon
art, ne pourra s’empêcher de recourir à Philoftrate
fur la citation de Vigenere, & le moins enthoufiafte
ne pourra fe refufer à l’application qui fe préfentera
à fon efprit de l’allégorie de Minerve quittant les
Rhodiens pour les Athéniens, parce que ceux-là lui
facrifioient fans feu. Sacrifier à’ Minerve fans feu, dira
t-il avec tranfport, c’eft évidemment s’appliquer
aux recherches phyfiques, en négligeant les fecours
de la Chimie ; & combien en effet, continuera-t-il, de
facrifices modernes faits, fans feu à Minerve phyfi-
cienne, portent le caraûere d’offrandes rejettéespar,
la déeffe ?
Quelques auteurs (à la tête defquels on peut placer
ce Fabre de Caftelnaudari que nous avons cité plus
haut) dont la manie de voir en tout & par-tout les
hiéroglyphes de la Chimie r ne s’eft pas épuifée fur
les fables gfeques, égyptiennes, & phéniciennes ,
fe font encore jettés & fur les ouvrages allégoriques
de l’ancien & du nouveauTeftament,comme lé Cantique
des cantiques, & l’Apocalypfe; & furies livres
de l’hiftorique le plus pofitif, tels queJgJPen-
tateuque, & les. E van gélifies; .travers dansSéquel
on ne fait s’il y a plus d’irréligion, que de folie. Au
refte, fi c’eft folie plutôt qu’irréligion, il faut avoiier
que la maniéré figurée propre aux Orientaux, ne
pouvoit guere manquer de mettre en jeu des imaginations
fi ’voifines du dérèglement.^
Mais dé tous, les auteurs qui ont écrit en faveur
de l’antiquité de la Chimie, nul ne s’eft montré plus
profond, plus férieux, plus avide de témoignages ,
& plus adroits à ourdir ces longs tiffus, ou à accrocher
entre eux ces atomes de; preuves dont nous
avons fait mention au commencement de ces.confédérations
hiftorïques, que le célébré chimifte Olaüs
Borrichius, dans fon traité de ortu &progreffii Chirnia
Il fe déclare, fans héfiter, pour l’opinion de ceux qui
font remonter l’origine de l’art jufqu’aux tems qui ont
précédé le déluge. Il eft dit au quatrième chapitre de
la Genefe deTubalcain, qu’il fut mallçator & faberin
cuncla généra aris & ferri. Tubalcain fut donc un chimifte
; « car Tubalcain n’a pu inventer, forger, per-
» fe&ionner ces ouvrages,, fans l’art de trouver les
» mines, de les trier, de les griller, de les fondre ;
<
>* toutes chofes dont la découverte ne peut appartenir
»qu’à un efprit divin, bien qu’un fimple manoeuvre
» ouiffe les exécuter, une fois qu’elles font trouvées...
» Des ouvriers peu inftruits de laChimie peuvent, à
» la vérité, traiter des mines fous la conduite d’un di-
» reâeur: mais le premier inventeur a dû être chimif-
» t e , ce directeur ne peut fepaffer de cet art.... Le
» premier brûleur de charbon préparera maintenant
»> la poudre-à-canon : ‘ mais fon procédé a coûté, dé
» profondes méditations , foit à Barthold Swartz ,
»foit à Roger Bacon........ .. C ’eft au chimifte Cor-
»> nélius Drebbel, qu’on doit l’ufage du thermome-
» tre & la découverte de l’écarlate, que, les ouvriers
» les plus ignorans préparent aujourd’hui fi parfaite-
» ment., . . . . Ce n’eft qu’après avoir confumé leur
» vie à des expériences de toute efpece, que les in-
» venteurs parviennent à établir les arts fur des fon-
» demens folides & invariables ». Donc le malleator
Tubalcain était un grand cliimifte. Le Vulcain des
anciens & le Tubalcain de l’Ecriture, font affez unanimement
reconnus pour un feul .& même perfon*
nage : comment fe refufer fur cela à l’autorité de
Voffius, à celle de Bochart, & à la refTemhlaiiçe
des noms ? Or l’antiquité payenne a attribué à Vulcain
l ’invention des ouvrages en fer, en airain , en
or & en argent, & des autres opérations qui s’exécutent
par le moyen du feu. L’hiftoire profane &
l’hiftoire facrée , font .donc évidemment d’accord
fur l’exiftence de la Chimie ante-diluvienne.
On fe doute bien que Borrichius n’a négligé ni
l’or de la terre d’Hevilat du quatrième chapitre de
la Genefe , ni les témoignages de Diodore de Sicile
, d’Homere, de Pindare, &c. ni celui de Philon
de Biblos : félon ce dernier , le Chryfor ou Chry-
faor , fixieme fucceffeur du Protogonos de Sancho-
niathon, ou de l’Adam de l’Ecriture fainte, eft le
même que Vulcain ; mais quel fentiment de r.econ-
noiffance le chimifte Borrichius n’auroit-il point eu
pour un littérateur dé fon tems, il s’en étoit rencontré
quelqu’un d’affez inftruit fur l’origine & la
fucceflion des anciens peuples, pour lui annoncer,
ainfi que M. de Fourmont l’a fait depuis, que ce Chry-
faor exiftoit trois générations avant Tubalcain, à qui
il prétend que V Ecriture ri attribue pas en propres termes
l'invention des ouvrages en ferma is feulement de
s'être mêle du métier plus qu'un autre, & d'avoir été un il-
lufire propagateur des ouvrages en fer. M. de Fourmont
qui reconnoît clairement dans l’Ecriture tous les per-
fonnages du fragment de Sanchoniathon, n’y retrouv
e point le Chryfaor ; il ne fait fi c’étoit ou non le
même que celui d’Hefiode : mais n’importe , Borrichius
vous dira qu’il n’en fut pas moins chimifte ; car
félon l’étymologie phénicienne de fon nom propofée
parBochart & adoptée par M. de Fourmont, ilfignifie
celui qui travaille ou au feu ou dans le feu ; ou , félon
M. Leclerc ( rem. fur Hejîode ) , celui qui garde le feu.
Or la qualité de chimifte eft également attachée à
l’une ou l’autre de ces fondions ; car que peut-on
avoir à faire au feu, dans le fe u , ou autour du feu,
finon de la Chimie ? D o n c , &c. C. q. f. d.
Après cette démonftration fondée fur les pafTages
de la Genefe que nous avons rapportés ci-deffus,
Borrichius a recours à des autorités qu’un auteur
célébré a mifes à leur jufte valeur dans un difcoftrs
hiftorique très-eftimé, fur l’origine & les progrès
de la Chimie. « L ’utilité , les connoiffances curieu-
» fes & étendues ; voilà , dit cet auteur, le mérite
» d’une fcience. Mais ce n’eft pas affez pour les Chi-
» milles : ils font remontés dans les tems les plus re-
» culés, pour y chercher l’origine de la Chimie ; ja-
» loux, comme les autres fa vans, de leurs contempo-
» rains, ils diminuent toûjours la gloire qu’ils ne peu-
» vent leur enlever ; prodigues à l’égard des anciens,
» iis leur tranfportent l’invention & la perfe&ion de
» leur fcleiîCé ; ils feroient, cé femble, moins efti-
» mabies fi des ariciens n’avoient penfé comme eux;
»Dans Ces idées, ils ônt fouillé daiis les fiecles
» qui ont précédé le déluge. Moyfe dit dans la Ge-
» nefe, que les enfaûs de Dieu s'allièrent aux filles des
» hommes :dà-deffus Zofime Panopolite parle ainfi;
» il eft rapporté dans les Livres faints1 .qu’il y a des
»génies qui ont eu commerce avec les.femmes;
» Hermès en fait mention dkns fés livres fur la ïia-
» ture : il n’eft prefque point de livre reconnu ou
» apocryphe, oii l’on ne trouve des veftiges de cette
» tradition. Ces génies ayeuglés d’amour pour les
» femmes , leur découvrirent les merveilles de la
» nature; pour avoir appris aux hommes le mal &
» ce qui étoit inutile aux âmes, ils furent bannis du
» ciel : c’eft de ces génies qüe font venus les géansi
» Le. livre pù furent écritS’Ièurs fecrets, fut intitulé
» kernû j & de*là eft fprfi lè nom de Chimie.
» Voiià un dés plu$,anciéns.écnvains chimiftès,
» félon le témoignage de Çonringius : ce qu’il avance
»eft: appuyé d’un“ auteùri. beaucoup plus ancien.
» Ajoutons , dit Cleqaént d’Alexandrie dans fes ta-
» pifferies, que les anges choifis pour habiter le c iel,
» s’abandonnèrent aux plaifirs de l’amour : alors ils
» découvrirent aux Femmes des fecrets qu’ils de-
» voient cacher ; c’eft. d’eux que nous vient la con-
» noiffanCe de l’avenir, & ce qu’il y a de plus re-
» levé dans les Sciences. Il ne manque à ce témoin
» gnage, ajoüte Borrichius, que le terme de Chimie.
» Mais la Chimie n’eft-èlle pas comprife dans ce qu’il
» y à de pliis relevé dans lès Sciences? Ce qui em-
» bàrraffe cet auteur , c’eft la fource d’où Clément
» & Zofime ont tiré ce qu’ils avancent ; il décide ce-
» pendant qu’il-y a apparence,qu’ils ont lû ces faits
» dans tés fragmens1 des livres d’EnocK. Gqmmént
» douter de cela ? Lès. anges, dit Enoch, au rapport
» de Sin’c e l, apprirerif'àiix femmes Sc aux hommes
» des enchantemens & les remedes pour leur maia-
» die. Exael, le dixième des premiers anges, apprit
» aux hommes l’art de fabriquer des épées, des cui-
» rafles, les machines de gùèrré, les ouvrages d’or
» Sc d’argent qui peuvent plaire aux femmes, l ’u-
» îage des pierres précièufes Sc du fard. "Sincel , fe-
» Ion Borrichius, èft un aute.uf très-digne de foi ;
» plufieurs faits historiques forit'venus jufqu’à lui de
» Manethon, de Jule Africain, d’Eufebe ; d’ailleurs
» le paffage qu’on vient de lire, n’eft-il pas foûtenu
» de l’aiitorité deTertullien? Les anges qui ont pé-
» ch é, dit ce Pere, découvrirent aux hommes l’o r,
» l’argent, l’ art dé les travailler, d’orner les paupie-
» rcs, de teindre la laine ; c’eft pour cela que Dieu
» les condamna, comme le rapporte Enoch.
» Borrichius regarde ççs paflages comme des té-
» moignages authentiques : il dit cependant qu’E-
» noch s’eft trompé. Ces anges dont il parle ne font
» pas des véritables anges ; ce n’eft que les defeen-
» dans de Seth Sc de Tubalcain, peu dignes de leurs
» peres. Ils fe livrèrent aux plaifirs honteux avec
» fes femmes qui defeendoienr de Caïn : c’eft parmi
» ces voluptés, qu’ils divulguèrent les fecrets que
» Dieu leur avoit confiés. Après cette découverte,
» Borrichius laiffe paroître un remords ; ce n’eft
»pas fans peine qu’il reconnoît que la Chimie ne
» vient pas des anges : un paffage de l’Exode le con-
» foie. Dieu dit à Moyfe ; j’ai choifi Befeléel de la
» tribu de Juda, je l’ai rempli de l’efprit du Sei-
» gneur & de fagefie, pour travailler fur l’or , l’ar-
» gent, le cuivre, le marbre, les pierres précieufes,
» le bois ». Nouveau cours de Chimie , félon les principes
«/« Newton & de Stahl, Difc. prèlim.
Borrichius, après avoir un peu repris courage,
ajoûte une réflexion qui eft d’un digne & zélé chimifte
; c’ell que cet art de traiter les .métaux ,