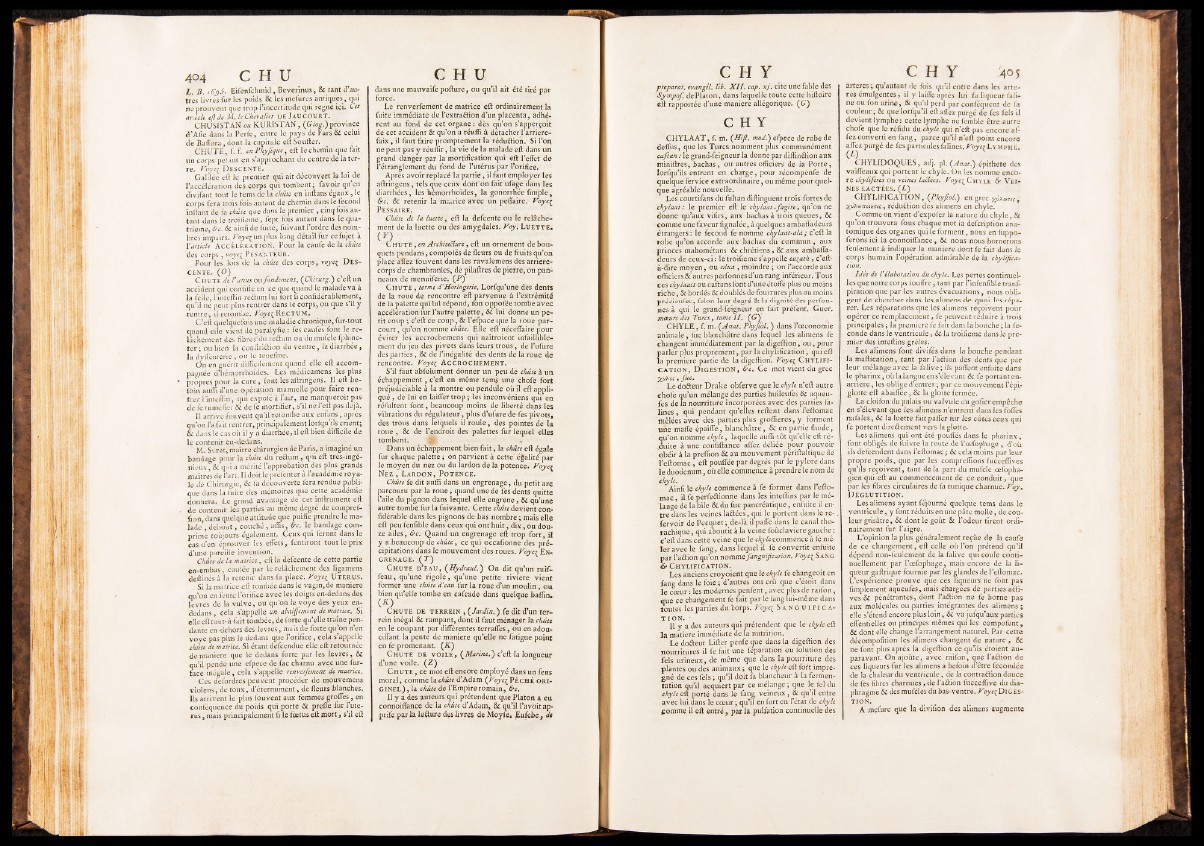
L . B. i (Fq5 . Eifenfchmid, Beverinus, & tant d’autres
livres fur les poids & les mefures antiques, qui
ne prouvent que trop l’incertitude qui régné ici. Cet
arnek e ft de U. le Chevalier DE J aUCOURT.
CHÜSISTAN ou KURISTAN, (Geog.) province
d ’Afie dans la Perle, entre le pays de Fars & celui
de Baffora, dont la capitale eft Soulier.
CHUTE, f. f. enPhyJique, eft le chemin que fait
u n c o rp s 'p e lan t en s’ap p ro chan t du cen tre de la terr
e . Voye^ D e s c e n t e .
Galilée eft le premier qui ait découvert la loi de
l ’accélération des corps qui tombent; favoir qu’en
divifant tout le tems de la chute en inftans égaux, le
corps fera trois fois autant de chemin dans le fécond
inftant de la chute que dans le premier , cinq fois autant
dans le troilieme, fept fois autant dans le quatrième,
&c. & ainfi de fuite, fuivant l’ordre des nombres
impairs. Voye{un plus long détail fur cefujet à
\article A c c é l é r a t io n . Pour la caufe de la chute
des corps , voye[ PeS A'NTEÛR.
Pour les lois de la chute des corps; voye^ D esc
e n te . (O)
C hute de l'anus ou fondement, ( Chirurg.) c’eftun
accident qui confifte en ce que quand.le malade va à
la felle, lîmeftin reflum lui fort fi confidérablement,
qu’il ne peut plus rentrer dans le corps, ou que s’il y
rentre , il retombe. Voye[ Re c tu m .
C’eft quelquefois une maladie chronique, fur-tout
quand eile vient de paralyfie : les caufes font le relâchement
des fibres1 du reflum ou dumufcle fphinc-
ter ; ou bien la conftriflion du ventre, la diarrhée,
la dyfl'enrerie , ou le tenefme.
On en guérit difficilement quand elle eft accompagnée
d’hémorrhoïdes. Les médicamens les plus
propres pour la cure, font les.aftringens. 11^ eft be-
l'oin aùfli d’une opération manuelle pour faire rentrer
l’inteftin, qui expofé à l’air, ne manqueroit pas
de fe tuméfier & de fe mprtifier, s’il ne l’elt pas déjà.
Il arrive fouvent qu’il retombe aux enfans, après
qu’on l’a fait rentrer, principalement lorfqu’ils crient;
& dans le cas où il y a diarrhée, il eft bien difficile de
le contenir èn-dedans. # J (
M. Suret, maître chirurgien de Paris, a imagine un
bàndagè pour la chute du refluai, qui eft très-ingénieux,
& qui a mérité l’approbation des plus grands
maîtres de l’art. II doit le préfenter à l’académie royale
de Chirurgie, & fa découverte fera rendue publique
dans la fuite des mémoires que cette académie
donnera». Le grand avantage de cet inftrument eft
de contenir les parties au même degré de compref-
fion, dans quelque attitude que puiffe prendre le malade
, debout, couché, aflis, &c. le bandage comprime
toujours également. Ceux qui feront dans le
cas d’en éprouver les effets, fentiront tout le prix
d’une pareille invention. .
Chute de U, matrice, eft la defeente de cette partie
en-embas, caulée par le relâchement des ligamens
deftinés à la retenir dans fa place. Voye{ Uté rus.
Si la matrice eft tombée dans le vagin, de maniéré
qu’on en fente l’orifice avec les doigts en-dedans des
levres de la vu lve, ou qu’on le voye des yeux en-
dedans , cela s’appelle un abaiffement de matrice. Si
elle eft tout-à-fait tombée, de forte qu’elle traîne pendante
en-dehors des levres, mais de forte qu’on n’en
voye pas plus le dedans que l’orifice, cela s’appelle.
chûte de matrice. Si étant defeendue elle eft retournée
de maniéré que le dedans forte par les levres, &
qu’il pende une efpece de fac charnu avec une fur-
face inégale, cela s’appelle renverfement de matrice.
Ces defordres peuvent procéder de mouvemens
violens, de toux, d’éternument, de fleurs blanches.
Ils arrivent le plus fouvent aux femmes groffes, en
conféquence du poids qui porte & prefl'e fur l’ute-
rus, mais principalement fi le foetus eft mort, s’il eft
dans une mauvaife pofture, ou qu’il ait été tiré par
force.
Le renverfement de matrice eft ordinairement la
fuite immédiate de l’extraftion d’un placenta, adhérent
au fond de cet organe : dès qu’on s’apperçoit
de cet accident & qu’on a réufli à détacher l’arriere-
fa ix, il faut faire promptement la réduflion. Si l’on
ne peut pas y réuflir, la v ie de la malade eft dans un
grand danger par la mortification qui eft l’effet de
l’étranglement du fond de l’utérus par l’orifice.
Après avoir replacé la partie, il faut employer les
aftringens, tels que ceux dont ôn fait ùfa'gè dans les
diarrhées, les hémorrhoïdes, la gonorrhée fimple ,
&c. & retenir la matrice avec un peffaire. Voye^
Pessaire.
Chiite de la luette, eft la defeente ou’ le relâchement
de la luette ou des amygdales. Vcjy. Lu e t t e .
m
C h u t e , en Architecture, eft un ornement de bouquets
pendans, compofés de fleurs ou de fruits qu’on
place allez fouvent dans les ravalemens des arriere-
corps de chambranles, de pilaftres de pierre, ou panneaux
de menuiferie. (T)
C hu te , terme d'Horlogerie, Lorfqu’une des dents
de la roue de rencontre eft parvenue à l’extrémité
de la palette qui lui répond, fon oppofée tombe avec
accélération lur l’autre palette, & lui donne un petit
coup ; c’eft ce coup, & l’efpace que la roue parcourt,
qu’on nomme chute. Elle eft néceffaire pour
éviter les accrochemens qui naîtroient infailliblement
du jeu des pivots dans leurs trous, de l’ufure
des parties, & de l’inégalité des dents de la roue de
rencontre. Voyeç A c c r o c h em e n t .
S’il faut absolument donner un peu de chute à un
échappement, c’eft en même tems une chofe fort
préjudiciable à la montre ou pendule où il eft appliqué
, de lui en laiffer trop ; les inconvéniens qui en
réfultent font, beaucoup moins de liberté dans les
vibrations du régulateur, plus d’ufure de fes pivots,
des trous dans lefquels il roule, des pointes de la
roue , &c de l’endroit des palettes fur lequel elles
tombent. wm *
Dans un échappement bien fait, la chute eft égale
fur chaque palette ; on parvient à cette égalité par
le moyen du nez ou du lardon de la potence. Voye^
Nez , L a r d o n , Po t en c e .
Chute fe dit aufli dans un engrenage, du petit arc
parcouru par la roue, quand une de fes dents quitte
l’aile du pignon dans lequel elle engrene, & qu’une
autre tombe fur la fuivante. Cette chute devient con-
fidérable dans les pignons de bas nombre ; mais elle
eft peu fenfible dans ceux qui ont huit, dix, ou douze
ailes, &c. Quand un engrenage eft trop fort, il
y a beaucoup de chute, ce qui occafionne des précipitations
dans le mouvement des roues. Voye{ Engrenage.
( T )
C h u te d’e a u , ( Hydraul. ) On dit qu’un rui£>
feau, qu’une rigole, qu’une petite riviere vient
former une chute d'eau fur la roue d’un moulin, ou
bien qu’elle tombe en cafcade dans quelque baflin.
H .
C hute de terrein , ( Jardin. ) fe dit d’un ter-
rein inégal & rampant, dont il faut ménager la chute
en le coupant par différentes terralfes, ou en adou-
ciffant la pente de maniéré qu’elle ne fatigue point
en fe promenant. (/£)
C hu te de v o il e , ( Marine.) c’eft la longueur
d’une voile. (Z )
C hute , ce mot eft encore employé dans un fens
moral, comme la chute d’Adam ([Voye{ PÉCHÉ orig
in e l ) , la chute de l’Empire romain, &c.
Il y a des auteurs qui prétendent que Platon a eu
connoiffance de la chute d’Adam, & qu’il Favoit ap-
prife par la leflure des livres de Moyfe, Eufcbc, de
préparai, evangél. lib. X I I . cap. x j. cite urte fable des
Sympof. de Platon, dans laquelle toute cette hiftoirc
eft rapportée d’une maniéré allégorique. (G)
C H Y
CH Y LA A T , f. m. (Hifl. mod.') efpece de robe de
deffus, que les Turcs nomment plus communément
caftan : le grand-feigneur la donne par diftinftion aux
miniftres, bachas, ou autres officiers de la Porte,
lorfqu’ils entrent en charge, pour récompenfe de
quelque fervice extraordinaire, ou même pour quelque
agréable nouvelle.
Les courtifans du fultan diftinguent trois fortes de
chylaat: le premier eft le chylaat -fagire, qu’on ne
donne qu’aux vifirs, aux bachas à trois queues, &
comme une faveur fignalée, à quelques ambaffadeurs
étrangers: le fécond fe nommé chylaat-ala; c’eft la
robe qu’on accorde aux bâchas du commun, aux
princes mahométans & chrétiens, & aux ambaffa-
deurs de ceux-ci : le troifième s’appelle cu^ath, c’eft-
à-dire moyen, ou edua , moindre ; on l’accorde aux
officiers& autresperfonnesd’un rang inférieur. Tous
ces chylaats ou caftans font d’une étoffe plus ou moins
riche, & bordés & doublés de fourrures plus ou moins
précieufes, félon leur degré & la dignité des perfon-
hes à qui le grand-feigneur en fait préfent. Guer.
moeurs des Turcs, tome II. (G)
CH Y L E , f. m. (Anat. Phyjiol. ) dans l’oeconomie
animale, fuc blanchâtre dans lequel les alimens fe
changent immédiatement par la digeftion, ou, pour
parler plus proprement, par la chylification, qui eft
la première partie de la digeftion. Voye[ C h y l if i-
c a t io n , D ig e s t io n , &c. Ce mot vient du grec
yyhoç, fuc. _
Le dofteur Drake obferve que le chyle n’eft autre
chofe qu’un mélange des parties huileufes & aqueu-
fes de la nourriture incorporées avec des parties fa-
lines, qui pendant qu’elles relient dans Feftomac
mêlées avec des parties plus grofîieres, y forment
une maffe épaiffe, blanchâtre, & en partie fluide,
qu’on nomme chyle, laquelle aufli-tot qu’elle eft re-
.duite à une confiftance affez déliée pour pouvoir
obéir à la preffion & au mouvement périftaltique de
l’eftomac, eft pouffée par degrés par le pylore dans
le duodénum, où elle commence à prendre le nom de
chyle.
Ainfi le chyle commence à fe former dans l’eftomac
, il fe perfefliomîe dans les inteftins par le mélange
de la bile & d u fuc pancréatique, enfuite il entre
dans les veines laflées, qui le portent dans le r e - ,
fervoir de Pecquet ; de-là il paffe dans le canal tho-
rachique, qui aboutit à la veine foûclaviere gauche :
c ’eft dans cette veine que le chyle commence à fe mêler
avec le fang, dans lequel il fe convertit enfuite
par l’aflion qu’on nomme fanguif cation. VoyeiSAKG
& C h y l if ic a t io n .
Les anciens croyoient que le chyle fe changeoit en
fang dans le foie ; d’autres ont crû que c’étoit dans
le coeur : les modernes penfent, avec plus de raifon,
que ce changement fe fait par le fang lui-même dans
toutes les parties du ’corps. Viye{ S a n g u i f i c a t
i o n . •
Il y a des auteurs qui prétendent que le chyle eft
la matière immédiate de la nutrition. /
Le dofteur Lifter penfe cjue dans la digeftion des
nourritures il fe fait une feparation ou folution des
fels urineux, de même que dans la pourriture des
plantes ou des animaux ; que le chyle eft foft imprégné
de ces fels ; qu’il doit fa blancheur à la fermentation
qu’il acquiert par ce mélange ; que le fel du
chyle eft porté dans le fang veineux, & qu’il entre
avec lui dans le coeur ; qu’il en fort en l’état de chyle
comme il eft entré, par la pullation continuelle des
arteres; qu’autant de fois qu’il entre dans les artères
émulgentes, il y laiffe après lui fa liqueur fali-
ne ou fon urine, & qu’il perd par conféquent de fa
couleur ; & que lorfqu’il eft affez purgé de fes fels il
devient lymphe : cette lymphe ne femble être autre
chofe que le réfidu du chyle qui n’eft pas encore affez
converti en fang, parce qu’il n’eft point encore
affez purgé de fes particules lalines. Voye.ç L ym ph e .
SmBM I H
CHYLIDOQUES, adj. pl. (Anat.) épithete des
vaiffeaux qui portent le chyle. On les nomme encore
chylifères ou veines lactées. Voye^ C hyle & VEINES
l a c t é e s . (L)
CHYLIFICATION, (Phyjiol.) en grec xô'Kmiçÿ
XuXûùTroiwric, réduflion des alimens en chyle.
Comme on vient d’expofer la nature du chyle, &
qu’on trouvera fous chaque mot la defeription anatomique
des organes qui le forment, nous en fuppo-
ferons ici la connoiffance, & nous nous bornerons
feulement à indiquer la maniéré dont fe fait dans le
corps humain l’opération admirable de la chyüfica~
don.
Idée de l'élaboration du chyle. Les pertes continuelles
que notre corps fouffre, tant par l’infenfible tranf-
piration que par les autres évacuations, nous obligent
de chercher dans les alimens de quoi les réparer.
Les réparations que les alimens reçoivent pour
opérer ce remplacement, fe peuventTéduire à trois
principales ; la première fe fait dans la bouche ; la fécondé
dans le ventricule, & la troifieme dans le premier
des inteftins grêles.
Les alimens font divifés dans la bouche pendant
la mafticarion, tant par l’aftion des dents que par
leur mélange avec la falive ; ils paffent enfuite dans
le pharinx, où la langue en s’élevant & fe portant en-
arriere, les oblige d’entrer ; par ce mouvement l’épiglotte
eft abaiffée, & la glotte fermée.
La cloifon du palais ou valvule du gofier empêche
en s’élevant que les alimens n’entrent dans les foffes
nafales, & la luette fait paffer fur les côtés ceux qui
fe portent direftement vers la glotte.
Les alimens qui ont été pouffes dans le pharinx ,
font obligés de fuivre la route de l’oefophage , d’où
ils defeendent dans l’eftomac; & cela moins par leur
propre poids, que par les comprenions fucceflives
qu’ils reçoivent, tant delà part du mufcle oefopha-
gien qui eft au commencement de ce conduit, que
par les fibres circulaires de fa tunique charnue. Voy.
D é g l u t it io n .
Les alimens ayant féjourné quelque tems dans le
ventricule, y font réduits en une pâte molle, de couleur
grisâtre, & dont le goût & l’odeur tirent ordinairement
fuf l’aigre.
L’opinion la plus généralement reçûe de la caufe
de ce changement, eft celle où l ’on prétend qu’il
dépend non-feulement de la falive qui coule continuellement
par l’oefophage, mais encore de la liqueur
gaftrique fournie par les glandes de l ’eftomac.
L’expérience prouve que ces liqueurs ne font pas
Amplement aqueufes, mais chargées de parties afti-
ves & pénétrantes, dont l’aflion ne fe borne pas
aux molécules ou parties intégrantes des alimens ;
elle s’étend encore plus loin, & va julqu’aux parties
effentielles ou principes mêmes qui les compofent,
& dont elle change l’arrangement naturel. Par cette
décompofition les alimens changent de nature , &
ne font plus après la digeftion ce qu’ils étoient auparavant.
On ajoûte, avec ràifon, que l’aflion de
ces liqueurs fur les alimens a befoin d’être fécondée
de la chaleur du ventricule, de la contraflion douce
de fes fibres charnues, de l’aflion fucceffive du diaphragme
& des mufcles du bas-ventre. Voye[ D igest
io n .
A mefure que la divifion des alimens augmente