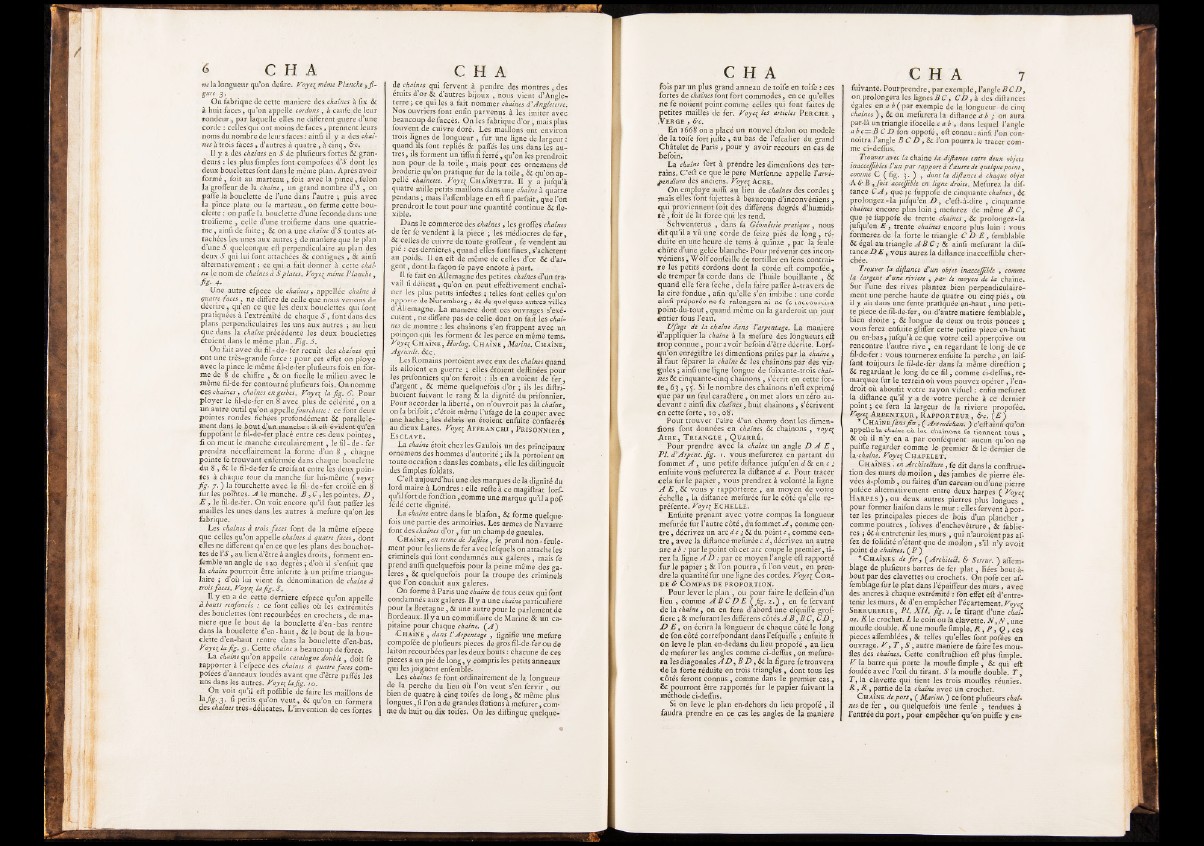
ne la longueur qu’on defire. Voyez même Planche y figure
g.
On fabrique de cette maniéré des chaînes à üx &
à huit faces, qu’on appelle cordons , à caufe de leur
rondeur, par laquelle elles ne different guère d’une
corde : celles qui ont moins de faces, prennent leurs
noms du nombre de leurs faces : ainfi il y a des chaînes
à trois fàces , d’autres à quatre , à cinq, &c.
Il y a des chaînes en S de plufieurs fortes & grandeurs
: les plus fimples font compofées d’51 dont les
deux bouclettes font dans le même plan. Après avoir
formé , foit au marteau , foit avec la pincé, félon
|a groffeur de la chaîne, un grand nombre d’i 1, on
paffe la bouclette de l’une dans l’ autre ; puis avec
la pince plate ou le marteau, on ferme cette bouclette
: on palfe la bouclette d’une fécondé dans une
troifieme , celle d’une troifieme dans une quatrième
, ainfi de fuite ; & on a une chaîne d'S toutes attachées
les unes aux autres ; de maniéré que le plan
d’une S quelconque eft perpendiculaire au plan des
deux S qui lui font attachées & contiguës , & ainfi
alternativement : ce qui a fait donner à cette chaîne
le nom de chaînes à S plates. Voyez même Planche,
f ië - 4-
Une autre efpece de chaînes, appellée chaîne à
quatre faces , ne différé de celle que nous venons de
décrire, qu’en ce que les deux bouclettes.qui font
pratiquées à l’extrémité de chaque S , font dans des
plans perpendiculaires les uns aux autres ; au. lieu
que dans la chaîne précédente les deux bouclettes
étoient dans le même plan. Fig. 6.
On fait avec du fil-de -fer recuit des chaînes qui
ont une très-grande fprce : pour cet effet on ployé
avec la pince le même fil-de-fer plufieurs fois en forme
de 8 de chiffre , & on ficelle le milieu avec le
même fil-de-fer contourné plufieurs fois. On nomme
ces chaînes , chaînes en gerbes. Voyez la fig. 6\ Pour
ployer le fil-de-fer en 8 avec plus de célérité, on a
un autre outil qu’on appelle fourchette : ce font deux
pointes rondes fichées profondément & parallèlement
dans le bout d’un manche : il eft é vident qu’en
fuppofant le fil-de-fer placé entre ces deux pointes,
li oh meut le manche circulairement, le fil - de - fer
prendra néceffairement la forme d’un 8 , chaque
pointe fe trouvant enfermée dans chaque bouclette
du 8 , & le fil-de-fer fe croifant entre les deux pointes
à chaque tour du manche fur lui-même ( voyez
fig. y. ) la fourchette avec le fil-de-fer croife en 8
fur les poiTttes. A le manche. B , C , les pointes. D ,
E t le fil-de-fer. On voit encore qu’ il faut paffer les
mailles les unes dans les autres à mefure qu’on les
fabrique.
Les chaînes à trois faces font de la même efpece
que celles qu’on appelle chaînes à quatre faces, dont
elles ne different qu’en ce que les plans des bouchet-
tes de l’i 1, au lieu d’être à angles droits, forment en-
femble un angle de 1 10 degrés ; d’oîi il s’enfuit que
la chaîne pourroit être infcrite à un prifme triangulaire
; d’où lui vient fa dénomination de chaîne à
trois faces. Voyez la fig. 8.
Il y en a de cette derniere efpece qu’on appelle
a bouts renfoncés : ce font celles où les extrémités
des bouclettes font recourbées en crochets, de maniéré
que le bout de la bouclette d’en-bas rentre
dans la bouclette «d’en-haut, & le bout de la bouclette
d’en-haut rentre dans la bouclette d’en-bas.
Vjyei la fig. C). Cette chaîne a beaucoup de force.
La chaîne qu’on appelle catalogne double , doit fe
rapporter à l’efpece des chaînes à quatre faces compofées
d’anneaux foudés avant que d’être paffés les
uns dans les autres. Voye{ la fig. io.
On voit qu’il eft poflible de faire les maillons de
& fig- 3 • petits qu’on v eu t, & qu’on en formera
des chaînes très-délicates. L ’invention de ces fortes
de chaînes qui fervent à pendre des montres , des
etuits d or & d’autres bijoux , nous vient d’Angleterre
; ce qui les a fait nommer chaînes d'Angleterre*
Nos ouvriers font enfin parvenus à les imiter avec
beaucoup de fuccès. On les fabrique d’o r , mais plus
fouvent de cuivre doré. Les maillons ont environ
trois lignes de longueur , fur une ligne de largeur :
quand ils font repliés & paffés les uns dans les , autres,
ils forment un tiffu fi ferré, qu’on les prendroit
non pour de la to ile , mais pour ces ornemens dé
broderie qu’on pratique fur de la toile, & qu’on appelle
chaînette. Voyez C haînette. Il y a jufqu’à
quatre mille petits maillons dans une chaîne à quatre
pendans ; mais l’affemblage en eft fi parfait, que l’oit
prendroit le tout pour une quantité continue & flexible.
Dans le commerce des chaînes , les groffes chaînes
de fer fe vendent à la piecè ; les médiocres de fe r ,
& celles de cuivre de toute groffeur, fe vendent au
pie : ces dernieres , quand elles font fines, s’achètent
au poids. Il en eft de même de celles d’or & d’argent
, dont la façon fe paye encote à parti
Il le fait en Allemagne des petites, chaînesd'un travail
fi délicat., qu’on en peut effeâivement enchaîner
les plus petits infè&es ; telles font celles qu’on
apporte de Nuremberg, & de quelques autres villes
d Allemagne. La maniéré dont ces ouvrages s’exécutent
,. ne différé pas de celle/dont on fait les chaînas
de montre : les chaînons s’en frappent avec un
poinçon qui les forment & les perce en même tems.
Voycy C H AÎNÉ, Horlog. C haîne , Marine. CHAÎNÉ,
Agricult. & c .
Les Romains portoient avec eux des chaînes quand,
ils allpient en guerre ; elles étoient dëftinées pour
les prifonniers qu’on feroit : ils en a voient de fe r ,
d’argent, & même quelquefois d’or ; ils les diftri-
buoient fuivant le rang & la dignité du prifonnier.
Pour accorder la liberté, on n’ouvroit pas la chaîne,
on la brifoit ; c ’étoit même l’ufage de la couper avec
une hache ; les débris en étoient enfuitë confacrés
au dieux Lares. Voyez Af franch i , Prisonnier
Es c l a v e .
La chaîne etoit chez les Gaulois un des principaux
ornemens des hommes d’autorité ; ils la portoient en
toute occafion : dans les combats, elle les diftinguoit
des fimples foldats.
C ’eft aujourd’hui une des marques de la dignité du
lord maire à Londres : elle refte à ce magiftrat lorf-
qu’il fort de fondion, comme une marque qu’il a pof-
fédé cette dignité.
La chaîne entre dans le blafon, & forme quelquefois
une partie des armoiries. Les armes de Navarre
font des chaînes d’o r , fur un champ de gueules.
C haîne , en terme de Jufiice, fè prend non-feulement
pour lesliens de fer avec lefquels on attache les
criminels qui font condamnés aux galeres , mais fe
prend aufli quelquefois pour la peine même des galères
, & quelquefois pour la troupe des criminels
que l’on conduit aux galeres.
On forme à Paris une chaîne de tous ceux qui font
condamnés aux galeres. Il y a une chaîne particulieré
pour la Bretagne, & une autre pour le parlement de
Bordeaux. Il y a un commiffaire de Marine & un capitaine
pour chaque chaîne. (A )
C haîne , dans VArpentage , fignifie une mefure
compofée de plufieurs pièces de gros fil-de-fer ou de
laiton recourbées par les deux bouts : chacune de ces
pièces a un pié de long, y compris les petits anneaux
qui les joignent enfemble.
Les chaînes fe font ordinairement de la longueur
de la perche du lieu où l’on veut s’en fervir, ou
bien de quatre à cinq toifes de long, & même plus
longues, fi l’on a de grandes ftations à mefurer, comme
de huit ou dix toifes. On les diftingue quelqueibïs
par .un plus grand anneau de toife en toife : ces
fortes de chaînes font fort commodes, en ce qu’elles
ne fe nouent point comme celles qui font faites de
petites maillés de fer. Voyel les articles Perche ,
.Verge , &ç.
En 1668 on a placé un nouvel étalon ou modèle
de la toife fort ju fte, au bas de l’efcalier du grand
Châtelet de Paris , pour y avoir recours en cas de
befoin.
La chaîne fert à prendre les dimenfions des ter?
rains. C ’eft ce que le pere Merfenne appelle Yarv.i-
pendium dés anciens. Voyez Acre.
On employé aufli au lieu de chaînes des cordes ;
mais elles'foïit fujettes à beaucoup d’inconvéniens,
qui proviennent fpit des différens degrés d’humidité
, foit dé la forcé qui les tend.
S ch venter us , dans fa Géométrie pratique , nous
'dit qu’il a yû une corde de feize pies de lpng , reT
cluite en une heure de tems à quinze , par la feule
chute d’iïnè gelée blançhe- Pour prévenir ces incon-
,vénièns, W o lf confeille de tortiller en fens contraire
les petits cordons dont la corde eft compofée.,
de tremper la corde dans de l’huile bouillante , &
quand elle fera feche, delà faire paffer à-travers de
la cire fondue , afin qu’elle s’en imbibe : une corde
ainfi préparée ne fe ralongera ni ne fe raccourcira
point-du-tout, quand même on la garderoit un jour
entier fous l’eau.
Ufage de la chaîne élans Varpentage. La maniéré
d ’appliquer la chaîne à la mefure des longueurs, eft
trop connue, pour avoir befoin d’être décrite. Lorf-
qu’on enregiftre les dimenfions prifes par la chaîne ,
il faut féparer la chaîne & les chaînons pair des virgules;
ainfi une ligne longue de foixante-trois chaînes
& cinquante-cinq chaînons ,. s’écrit en cette fort
e , 6 3 ,5 5. Si le nombre des chaînons n’eft exprimé
que par un feul carattére, on met alors un zéro au-
devant : ainfi dix chaînes,, huit chaînons, s’écrivent
en cette forte ", 10,08. ■
Pour trouver l’aire d’un champ, dont les dimen-
fions font données en chaînes & chaînons , voye{
A ir e , T r ian g l e , Q u arr£.
Pour prendre avec la chaîne, un angle D A E ,
PI. d'Arpent, fig. 1. vous mefurerez en partant du
fommet A , une petite diftance jufqu’en d&çenc ;
enfuite vous mefurerez la diftance d c. Pour tracer
cela fur le papier, vous prendrez à volonté la ligne
A E , & vous y rapporterez , au moyen de votre
échelle , la diftance mefurée fur le côté qu’elle repréfente.
Voyez Ech elle.
Enfuite prenant avec votre compas la longueur
méfurée fur l’autre cô té, du fommet A , comme centre
, décrivez un arc de ; & du point c , comme centre
, avec ia diftance mefurée c d , décrivez un* autre
àrc a b : par le point où cet arc coupe le premier, tirez
la ligne A D : par ce moyen l’angle eft rapporté
lur le papier ; & l’on pourra, fi l’on v eu t, en prendre
la quantité fur une ligne des cordes. Voyeç, C ord
e & C ompas de pr opo r t ion .
Pour lever le plan , ou pour faire le deffein d’un
lieu , comme A B C D E ( fig. 2. ) , en fe feryant
de la chaîne , on en fera d’abord une efquiffe grof-
fiere ; & mefurant les différens côtés A B ,B Ç, C D ,
D E y on écrira la longueur de chaque côté le long
de fon côté correfpondant dans l’efquîffe ; enfuite fi
on leve le plan en-dedans du lieu propofé , au lieu
de mefurer les angles comme ci-deffus, on mefure-
ra les diagonales A D , B D yèc la figure fe trouvera,
de la forte réduite en trois triangles , dont tous les.
côtés feront connus, comme dans le premier ca s ,
& pourront être rapportés fur le papier fuivant la
méthode ci-deffus.
Si on leve le plan en-dehors du lieu propofé , il
faudra prendre en ce cas les angles de la maniéré
fuivantë. Pour prendre, par exemple, l’angle B C D ,
on.prolongera les lignes B C , C D , à des diftances
égalés en a b ( par exemple de la longueur de cinq
chaînes ) , & on mefurera la. diftance a b ; on aura
par-là un triangle ifocelle.c <z £ , dans lequel l’angle
a igH e l Ü ^ °PP°1® » connu : ainfi l’on connoitra
l’angle B C D , & .l’on pourra le tracer comme
ci-deffus.
Trouver avec la chaîne la dijlance entre deux objets
inaccefjibles l'un par rapporta l'autre de quelquepoint,
comme C ( fig. 3. ) , dont la diftance à chaque objet
A & B , fo.it acceffible en ligne droite. Mefurez la diftance
C A , que je fuppofe de cinquante chaînes, &
prolongez r la jufqu’ën D , c’eft-à-dire , cinquante
chaînes encore plus loin ; mefurez de même B C ,
que je fuppofe de trente'chaînes , & prolongez-la
jufqu’en E , trente chaînes encore plus loin : vous
formerez de la forte le triangle C D E , femblable
& égal au triangle A B C ; & ainfi mefurant la diftance
D E , vous aurez la diftance inacceflible cherchée.
Trouver la diftance d'un objet inaccefjible , comme
la largeur, d'une riviere , par le moyen de la chaîne.
Sur l’une des rives plantez bien perpendiculairement
une perche haute de quatre ou cinq pies, où
il y ait dans une fente pratiquée en-haut, une petite
pie.ee dejfibde-fer, ou d’autre matière femblable ,
bien droite ; & longue de deux ou trois, pouces ;
vous ferez enfuite gliffer cette petite piece'en-haut
ou en:b.as, jufqu’à ce que votre oeil apperçoive ou
rencontre l’autre rive , en regardant lê long de ce
fil-de-fer : vous tournerez enfuite la perche, en laif-
fant toujours le fil-de-fer dans la même dire&ion ;
& regardant le long de ce f i l , comme ci-deffus, remarquez
fur le terrein où vous pouvez opérer, l’endroit
où aboutit votre rayon vifuel : enfin mefurez
la difta,nce. qu’il y a de vo tre perche à ce dernier
point ; ce fera la largeur de la riviere propofée.
Voyez Arren te vr , Ra p p o r t e u r , & c. ( E )
C h AÎNÉ f in s fin , ( Areméchan, ) g’eft ainfi qu’on
appelle la chaîne, oh les chaînons fe tiennent tous ,
& ou il n y en a par confequent aucun qu’on ne
puiffe regarder comme le premier & le dernier de
la-chaîne. Voyez C ha p e le t .
C haînes : eh Architecture-, fe dit dans la conftruc-
tiqn des piurs demoilon, des jambes de pierre élevées
à-plomb, ou faites d’un carcan ou d’une pierre
poléee alternativement entre deux harpes ( Voyez
Harpes ou deux autres pierres plus longues ,
pour former liaifon dans le mur : elles fervent à porter
les. principales pièces de bois d’un plancher ,
comme poutres, fbîives d’enchevêtrure, & faillie-
res ; & à entretenir les murs , qui n’auroient pas af-
fez de folidité n’étant que de mpilon , s’il n’y avoit
point de chaînes. ( P )
-C haînes de fer, ( Architect. & Serrur. ) affem-
blage de. plufieurs barres de fer p la t , liées bout-à-
bout par des clavettes ou crochets. On pofe cet af-
femblagefur le plat dans l ’épaiffeur des murs, avec
des ancres à chaque extrémité : fon effet eft d’entretenir
les murs, & d’en empêcher l’écartement. Voyez
Serrurerie, PI. X I I . f ig .,. le tirant d’une chaîne.
A le crochet. L le coin ou la clavette. N , N , une
moufle double. K une moufle fimple. R , P , Q , ces
pièces affemblées, & telles qu’elles font pofées en
ouvrage. V , T , S , autre maniéré de faire les moufles
des chaînes. Cette conftruâion eft plus fimple.
V la barre qui porte la moufle fimple , & qui eft
foudée avec l’oeil du tirant. S la moufle double. T ,
T , la clavette qui tient les trois moufles réunies.
R , R , partie de la chaîne avec un crochet.
C haîne de port, ( Marine. ) ce font plufieurs chaînes,
de fer , ou quelquefois une feule , tendues à
l’entrée du port, pour empêcher qu’on puiffe y en