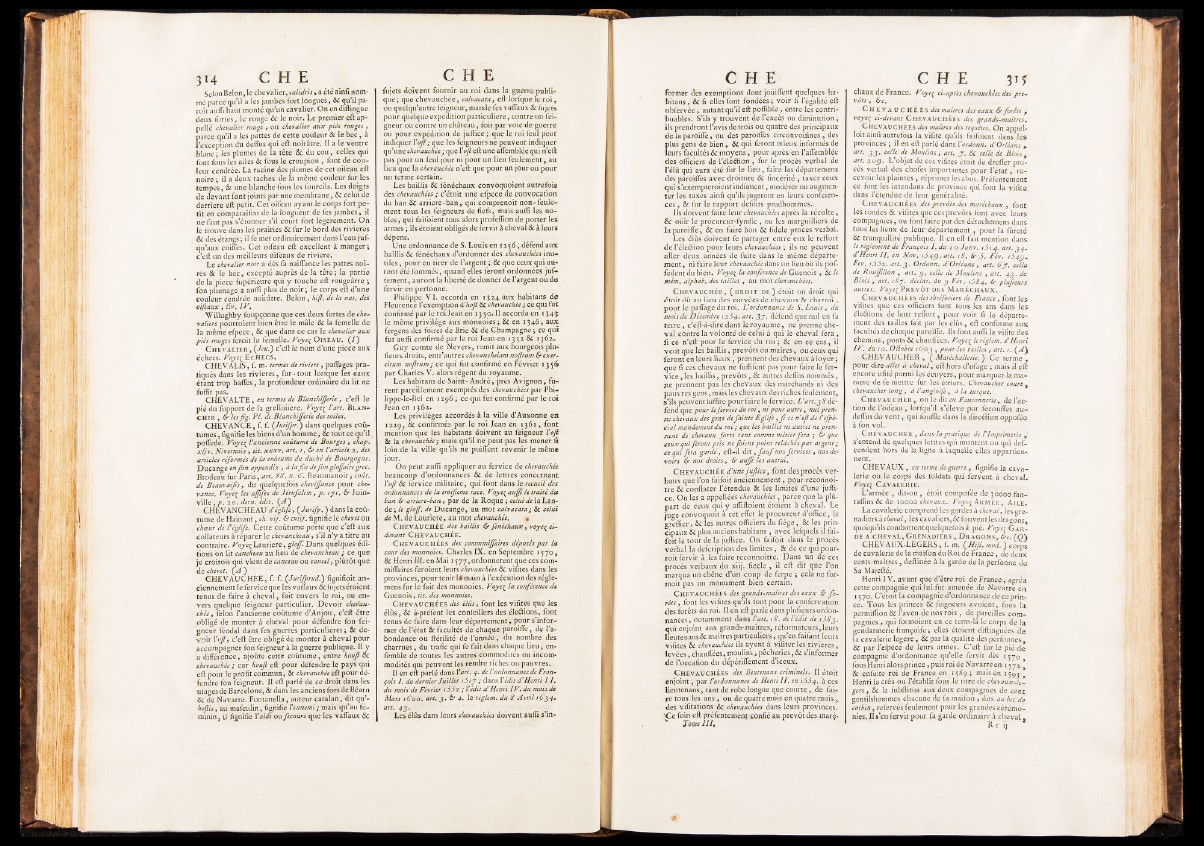
Selon Belon, le chevalier, calidris, a été ainfi nommé
parce qu’il a les jambes fort longues, & qu’il pa-
roît aufli haut monté qu’un cavalier. On en diftingue
<leux fortes, le rouge & le noir. Le premier eft appelle
chevalier rouge , ou chevalier aux pies rouges ,
parce qu’il a les pattes de cette couleur & le b ec, à
l ’exception du deffus qui eft noirâtre. Il a le ventre
blanc ; les plumes de la tête & du cou, celles qui
font fous les ailes & fous le croupion , font de couleur
cendrée. La racine dès plumes de cet oifeau eft
noire ; il a deux taches de la même couleur fur les
tempes, & une blanche fous les fourcils. Les doigts
de devant font joints par une membrane, & celui de
derrière eft petit. Cet oifeau ayant le corps fort petit
en comparaifon de la longueur de fes jambes, il
ne faut pas s’étonner s’il court fort legerement. On
le trouve dans les prairies & fur le bord des rivières
& des étangs ; il fe met ordinairement dans l ’eau j-uf-
qu’aux cuiffes. Cet oifeau eft excellent à manger;
c ’eft un des meilleurs oifeaux de riviere.
Le chevalier noir a dès fa naiffance les pattes noires
& le bec, excepté auprès de la tête ; la partie
de la piece fupérieure qui y touche eft rougeârre ;
fon plumage a aufti plus de noir; le corps eft d’une
couleur cendrée noirâtre. Belon, hifi. de la nat, des
oifeaux , liv. IV.
Willughby foupçonne que ces deux fortes de chevaliers
pourroient bien être le mâle & la femelle de
la même efpece, & que dans ce cas le chevalier aux
pies rouges feroit la femelle. Voye^ O iseau. ( / )
C hev alier , (/««.) c’eft le nom d’une piece aux
échecs. Voye^ Ech e cs .
CHEVALIS, f. m. termes de riviere, paffages pratiqués
dans les rivières, fur - tout lorfque les eaux
étant trop baffes, la profondeur ordinaire du lit ne
fuffit pas.
CHEVALTE, en termes de Blanchifferie , c’eft le
pié du fupport de la grelloiiere. Voye{ l'art. Blanch
ir , 6* lesfig. PI. de Blanchifferie des toiles.
CHEVANCE, f. f. ([Jurijpr.) dans quelques coutumes
, lignifie les biens d’un homme, & tout ce qu’il
poffede. Voye^ l'ancienne coutume de Bourges , chap.
xljv. Nivernois , tit. xxxv. art. i. & en l'article z. des
articles réformés de la coutume du duché de Bourgogne.
Ducange en fon appendix , à la fin defon gloffaire grec.
Brodeau fur Paris, art. 88. n. <8. Beaumanoir, coût,
de Beauvaifis, dit quelquefois chevifjance pour che-
vance. Voye{ les affifes de Jérufalem, p. iyi. & Joinville
, p. zo . dern. édit. (A')
CHEVANCHEAU d'èglife, ( Jurifp. ) dans la coû-
tume de Hainaut, ch. vif. & cviij. lignifie le chevet ou
choeur de l'églife. Cette coutume porte que c’eft aux
collateurs à réparer le chevancheau, s’il n’y a titre au
contraire. Voye[Lzunere, gloff. Dans quelques éditions
on lit cancheau au lieu de chevancheau ; ce que
je croirois qui vient de canceau ou cancel, plutôt que
de chevet. ÇA )
CHEVAUCHÉE, f. f. ÇJurifprudJ) fignifioit anciennement
le fer vice que les vaffaux &: fujets étoient
tenus de faire à cheval, foit envers le roi, ou en vers
quelque feigneur particulier. Devoir chevauchée,
félon l’ancienne coutume d’Anjou, c’eft être
obligé de monter à cheval pour défendre fon feigneur
féodal dans fes guerres particulières; & devo
ir Y ofi, c’eft être obligé de monter à cheval pour
acco'.mpagner fon feigneur à la guerre publique. Il y
a différence, ajoûte cette coûtume, entre houfi oc.
chevauchée ; car houfi eft pour défendre le pays qui
eft pour le profit commun, & chevauchée eft pour défendre
fon feigneur. Il eft parlé de ce droit dans les
ufages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn
& de Navarre. Fontanella, auteur catalan, dit qu’-
hofiis, au mafculin, fignifie l’ennemi ; mais qu’ au féminin
, il fignifie l'aide ou fecours que les vaffaux ôc
fujets doivent fournir au roi dans la guérre publique
; que chevauchée, calvacata, eft lorfque le ro i,
ou quelqu’autre feigneur, mande fes vaffaux & fujets
pour quelque expédition particulière, contre un feigneur
ou contre un château, foit par voie de guerre
ou pour expédition de juftice ; que le roi feul peut
indiquer l'ofi ; que les feigneurs ne peuvent indiquer
qu’une chevauchée ; que l'ofi eft une affemblée qui n’eft
pas pour un feul jour ni pour un lieu feulement, au
lieu que la chevauchée n’eft que pour un jour ou pour,
un terme certain.
Les baillis & fénéchaux convoquoient autrefois
des chevauchées ; c’étoit une efpece de convocation
du ban & arriéré-ban, qui comprenoit non-feulement
tous les feigneurs de fiefs, mais aufli les nobles,
qui faifoient tous alors profeflion de porter les
armes ; ils étoient obligés de lervir à cheval & à leurs
dépens.
Une ordonnance de S. Louis en 1 15 6, défend aux
baillis & fénéchaux d’ordonner des chevauchées inutiles
, pour en tirer de l’argent ; & que ceux qui au*,
ront été fommés, quand elles feront ordonnées juf-
tement, auront la liberté de donner de l’argent ou de
fervir en perfonne.
Philippe V I . accorda en 13x4 aux habitans de
Fleurence l’exemption à'ho f i &c chevauchée ; ce qui fut
confirmé par le roi Jean en 13 50. Il accorda en 1345.
le même privilège aux monnoies ; & en 1346, aux
fergens des foires de Brie & de Champagne ; ce qui
fut aufli confirmé par le roi Jean en 1351 & 1361.
Guy comte de Nevers, remit aux bourgeois plu-
fieurs droits, entr’autres chevaucheiam nofiram & exer-
citum nofirum; ce qui fut confirmé en Février 1356
par Charles V. alors régent du royaume.
Les habitans de Saint - André, près Avignon, furent
pareillement exemptés des chevauchées par Phi-
lippe-le-Bel en 1296 ; ce qui fut confirmé par le roi
Jean en 1361.
Les privilèges accordés à la ville d’Auxonne en
1229, & confirmés par.le roi Jean en 136 1 , font
mention que les habitans doivent au feigneur l'ofi
& la chevauchée ; mais qu’il ne peut pas les mener fi
loin de la ville qu’ils ne puiffent revenir le même
jour.O
n peut aufli appliquer au fervice de chevauchée
beaucoup d’ordonnances & de lettres concernant
Y ofi & fervice militaire, qui font dans le recueil des
ordonnances de la troifieme race. Voye{ auffi le traité dît
ban & arriere-ban., par de la Roque ; celui de la Lande;/
« gloff. de Ducange, au mot calvacata; & celui
de M. de Lauriere, au mot chevauchée. •
CHEVAUCHÉE des baillis & fénéchaux, voye^ ci-
devant C hev au ch ée.
C h ev au ch ées des commmiffaires députés par la
cour des monnoies. Charles IX. en Septembre 1570 ,
& Henri III. en Mai 1577, ordonnèrent que ces com-
miffaires feroient leurs chevauchées & vifites dans les
provinces, pour tenir l#main à l’exécution des régle-
mens fur le fait des monnoies. Voye^ la conférence de
Guenois, tit. des monnoies.
C hevauchées des élus, font les vifites que les
élûs, & à-préfent les conleillers des élections, font
tenus de faire dans leur département, pour s’informer
de l’état & facultés de chaque paroiffe, de l’abondance
ou ftérilité de l’année, du nombre des
charrues, du trafic qui fe fait dans chaque lieu, en-
femble de toutes les autres commodités ou inconn
modités qui peuvent les rendre riches ou pauvres.
Il en eft parlé dans l'art. 4. de l'ordonnance de François
1. du dernier Juillet l ô t j ; dans l'édit d'Henri 11.
du mois de Février tfiSz ; l'édit d'Henri IV . du mois de
Mars 1(800. art. f . & 4. le réglem. du 8 Avril *634.
art. 431 • • ■
Les élûs dans leurs chevauchées doivent aufli. s’in-
Former des exemptions dont joiiiffent quelques habitans
, & fi elles font fondées ; voir fi l’égalité eft
obfervée, autant qu’il eft poflible, entre les contribuables.
S’ils y trouvant de l’excès ou diminution ,
ils prendront l’avis de trois ou quatre des principaux
de la paroiffe, ou des paroiffes circonvoifines , des
plus gens de bien, & qui feront mieux informés de
leurs facultés & moyens, pour après en l’affemblée
des officiers de l’éleftion , fur le procès verbal de
l’élu qui aura été fur le lieu, faire les départemens
des paroiffes avec droiture & fincérité , taxer ceux
qui s ’exempteroient indûment, modérer ou augmenter
les taxes ainfi qu’ils jugeront en leurs confidences
, & fur le rapport defdits prudhommes.
Ils doivent faire leur chevauchées après la récolte,
& oiiir le procureur-fyndic, ou les marguilliers de
la paroiffe, & en faire bon & fidele procès verbal.
Les élûs doivent fe partager entre eux le reffort
de l’éleftion pour leurs chevauchées ; ils ne peuvent
aller deux années de fuite dans le même département
, ni faire leur chevauchée dans un lieu oit ils pof-
fedent du bien. Voye[ la conférence de Guenois , & le
mém. alphab. des tailles , au mot chevauchées.
. C hev au ch ée, ( d r o it d e ) étoit un droit qui
étoit dû au lieu des corvées de chevaux & charroi,
pour le paffage du roi. Vordonnance de S. Louis, du
mois de Décembre 1ZÔ4. art. 3 j . défend que nul en fa
terre, c’eft-à-dire dans le royaume, ne prenne cheval
contre la volonté de celui à qui le cheval fera ,
li ce n’eft pour le fervice du roi ; & en ce ca s, il
veut que les baillis, prévôts ou maires-, ou ceux qui
feront en leurs lieux, prennent des chevaux à loyer ;
que fi ces chevaux ne fuffifent pas pour faire le fervice
, les baillis, prévôts, & autres deffus nommés,
ne prennent pas les chevaux des marchands ni des
pauvres gens, mais les chevaux des riches feulement,
s’ils peuvent fuffire pour faire le fervice. L'art. 38 défend
que pour le fervice du roi, ni pour autre, nulpren-
71e chevaux des gens de fainte Èglife , j i ce n'efi de l'efpé-
cial mandement du roi ; que les baillis ni autres ne prennent
de chevaux forts tant comme métier fera ; 6* que ■
ceux qui feront pris ne foient point relâchés par argent;
ce qui fera gardé, eft-il d it , fa u f nos fervices , nos devoirs
& nos droits, & auffi les autrui.
C hev au ch ée d'une juftice, font des procès verbaux
que l’on faifoit anciennement, pour reconnoî-
tre & conftater l’étendue & les limites d’une juftice.
On les a appellées chevaluchées, parce que la plupart
de ceux qui y afliftoient étoient à cheval. Le
juge convoquoit à cet effet le procureur d’office, le
greffier, & les autres officiers du fiége, & les principaux
& plus anciens habitans , avec lefquels il faifoit
le tour de la juftice. On faifoit dàns le procès
verbal la defeription des limites , & de ce qui pour-
roit fervir à les faire rèconnoître. Dans un dé cès
procès verbaux du xiij. fieclë , il eft dit que l’on
marqua un chêne d’iin coup de ferpe ; cela ne for-
moit pas un monument bien certain.
C hevauchées des grands-maitres des eaux & .forêts
, font les vifites qu’ils font pour la confervation
<les forêts du roi. Il en eft parié dans plufieurs ordonnances,
notamment dans l'art. 18. de l'édit de 1683.
qui enjoint aux grands-maîtres, réformateurs,leurs
lieutenans& maîtres particuliers, qu’en faifant leurs
vifites & chevauchées ils ayent à vifiter les rivières,
levées, chauffées, moulins, pêcheries, & s’informer
dé l’occafion du dépériffement d’iceux.
CHEVAUCHÉES des lieutenans criminels. Il étoit
enjoint, par C ordonnance de Henri II. en 1884. à ces
lieutenans, tant de robe longue que courte, de faire
tous les ans , ou de quatre mois en quatre mois ,
des vifitations & chevauchées dans leurs provinces.
■ Ce foin eft préfentement confié au prévôt des març-
fome I I I ,
chaux de France. Voye^ ci-après chevauchées des prévôts
, &c.
CHEVAUCHÉES des maîtres des eaux & forêts ,
voye^ ci-devant CHEVAUCHEES des grands-maîtresè
C hevauchées des maîtres des requêtes. On appel-
loit ainfi autrefois la vifite qu’ils faifoient dans les
provinces ; il en eft parlé dans Yordonn. d'Orléans ,
art. 3 3 . celle de Moulins, art. y . & celle de Blois,
art. z oc). L’objet de ces vifites étoit de dreffer procès
verbal des chofes importantes pour l’é ta t , recevoir
les plaintes , réprimer les abus. Préfentement
ce^ font les intendans de province qui font la vifite
dans l’étendue de leur généralité.
CHEVAUCHÉES des prévôts des maréchaux , font
les rondes & vifites que ces prévôts font avec leurs
compagnies, ou font faire par des détachemens dans
tous les lieux de leur département , pour la fureté
& tranquillité publique. Il en eft fait mention dans
le réglement de François I. du z o Janv. iS 14. art. 34*
d'Henri I I . en Nov. 1Ô49. art. 18. & 5. Fév. 164c)-
Fev. ifiSz. art. 3 . Ordonn. d'Orléans , art. 'Gy. celle,
de Rouffillon , art. c). celle de Moulins , art. 4 3 .d e
Blois, art. 187. déclar. du c) Fév. 1684. & plufieurs
autres. Voye{ Pr e vÔT DES MARÉCHAUX.
C hevauchées des tkréforiers de France, font les
vifites que ces officiers font tous les ans dans les
élevions de leur reffort, pour voir fi le département
des tailles fait par les élûs, eft conforme aux
facultés de chaque paroiffe. Ils font aufli la vifite des
chemins, ponts & chauffées. Voye£ le réglem. d'Henri
IV. du 1 o. Octobre 1 (803 , pour les tailles , art. 1. (A\
CHEVAUCHER , .( Maréchallerie. ) Ce :erme ,
pour dire aller à cheval, eft hors d’ufage ; mais il eft
encore ufité parmi les écuyers, pour marquer la maniéré
de fe mettre fur les étriers. Chevaucher court,
chevaucher, l,ong, à L'angloife, à la turque.
CHEVAUCHER, on le dit en Fauconnerie, de l’action
de l’oifeau , lorfqu’il s’élève par fecouffes au-
deffus du v en t, qui foufïïe dans la direélion oppofée
à fon vol.
C hev au ch er , dans la pratique de C Imprimerie J
s’entend de quelques letttes qui montent ou qui descendent
hors de l'aligne à laquelle elles appartiennent.
CH EVAUX, en terme de guerre , fignifie la cavalerie
ou le corps des foldats qui fervent à cheval.
Voye{ C a v a lerie;
L’armée , dit-on, étoit compofée de 30ooofan-
taflins & de; x o o o o chevaux. Voye^ Armée , A ile.
La cavalerie comprend les gardes à cheval, les grenadiers
à cheval, les cavaliers, &fouvent les dragons,
quoiqu’ils combattent quelquefois à pié. Voye? Ga r de
a ch e v a l , G renadiers , D r a g o n s , & c.YQ )
CHEVAUX-LEGERS, f. m, ( H f i . mod. ) corps
de cavalerie de la maifon du Roi de France, de deux
cents maîtres , deftinée à la garde de la perfonne de
Sa Majefté.
Henri IV . avant que d’être roi de France, agréa
cette compagnie qui lui fut amenée de Navarre erx
1570. C’étoit la compagnie d’ordonnance de ce prince.
Tous les princes & feigneurs avoient, fous la
permiflion & l’aveu de nos rois , de pareilles compagnies,,
qui formoient en ce tems-là le corps de la
gendarmerie françoife ; elles étoient diftinguées de
la cavalerie Iegere, & par la qualité desperfonnes,
& par l’efpece de leurs armes. C ’eft fur le pié de
compagnie d’ordonnance qu’elle fervit dès 1570
fous Henri alors prince, puis roi de Navarre en 157 z y
& enfuite roi de France en 1589 ; mais en 1593
Henri la créa ou l’établit fous le titre de chevaux-le-
gers, Sc la fubftitua aux deux compagnies de cent
gentilshommes chacune de fa maifon, dits au bec de
corbin, refervés feulement pour les grandes cérémonies,
II s’en fervit pour fa garde ordinaire à cheval #
n - *