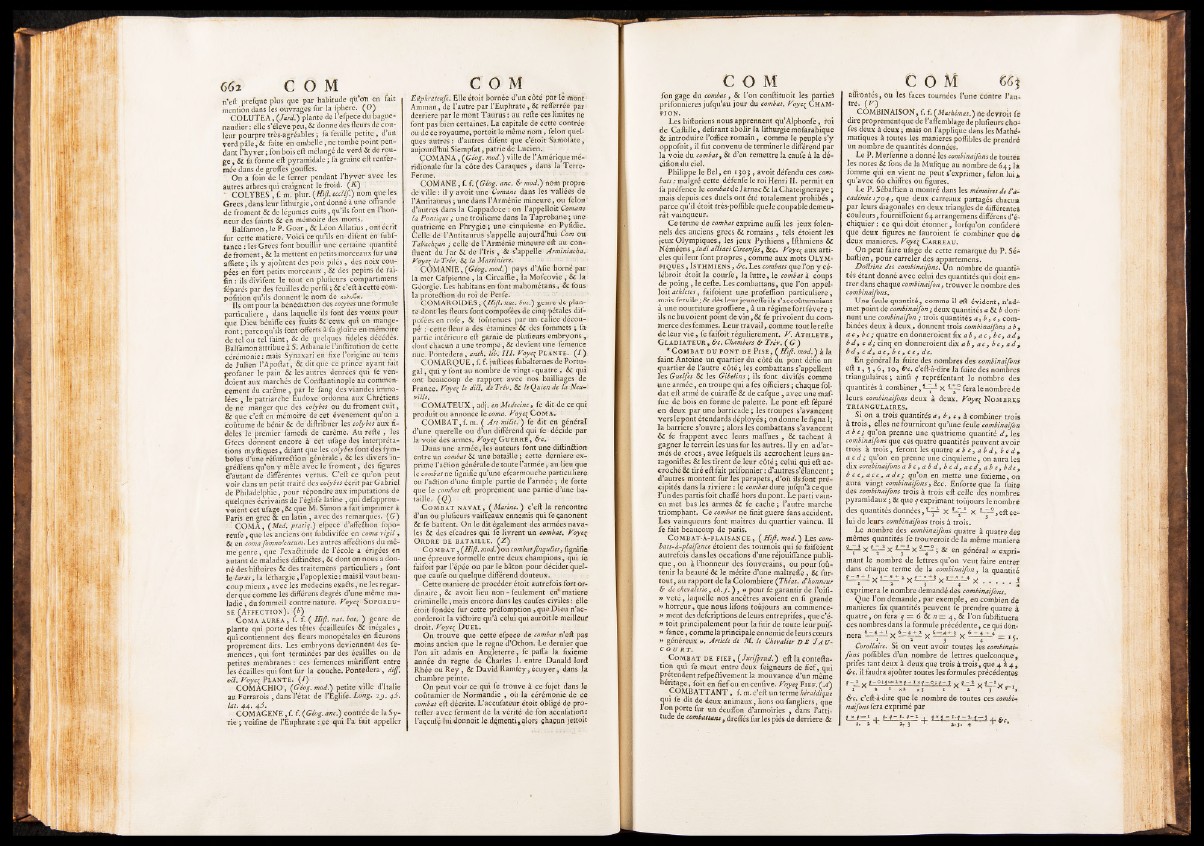
n’eft prefque plus que par habitude qU’oîi en fait
mention dans les ouvrages fur la fphere. (O)
C O LU T EA , (Jard.) plante de l ’efpece du bague-
naudier : elle s’élève peu, & donne des fleurs dé couleur
pourpre très-agréables ; fa feuille pe tite , d un
verd pâ le , & faite en ombelle, ne tombe point pendant
rhy ver ; fon bois eft mélange de verd & de roug
e , & w. forme eft pyramidale ; fa graine eft renfermée
dans de greffes gouffes. •
On a foin de le ferrer pendant l’hy ver avec les
autres arbres qui craignent le froid, (K)
J COLYBE S , f. m. plur. (Hifi. eccléf.) nom que les
G re c s , dans leur lithurgie, ont donné à une offrande
de froment ÔC de légumes cuits, qu ils font en 1 honneur
des faints & en mémoire des morts. ^
Balfamon, le P. G o a r , & Léon Allatius, ont écrit
fur cette matière. Voici ce qu’ils en difent én fu'bf-
tance : les Grecs font bouillir une certaine quantité
de froment, & la mettent en petits morceaux fur une
affrété ; ils y ajoutent des pois pilés , des noix cour
pées en fort petits morceaux , 6c des pépins dé r'ai-
fin : ilsdivifent le tout en plufieurs compartimens
féparés par des feuilles deperfil ; 6c c eft à cette compofition
qu’ils donnent1 le nom de koXvC*.
Ils ont pour la bénédi&ion des colybes une formulé
particulière , dans laquelle ils font des voeux pour
que Dieu béniffe ces fruits & ceux qui en mangeront
; parce qu’ils font offerts à fa gloire- én mémoire
de „tel ou tel faint, & de quelques fidèles décédés.
Balfamon attribue à S : Athanafe Finftitution de cette
cérémonie : mais Synaxari en fixe l’origine au ténis
de Julien l’Apoftat, & dit quê ce prince'ayant fait
profaner le pain & les autres denrées qui fe vendaient
aux marchés de Conftantinople au commencement
du carême , par le fang des viandes immolées
, le patriarche Eudoxe ordonna aux Chrétiens
de ne manger que des colybes ou du froment cu it,
& que c’eft en mémoite de cet événement qu’on a
coutume de bénir & de diftribuer lescolybès aux fidèles
le premier famedi de carême. Au refte , les
Gtecs donnent encore à Cet ufage des interprétations
myftiques, difant que les colybes font des fym-
fcoles d’une réfurreftion générale, 6c les divers in-
grédiens qu’on y mêle avec le froment, dès figures
d’autant de différentes vertus. C ’eft ce qu’on peut
voir dans un petit traité des colybes écrit par Gabriel
de Philadelphie, pour répondre aux imputations de
quelques écrivains de l’églife latine , qui défapprou-
voient cet u fag e , 6c que M. Simon a fait imprimer à
Paris en grec & en latin , avec des remarques. (G )
COM A , (Med., pratiq.) éfpece d’affeftion fopo-
reu fe , que les anciens ont fubdivifée en coma vigil,
& en comafomnolentum. Les autres affrétions du même
g enre, que l’exa&itude de l’école a érigées en
autant de m aladies diftinfres, 6c dont on nous a donné
des hiftoires & des traitemens particuliers, font
le larùs, la léthargie, l’ apoplexie : mais il vaut beaucoup
mieux, avec les médecins ex a fts, né les regarder
que comme les différens degrés d’une même malad
ie , du fommeil contre nature. Foye{^ Soporeuse
(Affection), (é)
C oma aurea , f. f. ( Hijl. nat. bot. ) genre de
plante qui porte des têtes écailleùfes & inégales ,
qui contiennent des fleurs monopétales en fleurons
proprement dits. Les embryons deviennent des fe-
men ces, qui font terminées par des écailles ou de
petites membranes : ces femences mûriffent entre
les écailles qui font fur la couche. Pontedera, dijf.
ocl. Voye£ PLANTE. (/) '
COMACHIO', (Géog. mod.) petite ville d’Italie
au Ferrarois , dans l’état de FEglife. Long. 2$. 45.
lat. 4 4 . 4 ^.
COM AGENE, f. f. (Géog. anc.) contrée de la Sy-
-rie ‘y voifine de l’Euphrate : .ce qui l’a fait appeller
Êùphrdteufe. Elle étoit bornée d’un côté par le mont
Amman, de l’autre par l’Euphrate, 6c refferréé par;
derrière par le mont Taurus : au refte cès limites ne
font pas bien certaines. La capitale de cette contrée
ou de ce royaume, portoit le même nom, félon quelques
autres: d’autres difent que c’étoit-Sânïofate,
aujourd’hui Siempfat, patrie de Lucien.
ÇOMANA, (Géog. mod.) ville de l’Amérique méridionale
fur la côte des Caraques , dahs la Terrer
Ferme.
ÇOMANE, f. f. (Géog. anc. & mod.') nom propre
de ville : il y avoit une Comane dans lès vallées de
l’Antitàtirus ; une dans l’Arménie mineure, ou félon
d’autres dans la Cappadoce : on l’appelloit Comane
la Ponùque ; une troifieme dans la T aprobane; une
qùatrieme en Phrygié ; une cinquième en Pyfidie.
Celle de FAntitaurus s’appelle aujourd’hui Corn ou
Tabachçan ; celle de F Arménie mineure eft au- confluent
du Ja r & de l’Iris ,. -& s’appelle Armïniacha.
Voyei le Trév. 6c la Martiniere.
: COM A N IE ,(Géog.mod.) pays d’Afiè'borné par
la mer Câfpienne, la Circàffie, la Mofcovie , & la
Géorgie. Les habitans en font mahométans-, & fous
la proteftion du roi de Perfe.
COM AROID ES, (Hijl. nat. bot.) genre de plante
dont lés fleurs font COmpOfées de cinq pétales dif-
pofées en rofe, & foûtenues par un calice décou-^
pé- : cette-fleur a des étamines-& des fômmets ; fa-
partie intérieure eft garnie de plufieurs embryons ,
dont chacun à une trompe, 6c devient une femence
nue. Pontedera, anth. lib. III. Voye^ Plan t e , ( ƒ )
COM A RQ U E , f. f. juftices fubalternes de Portugal
, qui y font au nombre de vingt - q u a tre , 6c qui
ont beaucoup de rapport avec nos bailliages de
France, f^oye^ le dicl. deTrév, ÔC leQuien de la Neuville.
\ COM A T EU X , adj. en Medecine , fe dit de ce qui
produit ou annonce le coma. Voye{ C oma.
C OM B A T ,f. m. ( Art-milita) te àit en général
d’une querelle ou d’un différend qui fe décide par
la voie" des armes. Voye{ Gu erre, & c.
Dans une armée, les auteurs font une diftinftion
entre un combat 6c une bataille ; cette derniere exprime
l’âfrion générale de toute l’armée j au lieu que
le combat ne lignifie qu’une efcarmouche particulière
ou Pafrion d’une Ample partie de l’a rm é e ; de forte
que le combat eft proprement une partie d ’une bataille
; (Q >
C ombat naval, (Marine.) c’eft la rencontre
d’un bu plufieurs vaiffeaux ennemis qui fe çanonent
6c fe battent. On le dit également des armées navales
& des efeadres qui fe livrent un combat. Voyeç
Ordre de bataille. (Z)
C om b a t , (Hijl. mod.) ou combatfingulier, lignifie
une épreuve formelle entre deux champions, qui fe
faifoit par l’épée ou par le bâton pour décider quelque
caufe ou quelque différend douteux.
Cette maniéré de procéder étoit autrefois fort ordinaire
, 6c avoit lieu non - feulement en* matière
criminelle , mais encore dans les caufes ciyiles: elle
étoit- fondée fur cette préfomption, que Dieu n’ac-
corderoit la vifroire qu’à celui qui auroitle meilleur
droit. Voye^ D uel.
On trouve que cette efpece de combat n’eft pas
moins ancien que le régné d’Othon. Le dernier que
Fon ait admis en Angleterre, fe paffa la fixieme
année du régné de Charles I. entre Danald lord
Rhée ou R e y , & David R amfey, écuyer , dans la
chambre peinte.
On peut voir ce qui fe trouve à ce fujet dans le
coutumier de Normandie , où la cérémonie de ce
combat eft décrite. L ’accufateur étoit obligé de pro-
tefter avec ferment de la vérité de fon accufation:
l’açcufç lui donnoit ledémen ti* alors çhaçun jettoit
C O M
fon gage du combat, & l ’on conftituoit les parties
prifonnieres jufqu’au jour du combat. Voyeç C hamp
ion .
L e s hiftoriens nous apprennent qu’AÎphonfe, foi
de Caftille, defirant abolir la lithurgie mofarabique
& introduire l’office romain, comme le peuple s ’y
oppofoit, il fut convenu de terminer le différend par
la voie du combat, & d’en remettre la caufe à la dé-
cifion du ciel.
Philippe le B e l, en 1303 , avoit défendu ces co/n-
bats : malgré cette défenfe le roi Henri II. permit en
fa préfence le combatte Ja rn a c& la Chateigneraye ;
mais depuis ces duels ont été totalement prohibés ,
parce qu’il étoit très-poffible que le coupable demeurâ
t vainqueur.
C e terme de combat exprime aufli les jèux folen-
nels des anciens grecs & romains > tels étoient les
jeux O lympiques, les jeux Pythiens , Ifthmiens &
Néméens, ludi aeliaei Circenfes, &c. Voyes^ aux articles
qui leur font p ropres, comme aux mots Olympiques
, Isthmiens , &c. Les combats que Fon y célébrait
étoit la courfe, la lutte, le combat à coups
de p o in g , le cefte. Les combattans, que Fon appel-
loit athlètes, faifoient une profeffion particulière,
•mais fervile ; & dès leur jeuneffe ils s’accoûtumoient
à une nourriture groffiere, à un régime fortfévefe ;
ils ne bu voient point de v in , & fe privoient du commerce
des femmes. Leur tra v a il, comme tout le refte
de leur v i e , fe faifoit régulièrement. V. Athlete ,
Gladiateur, &c. Chambers & Trév. (G )
* Combat du pont de Pi s e , ( Hijl. mod.) à la
faint Antoine un quartier du côté du pont défie un
quartier de l’autre côté ; les combattans s’appellent
les Guelfes & les Gibelins ; ils font divifés comme
Une armée, en troupe qui a fes officiers ; chaque fol-
d at eft armé de cuiraffe & de c afqu e , avec une maf-
fue de bois en forme de palette. L e pont eft féparé
en deux par une barricade ; les troupes s’avancent
vers le pont étendards déployés ; on donne lefigna 1;
la barnere s ’ouvre ; alors les combattans s’avancent
& fe frappent avec leurs maffues , ôc tachent à
gagner le terrein les uns fur les autres. Il y en a d’armés
de c ro cs, avec lefquels. ils accrochent leurs an-
îagoniftes & les tirent de leur côté ; celui qui eft accroché
& tiré eft fait prifonnier : d’autres s’élancent ;
d’autres montent fur les parapets, d ’où ils font précipités
dans la riviere : le combat dure jufqu’à ce que
l ’un des partis foit chaffé hors dupont. L e parti vaincu
met bas les armes & fe cache ; l’autre marche
triomphant. Ce combat ne finit guere fans accident.
Les vainqueurs font maîtres du quartier vaincu. Il
fe fajt beaucoup de paris.
C ombat-à-plaisance , ( Hijl. mod.) Les corn-
bats-à-plaifance étoient des tournois qui fe faifoient
autrefois dans les occafions d’une réjouiffance publique
, ou à l’honneur des fouverains, ou pour foû-
tenir la beauté & le mérite d’une maîtreffe, 6c fur-
tou t, au rapport de la Colombiere ("Théau <Phonneur
& de chevalerie, ch. J. ) , « pour fe garantir de l’oifi-
» v e té , laquelle nos ancêtres avoient en fi grande
» horreur, que nous lifons toujours au commence-
» ment des deferiptions de leurs entreprifes, que c’é-
» toit principalement pour la fuir de toute leurpuif-
» fan ce, comme la principale ennemie de leurs coeurs
» généreux » . Article de M. le Chevalier d e 'Ja V-
c OU R T .
Combat de f ie f f (Jurijprud.) eftla contefta -
tion qui fe meut entre deux feigneurs de fief, qui
prétendent refpe&ivement la mouvance d’un même
héritage, foit en fief ou encenfive. P’oye^ Fief. (A)
COM BATTAN T, f. m. c’eft un terme héraldique
qui fe dit de deux animaux, lions ou fangliers, que
* Porte fur un écuffon d’armoiries , dans l’attitude
de combattans, dreffésfuries piés de derrière &
affrontés, OU les faces tournées l’une Contre l’autre.
(V )
COMBINAISON, f. f. ( Mathémat.) rte devrait fè
dire proprement que de l’affemblage de plufieurs cho*
fes deux à deux ; mais on l’applique dans les Mathématiques
à toutes les maniérés poffiblesde prendré
un nombre de quantités données.
L e P. Merfenne a donné les combinaifon's de toiité*
les notes & fons de la Mufique au nombre de 64 ; lâ
fomme qui en vient ne peut s’exprimer, félon lui a
qu’avec 60 chiffres ou figures.
Le P. Sébaftien a montré dans les mémoires de l'académie
1 7 0 4 , que deux carreaux partagés chacun
par leurs diagonales en deux triangles de différentes
couleurs, fourniffoient 64 arrangemens différens d’échiquier
: ce qui doit étonner, lorfqu’on confiderè
que deux figures ne fauroient fe combiner que d«
deux maniérés. Vqye'i Carreau.
On peut faire ufage de cette remarque du P. Sébaftien,
pour carreler des appartemens.
Doctrine des combinaifons. Un nombre de quantités
étant donné avec celui des quantités qui doit entrer
dans chaque combinaijon, trouver le nombre des
combinaifons.
Une feule quantité, comme il eft évident, n’admet
point de combinaifon ; deux quantités a & b donnent
une combinaifon ; trois quantités a>b, c , combinées
deux à deux;, donnent trois combinaifons a b ,
ac , bc; quatre en donneraient fix a b, ac , bc, ad>
bdy cd; cinq en donneraient dix a b, ac , b c, ad ±
bd y cdyacybefCeyde.
En général la fuite des nombres des cômbinaifons
eft 1 , 3 , 6 , 1 0 , &c. ç’eft-à-dire la fuitedes nombres
triangulaires ; ainfi q repréfentant le nombre des
quantités à combiner, x q~ fera le nombre de
leurs combinaifons deux à deux. Voye^ NOMBRES
TRIANGULAIRES.
Si on a trois quantités a, b, c , à combiner trois
à tro is, elles ne fourniront qu’une feule combinaifon
a b c; qu’on prenne une quatrième quantité d, les
combinaifons que ces quatre quantités peuvent avoir
trois à t ro is , feront les quatre a b e, a b d, b c d ,
a cd; qu’on en prenne une cinquième, on aura les
dix combinaifons a b c , a b d , b c d, acd, ab e, b de,
b c e, ace , a de; qu’on en mette une fixieme, on
aura vingt combinaifons> & c . Enforte que la fuite
des combinaifons trois à trois eft celle des nombres
pyramidaux ; & que q exprimant toûjours le nombre
des quantités données, x x L j i ° >ef r ce^
lui de leurs combinaifons trois à trois.
Le nombre des combinaifons quatre à quatre des
memes quantités fe trouverait de la même maniera
X — X x ; & en général n exprimant
le nombre de lettres qu’on veut faire entrer
dans chaque terme de la combinaifon, la quantité
1-~ L 1 x q— ~ 2 X X 'L— 4 > > ............... 1
exprimera le nombre demandé des combinaifons.
Que Fon demande, par exemple, en combien dé
maniérés fix quantités peuvent le prendre quatre à
quatre, on fera q =z 6 ôc n = 4, 8c Fonfubftituera
ces nombres dans la formule précédente, ce qui don*
nera — ^— X — x X -— == 15,
Corollaire. Si on veut avoir toutes les combinai*
fons poffibles d’un nombre de lettres quelconque,
prifes tant deux à deux que trois à trois, que 4 3 4 ,
&c. il faudra ajoûter toutes les formules précédentes
? -J- v f - O v g - r - i x f - i x g - q ; ? - ? v j - z v } - i v
x x a i x i x 3 X T X , x î - 1,
&c. c’eft-à-dire que le nombre de toutes ces combinaifons
fera exprimé par
9 x 1— 1 1 9' 9-:?.• 1 9*9 - i - 9 -
1. 1 a. z '