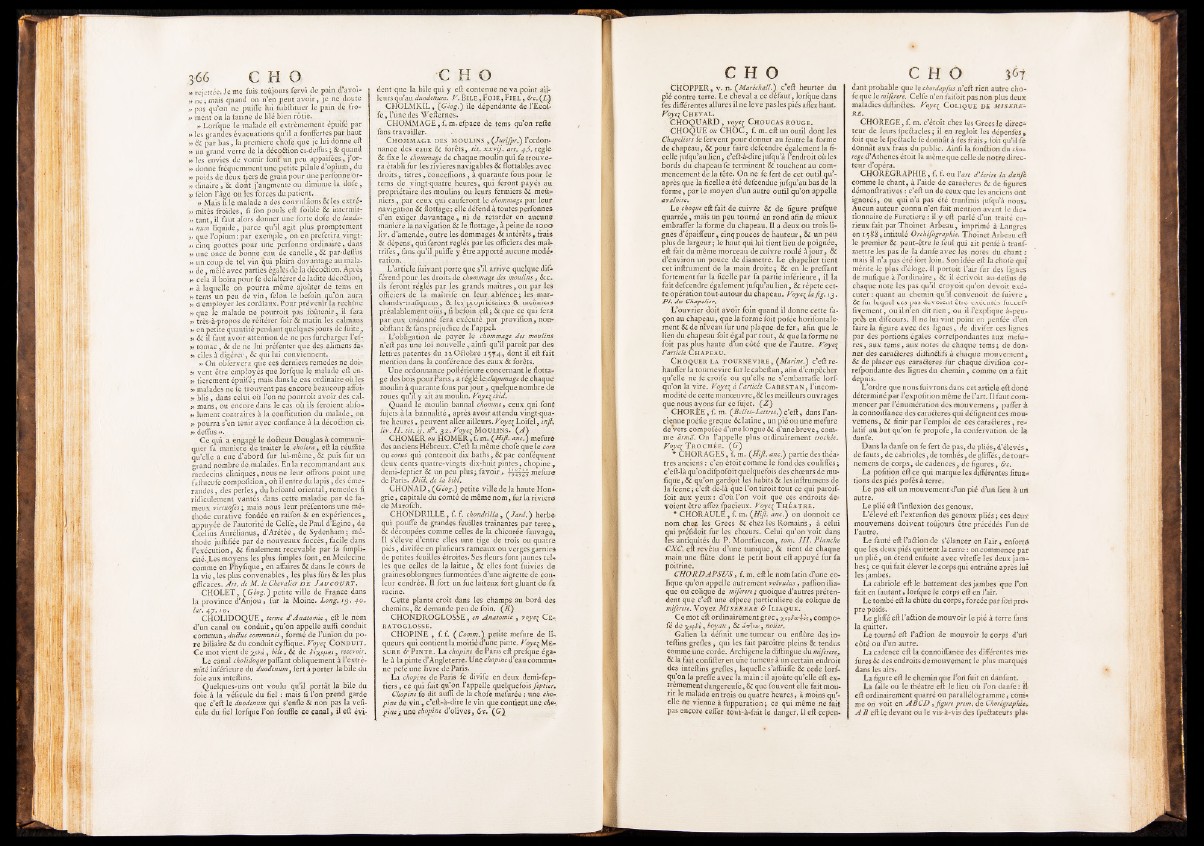
I I
♦ rejettée, Je me fuis-toujours fervi de pain d’avoi- .
» ne; mais quand on n’en peut avoir, je ne cloute i;
» pas qu’on ne püiffe lui fubftituer le pain de fro-
» ment ou la farine de blé bien rôtie.
» Lorfque le malade eft extrêmement épuifé par
» les grandes évacuations qu’il a fouffertes par haut
» 8c par bas , la première chofe que je lui donne eft ,
» un grand verre de la décoftion ci-deflùs ; & quand
» les envies de vomir fonfun peu appaifées., j’or-
yy donne fréquemment une petite pilule d’opium , du
» poids de deux tiers de grain pour une pérlpnnetor-
•m dinaire, & dont .j’augmente ou diminue la dofe,
v félon l’âge ou les forces du patient.
» Mais fi le malade a des convulsons & le? extre-
» mités froides, li fon pouls eft foible 8c intermit-:
» tant, il faut alors donner une forte dofe de l'aiida-
» mim liquide, parce qu’i l agit plus promptement
>, que l’opium : par exemple, on en prefcrir'a vingt-
„ cinq gouttes pour une perfonnë ordinaire, dans
» une once de bonne eau de cgnellé, 8c par-deflus
» un coup de tel vin qui plaira davantage auuiàla?
;> de, mêlé avec parties égalés de la décoftion. Après
»> cela il boira pour fe defaltérer de ladite déco£liç)n,
w à laquelle on pourra même ajouter de tems en
>> tems un peu de v in , félon le befoin qu’ôn aura
» d’employer les cordiaux. Pour prévenir la rechute
>> que le malade ne pourroit pas Soutenir, il fera
» très-à-propos de réitérer foir & matin les caïmans
» en petite quantité pendant quelques jours de fuite,
» 8c il faut avoir attention de ne pas furçharger l ’efi*
» tomac, & de ne lui préfenter que des alimens fa-.
» ciles à digérer, 8c qui lui conviennent.
» On obïèryera que ces derniers, remedes ne doi-
» vent être employés que lorfque le malade eft en-
,> tierement épuifé ; mais dans le cas ordinaire où les
>> malades ne le trouvent pas encore beaucoup affoi-
» blis, dans celui où l’on ne pourroit avoir des cal-
„ mans, ou encore dans le cas. où ils feroient abfo-
» lument contraires à la, conftitution du malade,..on
» pourra s’en tenir avec confiance à la décoaion ci-
»deffus».,. . .. jSf.;-. •. .MviÙA«
Ce qui a engagé le doÔeur Douglas à communiquer
fa maniéré de traiter Ie'choiera, eft la réuffite
qu’elle a eue d’abord fur lui-même, 8c puis fur un
grand nombre deimalaHes. En la recommandant aux
médecins cliniques, nous ne leur offrons point une
faftueufe compofition, où il entre du lapis, des émep
raudes, des perles, du b.efoard oriental, remedes fi
ridiculement vantés dans cette maladie par de fameux
virtuofes ; mais nous leur préfentons une méthode
curative fondée en raifon & en expériences,
appuyée de l’autorité de Celfe, de Paul d’Egine, de
Coelius Auréiianus, d’Arétée, de Sydenham; méthode
juftifiée par de nouveaux fuccès, facile dans
l’exécution, 8c finalement recevable par fa fimpli-
çité..Les moyens les plus fimples font, en Medecine
comme en Phyfique, en affaires 8c dans le cours de
la v ie , les plus convenables, les plus fûrs & les plus
efficaces. Are. de M. le Chevalier d e J a u c o u r t .
CHOLET, ( Géog. ) petite ville de France dans
la province d’Anjou, fur la Moine. Long. i$. 40.
lat. 47.1 o. . ..
CHOLIDOQUE, terme d'Anatomie, eft le nom
d’un canal ou conduit, qu’on appelle aufli conduit
commun, duclus commuais, formé de l’union du pore
biliaire 8c du conduit cyftique. Voye^ C o n d u it .
Ce mot vient de %oxà , hile , & de S'txo/^-i, recevoir.
Le canal cholidoque paffant obliquement à l’extrémité
inférieure du duodénum, fert a porter la bile du
foie aux inteftins.
Quelques-uns ont voulu qu’il portât la bile du
foie à la véficule du fiel : mais fi l’on prend garde
que c’eft le duodénum qui s’enfle & non pas la vefi-
cule du fiel lorfque l’on fouffle ce canal, il eft çvident
que la bile qui y eft contenue ne va point ait»
leurs qu’au duodénum. V. Bile , Foie , Fiel , &c. (L )
CHOLMKIL, (Géog.') île dépendante de l’Ecof*
f e , l’ûne des "Wefternes.
CHOMMAGE, f. m. efpace de tems qu’on refte
fans travailler..
C h ommage des moulins , (Jurifpr.') l’ordonnance
des eaux 8c forêts, tit. xxyij. art. 46. réglé
8c fixe le chommage de chaque moulin qui fe trouve-'
ra établi fur les rivières navigables 8c flottables avec
droits , titres ,.cpocêflions, à quarante fous pour le
tems de Vingt-quatre heures, qui feront payés au
propriétaire des moulins ou leurs fermiers 8c meû-
niers, par ceux qui cauferont le chommage par leur
navigation 8c flottage: elle défend à toutes perfonnes
d’én exiger.davantage, ni de retarder en aucune
manière la navigation 8c le flottage, à peine de 1000
liv. d’amende, outre les dommages & intérêts , frais
& dépens, qui feront réglés par les officiers des mat»
trifes, fans qu’il puifle y être apporté aucune modérations
.., . | .
L’article fuiyant porte que s’il arrive quelque difr
îérend pour,les droits de chommage des moulins, &c.
ils feront réglés par les grands maîtres, ou par les
officiers de la maîtrife en. leur.abfënee; les mar-
chands-trafiquaps, & les, propriétaires & meuniers
préalablemènt oiiis, fi befoin eft; & que ce qui fera
par eux ordonné fera exécute par provifion, non-*
pbftant & fans préjudice de l’appel.
L’obligation de payer le chommage des moulins
n’eft pas une loi nouvelle, ainfi qu’il paroît par de9
lettres patentes du 12 Octobre 1574, dont il eft fait
mention dans la conférence des eaux & forêts,
Une ordonnance poftérieure concernant le flotta?
ge des bois pour Paris , a réglé ie chqmmage de chaqué
moulin à quarante fous par jour, quelque nombre de
roues qu’il y ait ait moulin. Vryeç ïbid.
Quand le moulin bannal chomme, ceux qui font
fujets à la bannalité, après avoir attendu vingt-quatre
heures, peuvent aller ailleurs. Voyeç Loifel, injh
liv. I I . tit. ij. n°. 32. Voye^ MOULINS. (A )
. CHOMER ou HÔMÉR, f. m. (Hijl. anc.) mefurô
des anciens Hébreux. C ’eft la même chofe que le cors
ou corus qui contenoit dix baths, & p a r conféquent
deux cents quatre-vingts dix-huit pintes, chopine ,
demi-feptier & un peu plias; fàvoir y mefure
de Paris. Dicl. de la bibl.
CHONAD, (Géog.) petite ville de la haute Hongrie
, capitale du comté de même nom, fur la rivière
de Marofch.
CHONDRILLE, f. f. chondrilla, ( Jard. ) herb&
qui pouffe de grandes feuilles traînantes par terre ^
8c découpées comme celles de la chicorée fauvage,
Il s’élève d’entre elles une tige de trois ou quatre
piés, divifée en plufieurs rameaux ou verges garni e$
de petites feuilles étroites. Ses fleurs font jaunes tel?
les que celles de la laitue, 8c elles font fuivies de
graines oblongues furmontéçs d’une aigrette de cou-t
leur cendrée. Il fort un fuc laiteux fort gluant de fa
racine.
Qette plante croît dans les champs au bord des
chemins, 8c demande peu de foin. (K )
CHONDROGLOSSE, en Anatomie , voyeç C e-;
r a to g lo s se .
CHOPINE , f. f. ( Comm.) petite mefure de li-i
queurs qui contient la moitié d’une pinte. Voye^ Mesure
& Pin te . La chôpine de Paris eft prefque égale
à la pinte d’Angleterre. Une chopinè d’eau commu?
ne pefe une livre de Paris.
La chopinc de Paris fe divife en deux demî-fep-
tiers, ce qui fait qu’on l’appelle quelquefois feptier.
Chopine fe dit aufli de la chofe mefurée : une cho-.
pine de v in , c’eft-à-dire le vin que contient unc.cho“,
pine) une chopine d’olives, &c. (G)
CHOPPER, v. n. (Maréehall.) c’eft heurter du
pié contre terre. Le cheval a ce défaut, lorfque dans
les différentes allures il ne leve pas les piés aflèz haut.
Voye{ C he v al .
CH OQ UARD , voye{ C houcas ro u g e.
CHOQUE ou CH O C , f. m. eft un outil dont les
Chapeliers fe fervent pour donner au feutre la forme
de chapeau, & pour faire defeendre également la f icelle
jufqu’aulien, c’eft-à-dire jufqu’à l’endroit où les
bords du chapeau fe terminent & touchent au commencement
de la tête. On ne fe fert de cet outil qu’-
après que la ficelle a été defeendue jufqu’au bas de la
formé, par le moyen d’un autre outil qu’on appelle
avaloire.
Le choque eft fait de cuivre 8c de figure prefque
quarrée, mais un peu tourné en rond afin de mieux
embraffer la forme du chapeau. Il a deux ou trois lignes
d’épaiffeur, cinq pouces de hauteur, 8c un peu
plus de largeur ; le haut qui lui tient lieu de poignée,
eft fait du même morceau de cuivre roulé à jour, 8c
d’environ un pouce de diamètre. Le chapelier tient
cet infttument de la main droite4 & en le preffant
fortement fur la ficelle par fa partie inférieure, il la
fait defeendre également jufqu’au lien, 8c répété cette
opération tout-autour du chapeau. Voye{ la fig. 13.
PI. du Chapelier.
L’ouvrier doit avoir foin quand il donne cette façon
au chapeau, que la forme foit pofée horifontale-
ment 8c de niveau fur une plaque de fer, afin que le
lien du chapeau foit égal par tout, & que la forme ne
foit pas plus haute d’un côté que de l’autre. Voye^
Varticle CHAPEAU.
C hoquer l a to u r n e v ir ë , (Marine.) c’eft re-
haufferla tournevire furiecabeftan, afin d’empêcher
qu’elle ne fe çroife ou qu’elle ne s’embarraffe lorf-
qu’on la vire. Voye^à Üarticle C a b e s t an , l’incommodité
de cette manoeuvre, & les meilleurs ouvrages
que nous ayons fur ce fujet. (Z )
CHORÉE, f. m. (Belles-Lettres.) c’eft, dans l’ancienne
poéfie greque & latine, un pié ou une mefure
de vers compofée d’une longue 8c d’une breve, comme
àrma. On l’appelle plus ordinairement trochée.
Voyei T r o ch é e . (G )
* CHORAGES, f. m. (Hijl. anc.) partie des théâtres
anciens : c’en étoit comme le fond des coulifles ;
c’eft-là qu’on difpofoit quelquefois des choeurs de mu-
fique, 8c qu’on gardoit les habits & lesinftrumens de
la feene ; c’eft de-là que l’on tiroit tout ce qui paroif-
foit aux yeux : d’où l’on voit que ces endroits' dévoient
être affez fpacieux. Voye^T h é â t r e .
* CHORAULE, f. m. (Hijl. anc.) on donnbit ce
nom che» les Grecs 8c chez les Romains, à celui
qui préfidoit fur les choeurs. Celui qu’on voit dans
les antiquités du P. Montfaucon, torn. I II. Planche
CXC. eft revêtu d’une tunique, & tient de chaque
main une flûte dont le petit bout eft appuyé fur fa
poitrine.
CH ORDAPSl/S, f. m. eft le norh latin d’une cô-
lique qu’on appelle autrement volvulus, paflion iliaque
ou colique de miferere j quoique d’autres prétendent
que c’eft une efpece particulière de colique de
miferere. V oyez Mi s e r e r e & Iliaque;
Ce iiiot eft ordinairement grec, xopé'u^oçj compo-
fé de x oP^* i boyau, 8c aiBuv, noiieri
Galien la définit une tumeur ou enflûre des in-
teftins grefles, qui les fait paroître pleins & tendus
comme une corde. Archigene la diftingue du miferere,
& la fait confifter en une tumeur à un certain endroit
des inteftins grefles, laquelle s’affaiffe 8c cede lorf-
qu’on la preffe avec la main : il ajoûte qu’elle eft extrêmement
dangereufe, 8c que fouvent elle fait mou-
tir le malade entrois ou quatre heures,- à moins qu’elle
ne vienne à fuppuration ; Cë qui même né fait
pas encore ceffer tout-à-fait le danger. 11 eft cependant
probable que le chordapfus n’eft rien autre chofe
que le miferere. Celfe n’en faifoit pas non plus deux
maladies diftinâesi Voye^ C o lique d e m i s e r e r
e .
CHOREGE, f. m. c’étoit chez les Grecs le directeur
de leurs fpe&acles ; il en regloit les dépenfes,
foit que le fpeftacle fe donnât à fes frais ; foit qu’il fe
donnât aux frais du public. Ainfi la fon&ion du cho-
rege d’Athènes étoit la même que celle de notre directeur
d’opéra.
CHORÉGRAPHIE, f, f. ou l'art d'écrire la datifs
comme le chant, à l’aide de caractères 8c de figures
démonftratives : c’eft un de ceux que les anciens ont
ignorés, ou qui n’a pas été tranfmis jufqu’à nous;.
Aucun auteur connu n’en fait mention avant le dictionnaire
de Furetiere : il y eft parlé d’un traité curieux
fait par Thoinet Arbeau, imprimé à Langres
en 1588, intitulé Orchéfographie. Thoinet Arbeau eft
le premier & peut-être le feul qui ait penfé à tranf-
mettre les pas de la danfe avec les noies du chant :
mais il n’a pas été fort loin. Son idée eft la chofe qui
mérite le plus d’éloge. Il portoit l’air fur des lignes
de mufique à l’ordinaire, 8c il écrivoit au-defl’us dé
chaque note les pas qu’il croyoit qu’on dévoit exécuter
: quant au chemin qu’il convenoit de fuivre *
& fur lequel ces pas dévoient être exécutés fuccef-
fiyement, ou il n’en dit rien, ou il l’explique à-peu-
près en difeours. Il ne lui vint point en penfée d’en
faire la figure avec des lignes , de divifer ces lignes
par des portions égales correfpondantes aux mefu-
res, aux tems , aux notes de chaque tems ; de donner
des caraâeres diftinftifs à chaque mouvement,
8c de placer ces caraâeres fur chaque divifion cor-
refpondante des lignes du chemin, comme on a fait
depuis.
L’ordre que nous fuivrons dans cet article eft donc
déterminé par l’expofition même de l’art. Il faut commencer
par l’énumération des mouvemens, paffer à
la connoiffance des caraéteres qui défignent ces mouvemens
, 8c finir par l’emploi de ces caraéteres, relatif
au but qu’on fe propofe, la confervation de la
danfe.
Dans la danfe on fe fert de pas, de pliés, d’élevés ,
de fauts, de cabrioles, de tombés, de gliffés, de tour-
nemens de corps, de cadences, de figures, &c.
La pofition eft ce qui marque les différentes fitua-*
tions des piés pofés à terre.
Le pas eft un mouvement d’un pié d’un lieu à uri
antre.
Le plié eft l’inflexion des genoux.
L’élevé eft l’extenfion des genoux pliés ; ces deux
mouvemens doivent toujours être précédés l’un dé
l’autre.
Le fauté eft l’aélion de s’élancer en l’a ir , enforté
que les deux piés quittent la terre : on commence par
un plié, on étend enfuite avec vîteffe les* deux jambes
; ce qui fait élever le corps qui entraîne après lui
les jambes.
La cabriolé eft le battement des jambes que l’oii
fait en fautant, Iorfquë le corps eft en l’air.
Le tombé eft la chute du corps, forcée par fort propre
poids.
Le gliffé eft l’a&ion de mouvoir le pié à terre fans
la quitter*
Le tourné ëft l’aëtion de mouvoir le corps d’uii
côté ou d’un autre.
La cadence eft la connoiffance des différentes m'e^
fures 8c des endroits de mouvement le plus marqués
dans les airs.
La figure eft le chemin que l’ori fuit etl dànfant.
La falle ou le théâtre eft le lieu où l’on danfe : il
eft ordinairement quarré ou parallélogramme, com-.
me ori voit en A B C D , figure prem -, de Chorégraphiée
A B eft le devalit ou lé vis-à-vis des fpë&ateurs pla