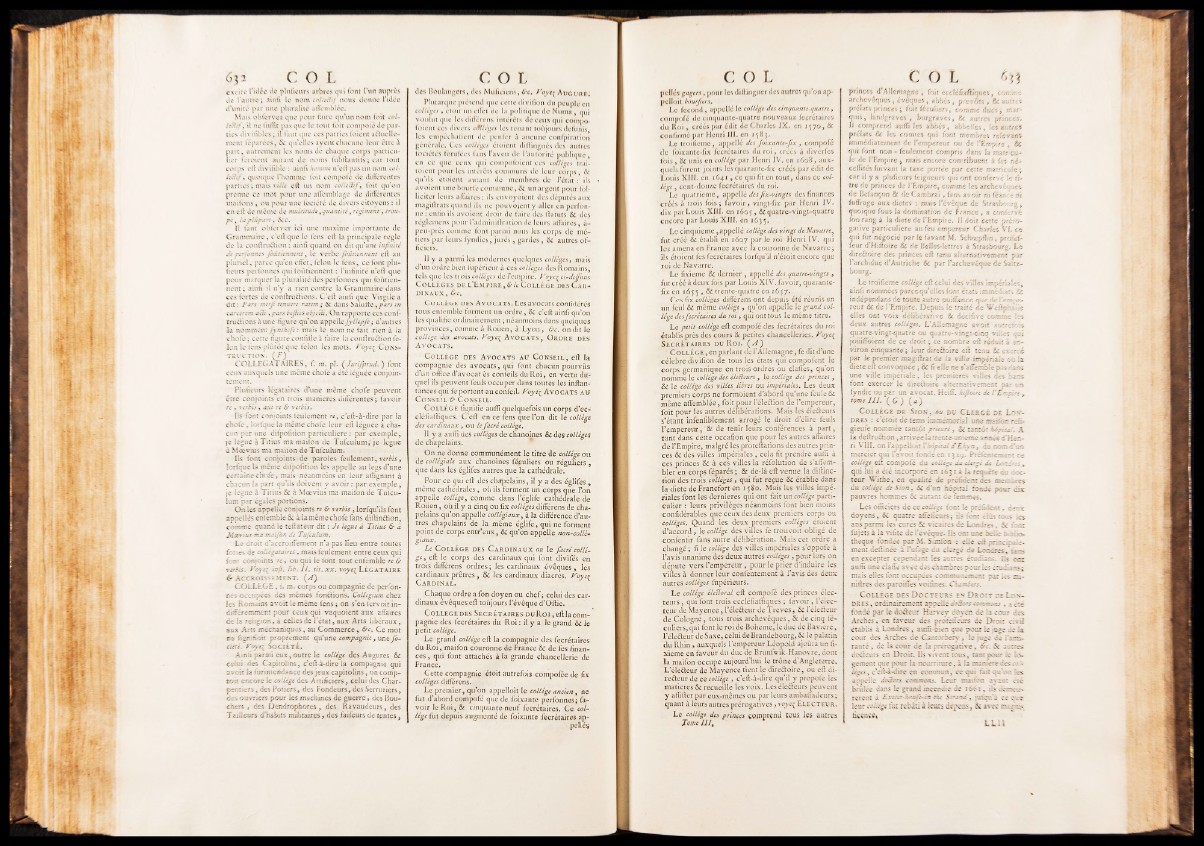
c u i t f l'idée de plulieurs arbres qui font l’un auprès
île l'autre; ainù le nom collectif nous donne l'idée
d'unité par une pluralité «d'emblée.
Mais obfcrvez que pour taire qu'un nom (bit col*
ItÏÏit y il ne t'ufRt pas que le tout (oit eompolé de parties
divilibles; il tant que ces parties (oient actuellement
téparees, & qu'elles ayent chacune leur être à
p a r t, autrement les noms de chaque corps particulier
(croient autant de noms (ubltantits; car tout
corps elt divilible ; ainfi honutim n'e(t pas un nom collectif,
quoique l'homme t'oit eompolé de différentes
parties ; mais ville elt un nom collectif ', (bit qu’on
prenne ce mot pour une aûeniblasq de diftérentes
maifon s, ou pour une fociété de divers citoyens : il
en elt de même de multitude, quantité, régiment, trou-
II tant oblervcr ici une maxime importante de
Grammaire, c 'eltque le fens elt la principale règle
de la conltrudion ; ainfi quand on dit qu’n/K infinité
Je perfonnes Jbù tiennent, le verbe jbùncnncnt elt au
pluriel, parce qu’en effet, félon le fens, ce font plu-
fieurs personnes qui l'outiennent : l’infinité n’eft que
pour marquer la pluralité des personnes qui l'oûtien-
nent ; ainli il n’y a rien contre la Grammaire dans
ces fortes de conltruêtions. C'elt ainfi que Virgile a
dit : Pats merji tcnuerc raton ; & dans Salufte 9pars in
carcerem a ch , pars beftiis objecté. On rapporte ces COnl-
truttions à une figure qu’on appelle J'yllepJe ; d’autres
la nomment Jyntkefe: mais le nom ne tait rien à la
choie; cette figureconfiiteà taire la confiruétionfélon
le fens plutôt que félon les mots. Foye^ C onst
r u c t io n . (.F)
COLLÉG ATA IR E S, f. m. pl. ( Jurifprud. ) font
ceux auxquels une même choie a été léguée conioin-
Pluiieurs légataires d’une même chofe peuvent
être conjoints en trois maniérés différentes; favoir
rc 3 verbis y aut re & verbis.
Ils font conjoints feulement rc, c’eft-à-dire par la
chofe , lorfque la même choie leur eff léguée à chacun
par une dilpoütion particulière : par exemple,
je légué à T itius ma maifon de Tufculum," je légué
à Moevius ma maifon de Tufculum.
Ils font conjoints-de paroles feulement-,verbis ,
lorfque la même diipofition les appelle au legs d’une
certaine chofe, mais néanmoins en leur affignant à
chacun la part qu’ils doivent y avoir : par exemple,
je ie^ue à Titius & à Moevius ma maifon de Tufculum
par égales portions.
On les appelle conjoints re & verbis, lorfqu’ils font
appellés enfemble & à la même chofe fans diftinction,
comme quand le teftateur dit : Je légué à Titius & à
Moevius ma maifon de Tufculum.
Le droit d’accroiffement n’a pas lieu entre toutes
fortes de coliégataïres , mais feulement entre ceux qui
font conjoints re, ou qui le font tout enfemble re &
verbis. Foyer infi. lib. 11. tit. xx. voye£ LÉGATAIRE
& A c c r o i s s e m e n t . ( â )
C O L L EG E , i. m. corps ou compagnie de personnes
occupées des mêmes fondions. Coltigium chez
les Romains avoit le même fens ; on s ’en lervoit indifféremment
pour ceux qui vaquoient aux affaires
de la religion, à celies de l’é ta t, aux Arts libéraux,
aux Arts mécha niques, au Commerce, &c. Ce mot
ne figmfioit proprement qu’une compagnie, une fo-
cieté. Voyc{ So c ié t é .
Ainsi parmi eu x , outre le collige des Augures &
celui des Capitolins, c’eft-à-dire la compagnie qui
avoit la furimendance des jeux capitolins, on comptoir
encore le collige des Artificiers, celui des Charpentiers
5 des P otiers, des Fondeurs, des Serruriers,
des ouvriers pour les machines de guerre, des Bouchers
, des Dendrophores , des Kavaudeurs, des
Taiiieurs d’habits militaires, des faifeurs de tentes,
des Boulangers, des Muliciens, Oc. Foyer AucuiurJ
Plutarque prétend que cette divilion du peuple en
collèges , étoii un effet de la politique de Nu ma , qui
voulut que les différens intérêts de ceux qui compo-
1 oient ces divers collèges les tenant toujours dclimis,
les cm pêcha tient de pcnlcr à aucune confpiraiion
générale. Ces collèges étoient dillingués des autres
(ociétés fondées fans l’aveu de l’autorité publique,
en ce que ceux qui compoloicnt ces collèges trai-
toient pour les intérêts communs de leur corps, &
qu’ils étoient autant de membres de l’état : ils
«voient une boude commune, 6c un argent pour foL
liciter leurs alla 1res : ils envoyoient des députés aux
magillrats quand ils ne pou voient y aller en perfon-
ne : enfin ils «voient droit de faire des llatuts 6c des
réglemens pour l’adminiftration de leurs affaires, à-
peu-pres comme font parmi nous les corps de métiers
par leurs fyndics, jurés, gardes, 6c autres officiers.
Il y a parmi les modernes quelques colliges y mais
d’un ordre bien (iipéricur à ces collèges clés Romains,
tels que les trois collèges de l’empire. Voyeç ci-deffous
C ollèges de l’Em p ir e , Ole C ollège des C a r dinaux
, &c.
C ollège des Av o c a t s . Les avocats confidérés
tous enfemble forment un ordre, 6c c’eft ainfi qu’on
les qualifie ordinairement ; néanmoins clans quelques
provinces , comme à Roiien, à Lyon, Oc. on dit le
collège des avocats. Voyei A v o c a t s , Ordre des
A v o c a t s .
C o llège des Avo c a t s àû C o n s e il , eff la
compagnie des avocats, qui font chacun pourvûs
d’un office d’avocat ès confeils du Roi, en vertu duquel
ils peuvent feuls occuper dans toutes les infian-
tances qui le portent au confeil. Foye^ Avo ca t s a u
C onseil O C onseil.
C o llège lignifie auffi quelquefois un corps d’ec-
cléfiaftiques. C ’elt en ce fens que l ’on dit le collige
des cardinaux , ou le facri collige.
Il ÿ a aulîi des collèges de chanoines & des colliges
de chapelains.
On ne donne communément le titre de collège ou
de collegiale aux chanoines féÿuliers ou réguliers ,
que dans les églifes autres que la cathédrale.
Pour ce qui elt des chapelains, il y a des églifes ,
même cathédrales, oli ils forment un corps que l’on
appelle collège y comme dans I’églife cathédrale de
Roiien, où il y a cinq ou lix collèges différens de chapelains
qu’on appelle collégiaux, à la différence d’autres
chapelains de la même églife, qui ne forment
point de corps entr’eux, & qu’on appelle non-colle*
giaux.
Le C o llege des C ard in au x ou le facri collège
, eff le corps des cardinaux qui font divifés en
trois différens ordres ; les cardinaux évêques, les
cardinaux prêtres , & les cardinaux diacres. Foyer
C a rd in a l.
Chaque ordre a fon doyen ou chef ; celui des cardinaux
évêques elt toujours l’évêque d’Ollie.
C ollege des Se c rét air es du Ro i , elt la compagnie
des fecrétaires du Roi : il y a le grand & le
petit collige.
Le grand collège elt la compagnie des fecrétaires
du Roi, maifon couronne de France & de fes finances
, qui font attachés à la grande chancellerie de
France.
Cette compagnie étoit autrefois compofée de lix
collèges différens.
Le premier, qu’on appelloit le collège ancien, ne
fut d’abord compofé que de foixante perfonnes; favoir
le Roi, & cinquante-neuf fecrétaires. Ce collège
fut depuis augmenté de foixante fecrétaires appelléç
pelles gager! , pour les diffingucr des autres qu’on ap-
pclloit bourfurs.
Le fécond, appelle le collège des cinquante-quatre,
compofé de cinquante-quatre nouveaux fecrétaires
du Roi, créés par édit de Charles IX . en 1 570, 6c
confirmé par Henri III. en 1583.
Le troilieme, appellé des foixantt-fix, compofé
de foixantc-lix fecrétaires du roi, créés à diverfes
fois, 6c unis en collège par Henri IV. en 1608, auxquels
furent joints les quarante-fix créés par édit de
Louis XIII. en 1641, ce qui fit en tout, dans Ce collège
, cent-douze fecrétaires du roi.
Le quatrième, appellé desftx-vingis des finances
créés à trois fois; lavoir, vingt-fix par Henri IV.
dix par Louis XIII. en 1605,6c quatre-vingt-quatfe
encore par Louis XIII. en 163 5.
Le cinquième, appellé collège des vingt de Navarre,
fut créé 6c établi en 1607 par le roi Henri IV. qui
les amena en France avec la couronne de Navarre ;
ils étoient fes fecrétaires lorfqu’il n’étoit encore que
roi de Navarre.
Le fixieme 6c dernier , appellé des quatre-vingts ,
fut créé à deux fois par Louis XIV. favoir, quarante-
fix en 1655,6c trente-quatre en 1657.
Ces fix collèges différens ont depuis été réunis en
un feul 6c même collège , qu’on appelle le grand collège
des fecrétaires du roi, qui ont tous le même titre.
Le petit collège eff compofé des fecrétaires du roi
établis près des cours & petites chancelleries. Foye^
Se c rét air es du Ro i . { A )
• C ollège , en parlant de l’Allemagne, fe dit d’une
célébré divilion de tous les états qui compofenî le
corps germanique en trois ordres ou clafles, qu’on
nomme le collège des électeurs , le collège des princes ,
Sc le collège des villes libres ou impériales. Les deux
premiers corps ne formoient d’abord qu’une feule &
même affemblée, foit pourlele&ion de l’empereur,
foit pour les autres délibérations. Mais les électeurs
s’étant infenliblement arrogé le droit d’élire feuls
l’empereur, ’& de tenir leurs conférences à part,
tant dans cette occafion que pour les autres affaires
de l’Empire, malgré les proteftations des autres princes
6c des villes impériales , cela fit prendre auffi à
ces princes 6c à ces villes la réfolution de s’affem-
bler en corps féparés ; & de-là eff venue la diffinc-
tion des trois collèges, qui fut reçue & établie dans
la diete de Francfort en 1580. Mais les villes impériales
font les dernieres qui ont fait un collège particulier
: leurs privilèges néanmoins font bien moins
■ confidérables que ceux des deux premiers corps ou
collèges. Quand les deux premiers collèges étoient
d’accord, le collège des villes fe trouvoit obligé de
confentir fans autre délibération. Mais cet ordre a
changé ; fi le collège des villes impériales s’oppofe à
l’ayis unanime des deux autres collèges, pour lors on
députe vers l’empereur, pour le prier d’induire les
villes à donner leur confentement à l’avis des deux
autres collèges fupérieurs.
Le collège électoral eff compofé des princes électeurs
, qui font trois eccléfiaftiques ; favoir, l’électeur
de Mayence, l’éleâeur de Treves, & l’êleâeur
de Cologne, tous trois archevêques, & de cinq ie-
culiers, qui font le roi de Boheme, le duc de Bavière,
l’électeur de Saxe, celui de Brandebourg, 6c le palatin
du Rhin, auxquels l’empereur Léopold ajouta un fixieme
en faveur du duc de Brunfwilc-Hanovre, dont
la maifon occupe aujourd’hui le trône d'Angleterre.
L’éleâeur de Mayence tient fe directoire, ou eff directeur
de ce college , c’eft-à-dire qu’il y propofe les
matières 6c recueille les voix. Les électeurs peuvent
y aflifter par eux-mêmes ou par leurs ambaffadeurs ;
quant à leurs autres prérogatives, voyc^ El e c teu r .
Le collège des priâtes çQjuprçud tous fes autres
Tome I I I ,
princ es d’Alhïmagne , foit ecicféfiaft/ques, c
archevêques,, évequ.
fée u lien.
, prévôts, U
prélaifs princes ; foit
cjim, landpraIV » , 1burgravcî 6c autre* yt
Il comprerni auffi les abbés, abbef'cs. les ;
prélat* 6c Je.<; comf1L'S qui foint membres rei
immédiarcmerit de 1’empereur OU de 1 Y.rr'i r
qui font non - feulement compris dans la mair eu-
le de l’Empire, mais encore con’ribucnt à fo? né-
ceffites fuivam la taxe portée par cette m»*r»eufe;
car il y a phificurs feigneurs qui ont conter/*; 1e titre
de prince» de l ’Empire, comme les archew.- ies
de Belançon & de Cambrai , fans avoir ni fez:. ' : ni
fuffrage aux dictes : mais l’évêque de Strasbo -.-v ,
quoique fous la domination de F ran ce, a confervé
fon rang à la diete de l’Empitc. il doit cette prérogative
particulière au feu empereur Charles VI. ce
qui fut négocié par le (avant M. Scboepffin, profèf-
leur d’Hiuoire & de Belles-lettres à Strasbourg. L é
directoire des princes eff tenu alternativement par
l’archiduc d’Autriche & par l’archevêque de $aîtz-
bourg.
Le rroifieme collège eff celui des villes impériales,
ainfi nommées parce qu’elles font états immédiats 6c
indépendans de toute autre puifiânee que de l'empereur
& de l'Empire. Depuis le traité de Veitphaüe
elles ont voix délibérative & décifive comme .
deux autres collèges. L’Allemagne avoit autrefois
quatre-vingt-quatre ou quatre-vingt-cinq vitîes e f f
joiiiffoient de ce droit ; ce nombre eff réduit à environ
cinquante ; leur directoire eff tenu & exercé
par le premier magiffrat de la ville impériale où la
diete eff convoquée ; & fi elle ne s’affemble p?s dans
une ville impériale, les premières villes des bans
font exercer le directoire alternativement par un
fyndic ou par un avocat. Heiff. hifloire de C Empire ,
tome 111. ( G ) ( a )
C o llège de Si o s , ou d u C l e r g é d e Londres
: c’étoit de tems immémorial une maifon reff-
gieufe nommée tantôt prieuré, & tantôt hôpital. A
fa deffrucrion, arrivée la trente-unieme année d’Henri
VIH. on Fa ppc [loi t Y hôpital dtEkyn, dn nom HV -
mercier qui l’avoit fondé en 13 »9. Préfeares&ent ce
collège eû compofé du collège du cierge de Londres ,
qui lui a été incorporé en 1631 à la requête du docteur
Withe, en qualité de préfidenr des membres
du collège de S ion, & d’un hôpital fonde pour dix
pauvres hommes & autant de femmes.
Les officiers de ce coileg; font fe préâc
doyens, & quatre affetîeis rs; iis font él
ans parmi les curés & vic<tires de Londr.
fujets à la vifite de l’evéqu«î. Iis ont une 1
theque fondée par M. Sunfba : elle eff
ment deftinée à fuldge du clergé de Lot
C o llège des D o c t e u r s ex D r o it de Lqx-
C<eBV ' L LU