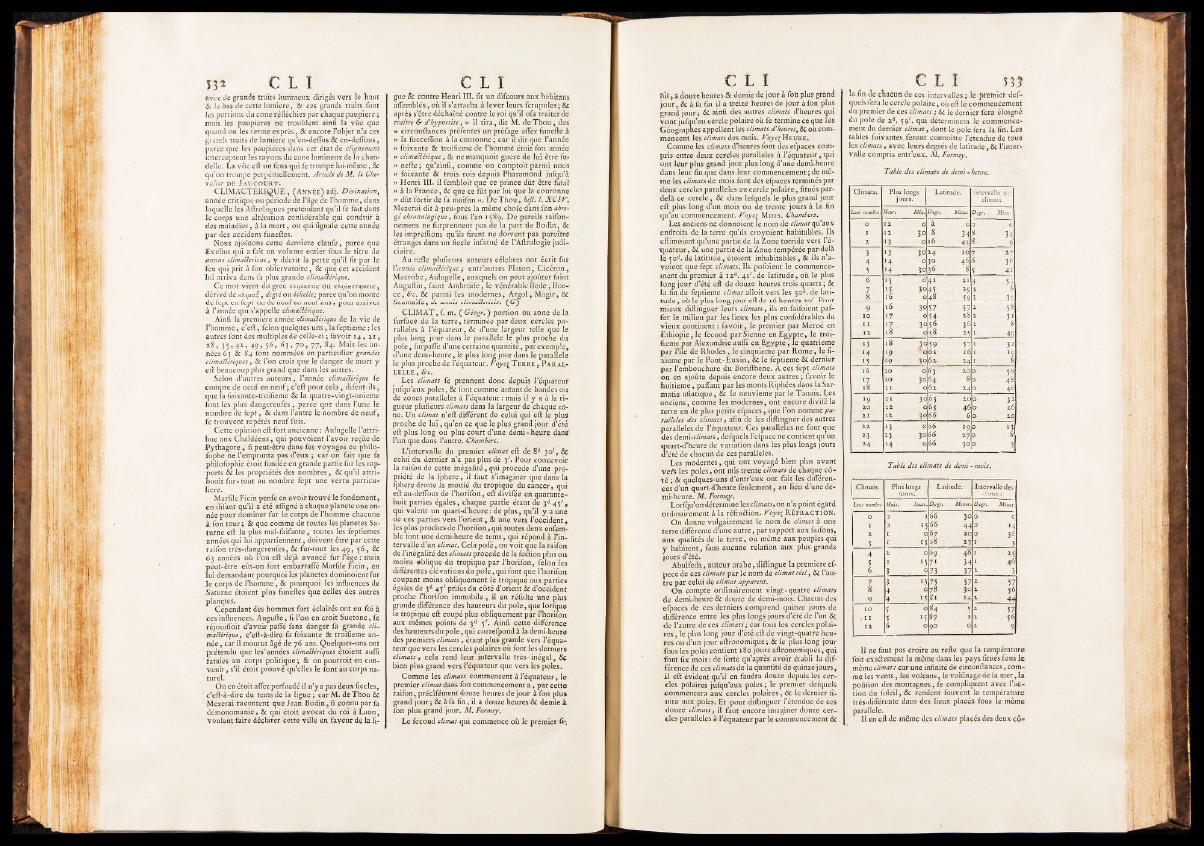
avec de grands traits lumineux dirigés Vers le haut
& le bas de cette lumière, & ces grands traits font
les portions du cône réfléchies par chaque paupière ;
mais les paupières ne troublent ainfi la vue que
quand on les ferme exprès, & encore l’objet n’a ces
grands traits de lumière qu’en-deffùs & en-deflous,
parce que les paupières dans cet état de dignement
interceptent les rayons du cône lumineux de la chandelle.
La vue eft un fens qui fe trompe lui-même, &
qu’on trompe perpétuellement. Article de M. le Che=-
valier de JAUCOURT.
CLIMACTÉRIQUE , (Année) adj. Divination,
année critique ou période de l’âge de l’homme, dans
laquelle les Aftrologues prétendent qu’il fe fait dans
le corps une altération confidérable qui conduit à
des maladies, à la mort, ou qui fignale cette année
par des accidens funeftes.
Nous ajoutons cette derniere claufé, parce due
Evelius qui a fait un volume entier fous le titre de
annus dimaclcrictis, y décrit la perte qu’il fit par le
feu qui prit à fon obfervatoire, & que cet accident
lui arriva dans fa plus grande climactérique.
Ce mot vient du grec xXi^etxTvç ou xXty.a.xTnpïxxi,
dérivé de , degré ou échelle; parce qu’on monte
de fept en fept ou de neuf en neuf ans, pour arriver
à l’année qui s’appelle climactérique.
Ainfi la première année climactérique de la vie de
l’homme, c’eft, félon quelques-uns, la feptieme : les
autres font des multiples de celle-ci ; favoir 14 , 21 ,
28, 3 5 ,4 1 , 49, 56, 6 3 ,7 0 , 77, 84. Mais les années.
6 3 & 84 font nommées en particulier grandes
climactériques, & l’on croit que le danger de mort y
eft beaucoup plus grand que dans les autres.
Selon d’autres auteurs, l’année climactérique fe
compte de neuf en neuf ; c’eft pour ce la , difent-ils,
que la foixante-troifieme de la quatre-vingt-unieme
font les plus dangereufes , parce que dans l’une le
nombre de fept, & dans l’autre le nombre de neuf,
fe trouvent répétés neuf fois.
Cette opinion eft fort ancienne : AuJugelle I’attri*
bue anx Chaldéens, qui pouvoient l’avoir reçûe de
Pythagore , fi peut-être dans fes voyages ce philo-
fophe ne l’emprunta pas d’eux ; car on fait que fa
philofophie étoit fondée en grande partie fur les rapports
de les propriétés des nombres, & qu’il attri-
buoit fur-tout au nombre fept une vertu particulière.
Marfile Ficin penfe en avoir trouvé le fondement,
en difant qu’il a été afligné à chaque planete une année
pour dominer fur le corps de l’homme chacune
à fon tour ; & que comme de toutes les planètes Saturne
eft la plus mal-faifante, toutes les feptiemes
années qui lui appartiennent, doivent être par cette
raifon très-dangereufes, de fur-tout les 49, 56, de
63 années où l’on eft déjà avancé fur l’âge : mais
peut-être eut-on fort embarraffé Marfile Ficin, en
lui demandant pourquoi les planètes dominoient fur
le corps de l’homme, & pourquoi les influences de
Saturne étoient plus funeftes que celles des autres
planètes.
Cependant des hommes fort éclairés ont eu foi à
ces influences. Augufte, fi l’on en croit Suetone, fe
réjoiüffoit d’avoir paffé fans danger fa grande climactérique,
c’eft-à-dire fa foixante & troifieme année
, car il mourut âgé de 76 ans. Quelques-uns ont
prétendu que les*années climactériques étoient aufli
fatales au corps politique ; & on pourrait en convenir,
s’il étoit prouvé qu’elles le font au corps naturel.
On en étoit affez perfuadé il n’y a pas deux fiecles,
c’eft-à-dire du tems de la ligue ; car M. de Thou de
Mezerai racontent que Jean Bodin, fi connu par fa
démonomanie, & qui étoit avocat du roi à Laon,
voulant faire déclarer cette ville en faveur de la ligue
& contre Henri III. fit un difeours aux habita ns
affemblés, où il s’attacha à lever leurs fcrupules ; de
après s’être déchaîné contre le roi qu’il ofa traiter de
traître & d'hypocrite, « il tira, dit M. de Thou,, des
v circon'ftances préfer.tes un préfage a fiez funefte à
» la fucceflion à la couronne ; car il dit que l’année
» foixante & troifieme de l’hommê étoit fon année
» climactérique, & ne manquoit guerè de hti être fii-
» nefté ; qu’ainfi, comme on Comptoit parmi nous
>r foixante & trois rois depuis Pharamond jüfqu’à
» Henri III. il fembloit que ce prince dût être fatal
» à la France, & que ce fût par lui que la couronne
» dût fortir de fa maifon ». I>e Thou, hiß. t. X C IV .
Mezerai dit à-peu-près la même chofe dans, fon abrégé
chronologique, fous l’an 1589. De pareils raifon-
nemens ne furprennent pas de la part de Bodin, &
les impreflions qu’ils firent ne doivent pas paraître
étranges dans un fiecle infatué de l’Aftrologie judiciaire.
Au refie plufieurs auteurs célébrés ont écrit fur
Xannée climactérique ; entr’autres Platon, Cicéron,
Macrobe, Aulugelle, auxquels on peut ajoûter faint
Auguftin, faint Ambroife, le vénérable Bede, Boe-
ce , &c. de parmi les modernes, Argol, Magir, de
Saumaife, de annis dimactericis. (G)
CL IMAT, f. m. ( Géogr. ) portion ôu zone de la
furface de la terre, terminée par deux cercles paralleles
à l’équateur, de d’une largeur telle que le
plus long jour dans le parallele le plus proche du
pôle, furpaffe d’une certaine quantité, par exemple,
d’une demi-heure, le plus long jour dans le parallele
le plus proche de l’équateur. Voye^ T erre , Paral-
LELLE , &C.
Les climats fe prennent donc depuis l ’équateur
jufqu’aux pôles, & font comme autant de bandes ou
de zones paralleles à l’équateur : mais il y a à la rigueur
plufieurs climats dans la largeur de chaque zone.
Un climat n’eft différent de celui qui eft le plus
proche de lu i, qu’en ce que le. plus grand jour d’été
eft plus long ou plus court d’une demi-heure dans"
l’un que dans l’autre. Chambers.
L’intervalle du premier climat eft de 8“ 3° , dé
celui du dernier n’a pas plus de Pour concevoir
la raifon de cette inégalité, qui procédé d’une propriété
de la fphere, il faut s’imaginer que dans la
fphere droite la moitié du tropique du cancer, qui
eft au-deffous de l’horifon, eft divifée en quarante-
huit parties égales, chaque partie étant de 3d 45/,
qui valent un quart-d’heure: de plus, qu’il y a une
de ces parties vers l’orient, & une vers l’occident,
les plus proches de l’horifon, qui toutes deux enfem-
ble font une demi-heure de tems, qui répond à l’intervalle
d’un climat. Cela pofé, on voit que la raifon
de l’inégalité des climats procédé de la feCtion plus ou
moins eblique du tropique par l ’horifon, félon les
différentes élévations du pôle, qui font que l’horifon
coupant moins obliquement le tropique aux parties
égales de 3d 45' prifes du côté d’orient & d’occident
proche l’horifon immobile, il en réfulte une plus
grande différence des hauteurs du pôle, que lorfque
le tropique eft coupé plus obliquement p$r l’horifon
aux mêmes points de 3d 5'. Ainfi cette différence
des hauteurs au pôle, qui correfpond à la demi-heure
des premiers climats, étant plus grande vers l’équateur
que vers les cercles polaires où font les derniers
climats, cela rend leur intervalle très-inégal, de
bien plus grand vers l’équateur que vers les pôles.
Comme les climats commencent à l’équateur, le
premier climat dans fon commencement a , par cette
raifon, précifément douze heures de jour à fon plu»
grand jour ; de à fa fin, il a douze heures & demie à
fon plus grand jour. M. Formey.
Le fécond dimat qui commence où le premier fi*
ftk , â douze heures & demie de jour àfoft plus grartd
jour, de à fa fin il a treize heures de jour à fon plus
grand jour ; de ainfi des. autres climats d’heures qui
Vont jufqu’au cercle polaire où fe termine ce que les
’Géographes appellent les climats d'heures, de où commencent
les climats des mois. Vbye^ Heure.
Comme les climats d’heures font des efpac.es compris
entre deux cercles parallèles à l’équateur, qui
ont leur plus grand jour plus long d’une demi-heure
dans four fin que dans leur commencement ; de même
les climats de mois, font dés efpaces terminés par
deux cercles parallèles au cercle polaire, fitués par-
delà ce cercle, de dans lefquels le plus grand jour
eft plus long d’un mois, ou de trente jours, à la fin
qu’au commencement. Voyeç M ois. Chambcrs.
Les anciens ne donnoient le nom de climat qu’aux
endroits de la terre qu’ils, çroyoient habitables. Ils
eftimoient qu’une partie de la Zone torride vers l’équateur
, de une partie de la Zone tempérée par-delà
le 5od. de latitude, étoient inhabitables, & ils n’a-
voieqt que fept climats« Ils pofoient le commencement
du premier à 1 zd. 4 i /. de latitude, où le plus
long jour d’été eft de douze heures trais quarts ; de
la fin du feptieme climat alloit vers les çod. de latitude
, où le plus long jour eft de 16 heures 20'. Pouf
mieux diftinguer leurs climats, ils en faifoient paf-
fer le milieu par les lieux les plus confidérables du
vieux continent : favoir, le premier par Meroé en
Ethiopie, le fécond par Sienne en Egypte, le troifieme
par Alexandrie aufli en Egypte, le quatrième
par l’île de Rhodes, le cinquième par Rome, le fi-
xieme par le Pont-Éuxin , de le feptieme de dernier
par l’embouchure du Borifthene. A ces fept climats
on en ajouta depuis encore deux autres ; favoir le
huitième, paffant par les monts Riphées dans laSar-
matie afiatique, de le neuvième par le Tanaïs. Les
anciens, comme les modernes, ont encore divifé la
terre en de plus petits efpaces, que l’on nommé parallèles
des climats, afin de lés diftinguer des autres
parallèles de l’équateur. Ces parallèles ne font que
des demi-climats, defquels l’elpace ne contient qu’un
quart-d’heure de variation dans les plus longs jours
d’été de chacun de ces parallèles.
Les modernes, qui ont voyagé bien plus avant
vefs les pôles > ont mis trente climats de chaque côté
; & quelques-uns d’eiitr’eux ont fait les différences
d’un qüart-d’heure feulement, au lieu d’une demi
heure. M. Formey.
Lorlqu’on détermine les climats, ôn n’a point égard
ordinairement à la réfra&ion. Voyt{ Ré f r a c t io n .
On donne vulgairement le nom de climat à une
terre différente d’une autre, par rapport aux faifons,
aux qualités de la terre, ou même aux peuples qui
y habitent, fans aucune relation aux plus grands
jours d’été.
Abulfeda, àtitéuf arabe, diftingue la première ef-
pece de ces climats par le nom de climat réel, de l’autre
par celui de climat apparent.
On compte ordinairement vingt-quatre climats
de demi-heure de douze de demi-mois. Chacim des
efpaces de ces derniers comprend quinze jours de
différence entre les plus longs jours d’été de l’un de
de l’autre de ces climats; car fous les cercles polaires
, le plus long jour d’été eft de vingt-quatre heures
oü d’un jour aftfonomique ; & le plus long jour
fous les pôles contient 180 jours aftfonomiques, qui
font fix mois i de forte qu’après avoir établi la difi
férence de ces climats de la quantité de quinze jours,
il eft évident qu’il en faudra douze depuis les cercles
polaires jufqu’aux pôles ; le premier defquels
commencera aux cercles polaires, de le dernier finira
aux pôles. Et pour diftinguer l’étendue de ces
douze climats, il faut encore imaginer douze cer-r
des parallèles à l’équateur par le commencement de
la fin de chacim de ces intervalles y lè premier defquels
fera le cercle polaire, où eft le commencement
du premier de ces climats ; de le dernier fera éloigné
du pôle de i d. 59/. qui déterminera le commencement
du dernier climat, dont le pôle fera la fin. Les
tables fuivantes feront connoîtfe l’étendue de tous
les climats, avec leurs degrés de latitude, & l’inter»,
valle compris entr’eux. M. Formey.
Table des climats de demi- heure.
Climats. Plus longs
jours.
Latitude. intervalle de
: Climats.
Leur nombre. Heur Min. Degr. Minut Degr. Minu:
O 12 O à 0 0 0
I 12 3D 8 34 8 34
2 !3 O16 43 9
3 !3 30 24 10 7 : 27
4 *4 O30 46 6 36
5 M 30 36 8 42
6 M O4 * 4 53
7 >5 39l45 29 4 b
8 16 4» . 59 5 30
9 16 30 57 57 2 58
10 l7 H 28 2 31
IJ 17 39 56 36 2
12 18 58 25 I 49
*3 18 30 59 : 57 I 32
14 ‘9 *0 61 16 I 19
r9 30 6z 24 I
16 20 063 20O t 6
17 20 30 64 8O 48
18 21 62 24 O'. ' 40
M 21 30 3 20 0 32
2Q 22 «4 46 0 26
BSHH '■ 22 ... m 66 6 0 20
22 *3 0 66 *9 0 13
13 23 30 66 3.70 8
M 24 p 66 30 0
Table des climats de demi mois.
Climats. Plus longs Latitude. Intervalle des
! jours. climats
Leur nombre Mois. Jours Vfir. Minut Degr. Minut.
O 66 30 Ô c
I 3 I 66 44 O H
2 1 C 67 20O 36
1. - 1 . M68 *3 r 3
4 2 0 48 1.1 1 *5
5 2 M7l 34 I 46
6 3 c 73 37 2 3
7 3 M 75 57 2 17
8 4 0 78 30 2 56
9 4 *5 81 x4 2 44
I l 10 S 0 84 5 2 17
.1 1 5 M 87 i 2 56
12 6 O90 O12 9
Il ne faut pas croire au refte que la température
foit exactement la même dans les pays fitués fous le
même climat: car une infinité de circonftances, comme
les vents, les volcans, le voifinage de la mer, la
pofition des montagnes, fe compliquent avec l’action
du foleil, & rendent fouvent la température
très-différente dans des lieux placés fous le même
parallèle.
Il en eft de même des climats placés des deux cô