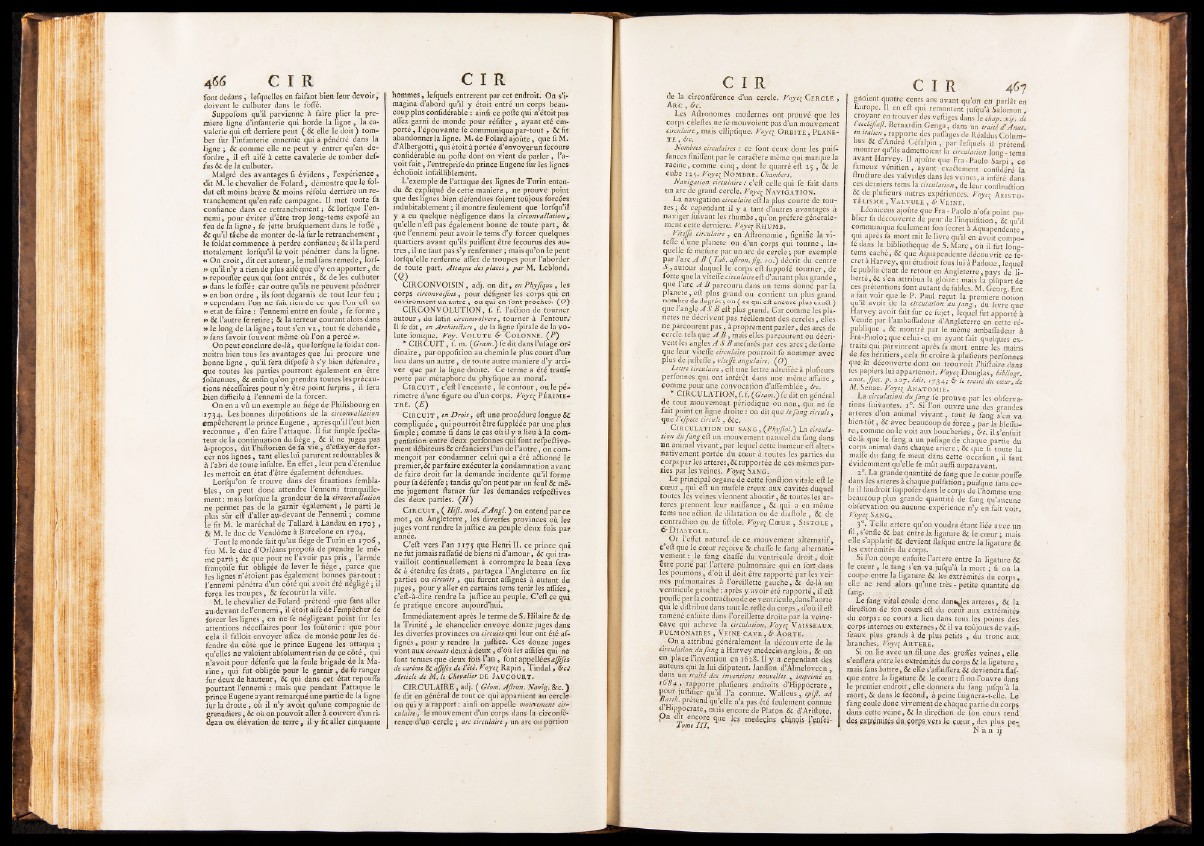
font dedans^ lefquelles en faifant bien leur devoir,
doivent le culbuter dans le fofle.
Suppofons qu’il parvienne à faire plier la première
ligne d’infanterie qui borde la ligne , la cavalerie
qui eft derrière peut ( 8c elle le doit ) tomber
fur l’infanterie ennemie qui a pénétré dans la
ligne ; & comme elle ne peut y entrer qu’en de-
fordre , il eft aifé à cette cavalerie de tomber def-
fus 8c de la culbuter.
Malgré des avantages li évidens , l’expérience ,
dit M. le chevalier de Folard, démontre que le fol-
dat eft moins brave & moins réfolu derrière un retranchement
qu’en rafe campagne. Il met toute fa
confiance dans ce retranchement ; & lorfque l’ennemi,
pour éviter d’être trop long-tems expofé au
feu de la ligne, fe jette brufquement dans le fofle ,
& qu’il tâche de monter de-là fur le retranchement,
le foldat commence à perdre confiance ; & il la perd
ttotalement lorfqu’il le voit pénétrer dans la ligne.
* On croit, dit cet auteur, lemalfansremede, lorf-
» qu’il n’y a rien de plus aifé que d’y en apporter, de
» repoufler ceux qui font entrés, 8c de les culbuter
» dans le fofle : car outre qu’ils ne peuvent pénétrer
» en bon ordre , ils font dégarnis de tout leur feu ;
» cependant l’on ne fait rien de ce que l’on eft en
» état de faire : l’ennemi entre en foule , fé forme ,
» & l’autre fe retire ; & la terreur courant alors dans
» le long de la ligne , tout s’en v a , tout fe débande,
» fans favoir fouvent même où l’on a percé ».
On peut conclure de-là, que lorfque le foldat con-
noîtra bien tous les avantages que lui procure une
bonne ligne , qu’il fera difpofé à s’y bien défendre,
que toutes les parties pourront également en être
foûtenues, 6c enfin qu’on prendra toutes les précautions
néceflaires pour n ’y être point furpris , il fera
bien difficile à l’ennemi de la forcer.
On en a vû un exemple au fiége de Philisbourg en
il73 4. Les bonnes difpofitions de la circonvallation
empêchèrent le prince Eugene , après qu’il l’eut bien
reconnue , d’en faire l’ attaque. Il fut fimple fpeâa-
teur de la continuation du fiége , 6c il ne jugea pas
à-propos, dit l’hiftorien de fa vie , d’effayer de forcer
nos lignes, tant elles lui parurent redoutables 8c
à l’abri de toute infulte. En effet, leur peu d’étendue
les mettoit en état d’être également défendues.
Lorfqu’on fe trouve dans des fituations fembla-
b les, on peut donc attendre l’ennemi tranquillement:
mais lorfque la grandeur delà circonvallation
ne permet pas de la garnir également, le parti le
plus sûr eft d’aller au-devant de l’ennemi ; comme
le fit M. le maréchal de Tallard à Landau en 1703 ,
6c M. le duc de Vendôme à Barcelone en 1704.
Tout le monde fait qu’au fiége de Turin en 1706 ,
feu M. le duc d’Orléans propofa de prendre le même
parti ; 6c que pour ne l’avoir pas pris, l’armée
françoife fut obligée de lever le fiége, parce que
les lignes n’étoient pas également bonnes pâr-tout :
l’ennemi pénétra d’un côté qui avoit été négligé ; il
força les troupes, 6c fecourût la ville.
M. le chevalier de Folard prétend que fans aller
au-devant de l’ennemi, i l étoit aifé de l’empêcher de
forcer les lignes , en ne fe négligeant point fur les
attentions néceflaires poiir les fouténir : que pour
cela il fallôit envoyer aflez de monde pour les défendre
du côté que le prince Eugene les attaqua ;
qu’elles ne valoient abfolument rien de ce cô té, qui
n’avoit pour défenfe que la feule brigade de la Marine
, qui fut obligée pour le garnir , de fe ranger
fur deux de hauteur, 6c qui dans cet état repouffa
pourtant l’ennemi : mais que pendant l’attaque le
prince Eugene ayant remarqué une partie de la ligne
fur la droite, où il n’y avoit qu’une compagnie de
grenadiers, 6c où on pouvoir aller à couvert d’un rideau
ou élévation de terre, il y fit aller cinquante
hommes, Iefquels entrèrent par cet endroit. On s’imagina
d’abord qu’il y étoit entré un corps beaucoup
plus confidérable : ainfi ce pofte qui n’étoit pas
aflez garni de monde pour réfifter , ayant été emporté
, l’épouvante fe communiqua par-tout, 6c fit
abandonner la ligne. M. de Folard ajoûte, que fi M.
d’Albergotti, qui étoit à portée d’envoyer un fecours
confidérable au pofte dont on vient de parler , l’a-
voit fa it , l ’entreprifedu prince Eugene fur les lignes
échoüoit infailliblement.
L ’exemple de l’attaque des lignes de Turin entendu
6c expliqué de cette maniéré , ne prouve point
que des lignes bien défendues foient toûjous forcées
indubitablement ; il montre feulement que lorfqu’il
y a eu quelque négligence dans la circonvallation p-
qu’ellen’eft pas également bonne de toute part, 6c
que l ’ennemi peut avoir le tems d’y forcer quelques
quartiers avant qu’ils puiflent être fecourus des autres
, il ne faut pas s’y renfermer ; mais qu’on le peut
lorfqu’elle renferme aflez de troupes pour l’aborder
de toute part. Attaque des places, par M. Leblond.
(<2)C
IRCONVOISIN, adj. on dit, en Phyßque , les
corps circonvoifins, pour défigner les corps qui en-
environnent un autre , ou qui en font proches. (O)
CIRCONVOLUTION, f. f. l’aftion de tourner
autour, du latin circumvolvere, tourner à l’entour.1
Il fe d it, en Architecture, de la ligne fpirale de la vo lute
ionique. Voy. V o lu t e & C olonne. {P)
* C IR CU IT , f. m. {Gram.') fe dit dans l’ufage ordinaire
, par oppofition au chemin le plus court d’un
lieu dans un autre, de toute autre maniéré d’y arriver
que par la ligne droite. Ce terme a été tranf-
porté par métaphore du phyfique au moral.
C ir c u it , c’eft l’enceinte, le contour, ou le périmètre
d’une figure ou d’un corps. Voyeç Périmèt
r e . {E)
' C ir c u it , en D roit, eft une procédure longue 8c
compliquée, quipourroit être fuppléée par une plus
fimple ; comme fi dans le cas où il y a lieu à la com-
penfation entre deux perfonnes qui font refpeftive-
ment débiteurs 8c créanciers l’un de l’autre, on com-
mençoit par condamner celui qui a été aftiomié le
premier, & parfaire exécuter la condamnation avant
de faire droit fur la demande incidente qu’il forme
pour fa défenfe ; tandis qu’on peut par un feul 8c même
jugement ftatuer fur les demandes refpeûives
des deux parties. (H )
C ir c u it , ( Hiß. mod. tTAngl.) on entend par ce
mot, en Angleterre, les diverfes provinces où les
juges yont rendre la juftice au peuple deux fois par
année.
C ’eft vers l’an 1175 que Henri II. ce prince qui
ne fut jamais rafîafié de biens ni d’amour, 8c qui tra-
vailloit continuellement à corrompre le beau fexe
8c à étendre fes états, partagea. l’Angleterre en fix
parties ou circuits , qui furent aflignes à autant de
juges, pour y à lle t en certains tems tenir les aflîfes,
c’eft-à-dire rendre la juftice au peuple. C ’eft ce qui.
fe pratique encore aujourd’hui.
Immédiatement après le terme de S. Hilaire 8c de
la Trinité , le chancelier envoyé douze juges dans
les diverfes provinces ou circuits qui leur ont été af-
fignés, pour y rendre la juftice*. Ces douze juges
vont aux circuits deux à deux, d’où les aflîfes qui ne
font tenues que deux fois l’a n , font appelléesâ^/es
de carême & affifes de l'été. Voye[ R apin, Tindal, &cl
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
CIRCULAIRE, adj. ( Gèom. Afiron. Navig. & e. )
, fe dit en général de tout ce qui appartient au cercle
ou qui y ajrâpport : ainfi on appelle mouvement cir~
culaire , lé mouvement d’un corps dans la-circonférence
d’un cercle j arc circulaire j un arc ou portion
de la circonférence d’un cercle. Voye{ C ercle
A r c , &c.'
Les Aftronomes modernes ont prouvé que les
corps céleftes ne fe mouvoient pas d’un mouvement
circulaire, mais elliptique. Voye^ O r b it e , Planèt
e ', &c.
Nombres circulaires : ce font ceux dont les puif-
fances Unifient par le caraftere même qui marque la
racine, comme cinq, dont le quarré eft 25 , 8c le
C ube .125. Voyei NOMBRE. Ckambers.
Navigation circulaire : c’eft celle qui fe fait dans
un arc de grand cercle. Voye% Na v ig a t io n .
La navigation circulaire eft la plus courre de toutes
; 8c cependant il y a tant d’autres avantages à
naviger fuivant les rhumbs, qu’on préféré généralement
cette dèrniere. Voye[ Rhumb.
V \teffe circulaire , en Aftronomie , lignifie la vî-
tefle d’une planete ou d’un corps qui tourne , laquelle
fe mefure par un arc de cercle ; par exemple
par l’arc A B {Tab. afiron. fig. 10.) décrit du centre
«S, autour duquel, le corps eft fuppofé tourner, de
forte que la vîtefle circulaire eft d’autant plus grande,
que l’arc A B parcouru dans un tems donne par la
planete, eft plus grand ou contient un plus grand
noffcbre de degrés ; ou ( ce qui eft encore plus exaét )
que l’angle^ S B eft plus grand. Car comme les planètes
ne décrivent pas réellement des cercles, elles
ne parcourent p as, à proprement parler, des arcs de
cercle, tels que A B , mais elles parcourent ou décrivent
les angles A S B mefurés par ces arcs ; de forte
que leur vîtefle circulaire pourroit fe nommer avec
plus de jufteffe, vîteffe.angulaire.(O) .
Lettre Circulaire, eft une lettre adreflée à plufieurs
perfonnes qui ont intérêt dans .une même affaire ,
comme pour une convocation d’affemblée, &c.
* CIRCULATION, f. f. {Gram.') fe dit en général
de tout mouvement périodique ou non, qui né fe
fait point en ligne droite : on dit que le fang circule,
que l'efpece circule, &c.
. C ircula t ion du s a n g , {Phyfiol.)T a circulation
du fang eft un mouvement naturel du fang dans
un animal v ivant, par lequel .cette humeur.eft alternativement
portée du coeur à, toutes les parties du
corps par les -arter.es, 6c rapportée de ;ces mêmes parties
par les veines. A’qyeç Sa n g .
Le principal organe de cette fonélion vitale eft le
coeur , qui eft un mufcle creux aux cavités duquel
toutes les Veines viennent aboutir, 8c toutes les artères
prennent leur naiffance, & qui a en même
tems une aôion de dilatation ou de diaftole , 8c de
contra&ion ou de fiftole. Voye^C(s.VK , Sistole ,
& D ia s to l e .
Or l’effet naturel de ce mouvement alternatif,
c’eft que le coeur reçoive & chaffe le fang alternat!- '
vement : le fang chaffé du vejitricule droit;doit
être porté par l’artere pulmonaire qui en fort dans-
les poumons, d’où il doit être rapporté par les veines
pulmonaires à l’oreillette gauche , & de-là an-
ventricule gauche : après y avoir été rapporté, il eft
pouffé par la contraûion de ce ventricule,dansl’aortè
qui le diftribue dans tout le, refte du corps , d’où. il.eft-
ramené enfuite dans l’oreillette droite par la veine-
cave qui' achevé la circulation., Voy e{ V aisseaux
pulmonaires ', V eine c a v e , & A o r te .
. _ On a attribué généralement la découverte de la
circulation du fang à Harvey médecin- anglois, 6c on
en place f’inventipn en 1628. Il y a cependant des
auteurs qui la lui difputent. Janffon d’Almeloyeen ,
dans, un traité des inventions nouvelles ,. imprimé en
16^ 4 , rapporte plufieurs endroits d’Hippocrate,
pour juftifier qu’i l . l ’a connue. Walleus, epifi. ad
Parth. prétend qu’elle n’a pas.été feulement connue
d Hippocrate, mais encoçe de Platon & d’Ariftote.
Vn dit encore que les médecins çhinçis l’çn/ei-
JomeJU, ‘ 1
gaoiertt quatre cents ans avant qu’on en parlât en
Europe. Il en eft qui remontent jufqu’à Salomon ,
croyant en trouver des veftiges dans le chap. x i j. de
LtccUjiafl, Bernardin Genga, dans un traité iTAnat,
cet italien , rapporte des paffages de Rialdus Colum-
bus & d André Céfalpin , par Iefquels il prétend
montrer qu’ils admettoient la circulation. long-tems
avant Harvey. Il ajoûte que Fra-Paolo Sarpi, ce
fameux venmen, ayant exaaement confidéré la
itruSure des valvules dans les veines, a inféré dans
! ces derniers tems la circulation, de leur conftmaion
& de plufieurs autres expériences. Voytr^ Aristo -
te lisme , V alvule , & V eine.
- Léoniceus ajoute que Fra - Paolo n’ofa point publier
fa découverte de peur de l’inquifition, & qu’il
communiqua feulement fon fecret à Aquapendente
qui après fa mort mit le livre qu’il en avoit compo-
fé dans la bibliothèque de S. M arc, où il fut long-
tems cache, & que Aquapendente découvrit ce fecret
à Harvey, qui étudioit fous lui à Padoue, lequel
le publia étant de retour en Angleterre, pays de liberté,
& s’en attribua la gloire : mais la plûpart de
ces prétentions font autant de fables. M. Georg. Ent
a fait voir que le P. Paul reçut la première notion
qu’il avoit de la circulation du fang., du livre que
Harvey avoit fait fur ce fujet, lequel fut apporté à
Venife par l’ambaffadeur d’Angleterre en cette république
, & montré par le même ambaffadeur à
Fra-Paolo; que celui-ci en ayant fait quelques extraits
qui parvinrent après fa mort entre les mains
de fes héritiers, cela fit croire à plufieurs perfonnes
que la découverte dont on trouvoit l’hiftoire dans
fes papiers lui appartenoit. Voye{_ Douglas, bibliogr.
anat. fpec. p. 227. édit. 17.34; & le traité du coeur, de
M. Senac■. Voye^ An a tom ie .
La. circulation du fang fe prouve pat les obferva-
tions fui vantes. i° . Si l’on ouvre une des grandes
arteres d’un animal v iv an t, tout le fang s’en va
bien tô t , & avec beaucoup de force , par la bleffu-
r e , comme on le voit aux boucheries, &c. il s’enfuit
de4a que le fang a un paffage de chaque partie du
corps animal dans chaque artere ; 8i que fi toute la
maffe du fang fe meut dans cette occafion, il faut
évidemment qu’elle fe mût auffi auparavant.
2°. La grande quantité de fang que le coeur pouffe
dans, les arteres à chaque pulfation ; puifque fans cela
il faudroit fuppofer dans le corps de l’homme une
beaucoup plus grande quantité de fang qu’aucune
obfervation ou aucune expérience n’y en fait voir,
Voye[ Sang.
3°- Telle artere qu’on youdra étant liée avec un
fil,, s’enfle & bat entre la ligature & le coeur .; mais
elle s’applatit & devient flafque entre la ligature &
les extrémités du corps.
Si Fon coupe enfuite l’artere entre la ligature 8c
le coeur, le lang s’en va jufqu’à la mort ; fi on la
coupe,-entre la ligature. & les.extrémités du corps,
elle, ne rend alors qu’une très-petite quantité de
fiing.; ^ ; .
Le .fang vital coule donc, d a n s e s arteres, 8c la
dire&ion- de: fon cours eft du coeur aux extrémités
du corps: ce cours a lieu dans; tous.les points des,
corps internes .ou externes , 8c il va toujours de vaif--
féaux plus grands à de plus petits , .du tronc aux,
branches, Voye[ Artere.
Si on lie avec un, fil. une des groffes veines, elle
s’enflera entre les extrémités du corps 8c la ligature ,
mais fans battre, & elle s’affaiffera & deviendra flafque
entre la ligature & le coeur : fi on l’ouvre dans
le premier endroit, elle donnera du fang jufqu’à la
mort, 8c dans le fécond, à peine faignera-t-elle. Le
fang coule donc yivement de chaque partie du corps
dans cetfe veine, 8c la dirçftion de fon cours tend
(Jùiçprps.yçrsie çççur, des plus pe-
N h n ij