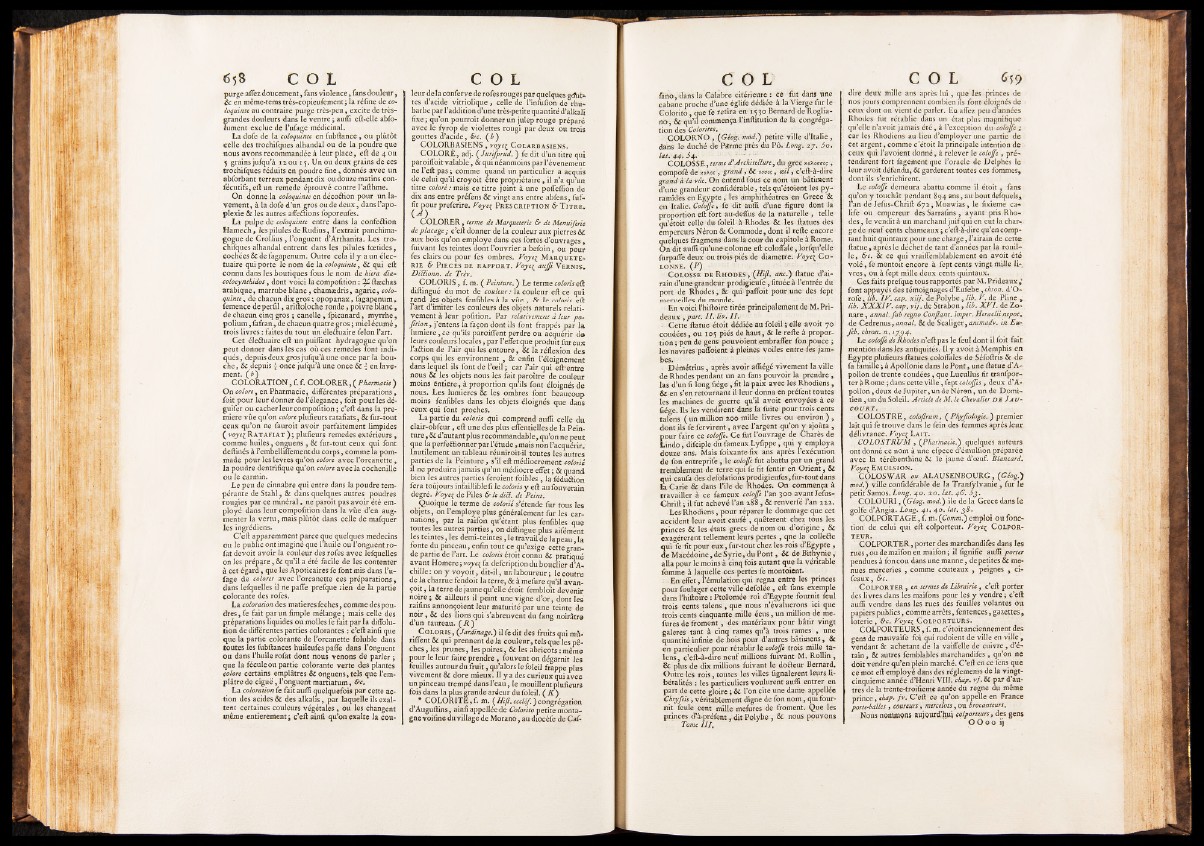
658 C O L
purge aflez doucement, fans violence, fans douleur,
Sc en même-tems très-copieufement ; la réfine de coloquinte
au contraire purge très-peu, excite de très-
grandes douleurs dans le ventre ; aufli eft-elle abfo-
lument exclue de l’ufage médicinal.
La dofe de la coloquinte en fubfiance, ou plutôt
celle des trochifques alhandal ou de la poudre que
nous avons recommandée à leur place, eft de 4 ou
5 grains jufqu’à 1 z ou 15. Un ou deux grains de ces
trochifques réduits en poudre fine, donnés avec un
abforbant terreux pendant dix ou douze matins con-
fécutifs, ell un remede éprouvé contre l’afthme.
On donne la coloquinte en décoôion pour un lavement,
à la dofe d’un gros oude deux, dans l’apoplexie
8t les autres affeéfions foporeufes.
La pulpe de coloquinte entre dans la confection
Hamech, les pilules de Rudius, l’extrait panchima-
gogue de Crollius, l’onguent d’Arthanita. Les trochifques
alhandal entrent dans les pilules foetides,
cochées 8c de lagapenum. Outre cela il y a un élec-
tuaire qui porte le nom de la coloquinte, 8c qui eft
connu dans les boutiques fous le nom de hiera dia-
colocynthidos, dont voici la compofition : I f ftaechas
arabique, marrube blanc, chamædris, agaric, coloquinte
, de chacun dix gros ; opopanax, fagapenum,
l’emence de perfil, ariftoloche ronde, poivre blanc,
de chacun cinq gros ; canelle , fpicanard, myrrhe,
polium, fafran, de chacun quatre gros ; mielécumé ,
trois livres : faites du tout un éleûuaire félon l’art.
Cet éleâuaire eft un puiflànt hydragogue qu’on
peut donner dans les cas où ces remedes font indiqués
, depuis deux gros jufqu’à une once par la bouche,
& depuis 7 once jufqu’à une once 8c ~ en lavement.
(£ )
COLORATION, f. f. COLORER,( Pharmacie )
On colore, en Pharmacie, différentes préparations,
foit pour leur donner de l’élegance, foit pout les dé-
guifer ou cacher leur compofition ; c’eft dans la première
vûe qu’on colore plufieurs ratafiats, 8c fur-tout
ceux qu’on ne fauroit avoir parfaitement limpides
( voyeç Ratafiat ) ; plufieurs remedes extérieurs ,
comme huiles, onguens , 8c fur-tout ceux qui font
deftinés à l’embelliffement du corps, comme la pommade
pour les levres qu’on colore avec l’orcanette,
la poudre dentrifique qu’ôn colore avec la cochenille
ou le carmin.
Le peu de cinnabre qui entre dans la poudre tempérante
de Stahl, & dans quelques autres poudres
rougies par ce minéral, ne paroît pas avoir été employé
dans leur compofition dans la vûe d’en augmenter
la vertu, mais plûtôt dans celle de mafquer
les ingrédiens.
C’eft apparemment parce que quelques médecins
ou le public ont imaginé que l’huile ou l’onguent ro-
fat de voit avoir la couleur des rofes avec lefquelles
on les prépare, 8c qu’il a été facile de les contenter
à cet égard, que les Apoticaires fe font mis dans l’ufage
de colorer avec l’orcanette ces préparations,
dans lefquelles il ne pafte prefque rien de la partie
colorante des rofes.
La coloration des matières feches, comme des poudres
, fè fait par un fimple mélange ; mais celle des
préparations liquides ou molles fe fait par la diflolu-
tion de différentes parties colorantes : c’eft ainfi que
que la partie colorante de l’orcanette foluble dans
toutes les fubftances huileufes paffe dans l’onguent
ou dans l’huile rofat dont nous venons de parler ;
que la fécule ou partie colorante verte des plantes
colore certains emplâtres 8c onguens, tels que l’emplâtre
de ciguë, l’onguent martiatum, &c.
La coloration fe fait aufti quelquefois par cette action
des acides 8c des alkalis, par laquelle ils exaltent
certaines couleurs végétales, ou les changent
même entièrement; c’eft ainfi qu’on exalte la cou-
C O L
leur de là cônferve de rofes rouges par quelques g<Sùfr
tes d’acide vitriolique, celle de l’infufion de rhubarbe
par l’addition d’une très-petite quantité d’alkali
fixe ; qu’on pourroit donner un julep rouge préparé
avec le fyrop de violettes rougi par deux ou trois
gouttes d’acide, &c. ( à )
COLO RBA SIEN S, voye^ C olar basiens.
C O LO R É , adj. ( Jurifprud. ) fe dit d’un titre qui
paroiffoit valable, & qui néanmoins par l’é venement
ne l’eft pas ; comme <pand un particulier a acquis
de celui qu’il croyoit être propriétaire, il n’a qu’un
titre coloré : mais ce titre joint à une pofleflion de
dix ans entre préfens 8c vingt ans entre abfens, fuf-
fit pour preferire. Voye{ Pr e sc r ip t io n 6* T it r e .
m
CO LO R E R , terme de Marqueterie & de Menuiferic
de placage ; c’eft donner de la couleur aux pierres 8e
aux bois qu’on employé dans ces fortes d’ouvrages,
fuivant les teintes dont l’ouvrier a befoin, ou pour
fes clairs ou pour fes ombres. Foye[ Marqueterie
& Pièces de r a p po r t . Foye^ aujji V ernis.
Dictionn. de Trév.
C O LO R IS , f. m. ( Peinture. ) Le terme coloris eft.
diftingué du mot de couleur : la couleur eft ce qui
rend les objets fenfibles à la vûe , & le coloris eft
l’art d’imiter les couleurs des objets naturels relativement
à leur pofition. Par relativement à leur pa-
Jitioriy j’entens la façon dont ils font frappés par la
lumière, ce qu’ils paroiflent perdre ou acquérir d »
leurs couleurs loc ales, par l’effet que produit fur eux
l’aftion de l’air qui les entoure, & la réflexion des
corps qui les environnent , & enfin l’éloignement
dans lequel ils font de l’oeil ; car l’air qui eft*entre
nous 8c les objets nous les fait paroître de couleur
moins entière, à proportion qu’ils font éloignés de
nous. L e s lumières 8e les ombres font beaucoup
moins fenfibles dans les objets éloignés que dans
ceux qui font proches.
L a partie du coloris qui comprend aufli celle du
clair-obfcur, eft une des plus eflentielles de la Peinture
, 8c d’autant plus recommandable, qu’on ne peut
que la perfectionner par l’étude , mais non l’acquérir.
Inutilement un tableau réuniroit-il toutes les autres
parties de la Peinture , s ’il eft médiocrement colorié
il ne produira jamais qu’un médiocre effet ; & quand
bien les autres parties feroient foibles , la fédu&ion
fera toûjours infaillible fi le coloris y eft aufouverain
degré. Voye{ de Piles & le dict. de Peint.
Quoique le terme de colorié s’étende fur tous les
o bjets, on l’employe plus généralement fur les carnations
, par la raifon qu’étant plus fenfibles que
toutes les autres parties, on diftingué plus aifément
les teintes, les demi-teintes, le travail de la pe au , la
fonte du pinceau, enfin tout ce qu’exige cette grande
partie de l’art. Le coloris étoit connu 8c pratiqué
ayant Homere ; voye^ fa defeription du bouclier d ’Achille:
on y v o y o it, dit-il, un laboureur; Iecoutre
de la charrue fendoit la tprre, & à mefure qu’il avançait
, la terre de jaune qu’elle étoit fembloit d evenir
noire ; & ailleurs il peint une vigne d’o r , dont le s
raifins annonçoient leur maturité par une teinte de
n oir, 8e des lions qui s’abreuvent du fang noirâtre
d’un taureau. ( À )
C o lo r is , ( Jardinage.) il fe dit des fruits qui mû-
riflent 8c qui prennent de la couleur, tels que les pêches
, les prunes, les poires, 8c les abricots : même
pour le leur faire prendre, fouvent on dégarnit les
feuilles autour du fru it, qu’alors le foleil frappe plus
vivement 8e dore mieux. Il y a des curieux qui avec
un pinceau trempé dans l’e au , le mouillent plufieurs
fois dans la plus grande ardeur du foleil. (K )
* CO LO R IT E , f. m. ( Hifi. ecclèf, ) congrégation
d’Auguftins, ainfi appellée de Colorito petite montagne
voifine du village de Moranô, au diocèfe de Caf-
C O L C O L 6 5 9
ffiflo.'üans la Gâlàbre citérieure : et fut dans une
cabane proche d’une églife dédiée à la Vierge fur le
Côlôrito, que fe retira èn 15 30 Bernard de Roglia-
no , & qu’il commença l’inftitution de là congréga-
tion des Çolorites, , y ”
C O LO RN O , ( Géog. mod.) petite ville d’Italie ,
dans le duché de Pàrirte près du Po. Long. zy. 5o.
lat. 44. 54.
CO LO S SE , terme dl Architecture, du grec xoXo<r<roç,
compofé de xoAoç , grand, 8c omoç, ceil, c’eft-à-dire
grand à la vue. On entend fous ce nom un bâtiment
d ’une grandeur confidérable, tels qu’étoient les pyramides
en Egypte ,' les amphithéâtres en Grece &
en Italie. Co/oj/e >-fe dit aufli d’une figure dont la
proportion eft fort au-deflus de la naturelle , telle
qu’etoit celle du folèiL à Rhodes & les ftatues des
empereurs Néron & Commode, dont il refte encore
quelques fragmens dans là cour dit capitole à Rome.
On dit aufli qu’une colonne eft coloffale, lorfqu’elle
furpafle deux ou trois pies de diamètre; Voye{ C o lonne.
(P ) ■ '• f
C olosse de Rhodes yifiifi. ancl) ftatue d’airain
d’une grandeur prodigieufe ,fitu é e à l’entrée du
port de Rhodes, & qui pafloit pour une des fept
merveilles du monde.
En voici l’hiftoire tirée principalement de M.Pri-
deaux , part. II. liv. II.
Cette ftatue étoit dédiée au foleil ; elle avoit 70
coudées, ou 105 piés de haut, & le refte à proportion
; peu de gens pouvôient embrafler fon pouce ;
les navires pafloient à pleines voiles entre les jam-
bes. ■ H | H ■
* Démétrius, après avoir afliégé vivement la ville
de Rhodes pendant un an fans pouvoir la prendre ,
las d’un fi long fié g e , fit la paix avec les Rhodiens,
& en s’en retournant il leur donna en préfent toutes
les machines de guerre qu’il avoit envoyées à ce
fiége. Ils les vendirent dans la fuite pour trois cents
talens ( un million 200 mille livres ou environ ) ,
dont jls fe fervirent, avec l’argent qu’on y ajoûta ,
pour faire ce colojfe. Ce fut l’ouvrage de Charès de
L in d o , difciple du fameux Lyfippe, qui y employa
douze ans. Mais foixante-fix ans après l’exécution
de fon entreprife, le colo(fe fut abattu par un grand
tremblement de terre qui fe fit fentir en Orien t, &
qui caufa des defolationsprodigieufes, fur- tout dans
la Carie & dans Tîle de Rhodes. On commença à
travailler à ce fameux colojfe l’an 300 avant Jefus-
Chrift ; il fut achevé l’an * 8 8 , & renverfé l’an 2zz.
L e s Rhodiens, pour répareyle dommage que cet
accident leur avoit caufé , quêtèrent chez tous les
princes & les états grecs de nom ou d’o rigine, &
exagérèrent tellement leurs pertes , qne la collede
qui fe fit pour eu x , für-tout chez les rois d’Egypte ,
de M acédoine, de S y rie , du P o n t, & de Bithynie,
alla pour le moins à cinq fois autant que la véritable
fomme à laquelle ces pertes fe montoient.
En effet, l’émulation qui régna entre les princes
pour foulager cette ville d e fo le e , eft fans exemple
dans l’hiftoire : Ptolomée roi d’Egypte fournit feul
trois cents talens , que nous n’évaluerons ici que
trois cents cinquante mille écu s, un million de me-
fures de from ent, des matériaux pour bâtir vingt
galeres tant à cinq rames qu’à trois rames , une
quantité infinie de bois pour d’autres bâtimens, &
en particulier pour rétablir le colojfe trois mille talen
s, c’eft-à-dire neuf millions fuivant M. R o llin ,
8c plus de dix millions fuivant le do&eur Bernard.
Outre lés r o is , toutes les villes fignalerent leurs libéralités
: les particuliers voulurent aufli entrer en
part de cette gloire ; & l’on cite une dame appellée
Chryfeis, véritablement digne de fon n om, qui fournit
feule cent mille mefures de froment. Que les
princes d’à-préfent y dit Pplybe , & nous pouvons
Tome / /ƒ .
dire deux mille ans après lui, qiie les princes de
nos jours comprennent combien ils font éloignés de
ceux dont on vient de parler. En aflez peu d’années
Rhodes fut rétablie dans un état plus magnifique
qu’elle n’avoit jamais été, à l’exception du * colojfe ;
car les Rhodiens au lieu d’employer une partie de
cet argent, comme c’étoit la principale intention de
ceux qui l’avoient donné, à relever le colojfe , prétendirent
fort fagement que l’oracle de Delphes le
leur avoit défendu, 8c gardèrent toutes ces fommes,
dont ils s’enrichirent.
Le colojfe demeura abattu comme il étoit, fans
qu’on y touchât pendant 894 ans, au boutdefquels*
l’an de Jefus-Chrift 672, Moawias, le fixieme ca’*
life ou empereur des Sarrafins , ayant pris Rhodes
, le vendit à un marchand juif qui en eut la char-,
ge de neuf cents chameaux ; c’eft-à-dire qu’en comptant
huit quintaux pour une charge, l’airain de cette
ftatue, après le déchet de tant d’années par la rouille,
&c. & ce qui vraiflemblablement en avoit été
volé, fe montoit encore à fept cents vingt.mille livres
, ou à fept mille deux cents quintaux.
Ces faits prefque tous rapportés par M.Prideaux,1
font appuyés des témoignages d’Eufebe, chron. d’O-
rofe, lib. IV . cap. x iij. de Polybe, lïb. V. de Pline ,
lib. X X X IV . cap. v ij. de Strabon , lib. X V I. de Zo-
nare, annal, fub regno Conjiant. imper. Heraclii. ncpotm
de Cedrenus, annal. 8c de Scaliger, animadv. in Eu-
feb. chron. n. i,y$4.
Le coloffè de Rhodes n’eft pas le feul dont il foit fait
mention dans les antiquités. Il y avoit à Memphis en
Egypte plufieurs ftatues coloflales de Séfoftris 8c de
fa famille ; à Apollonie dans le Pont, une ftatue d’Apollon
de trente coudées, que Lucullus fit tranfpor-
ter à Rome ; dans cette ville, fept colojfes, deux d’Apollon
, deux de Jupiter, un de Néron, un de Domi-
tien, un du Soleil .Article de M. le Chevalier d e J a u -
eo.UKT.
COLOSTRE, colojlrum, ( Phyjiologie. ) premier
lait qui le trouve dans le fein des femmes après leur
délivrance. Voye1 Lait.
COLOSTRUM , (Pharmacie.) quelques auteurs
ont donné ce nom à une efpece d’émulfion préparée
avec la térébenthine 8c le jaune d’oeuf. Blancard.
Foyer ÉMULSION.
COLOSWAR ou ALAUSENBOURG, (Géog.y
mod.) ville confidérable de la Tranfylvanie , fur le
petit Szmos.Long. 40. zo . lat. 46". i j .
COLOURI, ( Géog. mod.) île de la Grece dans le
golfe d’Angia. Long. 41. 40. lat. 38.
COLPORTAGE, f. m. ( Comm.) emploi ou fonction
de celui qui eft colporteur. Foye^ C olporteur.
COLPORTER, porter des marchandifes dans les
rues,oudemaifonenmaifon; il lignifie aufli porter
pendues à fon cou dans une manne, de petites 8c menues
merceries , comme couteaux , peignes , ci-
feaux, &c.
C olporter , en termes de Librairie, c’eft porter
des livres dans les maifons pour les y vendre ; c’eft
aufli vendre dans les rues des feuilles volantes ou
papiers publics, comme arrêts, fentences, gazettes ,
loterie, &c. Foyc{ C olporteurs.
COLPORTEURS ,,f. m. c’étoit anciennement des
gens de mauvaife foi qui rodoient de ville en ville 9
vendant 8c achetant de la vaiflelle de cuivre, d’étain
, 8c autres femblables marchandifes , qu’on ne
doit vendre qu’en plein marché. C’eft en ce fens que
ce mot eft employé dans des réglemenss de la vingt-
cinquieme année d’Henri V lll. chap. vj.&c par d’autres
de la trente-troifieme année du régné du même
prince, ehap. jv . C’eft ce qu’on appelle en France
porte-balles, coureurs , mercelots, ou brocanteurs.
Nous nommons aujourd’hui colporteurs, des gens
O O 0 0 ij