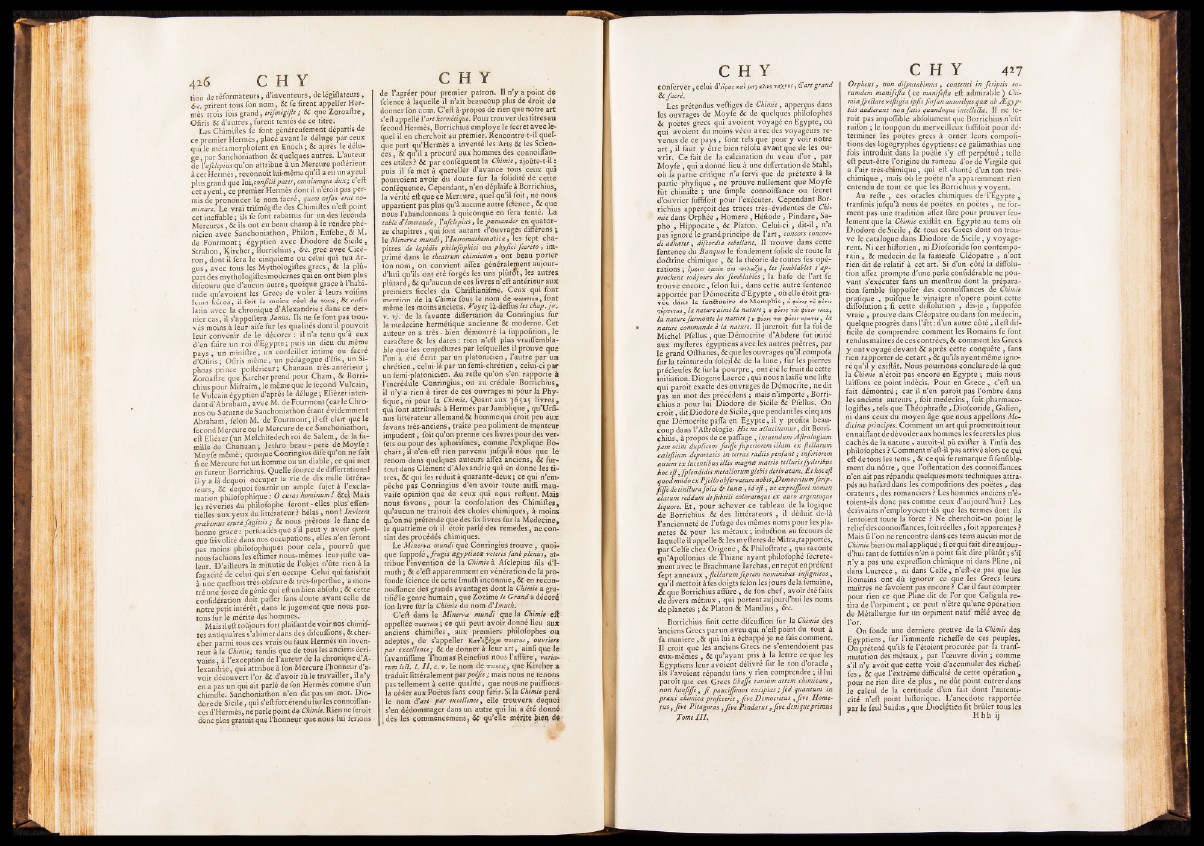
42.6 C H Y
lion de réformateurs, d’inventeurs, de légiilateurs,
&c. prirent tous fon nom, & fe firent appeller Hermès
trois fois grand, trifmtgifte ; Sc queZoroaftre,
Ofiris & d’autres, furent tentés de ce titre.
Les Chimiftes fe font généreufement départis de
ce premier Hermès, placé avant le déluge par ceux
qui le méfamorphofent en Enoch; & après le déluge
, par Sanchôniathon Sc quelques autres. L’auteur
de \?afdcpius qu’on attribue à un Mercure pollérieur
à cet Hermès, reconnoît lui-même qu’il a eu un ajreul
plus grand que lui,conjllii pater, omnïumqui dux; c’eft
cet ay eul, ce premier Hermès dont il n’étoit pas permis
de prononcer le nom facré, qucm mfas erai nq-
minare, Le vrai trifmégide des Chimiftes n elf point
cet ineffable ; ils fe font rabattus fur un des féconds
Mercures, Sc ils ont eu beau champ à le rendre phe- ;
nicien avec Sanchoniathon, Philon, Eufebe, 8r M.
de Fourmont ; égyptien avec Diodore de. Sicile,
Strabon,K-ûcher, Borrichius, Oc. grec avec Cicéron,
dont il fera le cinquième ou celui qui tua Argus
, avec tous les Mythologiftes grecs, St la plupart
des mythologiftesmodernes qui en ont bien plus
difcouru que d'aucun autre, quoique grâce à l’habitude
qu’avoient les Grecs de voler à leurs voifins
leurs héros, il foit le moins réel de tous; & enfin
latin avec la chronique d’Alexandrie; dans ce dernier
cas, il s’appellera Janus. Ils ne fe font pas trouvés
moins à leur aife fur les qualités dont il pouvoit
leur convenir de le décorer : il n’a tenu qu’à eux
d'en faire un roi d’Egypte; puis un dieu du même,
pays , un miniffre, un confeiller intime ou facre
d’OfirisI Ofiris même, un pédagogue d’Ifis,;un Si-
phoas prince pollerteur ; Chanaan tres-anteriéitr ;
Zoroaftre queKircherprendipour Chain, & Borrichius
pour Mïfraïm, le même que le fécond Vulcatn,
le Vnlcain égyptien d’ajirês le déluge ; Eliéaer intendant
d’Abraham, avec M. de Fourmont (car le Chro-
nos ou Saturne de Sanchoniathon étant évidemment
Abraham', félon M. de 'Fourmont, il eff clair que le
fécond Mercure ouïe Mercure de ce Sanchoniathon,
eft Eliéier(un Melchifedechroi de Salem, de. la famille
de Chanaan; Jethro beau-perè de Moyfe, ;
Moyfe même; quoique Conringius dife qu’on ne fait
fi ce Mercure fut un homme ou un diable1, ce qui met
en fureïir Borrichius. Quelle fource dediffertations!-
il y a là dequoi occuper la vie de dix mille littérateurs,.&
dequoi fournir un ample fuje tà l’exclamation
philofophique : O curas hominum! &cpMais
les rêveries du philofophe feront - elles plus1 effen-
tielles aux yeux du littérateur ï hélas, non ! Inviccm
prcebtmus scruta jagiuis; & nous prêtons le flanc de
bonne grâce : perfuadés que g » peut y avoir quelque
frivolitéidans nos-occupations, elles n’en feront
pas moins' philofophiques pour cela, pourvu que
nous fâchions les eflimer nous-mêmes leur jufte valeur.
D ’ailleurs la minutie de l’objet n’ôte rien à la
fagacité de celui qui s’en occupe Celui quifatisfait
à une queflion trës-obfcure Si très-fuperflue, a montré
une force de genie qui eff un bien abfolu ; & cette
confidération doit palier fans doute avant celle de
notrepetit.intérêt, dans le jugement-que nous por-
tonsfurle mérite des hommes; , . /
. Mais il eft toujours fort plaifant de voir nos chimiftes
antiquaires s’abîmer dans des difcuflïons , & chercher,
parmi tous ces vrais ou faux-Hermès un inventeur
à la Chimie; tandis que de tous les anciens écrivains
, à l’exception de l ’auteur de la chronique d’Alexandrie
, qui attribue àfon-MerCure l’honneur d’avoir
.découvert l’or & d’avoir lù le travailler, il n’y
en a pas un qui ait parlé de fon Hermès comme d’un
chimifte. Sanchoniathon n’en dit pas un mot. Diodore
de Sicile, qui s’eftfortétendufur les connoiffances
d’Hermès , ne parle point de Chimie. Rien ne feroit
donc plus gratuit que l’honneur que nous lui ferions
C H Y
de l’ agréer pour premier patron. Il n’y a point de
fcience à laquelle il n’ait beaucoup plus de droit de
donner fon nom. C ’eft à-propos de rien que notre art
s’eft appelle Y art hermétique. Pour trouver des titres au
fécond Hermès, Borrichius employé le fecret avec lequel
il en cherchoit au premier. Rencontre-t-il quelque
part qu’Hermès a inventé les Arts & les Sciences
. & qu’il a procuré aux hommes des connoiffan-
ces utiles ? & par conféquent la Chimie, ajoûte-t-il :
puis il fe met à quereller d’avance tous ceux qui
pourroient avoir du doute fur la folidite de cette
conféquence. Cependant, n’en déplaife à Borrichius,
la vérité eft que ce Mercure, quel qu’il foit, ne nous
appartient pas plus qu’à aucune autre fdence, & que
nous l’abandonnons à quiconque en fera tenté. La
table clémeraude, Yafclepius, le pamander en quatorze
chapitres, qui font autant d’ouvrages différens ;
le Minerva mundi, Ylatromathematica , les fept chapitres
de lapidis philofophici ou phyfici fecreto, imprimé
dans le theatrum chimicum, ont beau porter
fon nom, on convient affez généralement aujourd’hui
qu’ils ont été forgés les lins plutôt, les autres
plûtard, & qu’aucun de ces livres n’ eft antérieur aux
premiers fiecles du Chriftianifme. Ceux qui font
mention de la Chimie fous le nom de 'ooimnai, font
même les moins anciens, f p p l là-deffus les chap.jv.
v .v j. de la favante differtàtion de Conringius fur
la médecine hermétique ancienne & moderne. Cet
auteur en a très - bien démontré la fuppofition, le
carattere & les dates : rien n’eft plus vraiffembla-
ble que les conjeéhires par lefquelles il prouve que
l’un a été écrit par un platonicien, l’autre par un
chrétien, celui-là par un femi-chrétien, celui-ci par
un femi-platonicien. Au refte qu’on s’en rapporte à
l’incrédule Conringius, ou au crédule Borrichius,
il n’y a rien à tirer de ces ouvrages ni pour la Phy-
fique, ni pour la Chimie. Quant aux 36515 liv res ,
qui font attribués à Hermès par Jamblique, qu’Urfi-
nüs littérateur allemand & homme qui croit peu aux
favans très-anciens, traite peu poliment de menteur
impudent, foit qu’on prenne ces livres pour des ver*
fets ou pour des aphorifmes , comme l’explique Bo-
chart, il n’en eft rien parvenu jufqu’à nous que le
renom dans quelques auteurs affez anciens, & fur-
tout dans Clément d’Alexandrie qui en donne les ti-
' très, & qui les réduit à quarante-deux ; ce qui n’empêche
pas Conringius d’en avoir toute aufli mau-
vaife opinion que de ceux qui nous reftent. Mais
nous favons, pour la confolation des Chimiftes,
; qu’aucun ne traitoit des chofes chimiques, à moins
qu’on ne prétende qüe des fix livres fur la Medecine,
le quatrième où il étoit parlé des remedes, ne contînt
des procédés chimiques.
Le Minerva mundi que Conringius trouve, quoique
fuppofé, frugis agyptiaca veteris fané pie nus, attribue
l’invention dé la Chimie à Afclepius fils d’I-
muth ; & c’éft apparemment en vénération de lapro-
1 fonde fcience de cette Imuth inconnue, & en recon-
noiffance des grands avantages dont la Chimie a gra-
tifiéle genre humain, que Zozime le Grand a décoré-'
fon livre fur la Chimie du nom d’Imuthy ’ •'
C ’eft dans le Minerva mundi que la Chimie eft -
appellée wo/«t/x» ; ce qui peut avoir donné lieu aux-
anciens chimiftes, aux premiers philofophes ou
adeptes, de s’appeller YLarri^èxw •neimat, ouvriers
: par excellence; & de donner à leur art, ainfi que le
! favantiflime Thomas Reinefius uous l’affûre, varia*
i rum lect. I. I I . c. v. le nom de noimn, que Kireher a -
trâduit littéralement par poéjîe; mais nous ne tenons
pas tellement à cette qualité, que noysne puiflions^
la céder aux Poètes fans coup férir. Si la Chimie perd
j le nom d’art par excellence, elle trouvera dequoi;
! s’en dédommager dans un autre qui lui a été donné
[ dès les çommencemenSj -qu’elle mérite bien d^-
C H Y
conferver, celui d’/tp«ç ha) /xtya.\tiç mxvK > Kart grand
& facré.
Les prétendus veftiges de Chimie, apperçus dans
les ouvrages de Moyfe & de quelques philofophes
& poètes grecs qui avoient voyagé en Egypte, ou
qui avoient du moins vécu avec des voyageurs revenus
de ce pa ys, font tels que pour y Voir notre
a r t , il faut y être bien réfolu avant que de les ouvrir.
Ce fait de la calcination du veau d’or , par
Moyfe , qui a donné lieu à une differtàtion de Stahl,
où la partie critique n’a fervi que de prétexte à la
partie phyfique , ne prouve nullement que Moyfe
fût chimifte ; une fimple connoiffance ou fecret
d’ouvrier fuffifoit pour l’exécuter. Cependant Borrichius
apperçoit des traces très-évidentes de Chimie
dans Orphée , Homere , H éfiode, Pindare, Sa-
pho , Hippocate, & Platon. Celui-ci , dit-il, n’a
pas ignoré le grand principe de l’art, concors concor-
di adharet, difcordia rebellant.. Il trouve dans cette
fentence du Banquet le fondement folide de toute la
doftrine chimique , & la théorie de toutes fes opérations
; ofxotov o/jo'iA. Àtt «srtXetÇ*/, les femblables s approchent
toujours des femblables ; la bafe de l’art fe
trouve encore \ félon liii, dans cette autre fentence
apportée par Démocrite d’Egypte , où elle étoit gravée
dans le fanâuaire de Memphis, « çvtnç t» <pvuu
'TtpTrtTo.i, la nature aime la nature ; » tpvnç thf tputnv vjka,
la nature furmonte la nature ; « <pu<nç nw tpvtrtv xpaTi/, la
nature commande à la nature. II jureroit fur la foi de
Michel Pfellus , que Démocrite d’Abdere fut initié
aux myfteres égyptiens avec les autres prêtres, par
le grand Ofthanes, &que les ouvrages qu’il compofa
fur la teinture du foleil &c de la lune, fur les pierres
précieufes & fur la pourpre, ont été le fruit de cette
initiation. Diogene Laerce, qui nous a laiffé une lifte
qui paroît exafte des ouvrages de Démocrite, ne dit
pas un mot des précédens ; mais n’im porte, Borrichius
a pour lui Diodore de Sicile & Pfellus, On
c ro it, dit Diodore de Sicile, que pendantles cinq ans
que Démocrite paffa en Egypte, il y profita beaucoup
dans l ’Aftrologie. Hic ne allucinemur, dit Borrichius
, à propos de ce paffage , intuendum Aftrologiam
jam olim duplicem fuijfe fuperiorem illam ex fiellarum
coelefiium deportatis in terras radiis penfant ; inferiorem
autem ex lucentibus illis magna matris tellurisfyderibus
hoc eft,fplendidis metallorumglebis derivatam. Ethocefl
quodmodo ex Pfello obfervatum nobis,Democritum fcrip.
(iffe de tincturàJolis & luna,, id eji, ut expreffiori nomen
tlatum reddàm de fubtili coloratoque ex auro argentoque
liquore. E t , pour achever ce tableau de la logique
de Borrichius & des littérateurs , il déduit de-là
l’ancienneté de l’ufage des mêmes noms pour les planètes
& pour les métaux ; induftion au fecours de
laquelle il appelle & les myfteres de Mitra,rapportés,
par Celfe chez Origene, & Philoftrate , qui raconte
qu’Apollonius de Thiane ayant philofophé fecrete-
ment avec le Brachmane Iarchas, en reçut en préfent
fept anneaux , fiellarum feptem nominibus infignitos,
qu’il mettoit à les doigts félon les jours delà lemaine,
que Borrichius affûre , de fon chef, avoir été faits
de divers métaux , qui portent aujourd’hui les noms
de planètes ; &: Platon & Manilius , &c.
Borrichius finit cette difcuffion fur la Chimie des
anciens Grecs par un aveu qui n’eft point du tout à
fa maniéré , & qui lui a échappé je ne fais comment.
Il croit que les anciens Grecs ne s’entendoient pas
eux-mêmes , & qu’ayant pris à la lettre ce que les
Egyptiens leur avoient délivré fur le ton d’oracle,
ils l’avoient répandu fansy rien comprendre ; il lui
paroît que ces Grecs libajfe tantum artem chimicam ,
non haufjfe, J i pauciffimos excipias ; fed quantum in
praxi chimica profecerit, five Democritus ,fv e Home-
rus , fv e Pitagoras ,Jîve Pindarus ,Jîve denique primus
Tome I I I .
C H Y 4 2 7
Orpheus t non dijputabimus, contenti in fcriptis eo-
rumdem manifejla ( ce manifejla eft admirable ) Chi-
mioe fpeclare veftigia ipjis forfan autoribus qua ab Ægyp-
tiis audierant non fatis quandoque intellect a. Il ne feroit
pas impolïible abfolument que Borrichius n’eût
raifon ; le foupçon du merveilleux fuffifoit pour déterminer
les poètes grecs à orner leurs compofi-
tions des logogryphes égyptiens : ce galimathias une
fois introduit dans la poéfie s’y eft perpétué ; telle
eft peut-être l’origine du rameau d’or de V irgile qui
a l’air très-chimique, qui eft chanté d’un ton très-
chimique , mais où le poète n’a apparemment rien
entendu de tout ce que les Borrichius y voyent.
Au refte , ces oracles chimiques de •'l’Egypte ,
tranfmis jufqu’à nous de poètes en poètes , ne forment
pas une tradition affez fûre pour prouver feulement
que la Chimie exiftât en Egypte au tems où
Diodore de Sicile , & tous ces Grecs dont on trouve
le catalogue dans Diodore de Sicile, y voyagèrent.
Ni cet hiftorien, ni Diofcoride fon contemporain
, & médecin de la fameufe Cléopâtre , n’ont
rien dit de relatif à cet art. Si d’un côté la diffolu-
tion affez prompte d’une perle confidérable ne pouvant
s’exécuter fans un menftrue dont la préparation
femble fuppofer des connoiffances de Chimie
pratique , puifque le vinaigre n’opere point cette
diffolution ; fi cette diffolution , dis-je , fuppofée
vraie , prouve dans Cléopâtre ou dans fon médecin,
uelque progrès dans l’art : d’un autre côté , il eft dif-
cile de comprendre comment les Romains fe font
rendus maîtres de ces contrées, & comment les Grecs
y ont voyagé devant & après cette conquête , fans
rien rapporter de cet a r t , & qu’ils ayent même ignoré
qu’il y exiftât. Nous pourrions conclure de-là que
la Chimie n’étoit pas encore en Egypte ; mais nous
laiffons ce point indécis. Pour en Grece , c’eft un
fait démontré ; car il n’en paroît pas l’ombre dans
les anciens auteurs , foit médecins, foit pharmaco-
logiftes, tels que Théophrafte, Diofcoride, Galien,
ni dans ceux du moyen âge que nous appelions Medicina
principes. Comment un art qui promettoittout
ennaiffant de dévoiler aux hommes les fecrets les plus
cachés de la nature , auroit-il pu exifter à l’infû des
philofophes ? Comment n’ eft-il pas arrivé alors ce qui
eft de tous les tems , & ce qui fe remarque fi fenfible-
ment du nôtre, que l’oftentation des connoiffances
n’en ait pas répandu quelques mots techniques attrapés
au hafard dans les compofitions des poètes , des
orateurs, des romanciers ? Les hommes anciens n’é-
toient-ils donc pas comme ceux d’aujourd’hui? Les
écrivains n’employoient-ils que les termes dont ils
fentoient toute la force ? Ne cherchoit-on point le
relief des connoiffances, foit réelles , foit apparentes ?
Mais fi l’on ne rencontre dans ces tems aucun mot de
Chimie bien ou mal appliqué; fi ce qui fait dire aujourd’hui
tant de fottifes n’en a point fait dire plûtôt ; s’il
n’y a pas une expreffion chimique ni dans Pline, ni
dans Lucrèce, ni dans Ce lfe, n’eft-ce pas que les
Romains ont dû ignorer ce que les Grecs leurs
maîtres ne favoient pas encore ? Car il faut compter
pour rien ce que Pline dit de l’or que Caligula retira
de l’orpiment ; ce peut n’être qu’une opération
de Métallurgie fur un orpiment natif mêlé avec de
l’or.O
n fonde une derniere preuve de la Chimie des
Egyptiens, fur l’imriienfe richeffe de ces peuples.
On prétend qu’ils fe l’étoient procurée par la transmutation
des métaux, par l’oeuvre divin ; comme
s’il n’y avoit que cette voie d’accumuler des richef-
fes, & que l’extrême difficulté de cette opération ,
pour ne rien dire de plus, ne dût point entrer dans
le calcul de la certitude d’un fait dont l’autenti-
cité n’eft point hiftorique. L’anecdote rapportée
par le feul Suidas, que Dioclétien fit brûler tous les
r H h h i j