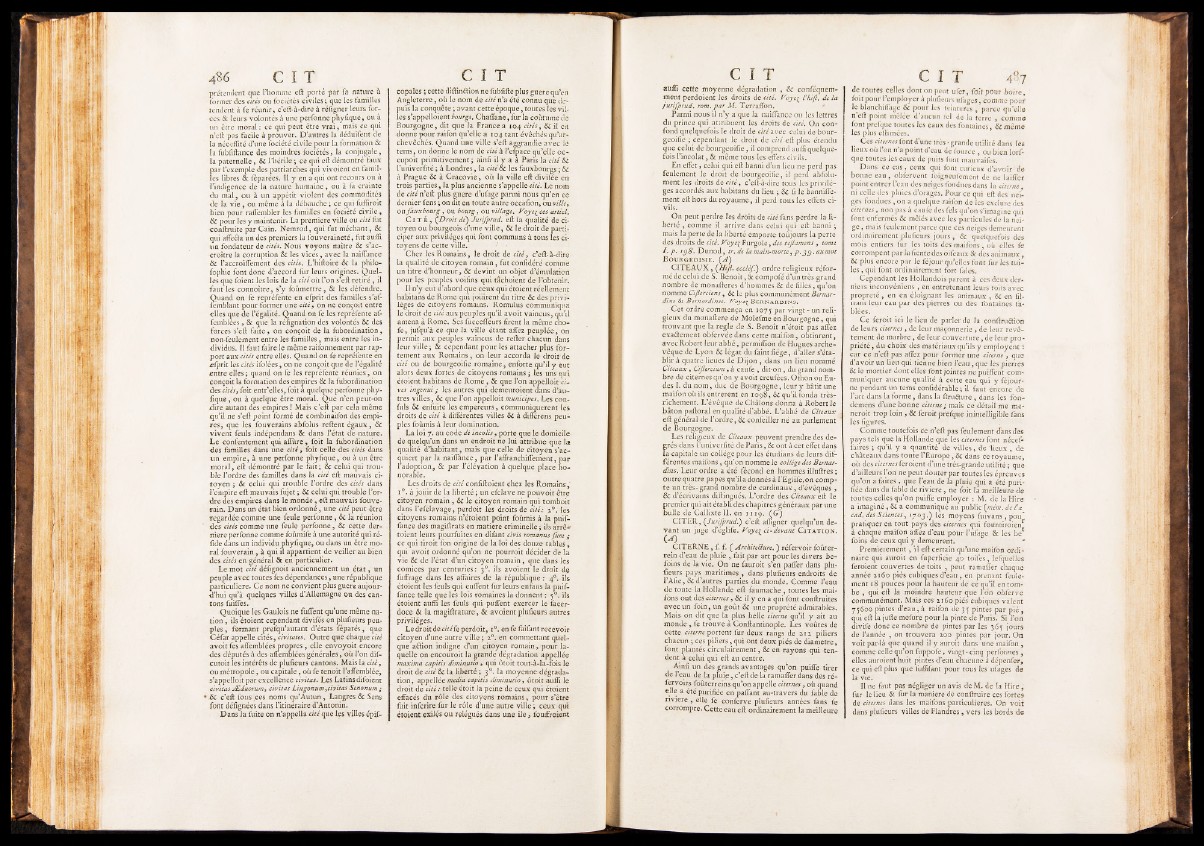
prétendent que l’homme cft porté paî fa nature à
former des cités ou fociétés civiles; que les familles
rendent à fe réunir, c’eft-à-dire à réfigner leurs forces
& leurs volontés à une perfonne phyfique, ou à
un être moral : ce qui peut être v ra i, mais ce qui
n’eft pas facile à prouver. D ’autres la déduifent de
la néceffité d’une fociété civile pour la formation &
la fubfiftance des moindres fociétés, la conjugale,
la paternelle, & l ’hérile ; ce qui eft démontré faux
par l’exemple des patriarches qui vivoient en familles
libres & féparées. Il y en a qui ont recours ou à
l’indigence de la nature humaine, ou à la crainte
du mal, ou à un appétit violent des commodités
de la vie , ou même à la débauche ; ce qui fuffiroit
bien pour raffembler les familles en focicté civile,
& pour les y maintenir. La première ville ou cité fut
conftruite par Caïn. Nemrod, qui fut méchant, &
qui affe&a un des premiers la fouveraineté, fut auffi
un fondateur de cités. Nous voyons naître & s’accroître
la corruption & les vices, avec la nailfance
& l’accroilfement des cités. L’hiftoire &c la philo-
fophie font donc d’accord fur leurs origines. Quelles
que foient les lois de la cité où l’on s’elt retiré , il
faut les connoître, s’y foûmettre, & les défendre.
Quand on fe repréfente en efprit des familles s’af-
femblant pour former une cité, on ne conçoit entre
elles que de l’égalité. Quand on fe les reprél'ente af-
femblees, & que la réfignation des volontés &c des
forces s’eft faite, on conçoit de la fubordination ,
non-feulement entre les familles, mais entre les individus.
Il faut faire le même raisonnement par rapport
aux cités entre elles. Quand on fe repréfente en
jelprit les cités ifolées, on ne conçoit que de l’égalité
entre elles ; quand on fe les repréfente réunies, on
conçoit la formation des empires & la fubordination
des cités, foit entr’elles, foit a quelque perfonne phy-
lique , ou à quelque être moral. Que n’en peut-on
dire autant des empires ! Mais c ’eft par cela même
qu’il ne s’eft point formé de combinaifon des empires
, que les fouverains abfolus relient égaux, &
vivent feuls indépendans & dans l’état de nature.
Le confentement qui aflïire, foit la fubordination
des familles dans une cité , foit celle des cités dans
tin empire, à une perfonne phyfique, ou à un être
moral, eft démontré par le fait; & celui qui trouble
l’ordre des familles dans la cité eft mauvais citoyen
; & celui qui trouble l’ordre des cités dans
l ’empire eft mauvais fujet ; & celui qui trouble l’ordre
des empires dans le monde, eft mauvais fouve-
rain. Dans un état bien ordonné, une cité peut être
regardée comme une feule perfonne, & la réunion
des cités comme une feule perfonne, & cette dernière
perfonne comme foûmife à une autorité qui ré-
fide dans un individu phyfique, ou dans un être moral
fouverain, à qui il appartient de veiller au bien
des cités en général & en particulier.
Le mot cité défignoit anciennement un é ta t , un
peuple avec toutes fes dépendances, une république
particulière. Ce nom ne convient plus guere aujourd
’hui qu’à quelques villes d’Allemagne ou des cantons
fuilfes.
Quoique les Gaulois ne fuffent qu’une même nation
, ils étoient cependant divifés en plufieurs peuples
, formant prefqu’autant d’états féparés, que
Céfar appelle cités, civitates. Outre que chaque cité
avoit fes affemblées propres, elle envoyoit encore
des députés à des affemblées générales, où l’on dif-
cutoit les intérêts de plufieurs cantons. Mais la cité,
ou métropole, ou capitale, où fe tenoit l’affemblée,
s’appelloit par excellence civitas. Les Latins difoient
civitas Æduorum, civitas Lingonum,civitas Senonum;
& c’eft fous jees noms qu’Autun , Langres & Sens
font défignées dans l’itinéraire d’Antonin.
Dans la fuite on n’appella cité que les villes épifcopales
; cette diftinûion ne fubfifte plus guere qu’en
Angleterre, où le nom de cité n’a été connu que d o
puis la conquête ; avant cette époque, toutes les villes
s’appelloient bourgs. Chaffane, fur la coutume de
Bourgogne, dit que la France a 104 cités, & il en
donne pour raifon qu’elle a 104 tant évêchés qu’ar-
chevêchés. Quand une v ille s’eft aggrandie avec le
tems, on donne le nom de cité à l’elpace qu’elle oc-
cupoit primitivement ; ainfi il y a à Paris la cité &C
l’univerfité ; à Londres, la cité & les fauxbourgs ; &C
à Prague & à Cracovie, où la ville eft divifée en
trois parties, la plus ancienne s’appelle cité. Le nom
de cité n’eft plus guere d’ufage parmi nous qu’en ce
dernier fens ; on dit en toute autre occàfion, ou ville,
ou fàuxbourg, ou bourg, ou village. Voye^ces articl.
C i t é , ('Droit de) Jurifprud. eft la qualité de citoyen
ou bourgeois d’une ville , & le droit de partir
ciper aux privilèges qui font communs à tous les citoyens
de cette ville.
Chez les Romains, le droit de cité, c’eft-à-dire
la qualité de citoyen romain, fut confidéré comme
un titre d’honneur, & devint un objet d’émulation
pour les peuples voifins qui tâchoient de l ’obtenir.
Il n’y eut d’abord que ceux qui étoient réellement
habitans de Rome qui jouirent du titre & des privilèges
de citoyens romains. Romulus communiqua
le droit de cité aux peuples qu’il avoit vaincus, qu’il
amena à Rome. Ses fûcceffeurs firent la même cho*
fe, jufqu’à ce que la ville étant affez peuplée, on
permit aux peuples vaincus de relier chacun dans
leur v ille ; & cependant pour les attacher plus fortement
aux Romains, on leur accorda le droit de
cité ou de bourgeoifie romaine, enforte qu’il y eut
alors deux fortes de citoyens romains ; les uns qui
étoient habitans de Rome, & que l’on appelloit cï-
ves ingenui ; les autres qui demeuroient dans d’autres
villes, & que l’on appelloit municipes. Les confias
& enfuite les empereurs, communiquèrent les
droits de cité à différentes villes & à différens peuples
fournis à leur domination.
La loi 7. au code di incolis, porte que le domicile
de quelqu’un dans un endroit ne lui attribue que la
qualité d’habitant, mais que celle de citoyen s’acquiert
par la naifftince, par l’affranchiffement, par
l’adoption,, & par l’élévation à quelque place honorable.
Les droits de cité confiftoient chez les Romains
i° . à jouir de la liberté ; un efclave ne pouvoir être
citoyen romain , & le citoyen romain qui tomboit
dans l’efclavage, perdoit les droits de cité: z°. les
citoyens romains n’étoient point fournis à la puif-
fance des magiftrats en matière criminelle ; ils arrê-ï*
toient leurs pourfuites en difant civis romànus fum ;
ce qui tiroir fon origine de la loi des douze tables,
qui avoit ordonné qu’on ne pourroit décider de la
vie & de l’état d’un citoyen romain, que dans les
comices par centuries: 30. ils avoient le droit de
fuffrage dans les affaires de la république : 40. ils
étoient les feuls qui euffent fur leurs enfansla puif-
fance telle que les lois romaines la donnent : 50. ils
étoient auffi les feuls qui puffent exercer le facer-
doce & la magiftrature, & avoient plufieurs autres
privilèges.
Le droit de cité fe perdoit, i°. en fe faifant recevoir
citoyen d’une autre ville ; z°. en commettant quelque
aélion indigne d’un citoyen romain, pour laquelle
on encouroit la grande dégradation appellée
maxima capitis diminutio, qui ôtoit tout-à-la-rois le
droit de cité &c la liberté ; 30. la moyenne dégradation,
appellée media capitis diminutio, ôtoit auffi le
droit de cité: telle étoit la peine de ceux qui étoient
effacés du rôle des citoyens romains, pour s’être
fait inferire fur le rôle d’une autre ville ; ceux qui
étoient exilés ou relégués dans une île , foudroient
auffi cette moyenne dégradation , & conféquem-
ment perdoient les droits de cité. Voye^ l'hifl. de la
jurifprud. rom. par M. Terraffon.
Parmi nous il n’y a que la naiffance ou les lettres
du prince qui attribuent les droits de' cité. On confond
quelquefois le droit de cité avec celui de bourgeoifie
; cependant le droit de cité eft plus étendu
que celui de bourgeoifie, il comprend auffi quelquefois
l’incolat, & même tous les effets civils.
En effet, celui qui eft banni d’un lieu ne perd pas
feulement le droit de bourgeoifie, il perd abfolti-
ment les droits de cité, c’eft-à-dire tous les p rivilèges
accordés aux habitans du lieu ; & fi le banniffe-
ment eft hors du royaume, il perd tous les effets civils.
On peut perdre les droits de cité fans perdre la liberté
, comme il arrive dans celui qui eft banni ;
mais la perte de la liberté emporte toujours la perte
des droits de cité. Voyt{ Furgole, des tejiamens , tome
I . p. 198. Dunod, tr. de la main-morte, p.3£)> au mot
Bourgeoisie. (A )
C ITEAU X , (Hifi. èccléf.) ordre religieux réformé
de celui de S. Benoît, Stcompofé d’un très grand
nombre de monafteres d ’hommes.& de filles, qu’on
nomme Ciflerciens, & le plus communément Bernardins
& Bernardines. Voye^ BERNARDINS.
Cet ordre commença en 1075 Par vingt - un religieux
du monaftere de Molefme en Bourgogne, qui
trouvant que la réglé de S. Benoît n’étoit pas affez
exaélement obfervéedans cette maifon, obtinrent,
avec Robert leur abbé, permiffion de Hugues archevêque'
de Lyon & légat du faintfiége, d’aller s’établir
à quatre lieues de Dijon , dans un lieu nommé
Çîteaux, Ciflercium, à caufe , dit-on, du grand nombre
de citernes qu’on y avoit creufées. Othon ou Eudes
I. du nom, duc de Bourgogne, leur y bâtit une
maifon où ils entrèrent en 1098, & qu’il fonda très-
richement. L’évêque de Châlons donna à Robert le
bâton paftoral en qualité d’abbé. L’abbé de Cîteaux
eft général de l’ordre, & confeiller né au parlement
de Bourgogne.
Les religieux de Citeaux peuvent prendre des degrés
dans l’univerfité de Paris, & ont à cet effet dans
la capitale un collège pour les étudians de leurs différentes
maifons, qu’on nomme le collège des Bernardins.
Leur ordre a été fécond en hommes illuftres ;
outre quatre papes qu’il a donnés à l ’Eglife,on compte
un très- grand nombre de cardinaux, d’évêques ,
& d’écrivains diftingués. L’ordre des Citeaux ell le
premier qui ait établi des chapitres généraux par une
bulle de Callixte II. en 1119. (G)
CITER , ( Jurifprud.) c’eft affigner quelqu’un devant
un juge d’églife. Voyez ci-devant C it a t io n .
■ ■ H
CITERNE, f. f. ( Architecture. ) réfervoir foûter-
rein d’eau de pluie , fait par art pour les divers besoins
de la vie. On ne fauroit s’en paflèr dans plufieurs
pays maritimes , dans plufieurs endroits de
l’Afie , & d’autres parties du monde. Comme l’eau
de toute la Hollande eft faumache , toutes les mai-*
fôns ont des citernes, & il y en a qui font conftruites
avec un foin, un goût & une proprété admirables.
Mais on dit que. la plus belle citerne qu’il y ait au
monde , fe trouve à Conftahtinople. Les voûtes de
cette citerne portent fur deux rangs de 112 piliers
chacun ; ces piliers, qui ont deux piés de diamètre,
font plantés circulairèment, & en rayons qui tendent
à celui qui eft au centre.
Ainfi un des grands avantages qu’on puiffe tirer
de l’eau de la plui.e, c’eft de la ramaffer dans des ré-
fervoirs foûterreins qu’on appelle citernes, où quand
elle a été purifiée en paffant au-travers du fable de
riviere , elle fe conferve plufieurs années fans fe
corrompre. Cette eau eft ordinairement la meilleure
Je toutes celles dont on peut ufer, foit pour boire,
foit pour l’employer à plufieurs ufages, comme pour
le blanchilîage & pour les teintures , parce qu’elle
n’eft point mêlée d’aucun lel de la terre , comme
font prefque toutes les eaux des fontaines, & même
les plus eftimées.
Ces citernes font d’une très - grande utilité dans lèi
lieux où Fon n’a point d’eau de fource , ou bien lorf-
que toutes les eaux de puits font mauvaifes.
Dans ce cas, ceux qui font curieux d’avoir de
bonne eau , obfervent loigneufement de ne laiffer
point entrer l’eau des neiges fondues dans la citerne
ni celle des pluies d’orages. Pour ce qui eft des nei-
ges fondues , on a quelque raifon de les exclure des
citernes , non pas à caufe des fels qu’on s’imagine qui
font enfermés & mêlés avec les particules de la nei-
g e , mais feulement parce que ces neiges demeurent
ordinairement plufieurs jours , & quelquefois des
mois entiers fur les toits des maifons, où elles fe
corrompent par la fiente des oifeaux & des animaux,
& plus encore par le féjour qu’elles font fur les tuiles
, qui font ordinairement fort fales.
Cependant les Hollandois parent à ces deux def*
niers inconvéniens , en entretenant leurs toits avec
propreté, en en éloignant les animaux , & en filtrant
leur eau par des pierres ou des fontaines fa-
blées.
Ce feroit ici le lieu de parler de la conftruétiort
de leurs citernes, de leur maçonnerie, de leur revêtement
de marbre, de leur couverture, de leur propriété,
du choix des matériaux qu’ils y employent î
car ce n’eft pas affez pour former une citerne , que
d’avoir un lieu qui tienne bien l’eau, que les pierres
& le mortier dont elles font jointes ne puiffenî communiquer
aucune qualité à cette eau qui y féjour-
ne pendant un tems confidérable ; il faut encore de
l’art dans la forme, dans la ftruâure , dans les fon-
demens d’une bonne citerne; mais ce détail me me-*
neroit trop loin , & feroit prefque inintelligible fans
les figures.
Comme toutefois ce n’eft pas feulement dans des
pays tels que la Hollande que les citernes font nécefr
laires ; qu’il y a quantité de ville s, de lieux , de
châteaux dans toute l’Europe, & dans ce royaume,
où des citernes feroient d’une très-grande utilité ; que
d’ailleurs l’on ne peut douter par toutes les épreuves
qu’on a faites , que l’eau de la pluie qui a été purifiée
dans du fable de riviere, ne foit la meilleure de
toutes celles qu’on puiffe employer : M. de la Hire
a imaginé, ôc a communiqué au public (mém. de Ca
cad. des Sciences, /703.) les moyens fuivans , pou*
pratiquer en tout pays des citernes qui fourniroienr
à chaque maifon affez d’eau pour l’ufage & les beC
foins ae ceux qui y demeurent. *
Premièrement, \l eft certain qu’une maifon ordinaire
qui auroit en fuperficie 40 toifes, lefquelles
feroient couvertes de toits , peut ramaffer chaque
année 2160 piés cubiques d’eau, en prenant feulement
18 pouces pour la hauteur de ce qu’il en tombe
, qui eft la moindre hauteur que l’on obferve
communément. Mais ces 2160 piés cubiques valent
75600 pintes d’eau, à raifon de 35 pintes par pié ,
qui eft la jufte mefure pour la pinte de Paris. Si l’on
divife donc ce nombre de pintes par les 365 jours
de l’année , on trouvera 200 pintes par jour. On
voit par-là que quand il y auroit dans une maifon ,
comme celle qu’on fuppofe, vingt - cinq performes ,
elles auroient huit pintes d’eau chacune à dépenfer,
ce qui eft plus que fufiifant pour tous les ufages de
la vie.
Il ne faut pas négliger un avis de M. de la Hire,
fur le lieu & fur la maniéré de conftruire ces fortes
de citernes dans les maifons particulières. On voit
dans plufieurs villes de Flandres, vers les bords de