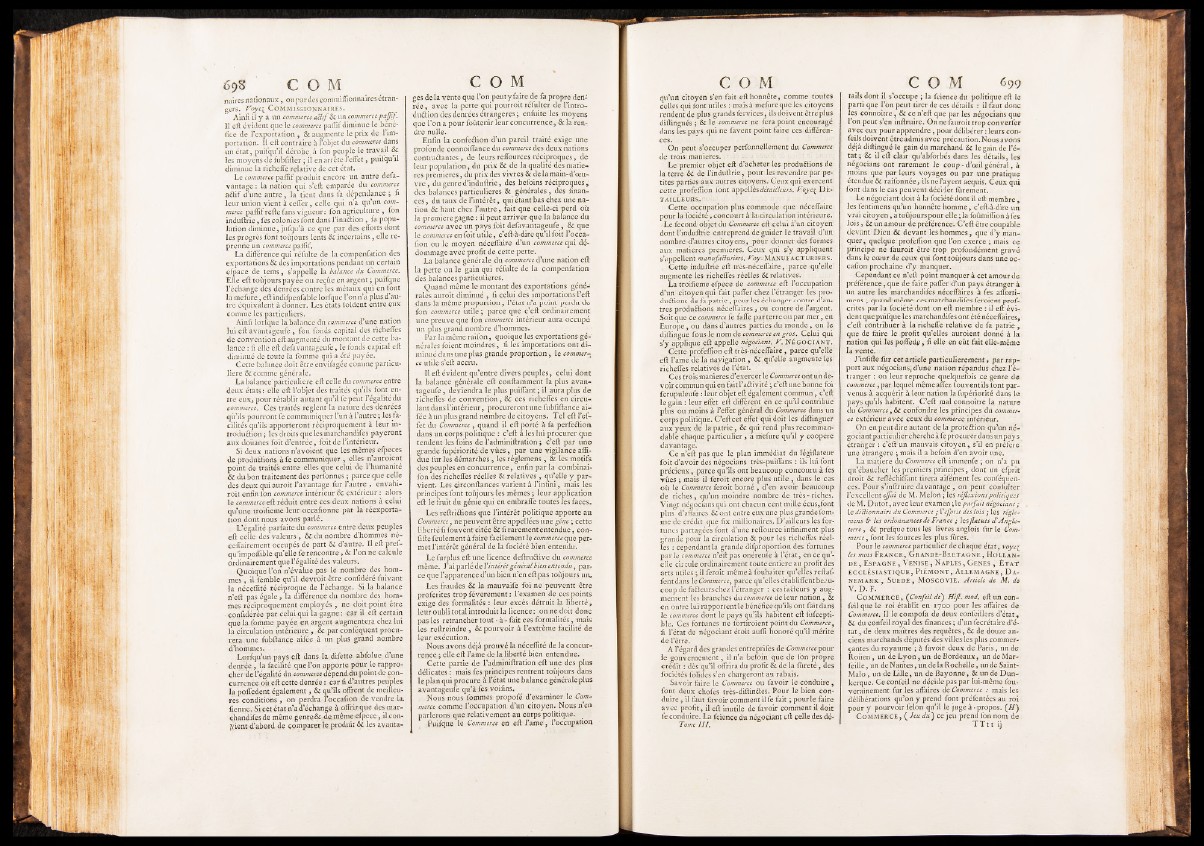
6()S C OM
n a ires n a tio n a u x , o u p a r des commiflionnaires etran g
e r s. Voyt{ C o m m i s s io n n a ir e s .
Ainfi il y a un commerce actif & un commerce pajjif.
Il eft évident que le commerce paflif diminue le benefice
de l’exportation , & augmente le prix de l’importation.
Il eft contraire à l’objet du commerce dans
un état, puifqu’il dérobe, à fon peuple le travail &
les moyens de fubfifter ; il en arrête l’effet, puifqu’il
diminue la richeffe relative de cet état.
Le commerce paflif produit encore1 un autre defà-
vantage : la nation qui s’eft emparée du commerce
aû if d’une autre, la tient dans fa dépendance ; fi
leur union vient à ceffer, celle qui n’a qu un commerce
paflif refte fans vigueur : fon agriculture , fon
induftrie, fes colonies font dans l’inaétion , fa population
diminue, jufqu’à ce que par des efforts dont
les progrès font toujours lents &; incertains, elle reprenne
un commerce paflif.
La différence qui réfulte de la compenfation des
exportations &c des importations pendant un certain
elpace de tems, s’appelle la balance du Commerce.
Elle eft toujours payee ou reçue en argent ; puifque
l’échange des denrees contre les métaux qui en font
là mefure, eft indifpenfable lorfque l’on n’a plus d’autre
équivalent à donner. Les états foldent entre eux
comme les particuliers.
Ainfi lorfque la balance du commerce d’une nation
lui eft avantàgeufe , fon fonds capital des richeffes
de convention eft augmenté du montant de cette balance
: fi elle eft defavantageufe, le fonds capital eft
diminué de toute la fomme qui a été payée.
Cette balance doit être envifagée comme particuliere
& comme générale.
La balance'particuliere eft celle du commerce entre
deux états: elle eft l’objet des traités qu’ils font entre
eux, pour rétablir autant qu’il fe peut l’égalité du
commerce. Ces traités règlent la nature des denrées
qu’ils pourront fe communiquer l’un à l’autre ; les facilités
qu’ils apporteront réciproquement à leur introduction
; lés droits que les marchandifes payeront
aux douanes foit d’entrée, foit de l’intérieur.
Si deux nations n’avoient que les mêmes efpeces
de prodü&ions à fe communiquer , elles n’auroient
point de traités entre elles que celui de l ’humanité
& du bon traitement des personnes ; parce que celle
des deux qui auroit l’avantage fur l’autre , envahi-
roit enfin fon commerce intérieur & extérieur : alors
le commerce eft réduit entre ces deux nations à celui
qu’une troifieme leur occafionne par la réexportation
dont nous avons parlé.
L’égalité-parfaite du commerce entre deux peuples
eft celle des valeurs , & du nombre d’hommes né-
ceffairement occupés de part & d’autre. Il eft pref-
qu’impoflible quelle fe rencontre, & l’on ne calcule
ordinairement que l’égalité des valeurs.
Quoique l’on n’évalue pas le nombre des hommes
, il femble qu’il devroit être confidéré fuivant
la néceflité réciproque de l’échange. Si la balance
n’eft pas égale, la différence du nombre des hommes
réciproquement employés , ne doit point être
• confidérée par celui qui la gagne : car U eft certain
que la fomme payée en argent augmentera chez lui
la circulation intérieure , & par conféquçnt procurera
une fubftance aifée à un plus grand nombre
d’homnjes. '
Lo.rfqu’un pays eft dans, la difette abfolue d’une
denrqe > la facilité que l’on apporte pour le rapprocher
de l’égalité du commerce dépend du point de concurrence
où eft cette denrée : car fi d’autres peuples
la poffedent également, & qu’ils offrent de meilleures
conditions , on perdra l’occafion de vendre la,
fienne. Si cet état n’a d’échange à offrir que des marchandifes
de même genfe&,'de.même efpece, il confient
d’abord de comparer le-produit êc les avanta-
C O M
ges de la vente que l’on peut y faire de fa propre denrée
, avec la perte qui pourroit réfulter de l’intro-
duttion des denrées étrangères ; enfuite les moyens
que l’on a pour foûtenir leur concurrence, Scia ren-,
dre nulle.
Enfin la confe&ion d’un pareil traité exige une
profonde connoiffance du commerce des deux nations
contractantes, de leurs reffources réciproques, de
leur population, du prix & de la qualité des matières
premières, du prix des Vivres & de la main-d’oeuv
r e , du genre d’induftrie, des befoins réciproques ,
des balances particulières & générales, des finances
, du taux de l’intérêt, qui étant bas chez une nation
& haut chez l’autre, fait que celle-ci perd où
la première gagne : il peut arriver que la balance du
commerce avec un pays foit defavantageufe, & que
le.commerce en foit utile, c’eft-à-dire qu’il foit l’occa-
fion ou le moyen néceffaire d’un commerce qui dédommage
avec profit de cette perte.
La balance générale du commerce d’une nation eft
la perte ou le gain qui réfulte de la compenfation
des balances particulières.
Quand même le montant des exportations générales
auroit diminué , fi celui des importations l’eft
dans la même proportion, l’état n’a point perdu de
fon commerce utile ; parce que c’eft ordinairement
une preuve que fon commerce intérieur aura occupé
un plus grand nombre d’hommes.
Par la même raifon, quoique les exportations gé-
nérales foient moindres, fi les importations ont diminué
dans une plus grande proportion, le commerce
utile s’eft accru.
Il eft évident qu’entre divers peuples, celui dont
la balance générale eft conftamment la plus avan-
tageufe, deviendra le plus puiffant ; il aura plus de
richeffes de convention, & ces richeffes en circulant
dans l’intérieur, procureront une fubfiftance aifée
à un plus grand nombre de citoyens. T el eft l’e f fet
du Commerce , quand il eft porté à fa perfection
dans un corps politique : c’eft à les lui procurer que
tendent les foins de l’adminiftration ; c’eft par un©
grande fupériorité de vûe s, par une vigilance afli-
due fur les démarches, les réglemens, & les motifs
des peuples en concurrence, enfin par la combinai-,
fon des richeffes réelles & relatives , qu’elle y parvient.
Les circonftartces varient à l’infini, mais les
principes font toujours les mêmes ; leur application
eft le fruit du génie qui en embraffe toutes les faces.
Les reftriCtions que l’intérêt politique apporte au
j Commerce, ne peuvent être appellées une gêne ; cette
liberté fi fouvent citée & fi rarement entendue, con-
fifte feulement à faire facilement le commerce que permet
l’intérêt général de la fociété bien entendu.
Le furplus eft une licence deftruCtive du commerce
même. J’ai parlé de l’intérêt général.bien entendu, parce
que l’apparence d’un bien n’en eft pas toujours un*
Les fraudes & la mauvaife foi ne peuventt être
proferites trop féverement : l ’examen de ces points
exige des formalités : leur excès détruit la liberté,
leur oubli total introduit la licence : on ne doit donc
pas les retrancher tout - à - fait ces formalités, mais
les reftreindre, & pourvoir à l’extrême facilité de
leur exécution.
Nous avons déjà prouvé la néceflité de la concur-,
rence ; elle eft l’ame de la liberté bien entendue.
Cette partie de l’adminiftration eft une des plus
délicates : mais fes principes rentrent toujours dans
le plan qui procure à l’état une balance générale plus
avantageufe qu’à fes. voifins.
Nous nous fournies propofé d’examiner le Commerce
comme l’occupation d’un citoyen. Nous n’en
parlerons que relativement au corps politique.
Puifque le Commerce en eft l’ame, l’occupation
C O M
qu’un citoyen s’en fait eft honnête, comme toutes
celles qui font utiles : mais à; mefure que les citoyens
rendent de plus grands fervices * ils doivent être plus
diftingués ; & le commerce ne fera point encouragé
dans les pays qui ne favent point faire ces différences
.O
n peut s’occuper perfonnellement du Commerce
de trois: maniérés. 1
Le premier objet eft d’acheter,les productions de
la terre &: de l’induftrie, pour les revendre jpar petites
parties aux autres citoyens.; Ceux qui exercent
cette profeflïon font appelles détailleiins. V.oye-^ DÉ-
t a i l l e u r s , • -
Cette occupation plus commode que néceffaire
pour la fociété -, concourt à- laïcirculation intérieure.
Le fécond objet du Commerce eft celui d’un citoyen
dont l’induftrie entreprend de guider le travail d’un
nombre d’autres citoyens, pour donner des formes-
aux matières premières. Ceux qui sfy appliquent
s’appellent- manufacturiers. Voy. Manufacturiers.
, Cette- induftrie eft wès-néceffaire, parce qu’elle
augmente les richeffes réelles & relatives.
La troifieme efpece de commerce eft l’occupation
d’un: citoyen qui fait paffer chez l’étranger les productions
de fa patrie, pour les échanger contre d’autres
productions néceffaires, ou contre de l’argent.
Soit que ce commerce fe faffe par terre ou par m er, en
Europe, ou dans d’autres parties du monde, on le
diftingue fous le nom de commerce en gros. Celui qui
s’y applique eft appelle négociant. V. Négociant.
Cette profeflion eft très-néceflaire , parce qu’elle
eft l’ame de là navigation , & . qu’elle augmenté les
richeffes relatives de l’état.
Ces trois maniérés d’exercer 11 Commerce ont un devoir
commun qui en fait l’aCtivitë ; c’eft une bonne foi
fcrupuleufe : leur objet eft également commun, c’eft
le gain : leur effet eft différent en ce qu’il contribue
plus ou moins à l’effet général du Commerce dans un
corps politique. C’eft cet effetqui doit les diftinguer
aux yeux de la patrie, & qui rend plus recommandable
chaque particulier, à mefure qu’il y coopéré
davantage.
Ce n’eft pas que le plan immédiat du Iégiflateur
foit d’avoir des négocians très-puiffans : ils lui font
précieux, parce qu’ils ont beaucoup concouru à fes
vûes ; mais il feroit encore plus utile , dans le cas
où le Commerce feroit borné , d’en avoir beaucoup
de riches, qu’un moindre nombre de très - riches.
Vingt négocians qui ont chacun cent mille écus,font
plus d’affaires & ont entre eux une plus grande fomme
de crédit que fix millionaires. D ’ailleurs les fortunes
partagées font d’une reffource infiniment plus
grande pour la circulation & pour les richeffes réelles
: cependant la grande difproportion des fortunes
par le. commerce n’eft pas onéreule à l’état, en ce qu’elle
circule ordinairement toute entière au profit des
arts utiles ; il feroit même à fouhaiter qu’elles reftaf-
fentdans \e Commerce, parce qu’elles établiffent beaucoup
de fadeurs chez l’étranger : ces fadeurs y augmentent
les branches du commerce de leur nation, &
en outre lui rapportent le bénéfice qu’ils ont fait dans
le commerce dont le pays qu’ils habitent eft fufeepti-
ble. Ces fortunes ne lortiroient point du Commerce,
fi l’état de négociant étoit aufli honoré qu’il mérite
de l’être.
A l’égard des grandes entreprises de Commerce pour
le gouvernement, il n’ a beloin que de fon propre
crédit : dès qu’il offrira du profit &. de la fureté, des
fociétés folides s’en chargeront au rabais.
Savoir faire le Commerce ou favoir. le conduire ,
font deux chofes très-diftindeS. Pour le bien conduire
, il faut favoir comment ilfe fait ; pour le faire
avec profit, il eft inutile de favoir comment il doit
fe conduire. La fcience du négociant eft celle des dé-
Tome I I I ,
C O M 6 9 9
tails dont il s’occupe ; la fcience du politique eft le
parti que l’on peut tirer de ces détails : il faut donc
les connoître, & ce n’eft que par les négocians que
l’on peut s’en inftruire. On ne fauroit trop converfer
avec eux pour apprendre, pour délibérer : leurs con-
feils doivent être admis avec précaution. Nous avons
déjà diftingué le gain du marchand & le gain de l’état
; & il eft clair qu’abforbés dans les détails, les
négocians ont rarement le coup - d’oeil général, à
moins que par leurs voyages ou par une pratique
étendue & raifonnée, ilsnel’ayent acquis. Ceux qui
font dans le cas peuvent décider fûrement.
Le négociant doit à la fociété dont il eft membre ,
les fentimens qu’un honnête homme, c’eft-à-dire un
vrai citoyen, a toujours pour elle ; la foûmiflion à fes
lois, & un amour de préférence. C ’eft être coupable
devant’Dieu.& devant les hommes, que d’y manquer
, quelque profeflion que l’on exerce ; mais ce
principe ne fauroit être trop profondément gravé
dans le coeur de ceux qui font toûjours dans une oc-
cafion prochaine d’y manquer.
Cependant ce n’eft point manquer à cet amour de
préférence, que de faire paffer d’un pays étranger à
un autre les marchandifes néceffâires à fes afîorti-
mens ; quand même ces marchandifes feroient proferites
par la fociété dont on eft membre : il eft évident
que puifque les marchandifes ont été néceffaires,
c’eft contribuer à la richeffe relative de fa patrie ,
que de faire le profit qu’elles auroient donné à la
nation qui les poffede, fi elle en eût fait elle-même
la vente. :
J’infifte.fiir cet article particulièrement , par rapport
aux négociansj d’une nation répandus chez l’étranger
: on leur reproche quelquefois ce genre de
commerce, par lequel mêmeaffez louventils lont parvenus
à acquérir à leur nation la fupériorité dans le
pays qu’ils habitent. C’eft mal connoître la nature
du Commerce, & confondre les principes du commerce
èxtêrieür avec ceux du commerce inférieur.
On en peut dire autant de la protection qu’un négociant
p'articulier cherche à fe procurer dans un pays
étranger : c’eft un mauvais citoyen, s’il en préféré
une étrangère ; mais il a befoin d’en avoir une.
La maniéré du Commerce eft immenfe ; on n’ a pu
qu’ébaucher les premiers principes, dont un efprit
droit & reflëchilfant tirera aifément lés COnféquen-
ces. Pour s’inftruire davantage , on peut conlulter
l’excellent effai de M. Melon; les réflexions politiques
dé M. Dutot, avec leur examen ; le parfait négociant ;
le dictionnaire du Commet ce ; Y efprit des lois ; les réglemens
& lés ordonnances de France ; 1es fatuts d'Angleterre
, & prefque tous les livres anglois fur le Commerce
, font les fources les plus fûres.
Pour le commerce particulier de chaque état, voye£
les mots Fran c e , Grande-Br e t a g n e , Ho llande
, Espagne , V enise , Naples , G enes , Ét a t
ECCLÉSIASTIQUE, PlÉMONT, ALLEMAGNE, DANEMARK
, Su èd e , Mo sc o v ie . Article de Mi do
y . d . f .
C om m er c e , (Confùlde') Hijt. mod. eft un con-
feilque le roi établit en 1700 pour les affaires de
Commerce. Il îe compofa de deux confeillers d’état,
& du confeil royal des finances ; d’un fecrétaire d’état
, de deux maîtres des requêtes, & de douze anciens
marchands députés des villes les plus commerçantes
du royaume ; à favoir deux de Paris, un de
Roiien , un de L y on , un de Bordeaux, un de Mar-
feille, un de Nantes, un de la Rochelle, un de Saint-
Malo, un de Lille, un de Bayonne, & un de Dunkerque.
Ce confeil ne décide pas par lui-même fou-
verainement fur les affaires de Commerce : mais les
délibérations qu’on y prend font préfentées au roi
pour y pourvoir félon qu’il le juge à - propos, (ƒ/)
C ommerc e, ( Jeu du') ce jeu prend fon nom de
T T t t ij