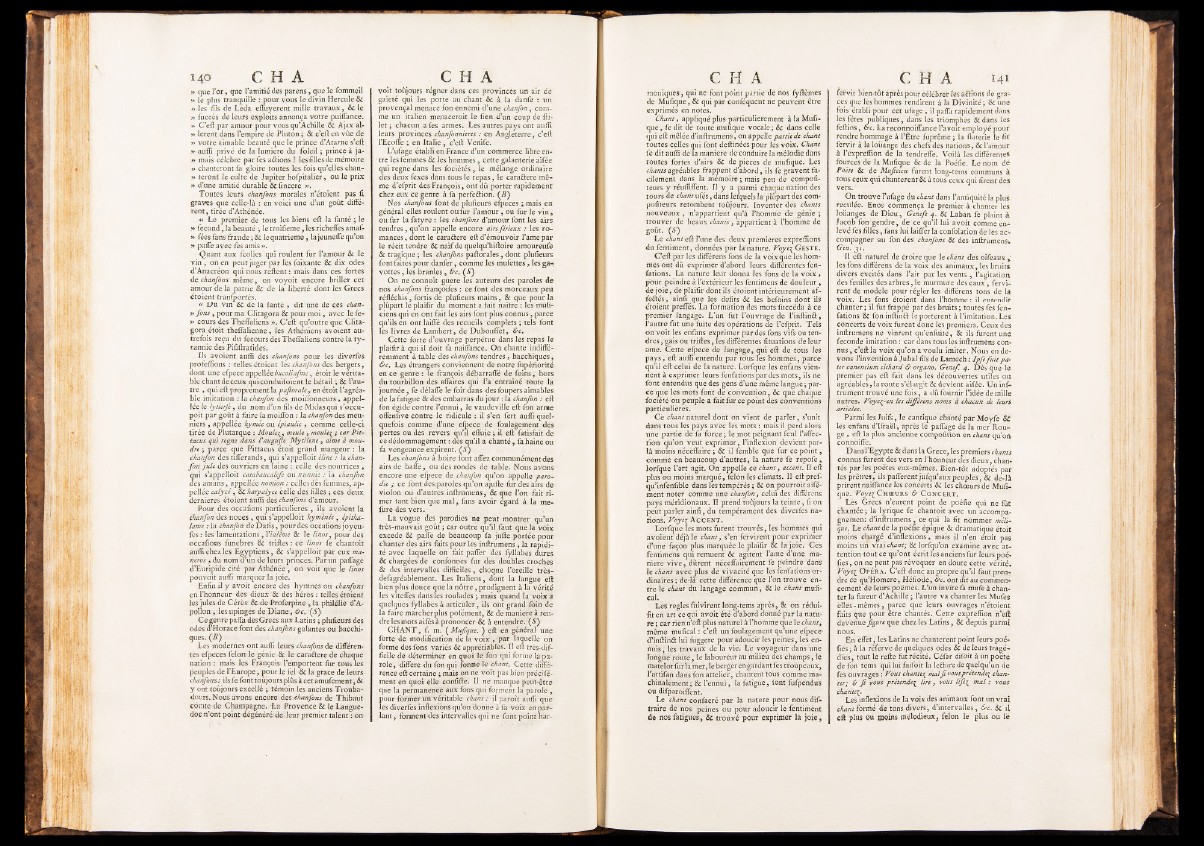
» que l’o r , que l’amitié des parens, que le fommeil
» le plus tranquille : pour vous le divin Hercule &
» les fils de Léda effuyerent mille travaux, & le
» fuccès de leurs exploits annonça votre puiffance.
» C’eft par amour pour vous qu’Achille & Ajax al-
» lerent dans l’empire de Pluton ; & c’eft en vûe de
» votre aimable beauté que le prince d’Atarne s’eft
» aufli privé de la lumière du folerl ; prince à ja-
» mais célébré par fes a étions ! les filles de mémoire
» chanteront fa gloire toutes les fois qu’elles chan-
» teronf le culte de Jupiter hofpitalier, ou le prix
» d’une amitié durable de fincere ».
Toutes leurs chanfons morales n’étoient pas fi
graves que celle-là : en voici une d’un goût différent,
tirée d’Athénée.
« Le premier de tous les biens eft la fanté ; le
» fécond, la beauté ; le troifieme, les richeffes amaf-
» fées fans fraude ; & le quatrième, la jeuneffe qu’on
» paffe avec fes amis ».
Quant aux fcolies qui roulent fur l’amour & le
vin , on en peut juger par lès foixante & dix odes
d’Anacréon qui nous rèftent : mais dans ces fortes
de chanfons même, on voyoit encore briller cet
amour de la patrie & de la liberté dont lès Grecs
étoient tranfportés.
« Du vin & de la fanté , dit une de ces ckan-
» fon s , pour ma Clitagora & pour moi, avec le fe-
» cours des Theffaliens ». C ’eft qu’outre que Clitagora
étoit theffalienne, les Athéniens avoient autrefois
reçu du fecours des Theffaliens contre la tyrannie
des Pififtràtides.
Us avoient aufli des chanfons pour les diverfes
profeflîons : telles étoient les chanfons des bergers,
dont une efpece appellée bucoliafme, étoit le véritable
chant de ceux qui conduifoient le bétail ; & l’autre
, qui eft proprement la pafiorale, en étoit l ’agréable
imitation : la chanfon des moiffonneurs , appellée
le lytierfe, du nom d’un fils de Midas qui s’occu-
poit par goût à faire la moiffon : la chanfon des meuniers
, appellée hymée ou épiaulie , comme celle-ci
tirée de Plutarque : Moule^, meule, moulées car Pit-
tacus qui régné dans l'augufie Mytilene , aime à moudre
; parce que Pittacus étoit grand mangeur : la
éhanfon des tifferands, qui s’appelloit eline : la chanfon
jule des ouvriers en laine : celle des nourrices ,
qui s’appelloit catabaucalefe ou nunnie : la chanfon
des amans, appellée nomion : celles dès femmes, appellée
calycè, & harpalyce celle des filles ; ces deux
dernières étoient aufli des chanfonsd’amour.
Pour des occafions particulières , ils avoient la
chanfon des noces , qui s’appelloit hyménèe , épitha-
lame ; la chanjbn de D atis, pour des occafioris joyeu-
fes: les lamentations , Yïàléme & le linos, pour des
occafions funèbres & triftes : ce linos fe chantoit
aufli chez les Egyptiens, & s’appelloit par eux ma-
héros , du nom d’un de leurs princes. Par un paffage
d’Euripide cité par Athénée , on voit que le linos
pouvdit aufli marquer la joie.
Enfin il y avoit encore des hymnes où chanfons
en l’honneur des dieux & des héros : telles étoient
les jules de Cérèsr &.deProferpine , la philélie d’Apollon
, des upingés de Diane, &c.
Ce genre paffa desGrëcs aux Latins ; plufieurs des
odes d’Horace font des chanfons galantes ou bacchiques.
(B )
Les modernes ont aufli leurs chanfons de différentes
efpeces félon le génie & le caraftere de chaque
nation : mais les Frànçoist l’emportent fur tous les
peuples de l’Europe, pour le fel & la grâce de leurs
chanfons : ils fe font toûjours plûs à cet amufement, &
y ont toûjours excellé ; témoin les anciens Troubadours.
Nous avons encore des chanfons de Thibaut
comte de Champagne.. -La Provence & le Languedoc
n’ont point dégénéré de leur premier talent : on
voit toujours régner dans ces provinces un air de
gaieté qui les porte au chant & à la danfe un
provençal menace fon ennemi d’une chanfon, comme
un italien menaceroit le fien d’un coup de fti-
let ; chacun a fes armes. Les autres pays ont aufli
leurs provinces chanfonnieres : en Angleterre, c’eft
l’Ecoffe ; en Italie, c’eft Venife.
L’ufage établi en France d’un commerce libre en-
■ tre les femmes & les hommes, cette galanterie aifée
qui régné dans les fociétés , le mélange ordinaire
des deux fexes dans tous le repas, le carafrere même
d’efprit des François, ont dû porter rapidement
chez eux ce genre à fa perfeftion. (2?)
Nos chanfons font de plufieurs efpeces ; mais en
général elles roulent ou fur l’amour , ou fur le vin ,
ou fur la fatyre : les chanfons d’amour font les airs
tendres, qu’on appelle encore airs féricux : les romances
, dont le cara&ere eft d’émouvoir l’ame par
le récit tendre & naïf de quelqu’hiftoire amoureufe
& tragique ; les chanfons paftorales, dont plufieurs
font faites pour danfer, comme les mufettes, les gar
vottes, les branles, &c. ( 5)
On ne connoît guère lés auteurs des paroles de
nos chanfons françoifes : ce font des morceaux peu
réfléchis, fortis de plufieurs mains, & que pour la
plûpart le plaifir du moment a fait naître : les mufi-
ciens qui en ont fait les airs font plus connus, parce
qu’ils en ontlaiffé des recueils complets ; tels font
les livres de Lambert, de Dubouffet, &c.
Cette forte d’ouvrage perpétue dans les repas le
plaifir à qui il doit fa naiflance. On chante indifféremment
à table des chanfons tendres, bacchiques ,
&c. Les étrangers conviennent de notre ftipériorité
en ce genre : le François débarraffé de foins, hors
du tourbillon des affaires qui l’à entraîné toute la
journée, fe délaffe le foir dans des foupërs aimables
de la fatigue & des embarras du jour : la chanfon : eft
fon égide contre l’ennui, le vaudeville eft fon arme
offenfivè contre le ridicule : il s’en fert aufli quelquefois
comme d’une efpece de foulagement des
pertes ou des revers qu’il effuie ; il eft fatisfait de
ce dédommagement : dès qu’il a chanté, fa haine ou
fa vengeance expirent. (S)
Les chanfons à boire font àffez communément des
airs de baffe, ou des rondes de table. Nous avons
encore une efpece de chanfon qu’on appelle parodie
; ce font desparoles qu’on ajufte fu!r des airs de
violon ou d’autres inftrumens, & que l’on fait rimer
tant bien que mal, fans avoir égard à la me-
fure des vers.
La vogue des parodies ne peut montrer qu’un
très-mauvais goût ; car outre qu’il faut que la voix
excede & paffe de beaucoup fa jufte portée pour
chanter des airs faits pour les inftrumens , la rapidité
avec laquelle on fait paffer dès fyllabes dures
& chargées de confonnes fur dés doubles croches
& des intervalles difficiles, choque l’oreille très-
defagréablement. Les Italiens, dont la langue eft
bien plus douce que la nôtre, prodiguent à la vérité
les vîtefles dans les roulades ; mais quand la voix à
quelques fyllabes à articuler, ils ont grand fbin de
la faire marcher plus pofément, & de manière à rendre
les mots aifésà prononcer & à entendre, (é1)
CH ANT, f. m. ( Mufique. ) eft en général une
forte de modification de la voix , par laquelle on
forme des fons variés & apprériables. Il eft très-difficile
de déterminer en quoi le fon qui forme la parole
, diffère du fon qui forme le chant. Cette différence
eft certaine ; mais on ne voit pas bien précifé-
riient en quoi elle confifte. Il ne manque peut-être
que la permanence aux fons qui forment la parole ,
pour former un véritable chant : il paroît aufli que
les diverfes inflexions qu’on donne à fa voix en parlant,
forment des intervalles qui ne font point harftioniques,
qui rie font point partie 'de ilos fÿftèiriès
de Mufique, & qui par conféquent ne peuvent être
exprimés en notes.
Chant, appliqué plus particulièrement à la Mufique
, fe dit de toute mufique vocale ; & dans celle
qui eft mêlée d’inftrumeris, on appelle partie de chant
toutes celles qui font deftiriées pour lés voix. Chant
fe dit aufli de la manière de conduire la mélodie dans
toutés fortes d’airs & de pièces de mufique. Les
chants agréables frappent d’abord, ils fe gravent facilement
dans la mémoire ; mais peu de compofi-
teurs y réufliffent. Il y a parmi chaque nation des
tours de chant u(és, dans lefquels la1 plûpart des conu-
pofiteiirs retombent toûjours. Inventer des chants
nouveaux, n’appartiérit qu’à l’homme de génie;
troiivèr de beaux chants, appartient à l’homme de
gofft.
Le chant eft l’une dès deux premières èxpreflions
du feritimenty données par la nature. Voyeç G este.
C ?èft par1 lès différens fons de la vôixque les hommes
ont dû exprimer d’abord leurs différentes fen-
fàtïons. La nature leur donna les fons de la voix ,
pour peindre à l’extérieur les feritimens de douleur ,
de joiè, de plaifir dont ils étoient intérieurement af-
fè&és-, 'ainfi que les défifs & les befôins dont ils
étoient préffés. La formation dés mots fuccéda à ce
premier langage. L ’un fut l’ouvrage de l’inftinft,
l’autre fut une fuite des opérations de l’efprit. Tels
on voit les érifans exprimer par des fons Vifs ou tendres
, gais ou triftes, les différentes fituatiôns de leur
ame. Cette efpece de langage, qui eft de tous les
pa ys, eft aufli entendu par to'us les hommes, parce
qu’il eft celui de la nature. Lôrfque les enfans viennent
à exprimer leurs fenfatiônspar des mots, ils rie
font entendus que des gens d’urie même langue ; parce
que les mots font de convention, & què chaque
fociété 'ou peüple a fait fur ce point des conventions
particulières.
Cè chant naturel dont on vient de parler, s’unit
dans tous les pays avec les mots : mais il perd alors
urie partie de fa force; le mot peignant feuî l’affec-
t'ion qu’on véut exprimer, l’inflexion devient par-
là moins riecëffaire ; & il femble que fur ce point,
comme en beaucoup d’autres, la nature fe repofe,
lorfque l’art agit. On appelle ce chant, accent. Il eft
plus pu moins marqué, félon les climats. Il eft pref-
qu’infenfible dans les tempérés ; & on pourroit aifé-
ment noter comme Une chanfon, celui des différens
pays méridionaux. Il prend toûjours la teinte, fi on
peut parler ainfi, dü tempérament des diverfes nations.
Voÿe^ A c c e n t .
Lorfque les mots furent trouvés, les hommes qui
avoient déjà le chant, s’en fief virent pour exprimer
d’une façon plus marquée le plaifir Sc là joie. Cès
fentimens qui remuent & agitent l’ame d’une maniéré
viv^e, dûrent néceffairemèrit fe peindre dàris
le chant avec plus dé yivâciré que les ferifations‘Ordinaires
; dé-là cette différence que l’on trouvé entre
lé chant du langage commun, & le chant mufi-
cal. " •
Les régies fuivîrent long-tems auprès, & on rédui-
fit en art ce qùi avoit été d’abord donné par la nature
; car rien n’éft plus naturel à l’homme que le chàrit,
même mufical : c’eft un foulagement qu’une efpece-
d’inftinâ lui fuggere pour adoucir lès peines, les en-
miis ; les travaux de la vie. Le voyâgeür dans une
lorigüe’ routé, le labouréur au milieu des champs, lè
matelot fur là mer, le bergèr'étt gardant fës tr’oÙpeauX,
l’artifan dans fon attelier, chariterit tous comme ma-,
chittalement ; & l’enriui, la fatigue, font fufpendus
ou difparôiffent.
Le chant confacré par la nature pour nous diü*
traire dè nos peines ou pour adoucir le fentiment
de nos fatigues, ôt trouvé pour exprimer la jo ie ,
lefrvit bxen-tôt après pour célébrer les âfribns de grâces
que les hommes rendirent à la D ivinité; & uné
fois établi pour cet ufage ; il paffa rapidement dans
les fêtes publiques, dans les triomphes & dans les
feftins, &c. La reconnoiffancé l’avoit employé pour
rendre hommage à l’Être fuprême ; la flaterië le fit
fervir à la louange des chefs des nations -, & l’amour
à l’expreflion de la tendreffe. Voilà les différente»
fourees de la Mufique & de la Poéfiè. Le nom dè
Poète & de Mujicien frirent long-tems communs à
tous ceux qui chantererir& à tous ceux qui firent des
Vers. '
On trouve l’ufage du chant dans l’antiquité la pluè
reculée. Enos commença le premier à chantér les
louanges de D ieu, Genefe 4. & Laban fe plaint à
Jacôb fon gendre, de ce qu’il lui avoit conimeen-
levé fes filles, fans lui laiffer la confolation de les ac^
èompàgrier au fori des chanfons & des inftruniensw
Gcn- d ' il
eft naturel de éroire que le chant des oifeaùx ±
les fons différens de la voix des animaux, les bruits
divers excités dans l’air par les vents , l’agitation
des feuilles des arbres, le murmure des eaux, férvi-
rent de modèle pour régler les différens tons de la
voix. Les fons étoient dans l’homme: il entendit
chanter ; il fut frappé par des bruits ; toutés fes fen-
fatïons & fon inftinft le portèrent à l ’imitation. Les
côncèrts de voix furent donc les premiers. Ceux des
inftrumens ne vinrent qu’enfuite, & ils frirent uné
fécondé imitation : car dans tous les inftrumens connus,
c’eft la voix qu’on a voulu imiter. Nous ende-
voris l’inverition à Jubal fils de Lamech : Ipfe fuit pa-
ter cahentium citkarâ & organo. Genef. 4. Dès'que le
premier pas eft fait dans les découvertes utiles ou
agréables, la route s’élargit & devient aifée. Un inf-
trurrient trouvé une fois, a dû fournir l’idée de mille
autres. f roye^en~les différens tiôms à chacun de leurs
articles.
Pàrtni les Juifs , ‘le Cantique charité par Moyfe &
les enfans d’Ifrael , après lë paflage de la mer Roug
e , èft la plus ancienne compofiüon en chant quon
cônnôïffe.
Dans i’Egypte & dans la Grèce, les premiers chants
connus furerit des vers en l ’horirieür dès dieux, chantés
par les poètes éux-riiêmes. Bien-tôt adoptés par
les prêtres, ils pafferent jrifqu’auxpeuples, & de-là
prirent naiflance les Côncèrts & les choeurs de Mufique.
Voye^ C hoeurs & C o n c e r t .
Lés Grecs n’eurent point de poéfie qui ne fût
chantée ; la lyrique fe chantoit avec un accompagnement
d’inftrumens , ce qui la fit nommèr mélU
que. Le chant de la poéfie épique & dramatique étoit
rfiôinS Chargé d’inflexions, mais il n’en étoit pas
moins uri Vrai chant; & lorfqu’on examine avec attention
tout ce qu’ont écrit les anciens fur leurs poér
fies, on ne peut pas révoquer en doute cette vérité*
Voyei Ôp ÉRA. C’eft donc au propre qu’il faut pren^
dre Ce qu’Ho'mere, Héfiode, &c. ont dit au comment
cernent de leurs poëmés. L’un invire fa mufe à chanter
la fureur d’Àchille ; l’autre va chanter lés Mufes
elles - mêmes, parce que leurs Ouvrages n’étoient
faits que pour être chantés. Cette expreflion n’eft
devenue figure que chez les Latins, & depuis parmi
nous.
En effet, les Latins ne chantèrent point leurs poé*
fies ; à là referve de quelques odes & de leurs tragédies,
tô,üt lé refte fut récité. Céfàr difôit à un poète
de fon téms qui lui faifoit la lefrure de quelqu’un de
feS ou vrages : Vous chante% mal f i vousprétende^ chanter;
& f i vous prétende£ lire , vous life£ mal : vous
chante£.
Lés inflexions de la voix des animaux font un vrai
chant formé de tons divers, d’intervalles, &c. &c il
eft plus qu moins mélodieux, félon le plus ou le