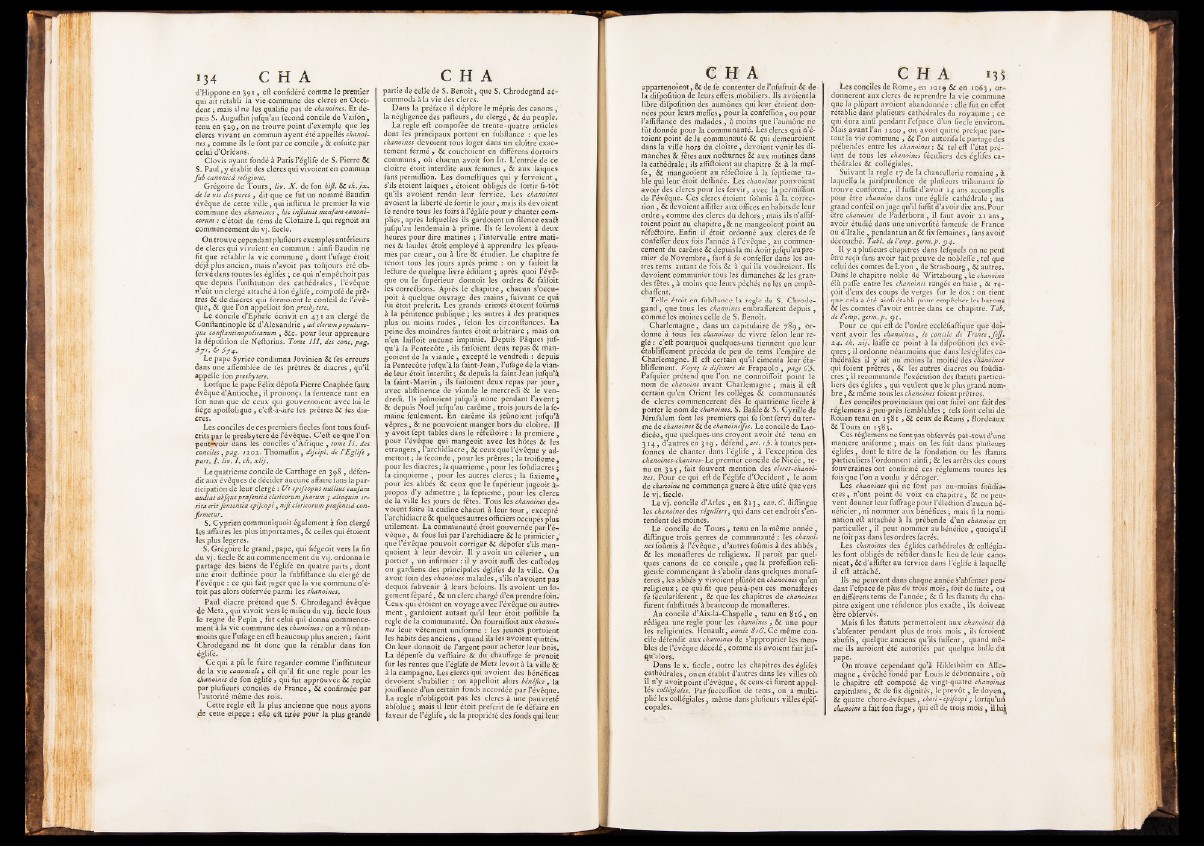
d’Hippone en 3 9 1 , eft confidéré comme le premier
qui ait rétabli la vie-commune des clercs en Occident
; mais il ne les qualifie .pas de chanoines. Et depuis
S. Auguftin jufqu’au fécond concile de Vaifon,
tenu en 519, on ne trouve point d’exemple que les
clercs vivant en commun ayent été appellés chanoines.
, comme ils le font par ce concile, & enfuite par
celui d’Orléans.
Clovis ayant fondé à Paris l’églife de S. Pierre 6c
S. Paul, y établit des clercs qui vivoient en commun
fub canonicâ religione,
Grégoire de Tours, liv. X . de fon hiß. 8 cck.jx.
de La vie des peres dit que ce fut un nommé Baudin
évêque de cette v ille , qui inftitua le premier la vie
commune des chanoines , hic infiituit menfam canoni-
cor um : c ’étoit du tems de Clotaire I. qui regnoit au
commencement du vj. fiecle.
On trouve cependant plufieurs exemples antérieurs
de clercs qui vivoient en commun : ainfi Baudin ne
fit que rétablir la vie commune , dont l’ufage étoit
déjà plus ancien, mais n’a voit pas toujours été ob-
fervé dans toutes les églifes ; ce qui n’empêchoit pas
que depuis l’inftitution des cathédrales , l’évêque
n’eût un clergé attaché à fon églife, compofé de prê»
très 6c de diacres qui formoient le confeil de l’évêque
, & que l’on appelloit fon presbytère.
Le concile d’Ephefe écrivit en 431 au clergé de
Conftantinople 6c d’Alexandrie , ad clerumpopulum-
que conßantinopolitanum , & c . pour leur apprendre
la dépolition de Neftorius. Tome I I I . des conc. pag.
& 5y 4.
Le pape Syrice condamna Jovinien & fes erreurs
dans une affemblée de l'es prêtres 6c diacres, qu’il
appelle fon presbytère.
Lorfque le pape Félix dépofa Pierre Cnaphée faux
évêque d’Antioche, il prononça la fentence tant en
fon nom que de ceux qui gouvernoient avec lui le
fiége apoftolique , c’eft-à-Uire fes prêtres 6c fes diacres.
Les conciles de ces premiers fiecles font tous fouf-
crits par le presbytère de l’évêque. C ’eft ce que l’on
peut*voir dans les conciles d’Afrique , tome II. des
conciles, pag. 1202. Thomafiin, difcipl. de C Eglife ,
part. I . Uv. I . ch. xlij.
Le quatrième concile de Carthage en 398 , défendit
aux évêques de décider aucune affaire làns la participation
de leur clergé : Ut epifcopüs nullius c auf am
audiat abfqueproefentiâ clericorum J'uorum ; alioquin irrita
erit Jèntentia epijcopi, fuß clericorum proefentiâ confirment.
S. Cyprien communiquoit également à fon clergé
les affaires les plus importantes, 6c celles qui étoient
les plus legeres.
S. Grégoire le grand,pape, qui fiégeoit vers la fin
du vj* fiecle 6c au commencement du vij. ordonna le
partagé des biens de l’églife en quatre parts, dont
une étoit deftinée pour la fubfiftance du clergé de
l’évêque : ce qui fait juger que la vie commune n’é-
toit pas alors obfervée parmi les chanoines.
Paul diacre prétend que S. Chrodegand évêque
de Metz, qui v ivoit vers le milieu du vij. fiecle fous
le regne de Pépin , fut celui qui donna commencement
à la vie commune des chanoines : on a vû néanmoins
que l’ufage en eft beaucoup plus ancien ; faint
Chrodegand ne fit donc que la rétablir dans fon
églife.
Ce qui a pû le faire regarder comme l’infti tuteur
de la v ie canoniale , eft qu’il fit une regle pour les
chanoines de fon églife, qui fut approuvée 6c reçûe
par plufieurs conciles de France, 6c confirmée par
l’autorité même des rois..
Cette regle eft la plus ancienne que nous ayons
.de cette elpece : elle eft iirée pour la plus grande
partie de telle de S. Benoît, que S. Chrodegand accommoda
à la v ie des clercs.
Dans la préface il déplore le mépris des canons,
la négligence des pafteurs, du clergé, 6c du peuple^
La réglé eft compofée de trente-quatre articles
dont les principaux portent en fubflance : que les
chanoines dévoient tous loger dans un cloître exactement
fermé , 6c couchoient en différens dortoirs
communs, où chacun avoit fon lit. L’entrée de ce
cloître étoit interdite aux femmes , & aux laïques
fans permiffion. Les domeftiques tjui y fervoient ,
s’ils étoient laïques , étoient obliges de fortir fi-tôt
qu’ils avoient rendu leur fervice. Les chanoines
avoient la liberté de fortir le jour, mais ils dévoient
fe rendre tous les foirs à l’églife pour y chanter compiles
, après lefquelles ils gardoient un filence exaft
jufqu’au lendemain à prime. Ils fe levoient à deux
heures pour dire matines ; l’intervalle entre matines
& laudes étoit employé à apprendre les pfeau-
mes par coeur, ou à lire 6c étudier. Le chapitre fe
tenoit tous les jours après prime : on y faifoit la
leéture de quelque livre édifiant ; après quoi l’évêque
ou le fupérieur donnoit les ordres 6c faifoit
les corrections. Après le chapitre, chacun s’oecu-
poit à quelque ouvrage des mains, fuivant ce qui
lui étoit prelcrit. Les grands crimes étoient fournis
à la pénitence publique ; les autres à des pratiques
plus ou moins rudes , félon les circonftances. La
peine des moindres fautes étoit arbitraire ; mais on
n’en laifioit aucune impunie. Depuis Pâques juf-
qu’à la Pentecôte , ils faifoient deux repas & man-
geoient de la viande , excepté le vendredi : depuis
la Pentecôte jufqu’à la faint-Jean, l’ufage de la viande
leur étoit interdit ; 6c depuis la faint-Jean jufqu’à
la faint-Martin * ils faifoient deux repas par jou r,
avec abftinence de viande le mercredi 6c le vendredi.
Ils jeunoient jufqu’à none pendant l’a vent 5
8c depuis Noël jufqu’au carême, trois jours de la fe-
maine feulement. En carême ils jeûnoient jufqu’à
vêpres , & ne pouvoient manger hors du cloître. Il
y avoit fept tables dans le réfeftoire : la première ,
pour l’évêque qui mangeoit avec les hôtes & les
étrangers, l’archidiacre, 6c ceux que l’évêque y admettait
; la fécondé, pour les prêtres ; la troifieme ,
pour les diacres ; la quatrième, pour les foûdiacres ;
la cinquième , pour les autres clercs ; la fixieme ,
pour les abbés 6c ceux que le fupérieur jugeoit à-
propos d’y admettre ; la feptieme, pour les clercs
de la ville les jours de fêtes. Tous les chanoines de-
voierit faire la cuifine chacun à leur tou r, excepté
l’archidiacre & quelques autres officiers occupés plus
utilement. La communauté était gouvernée par l’évêque
, & fous lui par l’archidiacre & le primicier
que l’évêque pouvoit corriger 6c dépofer s’ils man-
quoient à leur devoir. Il y avoit un célerier , un
portier , un infirmier : il y avoit auffi des cuftodes
ou gardiens des principales églifes de la ville. On
avoit foin des chanoines malades, s’ils n’a voient pas
dequoi fubvenir à leurs befoins. Ils avoient un logement
féparé, & un clerc chargé d’en prendre foin.’
Ceux qui étaient en voyage avec l’évêque ou autre»
ment, gardoient autant qu’il leur était poffible la
réglé de la communauté. On fourniffoit aux chanoines
leur vêtement uniforme : les jeunes portaient
les habits des anciens , quand ils les avoient quittés.
On leur donnoit de l’argent pour acheter leur bois.'
La dépenfe du veftiaire & du chauffage fe prenoit
fur les rentes que l’églife de Metz levoit à la ville &
à la campagne. Les clercs qui avoient des bénéfices
dévoient s’habiller : on appelloit alors bénéfice, la
joiiiffance d’un certain fonds accordée par l’évêque.
La réglé n’obligeoit pas les clercs à une pauvreté
abfolue.; mais il leur était prefcrit de fe défaire en
faveur de l’églife, de la propriété des fonds qui leur
appartenoient, & dp.fe contenter de l’ufufruit & de
la difpofitipn de leurs effetsTmobiliers. Ils avôieritla
libre difpofition des aumônes qui leur étoient données
pour leurs méfiés , pour la confeffion, ou pour
l’affiftancè des malàdgs , moins que l’aumône ne
fût donnée pour la communauté. Les clercs qui ri’é-
toient point de la communauté 6c qui demeuroiérit
dans la ville hors du. cloître, dévoient venir les dimanches
& fêtes aux nofturrtes 6c aux matihès dans
là cathédrale ; ils affiftoient au chapitre & à la mef-
f è , & mangeoient au réfeftoire à la feptieme table
qui leur était deftinée. Les chanoines pouvoient
avoir des clércs pour les fervir, avec la permimon
de l’évêque. Ces clercs étoient foûmis à la correction
, & dévoient affifter aux offices en habits de’Ieur
ordre y comme des clercs du dehors j mais ils n’affif-
toient point au chapitre, & ne mangeoient point au
réfeftoire. Enfin il était ordonné aux clércs de fe
cônfeffer deux fois Farinée à l’évêque , au commencement
du Carême 6c depuis là mi-Août jufqu’au premier
de Novembre, fauf à fe çonfeffer dans les autres
tems autant de fois & à qui ils vôudfoient. Jls
dévoient communier tous les dimanches 6c lés grandes
fêtes, à moins que leurs péchés ne lès en empê-
chaffentj \
Telle étoit en fubftànce la réglé de S. Chrodegand
, que tous les chanoines embrafferent depuis,
çomméles moines celle de S. Benoît.
Charlemagne, dans un capitulaire de 789, ordonne
à tous les: chanoines de vivre félon leur règle
: c’eft pourquoi quelques-uns tiennent que leur
établiffement précéda dé peu de tems l’empire de
Charlemâgné. Il eft certain qu’il cimenta'leur éta-
bliffement. Voye^ Le difçoùrs de Frapaolo , page G5.
Pafquier prétend que l’on ne connoiffoit point lé
nom de chanoine avant Charlemagne ; mais il eft
Certain qu’en Orient les collèges 6c communautés
de clercs commencèrent dès le quatrième fiecle à
porter le nom de chanoines. S. Bafile & S. Cyrille de
Jérufalem font les premiers qui fefontfervi du terme
de chanoines 6c de chanoinejfes. Le concile de Lao-
dicée, que quelques-uns croyent avoir été tenu en
3 1 4 , d’autres en 3 19 , défend, art. ià. à toutes personnes
de chanter dans l’églife , à l’exception dès
chanoines-chantres- Le premier concile de Nicée, tenu
en 315 , fait fouvent mention des clercs-chanoines.
Pour ce qui eft de l’églife d’Occîdènt, ,1e nom
de chanoine ne commença guere à être ufité que vers
le vj. fiecle.
Le v j. concile d’Arles , en 8 13, can. 6. diftingtte
les chanoines des réguliers, qui dans cet endroit s’entendent
des moines.
Le concile de Tours, tenu en la même anneé,
diftingue trois genres de communauté : les chanoines
foûmis à l’évêque, d’autres foûmis à des abbés,
6c les monafteres de religieux. Il paroît par quelques
canons dé ce concile, que la profeffion teli-
gieufe commençant à s’abolir dans quelques riiohaf-
teres, lès abbés y vivoient plûtôt en chanoines qu’ert
religieux ; ce qui fit que peu-à-peu ces monafterës
fe feculariferent, 6c que les chapitres de chanoines
furent fubftitués à beaucoup de monafteres.
Au concile d’Aix-la-Çhapelle, tenu en 81 <5 , ori
rédigèa une réglé pour les chanoines , 6c une pour
les religieufes. Henault, année Si G. C e même concile
défendit aux chanoines de s’approprier lès meubles
de l’évêque décédé, comme ils avoient fait juf-
.qu’a lors.
Dans le x. fiecle, outré les chapitres des églifes
cathédrales, on en établit d’autres dans les villes où
il n’y avoit point d’évêque , 6c ceux-ci furent appellés
collégiales. Par fucceffion de tems, on a multiplié
les collégiales, même dans plufieurs villes épif-
copalcs. '
Les conçues de Rome> en 1019 & eh 1063 , ordonnèrent
aux clercs de reprendre la vie commune
que la plûpart avoient abandonnée : elle fut en effet
rétablie dans plufieurs cathédrales du royaume ; ce
qûi dura ainfi pendant l’efpacé d’un fiecle environ.
Mais,avant l’an izoo , oryavoit quitté prefque partout
là vie commune , 6c l’on autôrifa le partage des
prébendes entre les chanoines : 6c tel eft l’état pré-
lent de tous les chanoines féculiers des églifes cathédrales
6t collégiales.
Suivant la réglé 17 de la chancellerié romaine , à
laquelle la jurifpfudénce' de plufieurs tribunaux fe
trouve conforme, ilfuffitd’avoir 14 ans accomplis
pour être chanoine dans une églife câthédrale ; au
grand confeil on juge qu’il fuffit d’avoir dix ans. Pour
être chanoine de Padérborn , il faut avoir z i ans,
avoir étudié dans une univerfité fameufe de France
ou d’Italie , pendant un an & fixfemaines, fans avoit
découché. Tabl. del'emp. germ.p. $4.
Il y a plufieurs chapitres dans lefquels on ne peut
être reçu fans avoir fait preuvé de nobleffe, tel que
celui dés Comtes d eLyon , de Strasbourg, 6c autres.'
Dans le chapitre noble de Wirtzbourg , le chanoine
élu paffe entre les chanoines rangés en haiè , & re-
ççit d’eux des coups de verges fur le dos. : on tient
que céla a été ainfi établi pour empêcher les barons
8C les comtes d’avoir entrée dans ce chapitre. Tab.
de Temp'. gerrn. p. 9 1 .
Pour ce qui eft de l’ordre eccléfiâftiqtie que doivent,
avoir les chanoines, le concile, de Trente ,fef[.
24. ch. xij. làiffe ce point à là difpofîtioiï de's évêques
; il ordonne néanmoins que dans'lësjégiifes cà-
thé'dfâlês il y ait aû' mOinS' la moitié dès cKâhbïnes
qui foient prêtres , & les autres diacres du foûdiacres
; il recommande l’exécution dés ftatuts particuliers
des églifes , qui veulent que le plus grand nombre
, 6c même tous les chanoines foient prêtres.
Les conciles provinciaux qui ont fuivi ont fait des
réglemens à-peu-près femblables ; tels font celui de
Roiientenü en 15 8 1 ,6 c céux de Reims , Bordeaux
& T o ü r s én 1583.
Ces réglemens ne font pas ôbfervés pat-tout d’une '
maniéré uniforme ; mais on lés fuit dans plufieurs
églifes , dont lé titre de la fondation ou les ftatuts
particuliers l’ordonnent ainfi ; & les arrêts des cours
îbüveraines ont confirmé ces réglemens toutes les
fois que l ’on a voulu y déroger.
Les chanoines qui ne font pas àu-moiiis foûdiacres,
n’ont point de voix en chapitre, 6c ne peuvent
donner leur fuffrage pour l’élèûion d’aucun bénéficier
, ni nommer aux bénéfices ; mais fi la nomination
eft attachée à la prébende d’un chanoine en
particulier, il peut nommer au bénéfice , quoiqu’il
ne foit pas dans les ordres facrés.
Les chanoines des églifes cathédrales & collégiales
font obligés de réfider dans le lien de lëiir cano-
nicat , & d ’aflifter au fervice dans l ’églife à laquelle
il éft attaché.
Ils rie peuvent dans chaque ânnéé s’abfenter pendant
l’efpacedé plus de trois mois, foit dèfuite, oit
en différens tetris de l’année ; & fi les ftatuts dû chapitre
exigent ufte réfidènee plus exa&ô , ils doivent
être obfèrvés.
Mais fi les ftàtuts pèrriièttoient aux chanoines de
s’abfentér peridarit plus de trois mois , ils féroient
abufifs, quelque anciens qu’ils fuffént, quand même
ils autoient été autorifés par quelque bullè du
pape.
On troiiVé cependant qu’ à Hildeshèifn eh Allemagne
, évêché fondé par Louis lé débonnaire, oîi
le chapitre eft compolé de vingt-quatre chanoines
capitulans, & de fix dignités, le prévôt, lé doyen y
6c quatre chore-évêquçs, chori - épifeopi ; lorfqu’üii
chanoine a fait fon ftage, qui eft de trois m ois, il lui