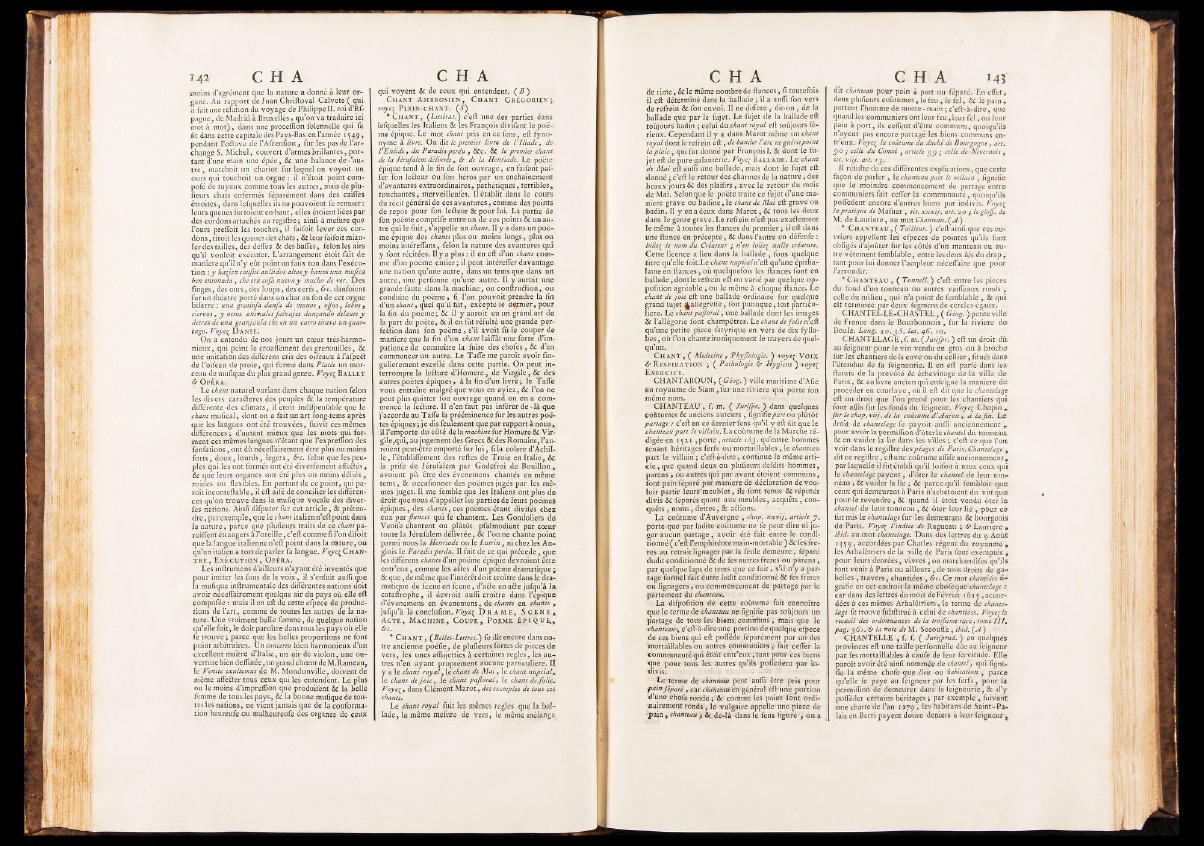
i 0 C H A
moins ^’agrément que la nature a donné à leur or* !
«ane. Au rapport de Juan Chriftoval Calvete ( qui
a fait une relation du voyage de Philippe II. roi d’Efi
pagne, de Madrid à Bruxelles, qu’on va traduire ici
mot à mot), dans une proceffion folennelle qui fe
fit dans cette capitale des Pays-Bas en l’année 1 549,
pendant l’oûave de TAfeenfion, fur les pas de l’archange
S. Michel, couvert d’armes brillantes, portant
d’une main une épée, 8c une balance de i’au-
t r e , marchoit un chariot fur lequel on voyoit un
Ours qui touchoit un orgue : il n’étoit point com-
pofé de tuyaux comme tous les autres, mais de plu-
iicurs chats enfermés féparément dans des cailles
étroites, dans lefquelles ils ne pouvoient fe remuer :
leurs queues fortoient en-haut, elles étoient liées par
des cordons attachés au regiftre; ainfi à mefure que
Tours preffoit les touches, il faifoit lever ces cordons
, tiroit les queues des chats, & leur faifoit miauler
des tailles, des deffus & des baffes, félon ies airs
qu’il vouloit exécuter. L’arrangement étoit fait de
maniéré qu’il n’y eût point un faux ton dans l’exécution
:y haçicn coufus aullidos altos y baxos una mujica
ben entonada , che er'a cofa nuevay mucho de ver. Des
linges, des ours, des loups, des cerfs, &c. danfoient
fur un théâtre porté dans un char au fon de cet orgue
bifarre : una gratiofa danfa de monos , ojfos, lob os ,
ciervos , y otros animales falvajes dançando delaute y
detras de una granjaula che en un carro tirava un quar-
tago. yb y ei D anse.
On a entendu de nos jours un coeur très-harmonieux
, qui peint le croaffement des grenouilles, 8c
une imitation des différens cris des oifeaux à l’afpeâ
de l’oifeau de proie, qui forme dans Platée un morceau
de mufique du plus grand genre. Voye^ Ballet
6* Opéra.
Le chant naturel variant dans chaque nation félon
les divers caraéferes des peuples 8c la température
différente des climats, il étoit indifpenfâble que le
chant mufical, dont on a fait un art long-tems après
que les langues ont été trouvées, fuivît ces mêmes
différences ; d’autant mieux que les mots qui forment
ces mêmes langues n’ étant que Texprefïion des
fenfations, ont dû neceffairement être plus ou moins
forts, doux, lourds, légers, &c. félon que les peuples
qui les ont formés ont été diverfement affe&és,
& que leurs organes ont été plus ou moins déliés ,
roides oü flexibles. En partant de ce point, qui pa-
roît inconteftable, il eft aifé de concilier les différences
qu’on trouve dans la mufique vocale des diver-
fes nations. Ainfi difputer fur cet artiçle, & prétendre,
par exemple, que le chant italien n’eft point dans
la nature, parce que plufieurs traits de ce chant pa-
rôiffent étrangers à l’oreille, c’eft comme fi l’on difoit
que la langue italienne n’eft point dans la nature, ou
qu’un italien a tort de parler fa langue. Voye^ C hant
r e , Ex é c u t io n , O péra.
Les inftrumens d’ailleurs n’ayant été inventés que
pour imiter les fons de la v o ix , il s’enfuit auffi que
la mufique inftrumentale des différentes nations doit
avoir neceffairement quelque air du pays oii elle eft
compofée : mais il en eft de cette efpece de productions
de l’art, comme de toutes les autres de la nature.
Une vraiment belle femme, de quelque nation
qu’elle foit, le doit paroître dans tous les pays oii elle
fe trouve ; parce que les belles proportions ne font
point arbitraires. Un concerto bien harmonieux d’un
excellent maître d’Italie, un air de violon, une ouverture
bien deffinée , un grand choeur de M.Rameau,
le Venite exultemus de M. Mondonville, doivent de
meme affetter tous ceux qui les entendent. Le plus
ou le moins d’imprefïion que produifent 8c la belle
femmë de tous les pays, 8c la bonne mufique de toutes
les nations, ne vient jamais que de la conformation
heureufe ou malheureufe des organes de ceux
C H A
qui voyent & de ceux qui entendent.' ( B )
C hant Am br o s ien , C h a n t G r ég o r ien ;
voye£ Plein-ch an t . (S)
* C h a n t , ( Littérat.) c’eft une des parties dans
lefquelles les Italiens & les François divifent le poème
épique. Le mot chant pris en ce fens, eft fyno-
nyme à livre. On dit le premier livre de VIliade , de
l'Enéide , du Paradis perdu , & c . 8c le premier chant
de la Jérufalem délivrée, & de la Henriade. Le poète
épique tend à la fin de fon ouvrage, en faifant paf-
fer fon leâeur ou fon héros par un enchaînement
d’avantures extraordinaires, pathétiques, terribles,
touchantes, merveilleufes. Il établit dans le cours
du récit général de ces avantures, comme des points
de repos pour fon le&eur & pour lui. La partie de
fon poème comprife entre un de ces points 8c un autre
qui le fuit, s’appelle un.chant.i l y a dans un poème
épique des chants plus ou moins longs, plus ou
moins intéreflans, félon la nature des avantures qui
y font récitées. Il y a plus : il en eft d’un chant comme
d’un poème entier ; il peut intéreffer davantage
une nation qu’une autre, dans un tems que dans un
autre, une perfonne qu’une autre. Il y auroit une
grande faute dans la machine, ou conftruâion, ou
conduite du poème, fi Ton pouvoit prendre la fin
d’un chant, quel qu’il fû t, excepté le d én ier , pour
la fin du poème; & il y auroit eu un grand art de
la part du poète, & il en fût réfulté une grande per-
fedion dans fon poème, s’il avoit fû le couper de
maniéré que la fin d’un chant laiffât une forte d’impatience
de connoître la fuite des chofes, 8c d’en
commencer un autre. Le Taffeme paroît avoir fin-
gulierement excellé dans cette partie. On peut interrompre
la le&ure d’Homere, de Virgile, 8c des
autres poètes épiques, à la fin d’un livre ; le Tafle
vous entraîne malgré que vous en ay iez , & Ton ne
peut plus quitter fon ouvrage quand on en a commencé
la lefture. Il n’en faut pas inférer de - là que
j’accorde au Taffe la prééminence fur les autres poètes
épiques ; je dis feulement que par rapport à nous,.
il l’emporte du côté delà machine fur Homere 8c Virgile,
qui, au jugement des Grecs 8c des Romains, l’au-
roient peut-être emporté fur lu i, fi la colere d’Achille
, l’établiffement des reftes de Troie en Italie, 8c
la prife de Jérufalem par Godefroi de Bouillon,
avoient pû être des évenemens chantés en même
tems, & occafionner des poèmes jugés par les mêmes
juges. Il me femble que les Italiens ont plus de
droit que nous d’appeller les parties de leurs poèmes
épiques, des chants, ces poèmes étant divifés chez
eux par fiances qui fe chantent. Les Gondoliers de
Venife chantent ou plûtôt pfalmodient par coeur
toute la Jérufalem délivrée, & Ton ne chante point
parmi nous la Henriade ou le Lutrin, ni chez les An-
glois le Paradis perdu. Il fuit de ce qui précédé, que
les différens chants d’un poème épique devroient être
entr’eux, comme les aftes d’un poème dramatique ;
& que, de même que l’intérêt doit croître dans le dramatique
de fcene en fcene, d’aéfe en a fie jufqu’à la
cataftrophe, il devroit auffi croître dans l’epique
d’évenemens en évenemens, de chants en chants ,
jufqu’à la conclufion. Voye^ D r a m e , S c e n e ,
A c t e , Ma c h in e , C o u p e , Poeme é p iq u e ,,
&c.
* C h a n t , ( Belles-Lettres.) fe dit encore dans notre
ancienne poéfie, de plufieurs fortes de pièces de
vers, les unes affujetties à certaines réglés, les autres
n’en -ayant proprement aucune particulière. U
y a le chant royal, le chant de Mai, le chant nuptial%
le chant de jo ie , le chant pafioral, le chant de folié*
Voye^, dans Clément Marot, des exemples de tous ces
chants.
Le chant royal fuit les mêmes réglés quç la ballade
, la même mefure de yers, le même mélange
C H A
de rime, 8c le même nombre de ftances, fi toutefois
il eft déterminé dans la ballade ; il a auffi fon vers
de refrein & fon envoi. 11 né différé, dit-on , de la
ballade que par le fujet. Le fujet de la ballade eft
toujours badin ; celui du chant royal eft toûjours fé-
rieux. Cependant il y a dans Marot même un chant
royal dont le refrein e f t , débander l'arc ne guérit point
la plaie, qui fut donné par François I. & dont le fujet
eft de pure galanterie. Voye[ Ballade. Le chant
de Mai eft auffi une ballade, mais dont le fujet eft
donné ; c’eft le retour des charmes de la nature, des
beaux jours 8c des plaifirs, avec le retour du mois
de Mai. Selon que le poète traite ce fujet d’une maniéré
grave ou badine, le chant de Mai eft grave ou
badin. Il y en a deux dans Marot, & tous les deux
dans le genre gravé. Le refrein n’eft pas exa&ement
le même à toutes les ftances du premier ; il eft dans
une ftaiice en précepte, 8c dans l’autre en défenfe
loïier le nom du Créateur ; rÜen loïie£ nulle creature.
Cette licence a lieu dans la ballade , fous quelque
titre qu’elle foit.Le chant nuptial n’eft qu’une épitha-
lame en ftances, où quelquefois les ftances font en
ballade, dont le refrein eft ou varié par quelque op-
pofition agréable, Ou le même à chaque ftance.. Le
chant de joie eft une ballade ordinaire fur quelque
grand fujet ÿallégféffe, foit publique, foit particulière.
Lâ chant pafioral ; une ballade dont les images
& l’allégorie font champêtres. Le chant de folie Weft.
qu’une petite piece fatyrique en vers de dix fylla-
b e s , où'l’on chanteironiquement le travers de quelqu’un.
CHANÏ, ( Médecine , Phyjiologie'. ) voyez VOIX
& R espiration ; ( Pathologie & Hygiene ) voye^
Ex er c ic e .
CHANTABOUN, ( Géog. ) ville maritime d’Afie
au royaume de Siam, fur une riviere qui porte fon
même nom.
CHANTEAU , fi m. ( Jurifpr. ) dans quelques
coûtumes 8c anciens auteürs , fignifièpart ou plûtôt
partage : c’eft en ce dernier fens qu’il y eft dit que le
chanteau part le villain. Lacoûtume de la Marche rédigée
en 1511 , porte, article 163. qu’entre hommes
tenant héritages ferfs oti mortaillables , le chanteau
part lé villain ; c!eft-à-dire,'continue le même artic
le , que quand deux ou plufieurs defdits-hommes,
parens , ou àutr-és qui- par avant étoient communs,
fontpain féparé par maniéré de déclaration de vouloir
partir leurs^metibles , iis -font- ténus réputés
divis & -féparés quant aux meubles, acquêts, con-
quêts, noms, dettes, & aûions.
La coûtume d’Auvergne-, chap, xxvij, article y .
porte que par ladite' coutume ne fe peut dire ni juger
àucUii partage, avoir été fait entré le. conditionne
( c’eft Temphiteotémain-mortable ) & féS frères
au retrait lignager par la feule demeure-, féparé
dudit-conditionné & de fes'autres.frerës ou parens ,
par quelque laps de tems que ce foit , s’ilin’y a partagé
fofmèl fâît éntre ledit conditionné 8c fes frétés
ou lignagers , ou commëfiçeinent de-partage par le
partement dti ckahte'àù.
La difpofitio'n dé cëtte coûtume fait connaître
que le terme dc-chantdiw ne fignifiè p'as toujours1 un
partage de tous1 les biens; comntuns ^ filais que le
chanteàuHy.c’eft1 à-dire une pôrtiOn'dë-quèlqiie efpece
de ces biens qui eft pofféde féparément par ùri'des
mortaillables ou autres Cdmmitttiërisi y- fait céffef la
rcommunauteqiii: étôïfèhtr’eux ; tant p'<5ùr!ce's:biens
que pour tous les autres qu’ils poffedént par ifr
'divis. imp
• Le terme dè chanteau peut! auffi etref'pris pour
pain féparé, car choefrtéaûë n’gé.néral éftHine portion
d’une; chôfé ronde ; comme lés paihS'fônt, ordinairement
ronds, le-vulgaire appelle’Une piece de
•pain, chanteau j 8c.dé-là dans le fens figuré', on a
C H A M3
dit chanteau pour pain à part ou féparé. En effet,
dans plufieurs coûtumes, le feu , le fe l, 8c le pain ,
partent l’homme de morte- main ; c’eft-à-dire, que
quand les communiers ont leur feu , leur fe l, ou leur
pain à port, ils ceffent d’être communs, quoiqu’ils
n ayent pas encore partagé les biens communs en-
tr eux.- Voye^ la coutume du duché de Bourgogne, art.
c) o ,• celle du Comté , article c)() • celle de Nivernois ,
tit. viij. art. 13 .
Il réftilte de ces différentes explications, que cette
façon de parler , le chanteau part le villain , fignifiè
que le moindre commencement de partage entre
communiers fait ceffer la communauté, quoiqu’ils
poffedent encore d’autres biens par indivis. Voytç.
la.pratique de Mafuer , tit. x x x ij. art. cto ; leglojf. de
M. de Lauriere, au mot Chanteau. ( ^ )
* C hanteau , ( Tailleur ; ) c’ëft ainfi que ces ouvriers
appellent les elpeces de pointes qu’ils font
obligés d ’ajoûter fur les côtés d’un manteau ou autre
vêtement femblable, entre les deux lés du drap ,
tant pour lui donner l’ampleur néceffaire que pour
l’arrondir.
* C h anteau , ( Tonnell. ) c’eft entre les pièces
du fond d’un tonneau ou autres vaiffeaux ronds ,
celle du milieu, qui n’a point de femblable , & qui
eft terminée-par deux fegmens de cercles égaux.
CHANTEL-LE-CHASTEL, ( Géog. ) petite ville
de France dans le Bourbonnois , fur la riviere de
Boule. Long. 2.0, 36 . lat. 46V 10.
CHANTELAGE, fi m. ( Jurifpr. ) eft un dfoit dû.
au feigneur pour le vin vendu en gros ou à broche
fur les chantiers delà cave ou du cellier, fitués dans
l’étendue de fa feigneurie; II en eft parlé dans les
ftatuts de la prévôté 8c échevinage dé la ville de>
Paris, 8c au livre ancien quienfeigne la maniéré de
procéder en courlaye, où il eft dit que le chantelagc
eft un droit que l’on prend pour les chantiers qui
font affis fur les fonds du feigneur. Voyeç Chopin y.
fur le ckap. viij. de la coûtume d'Anjou4 à la fih. Le
droit de chantelage fe payoit auffi anciennement r
pour avoir la per million d’ôter le ehanttl du tonneau.
8c en vuider la lie dans les villes ; c’ eft ce que Ton.
voit dans le regiftre des péages de Paris. Chantelage ÿ
dit ce regiftre,' eft-une coûtume affife anciennement,
par laquelleril futetabli qu’il loifôità tous ceux qui
le chantelage payent , d’ôter le charnel de leur tonneau
, & vüider la- lie ; 8c parce qu’il, fembloit. que
ceux qui demeurent à Paris h’achetoient du vit! que,
pour le revendre, & quand il étoit vendu ôter, le
chantel de leur tonneau , 8c ôter leur lié , pbur ce
fut mis le ekantelageiwxAos demeurons & bourgeois
de Paris. Voye{ l'indice de Ragueau ; & Lauriçre ,
ibid. au mot chantelage. Dans des: lettres du 9 Août
1359, accordées par Charles régent du royaume y
les Arbalétriers de la ville de Paris font exemptés *
pour leurs ;denrées y vivres ) ou marchandifes qu’ils
font venir à Paris ou ailleurs ,1 de tous droits de iga»
belles;, travers, chantiées-, &c. Ce mot chantiées ftr-
gnifie en cet endroit la même-ch&fe que chantelage c
car dans des lettres diimôis:'de Février.i 6T Ç-,accor-
déêS à ces mêmes Arbalétriers^ le terme de chante*
lagt îe trouve fubftitiVé'à "celui de chantiées. Voyelle
rectieil des ordonnances de la troifiemc titct-y tome LII.
pag.-36r.Pf la note de M. Secouffe, ibid. ÇA) ; 1«
CHANTELLE , fi f. -( Jurifptud. ) en quelques
provinces eft une taille perfonftelle due au feigneur
par fes mortaillables à caufe de leur férvitûde. Elle
paroît avoir été ainfi" nommée de chantel -, qui figni-
fie-la même chofe que -lieu ou 'habitation , parce
qu’elle fe paye au feigneur par les ferfs , pour la
permiffion de demeurer dans' fa feignëürie, & -d’y
pofféder certains héritages ; par exemple , fîiivant
une charte de l’an 1179 , les habitans de Saint - Pa-
| lais en Berri payent douze deniers à iepr feigneur t