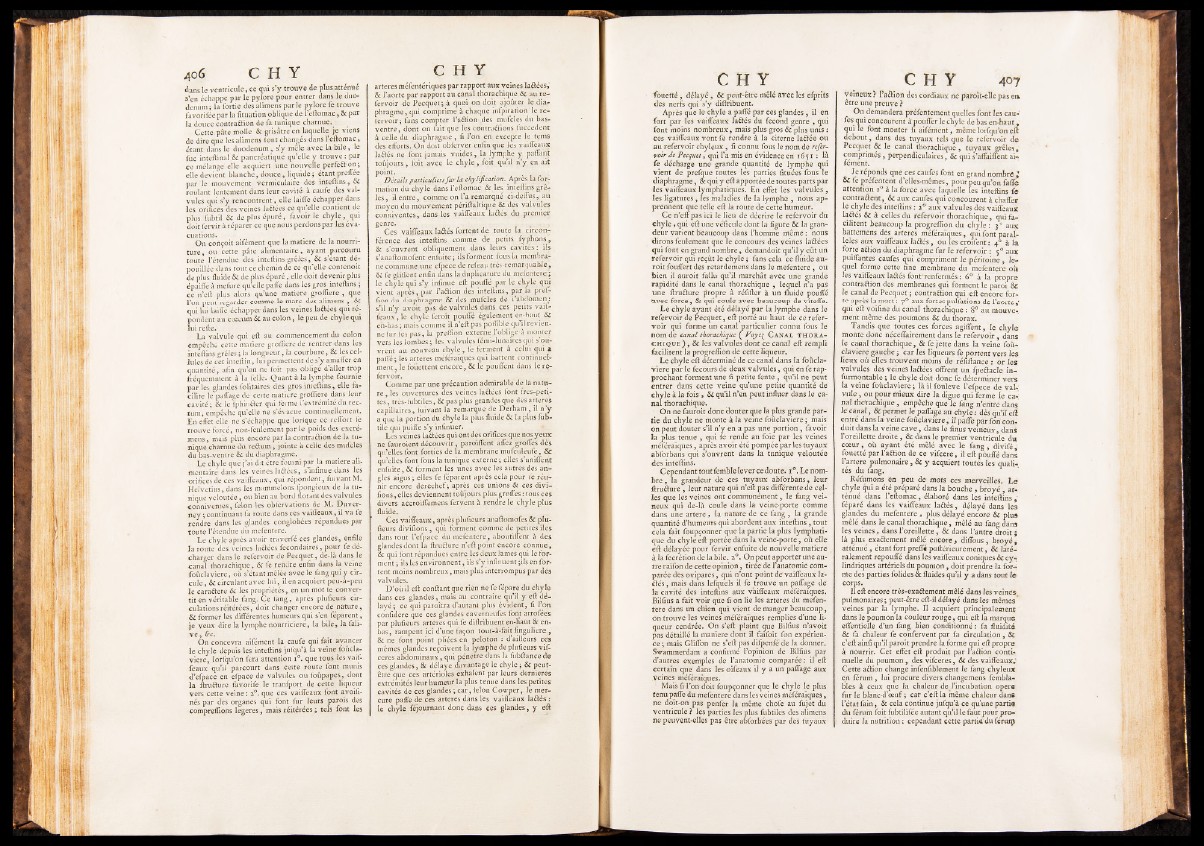
dans le ventricule, ce qui s’y trouve de plus atténué
s’en échappe par le pylore pour entrer dans le duodénum
; la fortie des alimens parle pylore fe trouve
favorifée par la fituation oblique de l’eftomac, & par
la douce contraélion de fa tunique charnue.^
Cette pâte molle & grisâtre en laquelle je viens
de dire que les alimens font changés dans l’eftomac,
étant dans le duodénum, s’y mêle avec la.bile, le
fuc inteftinal ôc pancréatique qu’elle y trouve : par
ce mélange elle acquiert une nouvelle perfeét’.on;
elle devient blanche, douce, liquide ; étant preflée
par le mouvement vermiculaire des inteftins, ôc
roulant lentement dans leur cavité à caufe des valvules
qui s’y rencontrent, elle lailfe échapper dans
les orifices des veines laftées ce qu’elle contient de
plus fubtil ôc de plus épuré, favoir le ch yle , qui
doit fervir à réparer ce que nous perdons par les évacuations.
. .
On conçoit aifément que la matière de la nourriture,
ou cette pâte alimentaire, ayant parcouru
toute l’étendue des inteftins grêle.s, ôc s’étant dépouillée
dans tout ce chemin de ce qu’elle contenoit
de plus fluide ôc de plus épuré, elle doit devenir plus
épaifle à mefure qu’elle paffe dans les gros inteftins ;
ce n’eft pliis alors qu’une matière grofliere , que
l’on peut regarder comme le marc des alimens , ôc
qui lui laiffe échapper dans les veines la&ées qui répondent
au cæcum ôc au colon, le peu de chyle qui
lui relie. •
La valvule qui elt au commencement du colon
empêche cette matière grolîiere de rentrer dans les
inteftins grêles ; la longueur, la courbure, ÔC les cellules
de cet inteftin, lui permettent de s’y amaffer en
quantité, afin qu’on ne l’oit pas oblige d’aller trop
fréquemment à la felle. Quant à la lymphe fournie
par les. glandes folitaires des gros, inteftins* elle facilite
le paffage de cette maticre grolîiere dans leur
cavité ; ÔC le lphinôer qui ferme l’extrémité du rectum,
empêche quelle ne s’évacue continuellement.
En effet elle ne s’échappe que lorique ce reffort le
trouve forcé, non-feulement par le poids des excré-
mens, mais plus encore par la contraûion de la tunique
charnue du reâum, jointe a celle des mufcles
du bas-ventre ôc du diaphragme.
Le chyle que j’ai dit être fourni par la matière alimentaire
dans les veines laélées, s’infinue dans les
orifices de ces vaiffeaux, qui répondent, fuivantM.
Helvetius, dans les mammelons fpongieux de la tunique
veloutée, ou bien au bord flotant des valvules
conniventes’, félon les obfervations de M. Duver-
ney ; continuant fa route dans ces vaiffeaux, il va fe
rendre dans les glandes conglobées répandues par
toute l’étendue du melentere.
Le chyle après avoir traverfé ces glandes, enfile
la route des veines laâées fecondaires, pour fe décharger
dans le refervoir de Pecquet, de-là dans le
canal thorachique, & fe rendre enfin dans la veine
fouclaviere, où s’étant mêlée avec le lang qui y circule
, & circulant avec lui, il en acquiert peu-à-peu
le caraéiere Ôc les propriétés, en un mot le convertit
en véritable fang. Ce fang, après plufieurs circulations
réitérées, doit changer encore de nature,
& former les différentes humeurs qui s’en féparent,
je veux dire la lymphe nourricière, la bile, la fali-
v e , &c. . ' .-- in
On concevra aifément la caufe qui fait avancer
le chyle depuis les inteftins jufqu’à la veine foûda-
viere, lorfqu’on fera attention i°. que tous les vaif-.
féaux qu’il parcourt dans cette route font munis
d’efpace en efpace de valvules ou foupapes, dont
la ftru&ure favorife le tranfport de cette liqueur
vers cette veine : 2°. que ces vaiffeaux font avoifi-
nés par des organes qui font fur leurs parois des
comprenions legeres, mais réitérées ; tels font les
arteres méfentériques par rapport aux veines Iaélées,'
& l’aorte par rapport au canal thorachique ôc au refervoir
de Pecquet; à quoi on doit ajouter le.diaphragme,
qui comprimé à chaque infpiration le refervoir;
fans compter l’aftion des mufcles du bas-
ventre, dont on fait que les contractions fuccedent
à celle du diaphragme , fi l’on en excepte le tems
des efforts. On doit obferver enfin que les vaiffeaux
la liés ne font jamais vuides, la lymphe y paffant
toujours , foit avec le chyle ,/oit qu’il n’y en ait
point. : ,
Details particuliers fur la chylification. Après la formation
du chyle dans l’eftomac & les inteftins grêles,
il entre , comme on l’a remarqué ci-deffus ,; au
moyen du mouvement pér,iftaltique ôc des valvules
conniventes, dans les vaiffeaux la&és du premier
genre. . , -.ir . xrre-• :'
Ces vaiffeaux laétés fortent de toute la circon-
férence des inteftins comme de petits, fyphons,
& s’ouvrent obliquement dans leurs cavités : ils
s’anaftomofent enfuite; ils forment fous la membrane
commune une efpece de refeau très-remarquable,
& fe gliflent enfin dans la duplicature du mefentere’;
le chyle qui s’y infmue eft pouffé par le chyle qui
vient après, par l’aâion des,inteftins, par la prefr
lion du diaphragme ôc des mulcles de l’abdomen :
s’il n’y avoit pas de valvules dans ces petits vaiffeaux,
le chyle feroit pouffé également en-haut ÔC
en-bas; mais comme il n’eft pas poftible qu’il revienne
fur les pas, la preflïon externe l’oblige-à monter
vers les lombes ; les Valvules fémi-lunaires qui s’qu-
vrent au nouveau chyle , le ferment à celui qui a
paffé ; les arteres méféraïques qui battent continuel-
ment, le foiiettent encore, ôc le pouffent dans le refervoir.
Comme par une précaution admirable' de la nature
, les ouvertures des veines laétees font très-petites
, très-1 ubtiles, ôc pas plus grandes que des arteres
capillaires, fuivant la remarque de Derham , il n’y
a que la portion du chyle la plus fluide ôc la plus fub-
tile qui puiffe s’y infinuer.
Les veines laâées qui ont des orifices que nos yeux
ne fauroient découvrir, paroiffent affez groffes dès
qu’elles font forties de la membrane mufculeufe, &
qu’elles font fous la tunique externe ; elles s’uniffent
enfuite, ôc forment les unes avec les autres des angles
aigus; elles fe féparent après cela pour fe réunir
encore derechef ; après ces unions & ces divi-
fions, elles deviennent toujours plus groffes : tous ces
divers accroiffemens fervent à rendre le chyle plus
fluide.
Ces vaiffeaux, après plufieurs atiaftomofes & plufieurs
divifions , qui forment comme de petites îles
dans tout l’efp.ace du mefentere, aboutiffent à des
glandes dont la ftruûure n’eft point encore connue,
ôc qui font répandues entre les deux lames qui le forment
; ils les environnent, ils s’y infinuent ;ils en fortent
moins nombreux, mais plus interrompus par dés
valvules.
D ’où il eft confiant que rien ne fe fépare du chyle
dans ces glandes, mais au contraire qu’il y eft délayé;
ce qui paroîtra d’autant plus évident, fi l’on
confidere que ces glandes caverneufes font arrofées
par plufieurs arteres qui fe diftribuent en-haut & en-
bas, rampent ici d’une façon tout-à-fait finguliere,,
ôc ne font point pliées en peloton : d’ailleurs ces
mêmes glandes reçoivent la lymphe de plufieurs vif-
ceres abdominaux, qui pénétré dans la fubftance de
ces glandes, & délaye davantage le chyle ; ôc peut-
être que ces artérioles exhalent par leurs dernieres
extrémités leur humeur la plus tenue dans les petites
cavités de ces glandes ; car, lelon Cowper, le mercure
paffe de ces arteres dans les vaiffeaux laftés :
le chyle féjournant donc dans ces glandes, y eft:
fbuefté , délayé, & peut-être mêlé avec les efprits
des nerfs qui s’y diftribuent.
Après que le chyle a paffé par ces glandes, il en
fort par les vaiffeaux laftés du fécond genre , qui
font moins nombreux, mais plus gros & plus unis :
Ces vaiffeaux vont fe tendre à la citerne lâ&éè ou
au refervoir chyleux , fi connu fous le nom de refervoir
de Pecquet, qui l’a mis en évidence en 1651 : là
fe décharge une grande quantité de lymphe qui
vient de prefque toutes les parties fituées fous le
diaphragme, & qui y eft apportée de toutes parts par
les vaiffeaux lymphatiques. En effet les valvules ,
les ligatures, les maladies de la lymphe , ricJus apprennent
que telle eft la route de cette humeur.
Ce n’eft pas ici le lieu de décrire le refervoir du
ch y le , qui eft une véficule dont la figure & la grandeur
varient beaucoup dans l’homme même : nous
dirons fettlement que le concours des veines la&ées
qui font en grand nombre, demandoit qu’il y eût üri
refervoir qui reçût le chyle ; fans cela ce fluide au-
roit fouffért des retardemens dans le mefentere , oit
bien il auroit fallu qu’il marchât avec une grande
rapidité dans le canal thorachique , lequel n’a pas
une ftruélure propre à réfifter à un fluide pouffé
avec force, & qui coule avec beaucoup de vîteffe.
Le chyle ayant été délayé par la lymphe dans le
refervoir de Pecquet, eft porté au haut de ce refervoir
qui forme un canal particulier connu fous le
nom de Canal thorachique ( Voye^ C anal THORACHIQUE),
ôc les valvules dont ce canal eft rempli
facilitent la progreflion de cette liqueur.
Le chyle eft déterminé de ce canal dans la foûcla-
viere par le fêcours de deux valvules, qui en fe rapprochant
forment une fi petite fente , qu’il ne peut
entrer dans cette veine qu’une petite quantité de
chyle à la fo is , ôc qu’il n’en peut influer dans le canal
thorachique.
On ne fauroit donc douter que la plus grande partie
du chyle ne monte à la veine fouclaviere ; mais
on peut douter s’il n’y en a pas une portion, favoir
la plus tenue , qui fe reride au foie par les veines
méféraïques, après avoir été pompée par les tuyaux
abforbans qui s’ouvrent dans là tunique veloutée
des inteftins.
Cependant tout femblè lever ce doute. 1 °. Le nomb
r e , la grandeur de ces tuyaux abforbans, leur
ilrufture , leur nature qui n’eft pas différente de celles
que les veines ont communément, lè fang veineux
qui de-là coule dans la veine-porte comme
dans une artere , la nature de ce fang , la grande
quantité d’humeurs qui abordent aux inteftins, tout
cela fait foupçonner que la partie la plus lymphatique
du chyle eft portée dans la veine-porte, où elle
eft délayée pour fervir enfuite de nouvelle matière
à la fecrétion de la bile. 20. On peut apporter une autre
raifon de cette opinion, tirée de l’anatomie comparée
des ovipares, qui n’ont point de vaiffeaux la-
étés , mais dans lefquels il fe trouve un paffage dë
la cavité des inteftins aux vaiffeaux méféraïques.
Bilfius a fait voir que fi on lie les arteres du mefentere
dans un chien qui vient de manger beaucoup,
On trouve les veines méféraïques remplies d’une liqueur
cendrée. On s’eft plaint que Bilfius n’avoit
pas détaillé la maniéré dont il faifoit fort expérience
; mais Gliffon ne s’eft pas difpenfé de la donner.
Svrammerdam a confirmé l’opinion de Bilfius par
d’autres exemples de l’anatomie comparée: il eft
certain que dans les oifeaux il y a un paffage aux
veines méféraïques.
Mais fi l ’on doit foupçonner que le chyle le plus
tenu paffe du mefentere dans les veines méféraïques,
ne doit-on pas penfer la même chofe au fujet du
ventricule ? les parties les plus fubtiles des alimens
ne peuvent-elles pas être abforbées par des tuyaux
Veineux ? Pa&ioii des cordiaux ne paroît-elle pas e a
être une preuve ?
On demandera préfêntement quelles font les caufes
qui concourent à pouffer le chyle de bas en-haut,
qui le font monter fi aifément, même lorfqu’on eft
debout, dans des tuyaux tels que le refervoir de
Pecquet 6c le cariai thorachique, tuyaux grêles,
comprimés, perpendiculaires, ôc qui s’affaiffent aifément.
Je réponds que ces caüfcs font en grand nombre ;
& fe prefentent d elles-mêmes, pour peu qu’on faffe
attention i° à la force avec laquelle les inteftins fe
contrarient, ôc aux caufes qui concourent à chaffer
le chyle des inteftins : 20 aux valvules des vaiffeaux
laétés & à celles du refervoir thorachique, qui facilitent
beaucoup la progreflion du chyle : 3 u aux
battemens des arteres méféraïques, qui font parallèles
aux vaiffeaux laftés, ou les croifent : 40 à la
forte aélion du diaphragme fur le refervoir : 50 aux
puiffantes caufes qui compriment le péritoine, lequel
forme cette fine membrane du mefentere oii
les vaiffeaux laêlés font'renfermés : 6° à la propre
contraélion des membranes qui forment le paroi Sc
le canal de Pecquet ; contraction qui eft encore forte
après la mort : 70 aux fortes pulfations de l ’aorte
qui eft vôifine du canal thorachique : 8° au mouve-,
ment même des poumons ôc du thorax.
Tandis que toutes ces forces agiffent, le chyle
monte donc néceffairement dans le refervoir , dans
le canal thorachique, & fe jette dans la veine foû-
claviefe gauche ; car les liqueurs fe portent vers les
lieux où elles trouvent moins de réfiffance : or les
valvules des veines Iaélées offrent un fpedacle in-
furmontable ; le chyle doit donc fe déterminer vers
la vèinè fouclaviere ; là il fouleve l’efpece de vaû;
v u le , ou pour mieux dire la digue qui ferme le ca-;
nal thdïachique, empêche que le fang n’eritrè dans
le canal, & permet le paffage au chyle : dès qu’il eiî
entré dans la veine fouclaviere, il paffe par fori conduit
dans la veine ca ve , dans le finus veineux, dans
l’oreillette droite, ôc dans le premier ventricule du
coeu r, où ayant été mêlé avec le fan g , divifé -
fouetté par l’aClion de ce vifeere, il eft pouffé dans
l’artere pulmonaire, ôc y acquiert toutes les qualités
du fang.
Réfumons én peu de mots ces merveilles. Le
chyle <|ui a été préparé dans la bouche, b ro y é , atténué
dans l’eftomac, élaboré dans les inteftins
féparé dans les vaiffeaux laftés, délayé dans les
glandes du mefentere, plus délayé encore ôc plus
mêlé dans le canal thorachique, mêlé au fang dans
les veines, dans l’oreillette, ôc dans l ’antre droit ;
là plus exactement mêlé encore > diffous, b royé,
atténué, étant fort preffé poftérieurement, ôc latéralement
repouffé dans les vaiffeaux coniques ôc cy lindriques
artériels du poumon, doit prendre la forme
des parties folides & fluides qu’il y a dans tout le
corps.
Il eft encore très-exadement mêlé dans les veines
pulmonaires ; peut-être eft-il délayé dans les mêmes
veines par la lymphe. Il acquiert principalement
dans le poumon la couleur rouge, qui eft la marque
effentielle d’un fang bien conditionné: fa fluidité
ôc fa chaleur fe confervent par fa circulation, &
c’eft ainfi qu’il paroît prendre la forme qui eft propre
à nourrir. Cet effet eft produit par l’aCtion continuelle
du poumon, des vifeeres, ÔC des vaiffeaux.’
Cette aélion change infenfiblement le fang chyleux
en férum, lui procure divers changemens fembla-
bles à ceux que la chaleur de l’incubation opéré
fur le blanc-d’oeuf ; car c’eft la même chaleur dan#
l’état fain, & cela continue jufqu’à ce qu’une partie
du férum foit fubtilifée autant qu’il le faut pour produire
la nutrition ; cependant cette partie du féruipi