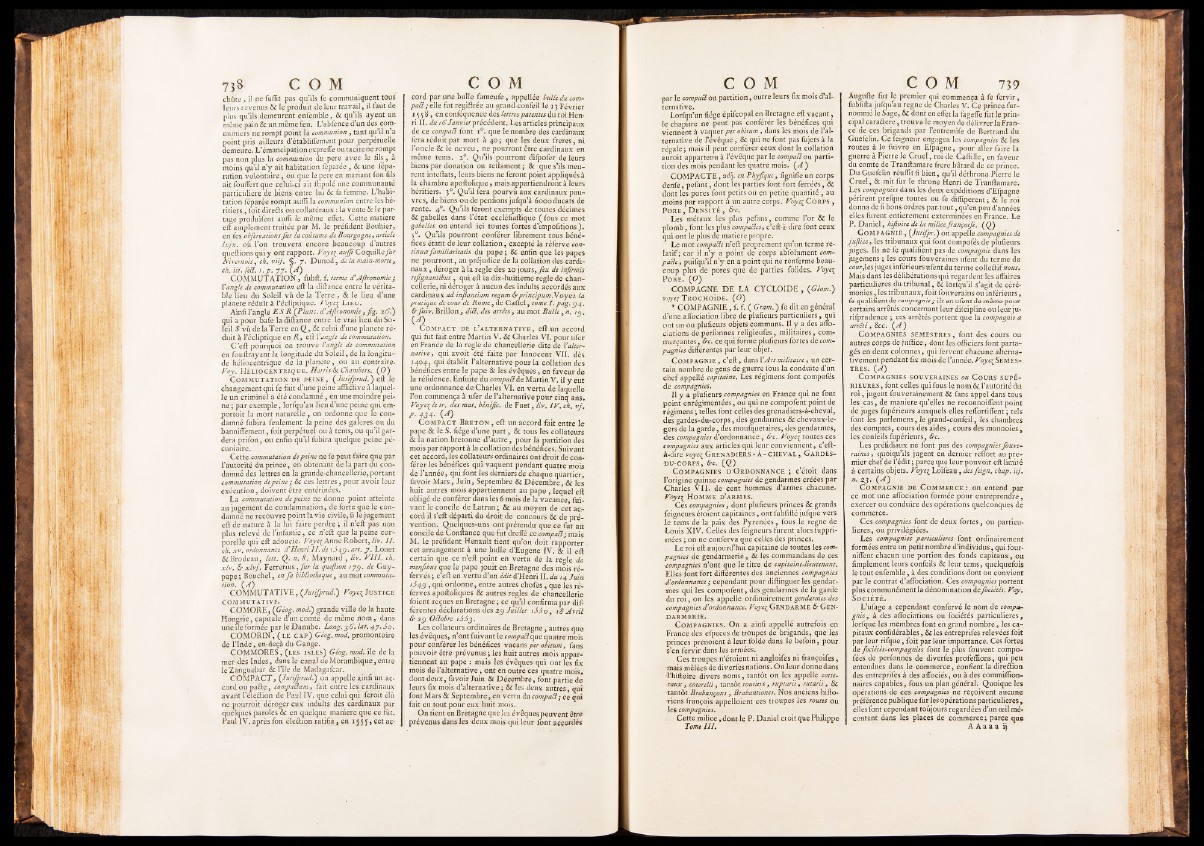
73$ C O M
chiite, il ne fuffit pas qu’ils fie communiquent tous
leurs revenus & le produit de leur travail, il faut de
pius qu’ils demeurent enfemble, & qu’ils ayent un
même pain & un même feu. L’abfence d’un des com-
muniers ne rompt point la communion , tant qu’il n’a
point pris ailleurs d’établilTement pour perpétuelle
demeure. L ’émancipation expreffe ou tacite ne rompt
pas non plus la communion du pere avec le fils, à
moins qu’il n’y ait habitation féparée , & une fepa-
ration volontaire, ou que le pere en mariant fon fils
ait fouffert que celui-ci ait ftipulé une communauté
particulière de biens entre lui & fa femme. L’habitation
féparée rompt aulîi la communion entre les heritiers,
foit direfts on collatéraux : la vente & le partage
produifent aulîi le même effet. Cette matière
eft amplement traitée par M. le préfident Bouhier,
en fes obfervations fur la coutume de Bourgogne, article
Ixjx. oii l’on trouvera encore beaucoup d’autres
queftions qui y ont rapport. Voyez aujji Coquille fur
Nivémois, ch. vüj. § . y. Dunod, de la main-morte ,
ck. iii- wUBËBÈBê_„ . . . C COMMUTATION, fiubft. f. terme d Aflronomie ;
f angle de commutation eft la diftance entre le véritable
lieu du Soleil vu de la Terre , & le lieu d’une
planète réduit à l’écliptique. Voyez Lieu.
Ainfi l’angle E S R {Plane, d'Aflronomie, fig. zG.~)
qui a pour bafe la diftance entre le vrai lieu du Soleil
S vu de la Terre en Q , & celui d’une planete réduit
à l’écliptique en A , eft l’angle de commutation.
C ’eft pourquoi on trouve Sangle de commutation
en fouftrayant la longitude du Soleil, de la longitude
héliocentrique de la planete, ou au contraire.
Voy. Héliocentrique. Harris & Chambers. (O)
C ommutation de peine, ( Jurifprud. ) eft le
changement qui fe fait d’une peine affliâive à laquelle
un criminel a été condamné, en une moindre peine
; par exemple, lorfqu’au lieu d’une peine qui em-
portoit la mort naturelle, on ordonne que le condamné
fubira feulement la peine des gaîeres ou du
banniflement, foit perpétuel ou à tems, ou qu’il gardera
prifon, -ou enfin qu’il fubira quelque peine pécuniaire.
Cette commutation de peine ne fe peut faire que par
l’autorité du prince, en- obtenant de la part du condamné
des lettres en la grande-chancellerie, portant
commutation de peine ; & ces lettres, pour avoir leur
exécution, doivent être entérinées.
La commutation de peine ne donne point atteinte
au jugement de condamnation, de forte que le condamné
ne recouvre point la vie civile, fi le jugement
eft de nature à la lui faire perdre ; il n’eft pas non
plus relevé de l’infamie, ce n’eft que la peine corporelle
qui eft adoucie. Voyez Anne Robert, liv. II.
ch. xv. ordonnance d’Henri I I. de 1649. art. J ' Louet
&Brodeau, lett. Q_. n. 8. Maynard , liv. VIII. ch.
xlv. (y %lvj, Ferrerius yfur la queflion iyc). de Guy-
pape.; Bouchel, en fa bibliothèque, au mot commutation.
{A')
COMMUTATIVE, {Jurifprud.') Voyez Justice
commutative.
COMORE, ( Géog. mod.) grande ville de la haute
Hongrie, capitale d’un comté de même nom, dans
uneîlé formée par le Danube. Long. 3 (f. lat. 4 7 .5o.
COMORIN, ( le cap) Géog.mod. promontoire
de l’Inde, en-deçà du Gange.
CQMMORES, (les isles) Géog. mod. île de la
mer des Indes, dans le canal de Morambique, entre
le'Zanguebar & Fîle de Madagaficar.
COM PA C T, ( Jurifprud.) on appelle ainfi un accord
ou pafte, compaïlum, fait entre les cardinaux
avant l’éleÛion de Paul IV. que celui qui feroit élu
lie pourroit déroger eux induits des cardinaux par
quelques paroles & en quelque maniéré que ce fût.
Paul IV, après fon élection ratifia, en 15 5 5, cet aç-
C O M
cord par une bulle fameufe, appellée bulle du compact;
elle fut regiftrée au grand-confeil le 13 Février
1558, en conféquence des lettres patentes dit roi Henri
II. du 16Janvier précédent. Les articles principaux
de ce compact font i p. que le nombre des cardinaux
fera réduit par mort à 40 ; que les deux freres, ni
l’oncle & le neveu, ne pourront être cardinaux en
même tems. z°. Qu’ils pourront difpofer de leurs
biens par donation ou teftament ; & que s’ils meurent
inteftats, leurs biens ne feront point appliqués à
la chambre apoftolique , mais appartiendront à leurs
héritiers. 30. Qu’il fera pourvu aux cardinaux pauvres,
de biens ou de penfions jufqu’à 6000 ducats de
rente. 40. Qu’ils feront exempts de toutes décimes
& gabelles dans l’état eccléfiaftique ( fous ce mot
gabelles on entend ici toutes fortes d’impofitions ).
5°. Qu’ils pourront conférer librement tôus bénéfices
étant de leur collation, excepté la réferve continua
familiaritatis du pape ; & enfin que les papes
ne pourront, au préjudice de la collation des cardinaux
, déroger à la réglé des 10 jours, feu de infirmis
rejignantibus , qui eft la dix-huitieme réglé de chancellerie,
ni déroger à aucun des induits accordés aux
cardinaux ad inflantiam regum &principum.V oyez la
pratique de cour de Rome, de Caftel, tome I . pag. 9 4 .
& fuir. Brillon , dict. des arrêts, au mot Bulle .n . iq.
■ - K
Compact de l’alternative, eft un accord
qui fut fait entre Martin V. & Charles VI. pour ufer
en France de la réglé de chancellerie dite de l’alternative,
qui avoit été faite par Innocent VII. dès
1404, qui établit l’alternative pour la collation des
bénéfices entre le pape & les évêques, en faveur de
la réfidence. Enfuite du compact de Martin V. il y eut
une ordonnance de Charles VI. en vertu de laquelle
l’on commença à ufer de l’alternative pour cinq ans.
Voyez le tr. des mat, bénéfle. de Fuet, liv. IV . ch. vj.
f . 434- {■ *)
C ompact Breton , eft un accord fait entre le
pape & le S. fiége d’une part, & tous les collateurs
& la nation bretonne d’autre, pour la partition des
mois par rapport à la collation des bénéfices. Suivant
cet accord, les collateurs ordinaires ont droit de conférer
les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois
de l’année, qui font les derniers de chaque quartier,
favoir Mars, Juin, Septembre & Décembre, & les
huit autres mois appartiennent au pape, lequel eft
obligé de conférer dans les 6 mois de la vacance, fui-
vant le concile de Latran ; & au moyen de cet accord
il s’eft départi du droit de concours & de prévention.
Quelques-uns ont prétendu que ce fut ail
concile de Confiance que fut dreffé ce compact; mais
M. le préfident Henault tient qu’on doit rapporter
-cet arrangement à une bulle d’Eugene IV. & il eft
certain que ce n’eft point en vertu de la réglé de
menfibm que le pape jouit en Bretagne des mois ré-
fervés ; c’eft en vertu d’un édit d’Henri II. du 14 Juin
1S49 , qui ordonne, entre autres chofes, que les ré-
ferves apoftoliques & autres réglés de chancellerie
foient reçues en Bretagne ; ce qu’il confirma par différentes
déclarations des 2 c) Juillet i55 o , 18 Avril
& zç) Octobre 1SS3.
Les collateurs ordinaires de Bretagne, autres que
les évêques, n’ontfuivant le compactasse quatre mois
pour conférer les bénéfices vacans per obitum, fans
pouvoir être prévenus ; les huit autres mois appartiennent
au pape : mais les évêques qui ont les fix
mois de l’alternative, ont en outre ces quatre mois,
dont deux, favoir Juin & Décembre, font partie de
leurs fix mois d’alternative ; & les deux autres, qui
font Mars & Septembre, en vertu du compact; ce qui
fait en tout pour eux huit mois.
On tient en Brètagne que les évêques peuvent être
prévenus dans les deux mois qui leur font accordés
C O M
par le compact ou partition, outre leurs fix mois d’alternative.
Lorfqu’un fiége épifcopal en Bretagne eft vacant,
le chapitre ne peut pas conférer les bénéfices qui
viennent à vaquer per obitum, dans les mois de l’alternative
de l’evêque, & qui ne font pas fujets à la
régale ; mais il peut conférer ceux dont la collation
auroit appartenu à l’évêque par le compact ou partition
des mois pendant les quatre mois. ( A )
COMPACTE, adj. en Phyfîque, lignifie un corps
denfe, pefant, dont les parties font fort ferrées, &
dont les pores font petits ou en petite quantité , au
moins par rapport à un autre corps. Voyez Corps ,
Pore, Densité, & c.
Les métaux les plus pefans, comme l’or & le
plomb, font les plus compactes, c’ eft-àdire font ceux
qui ont le plus de matière propre.
Le mot compacte n’eft proprement qu’un terme relatif;
car il n’y a point de corps abfolument compacte
, puifqu’il n’y en a point qui ne renferme beaucoup
plus de pores que de parties folides. Voyez
Pore. (O)
COMPAGNE DE LA CYCLOIDE , (<Géom.)
voyez Trochoïde. (O)
* COMPAGNIE, f. f. ( Gram. ) fe dit en général
d’une aflociation libre de plufieurs particuliers, qui
ont un ou plufieurs objets communs. Il y a des aflo-
ciations de perfonnes religieufes, militaires, commerçantes,
&c. ce qui forme plufieurs fortes de compagnies
différentes par leur objet.
C ompagnie , c’eft, dans l’Art militaire, un certain
nombre de gens de guerre fous-la conduite d’un
chef appellé capitaine. Les régimens font compofés
de compagnies.
Il y a plufieurs compagnies en France qui ne font
point enrégimentées, ou qui ne compofent point de
régimens ; telles font celles des grenadiers-à-cheval,
des gardes-du-corps, des gendarmes & chevaux-le-
gers de la garde, des moufqueraires, des gendarmes,
des compagnies d’ordonnance, &c. Voyez toutes ces
compagnies aux articles qui leur conviennent, c’eft-
à-dire voyez Grenadiers - à - cheval , Gardes-
du-corps, &c. (Q)
C ompagnies D’Ordonnance ; c’étoit dans
l’origine quinze compagnies de gendarmes créées par
Charles V I I . de cent hommes d’armes chacune.
Voyez Homme d’armes.
Ces compagnies, dont plufieurs princes & grands
feigneurs étoient capitaines, ont fubfifté jufque vers
le tems de la paix des Pyrénées, fous le régné de
Louis XIV. Celles des feigneurs furent alors fiuppri-
mées ; on ne conferva que celles des princes.
Le roi eft aujourd’hui capitaine de toutes les compagnies
de gendarmerie, & les commandans de ces
■ compagnies n’ont que le titre de capitaine-lieutenant.
Elles font fort différentes des anciennes compagnies
J!ordonnance ; cependant pour diftinguer les gendarmes
qui les compofent, des gendarmes de la garde
du ro i, on les appelle ordinairement gendarmes des
„compagnies d’ordonnance. Voyez GENDARME & GENDARMERIE.
Compagnies. On a ainfi appellé autrefois en
France des efpeces de troupes de brigands, que les
princes prenoient à leur folde dans le befoin, pour
s’en fervir dans les armées.
Ces troupes n’étoient ni angloifes ni françoifes,
■ mais mêlées de diverfes nations. On leur donne dans
Thiftoire divers noms, tantôt on les appelle cotte-
raupc , coterelli, tantôt routiers , ruptarii, rutarii, &
•tantôt Brabançons , Brabantiones. Nos anciens hifto-
•riens françois appelloient ces troupes les routes ou
les compagnies.
Cette m ilice, dont le P. Daniel croit que Philippe
Tome I I I .
C O M 739
Augufte fut le premier qui commença à fe fervir,
fubfifta jufqu’au régné de Charles V. Ce prince, fur-
nommé le Sage, & dont en effet la fageffe fut le principal
cara&ere, trouva le moyen de délivrer la France
de ces brigands par l’entremife de Bertrand du
Guefclin. Ce leignenr engagea les compagnies & les
routes à le fuivre en Efpagne, pour aller faire la
guerre à Pierre le Cruel, roi de Caftille, en faveur
du comte de Tranftamare frere bâtard de ce prince.
Du Guefclin réuffitfi bien, qu’il déthrona Pierre le
Cruel, & mit fur le throne Henri de Tranftamare.
Les compagnies dans les deux expéditions d’Efpagne
périrent prefque toutes ou fe diffiperent ; & le roi
donna de fi bons ordres partout, qu’en peu d’années
elles furent entièrement exterminées en France. Le
P. Daniel, hifloire de la milice françoife. (Q)
C ompagnie , (Jurifpr.) on appelle compagnies de
juflice, les tribunaux qui font compofés de plufieurs
juges. Ils ne fe qualifient pas de compagnie dans lés
jugemens ; les cours fouveraines ufent du terme de
cour^ les juges inférieurs ufent du terme collectif nous.
Mais dans les délibérations qui regardent les affaires
particulières du tribunal, & lorfqu’il s’agit de cérémonies
, les tribunaux, foit fouverains ou inférieurs,
fe qualifient de compagnie; ils en ufent de même pour
certains arrêtés concernant leur difeipline ou leur ju-
rifprudence ; ces arrêtés portent que la compagnie a
arrêté y & c . {A )
C ompagnies semestres , font des cours ou
autres corps de juftice, dont les officiers font partagés
en deux colonnes, qui fervent chacune alternativement
pendant fix mois de l’année. Voyez Semestres.
(A )
C ompagnies souveraines ou Cours supérieures
, font celles qui fous le nom & l’autorité du
ro i, jugent fouverainement &c fans appel dans tous
les cas, de maniéré qu’elles ne reconnoiffent point
de juges fupérieurs auxquels elles reffortiffent ; tels
font les parlemens, le grand-confeil, les chambres
des comptes, cours des aides, cours des monnoies,
les confeils fupérieurs, &c.
Les préfidiaux ne font pas des compagnies fouveraines
y quoiqu’ils jugent en dernier reffort au premier
chef de l’édit ; parce que leur pouvoir eft limité
à certains objets. Voyez Loifeau, des feign. chap. iij.
n . Z 3 . ( A )
C ompagnie de C ommerce: on entend par
ce mot une aflociation formée pour entreprendre,
exercer ou conduire des opérations quelconques de
commerce.
Ces compagnies font de deux fortes, ou particulières,
ou privilégiées.
Les compagnies particulières font ordinairement
formées entre un petit nombre d’individus, qui four-
niflent chacun une portion des fonds capitaux, ou
Amplement leurs confeils & leur tems, quelquefois
| le tout enfemble, à des conditions dont on convient
par le contrat d’aflociation. Ces compagnies portent
plus communément la dénomination defociétés. Voy.
Société.
L’ufage a cependant confervé le nom de compagnie
y à des affociations ou fociétés particulières,
lorfque les membres font en grand nombre, les capitaux
confidérables, & les entreprifes relevées foit
par leur rifque, foit par leur importance. Ces fortes
de fociétés-compagnies font le plus fouvent compo-
fées de perfonnes de diverfes profeflions, qui peu
entendues dans le commerce, confient la direâion
des entreprifes à des affociés, ou à des commiflion-
naires capables, fous un plan général. Quoique les
opérations de ces compagnies ne reçoivent aucune
préférence publique fur les opérations particulières ,
elles font cependant toujours regardées d’un oeil mécontent
dans les places de commerce; parce que
Ii
«
il!