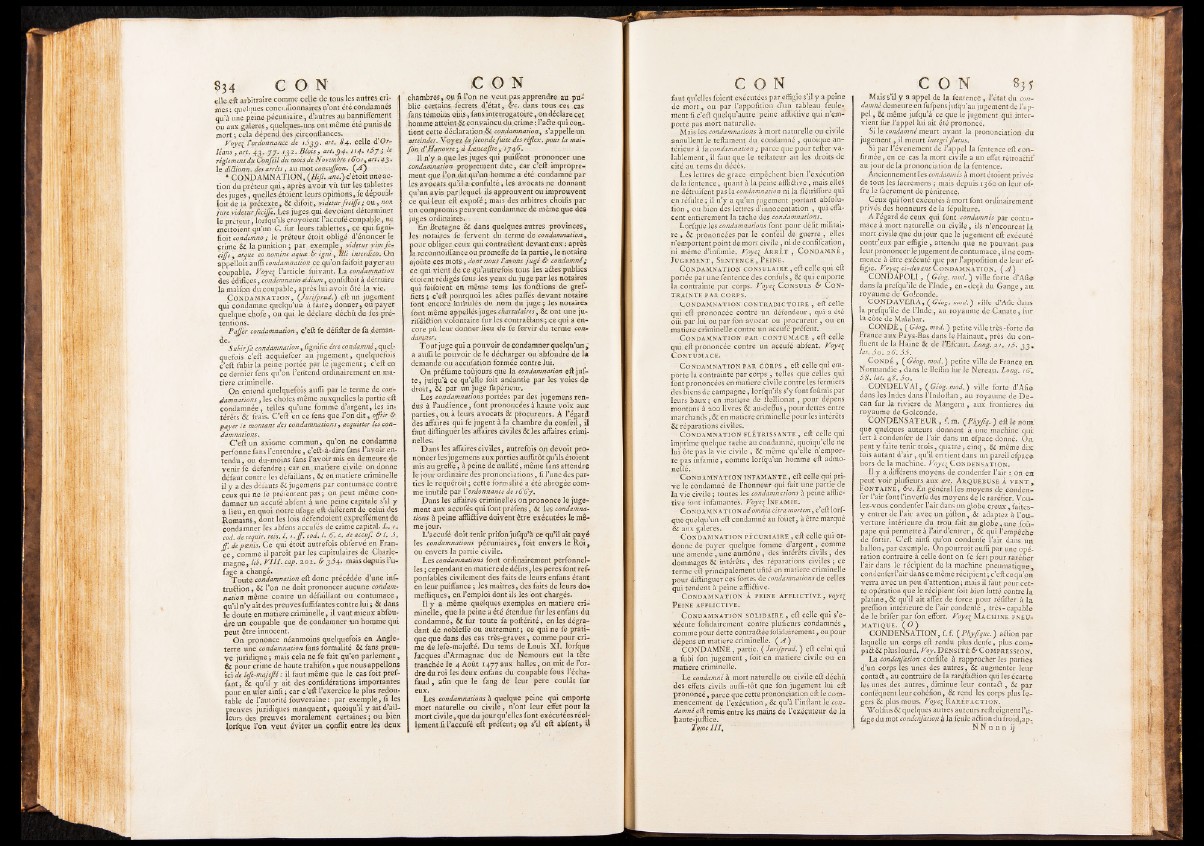
elle eft arbitraire comme celle de tous les autres, crimes
: quelques concr.ffionnaireïs n’ont été condamnes
qu’à une peine pécuniaire, d’autres au banniffeiricnt
pu aux galeres, quelques-uns ont même été punis à ç
mort ; cela dépend des jcirçonftances.
Voyezl'ordonnance de 163ÿ . a r t> 84* celle & Orléans
, art. 43. y J . 132. B lo is , art. g 4. 114. iSy J U
réglement du Confeil du mois de Novembre 1 S o i y a rt. 43.
le diction4 . des a r rê ts, au m o t c o n a tio n . ( A )
* CONDAMNATION, (Hift. anc.) c’étoituneae-
tion du préteur qui, après avoir vû fur les tablettes
des juges, quellesétoient leurs opinions,fe dépouil-
loit de fa .prétexte, & difoif, yidttur feciffe; ou, non
jure videtur feciffe. Les juges, qui dévoient déterminer
le préteur, lorl'qu’ils çroyoient l’açcufé coupable v ne
mettoient qu’un C. fur leurs tablettes, ce qui figni-
fioit condemno ; le préteur étoit obligé d’énoncer le
crime & la punition ; par exemple, videtur yitn f e ciffe
, atque eo no mine aqutz & ig n i, tlli interdico. On
appelloit aufli condamnation ce qu’on faifoit payer au
coupable. Voyez l’article fuivant. La condamnation
des édifices, condemnatio àdium, confiftoit à détruire
la maifon du coupable, après lui avoir ôté lu vie.
C o n d am n a t io n , ( Jurifprud.) eft un jugement
qui condamne quelqu’un à faire, donner, ou payer
quelque chofe, ou qui le déclare déchu de les prétentions.
Paffer condamnation, c’eft fe délifter de fa .demande.
Subir f a condamnation, fignifie être condamné, quelquefois
c’eft acquiefcer au jugement, quelquefois
c’eft fubir la peine portée par le jugement ; c’eft en
ce dernier fens qu’on l’entend ordinairement en matière
criiuine.He.
On entend quelquefois aufti par le terme t e condamnations
, les chofes même auxquelles la partie eft
condamnée, telles qu’une fomme d’argent, les intérêts
& frais. C’eft en ce fens que l’on dit, offrir &
payer le montant des condamnations y acquitter les condamnations.
C ’eft un axiome commun, qu’on ne condamne
perfonne fans l’entendre, c’eft-à-dire fans l’avoir entendu,
ou du-moins fans l’avoir mis en demeure de
yenir fe défendre ; car en matière civile on dpnne
défaut contre les défaillant, & en matière criminelle
il y a des défauts & jugemens par contumace contre
çeux qui ne fe préièntent pasj on peut meme condamner
un accule .abfent à une peiiie capitale s’il y
a lieu, en quoi notre ufage eft différent de celui des
Romains, dont les lois defendoient expreffément de
condamner les abfens accufés de crime capital. L . 1.
çod. de requir. reis. L i . f f eod. I. 6. c. de accuf. & l. 5.
f f depoenis. Ce qui étoit autrefois obfervé en France
comme il paroît par les capitulaires de Charlemagne,
lib. VIH. cap. 202. & 3 64• mais depuis l’u-
fage a changé. W Ê Ê Ê Ê k . .
Toute condamnation eft donc precedee d une înl-
truâion, & l’on ne doit prononcer aucune condamnation
même contre un défaillant ou contumace,
qu’il n’y ait des preuves fuffifantes contre lui ; & dans
le doute en matière criminelle, il vaut mieux abfou-
dre un coupable que de condamner tin homme qui
peut être innocent.
On prononce néanmoins quelquefois en Angleterre
une condamnation fans formalité & fans preu-
y e juridique ; mais cela ne fe fait qu’en parlement,
& pour crime de haute trahifon » que nous appelions
ici de left-majefié : il faut même que le cas foit préfixant,
& qu’il y ait des confidérations importantes
pour en ufer ainfi ; car ç ’eft l’exercice le plus redoutable
de l ’autorité fouveraine : par exemple , fi les
preuves juridiques manquent, quoiqu’il y ait d’ailleurs
des preuves moralement certaines ; ou bien
^orfque l’on veut éviter un conflit entre les deux
chambres j oji fi l’on ne veut pas apprendre aupu-
blic ;ce,çtains^fe.cr§ts gd’état,. fyc. dans tous ces cas
fans, témoin^ QÜjs, fansintetrogatoire, on déclare cet
homme atteint (^convaincu du çrime : l’aéle qui contient
cette déclaration & condamnation, s’appelle un
atteinder. Voyez -lafécond^ fuite desrefex. pour la maifon
d'Hanovre ; à Lancaflre | i y 46.
Il n’y a.que les juges qui .puiffent prononcer une
condamnation proprement dite, car c’eft improprement
que l’on .dit,qu’un homme a été condamné par
les avo.cats qu’ifa con&ilté, les avocats.ne donnant
qu’un ayis par (lequel ils approuvent ouimprouvent
gp qui leur eft expofé; mais des arbitres choifis par
un compromis,peuvent condamner de .même.que des
juges ordinaires. ;
En Bretagne.& dans quelques autres provinces,'
les notaires fe fervent du terme de condamnation,
pour obliger, ceux qui contractent devant eux : après
la reconnoilfanceou promeffe de la partie, le notaire
ajoute .ces mots, dont nous I avons jugé & condamné ;
ce qui vient de ce qu’autrefois tous les a#es publics
étoient rédigés fous les yeux du juge par les notaires
qui faifoient en même tems les fondions de greffiers
; c’eft pourquoi les a#es paffés devant notaire
font encore intitulés du nom du juge ; les notaires
font même appelles juges chartulaires, & ont une ju-
xifdidion volontaire fur les contraftans ; ce qui a encore
pu leur donner lieu de fe fervir du terme condamner.
Tout juge qui a pouvoir de condamner quelqu’un y
a aufli le pouvoir de le décharger ou 'abfoudre de la
demande ou accufation formée contre lui.
On pré fume toujours que la condamnation eft jufi-
te, jufqu’à ce qu’elle foit anéantie par les voies de
droit , ôt par un juge fupérîeur.
Les condamnations portées par des jugemens rendus
à l’audience, font prononcées à haute voix aux
parties, ou à leurs avocats & ptocureurs. A l’égard
1 des affaires qui fe jugent à la chambre du confeil, il
faut diftinguer les affaires civiles & les affaires criminelles.
Dans les affaires civiles, autrefois on devoit prononcer
les jugemens aux parties auflitôt qu’ils étoient
mis au greffe, à peine de nullité, même fans attendre
ie jbur ordinaire des prononciations, fi l’une des parties
le requérôit ; cette formalité a été abrogée comme
inutile par l’ordonnance de / G Gy.
Dans les affaires criminelles on prononce le jugement
aux accufés qui font préfens, & les condamna-
tions à peine affli#ive doivent être exécutées le même
jour.
L’accufé doit tenir prifon jufqu’à ce qu’il ait payé
les condamnations pécuniaires, foit envers le Roi,
ou envers la partie civile.
Les condamnations font ordinairement perfonnel-
les ; cependant en matière de délits, les peres font ref-
ponfables civilement des faits de leurs enfans étant
en leur puiflance ; les maîtres, des faits de leurs do*
meftiques, en l’emploi dont ils les ont chargés.
Il y a même quelques exemples en matière criminelle,
que la peine a été étendue fur les enfans du
condamne, & fur toute fa poftérité, en les dégradant
de nobleffe ou autrement ; ce qui ne fe pratique
que dans des cas très-graves, comme pour crime
de lefe-majefté. Du tems de Louis XI. lorfquç
Jacques d’Armagnac duc de Nemours eut la tête
tranchée le 4 Août 1477aux halles, on mit de l’ordre
du roi les deux enfans du coupable fous l’échafaud
, afin que le fang de leur pere coulât fur
eux. # : '
Les condamnations à quelque peine qui emporte
mort naturelle ou civile, n’ont leur effet pour la
mort civile, que du jour qu’elles font exécutées réellement
fi l’accufé eft préfent; op s’il eft abfent , U
faut qu’elles foient exécutées par effigie s’il y a peine
de mort, ou par l’appofition d’un tableau feulement
fi c’eft quelqu’autre peine affliâive qui n’emporte
pas mort naturelle.
Mais les condamnations à mort naturelle ou civile
annullent le teftament du condamné , quoique antérieur
à fa condamnation ; parce que pour tefter valablement,
il faut que le teftateur-ait les droits de
cité au tems du décès.
Les lettres de grâce empêchent bien l’exécution
de la fentence, quant à la peine affliûive, mais jelles
.ne détruifent pas la condamnation ni la flétriffure qui
en réfulte ; il n’y a qu’un jugement portant abfolu-
tion , ou bien des lettres d’innocentation , qui effacent
entièrement la tache des condamnations.
Lorfque les condamnations font pour délit militaire
, & prononcées par le confeil de guerre , elles
n’emportent point de mort civile, ni de confiscation,
ni même d’infamie. V,oye%_ A rrêt , C ondamne ,
Ju g em en t , Sen t en c e ,.Peine.
C ondam nation consulaire , eft celle qui eft
portée par une.fentence des, confuls, & qui emporte
la.contrainte par corps. Voye£ C onsuls & C ontr
ain te par CORPS.
C o ndam nation co n t r a d ic to ir e , eft celle
qui eft prononcée contre un défendeur , qui a été
oiii par lui ou par fon avocat ou procureur, où en
matière criminelle contre un accufé préfent.
- C ondam nation par co n tum a ce , .eft celle
qui. eft prononcée contre un accufé abfent. Voye^
C o n tum a ce , )
C ondamnation par corps , eft celle qui emporte
la contrainte par corps , telles que celles qui
font prononcées en matière civile contre les fermiers
des biens de campagne, lorfqu’ils s’y font fournis par
leurs baux ; eh matière, de ftellionat, pour dépens
môntans à zoo livres & au-deflus, pour dettes entre
marchands, & en matière criminelle pour les intérêts
& réparations civiles. -
C o ndam nation f létrissante , eft celle qui
imprime quelque tache au condamné, quoiqu’elle ne
lui ôte pas la vie civile , & même qu’elle n’emporte
pas infamie, comme lorfqu’un homme eft admo-
nefté.
C o nd am natio n in famante , eft celle qui prive
le condamné de l’honneur qui fait une partie de
la yie civile ; toutes les condamnations à peine afflictive
font infamantes. Voÿe^ Infamie.
C ondam nation a d omnia citra mortem, c’eftlorf-
que quelqu’un eft condamné au foiiet, à être marqué
& aux galeres.
C o n d am na tio n p é cu n ia ir e , eft celle qui ordonne
de payer quelque fomme d’argent, comme
une amende , une aumône, des intérêts civils, des
dommages & intérêts , des réparations civiles ; ce
terme eft principalement ufité en matière criminelle
pour diftinguer ces fortes de condamnations de celles
qui tendent à peine affliûive.
C ondam nation À peine a f f l ic t iv e , voye^
Peine a f f l ic t iv e .
C o ndam nation solidaire , eft celle qui s’exécute
folidairement contre plufieurs condamnés ,
comme pour dette contraûée folidairement, ou pour
idépens en matière criminelle. ( A )
CONDAMNÉ, partie. ( Jurifprud. ) eft celui qui
a fubi fon jugement, foit en matière civile ou en
matière criminelle.
Le condamné à mort naturelle ou civile eft déchu
des effets civils aufli-tôt que fon jugement lui eft
prononcé, parce que cette prononciation eft le commencement
de l’exécution, & qu’à l’inftant.le condamné
eft remis entre les piains de l’exécuteur de la
Jiaute-juftice.
Tqjnt I I I ,
Mais's’il y a appel de la fentence, l’état du condamné
demeure en fufpens jiifqu’au jugement de l’appel
, & même jufqu’à ce que le jugement qui intervient
fur l’appel lui ait été prononcé.
Si le condamné meurt avant la prononciatiori du
jugement, il meurt integri Jla tu s.
Si par l’évenement de l’appel la fentence eft confirmée
, en ce cas la mort civile a un effet rétroaftif
au jour de la prononciation de la fentence.
Anciennement les condamnés à mort étoient privés
de tous les facremens ; mais depuis 1360 oh leur offre
le facrement de pénitence.
Ceux qui font exécutés à mort font ordinairement
privés des honneurs de la fépulture.
A l’égard de ceux qui font condamnés par contumace
à mort naturelle ou civile, ils n’encourent la
mort civile que du jour que le jugement eft exécuté
contr’eux par effigie , attendu que ne pouvant pas
leur prononcer le jugement cle contumace, il ne commence
à être exécuté que par l’appofition de leur effigie.
Voye[ ci-devant CONDAMNATION. ( A Y
CONDAPOLI, ( Géog. mod. ) ville; forte d’Afiet
dans la prefqu’île de l’Inde, en - deçà du Gange, an,
royaume de Goîconde.
CONDAVERA, (G é o g . mod.') ville d’Afie dans
la prefqu’île de l’Inde.-, au royaume de Canate, fur
la côte de Malabar.
CONDÉ, (G éo g . m o d .) petite ville très-forte de
France aux Pays-Bas dans le Hainaut, près du confluent
de la Haine & de I’Efcaut. L on g. 2 1 . iS . 3 3 J
la t. S o .% 6.65. .............. ' ' . \ ,
C ondé , ( Géog. mod. ) petite ville de France.en
Normandie , dans le Befîin fur le Nereau. L on g . / (T.
58. la t. 4 8 . S o .
CONDELVAI, (G é ô g .m o d .) ville forte d’Afie
dans les Indes dans l’Indoftan, au royaume de Dé-
can fur la riviere de Mangera, aux frontières du
royaume de Goîconde.
CONDENSATEUR, f. m. (P h y jîq . ) eft le nom'
que quelques auteurs donnent à. une, machine qui:
fert à condenfer de l ’air dans un efpace donné. On.
peut y faite tenir trois, quatre, cinq, & même dix:
fois autant d’air, qu’il en tient dans un pareil efpaca
hors de la machine. Voyez C ondensation.
Il y a différens moyens de, condenfer l’air : on en
peut voir plufieurs aux ar t. A rquebuse À v e n t ,
Fo n ta in e , & c. En général les moyens de condenfer
l’air font l’inverfe des moyens de le raréfier. Voulez
vous condenfer l’air dans un glpbe creux, faites-
y entrer de l’air avec un pifton,.& adaptez à l’ouverture
intérieure du trou fait au globe , une /oû-
pape qui permette à l’air d’entrer, & qui l’empêche
de fortir. C’eft ainfi qu’on condenfe l’air dans un
ballon, par exemple. On pourroit aufli par une opération
contraire à celle dont on fe fert pour raréfier
l’air dans le récipient de la machine pneumatique,
condenfer l’air dans ce même récipient ; c’eft ce qu’pn
verra avec un peu d’attention ; mais il faut pour cette
opération que le récipient foit bien lutté contre la
platine, & qu’il ait allez de force pour réfifter à la
preffion intérieure de l’air condenlé , très-capable
de le brilèr par fon effort. Voyez Ma chin e pneum
a t iq u e . ( O )
CONDENSATION, f.f. (P h y fq u e .) aftion par
laquelle un corps eft rendu plus denfe, plus comparée
pluslourd. Voy. D ensité & C ompression»
La condensation confifte à rapprocher les parties
d’un corps les unes des autres, & augmenter leur
conta#, au contraire de la raréfaâion qui les écarte
les unes des autres, diminue leur conta# , & par
conféquent leur cohéfion, & rend les corps plus légers
& plus mous. Voyez Ra r é f a c t io n .
Wolfius & quelques autres auteurs reftreignentl’u-
fage du mot condenfation à la feule a#ion du froid,ap-
NNnnn ij '