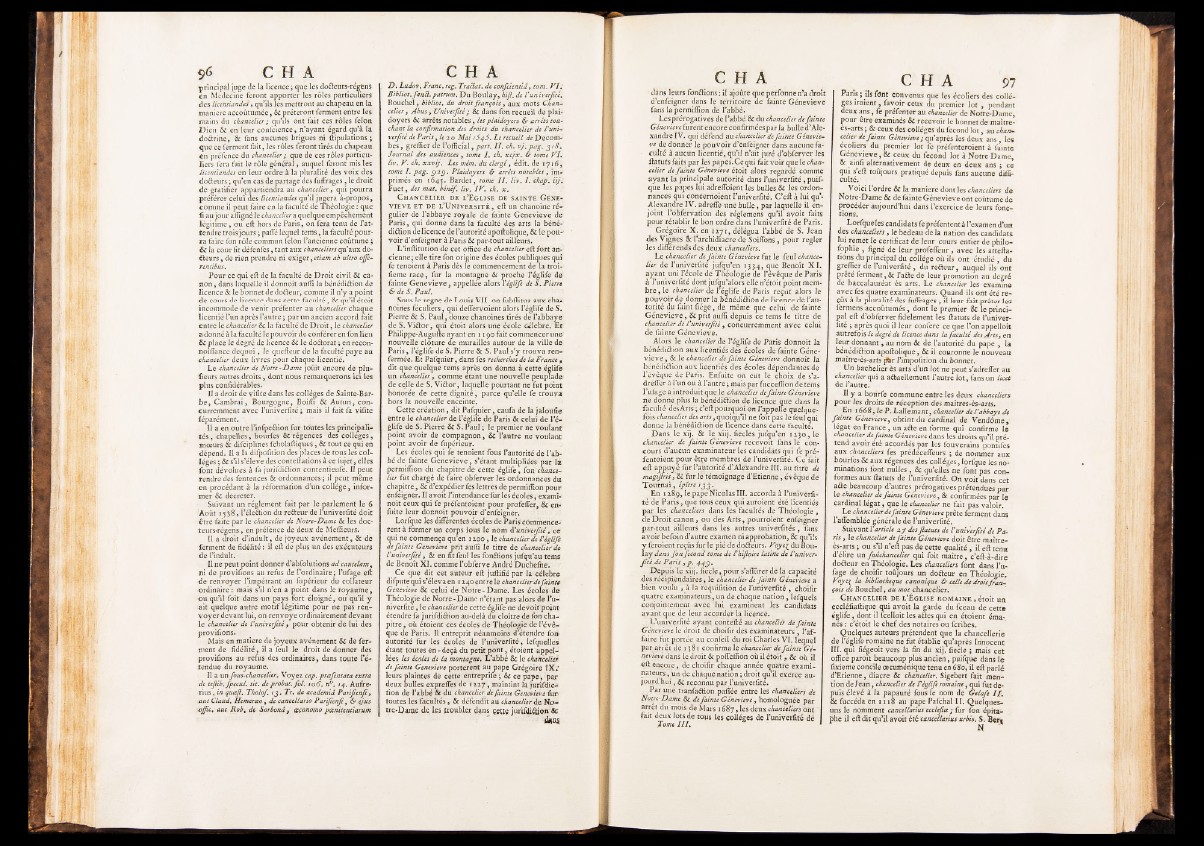
principal juge de ia licence; que les doâeurs-rég;éns
én Medecine feront apporter les rôles particuliers
des licentiandes, qu’ils les mettront au chapeau en la
maniéré aCcoûtUmée, 8c prêteront ferment entre les
mains du chancelier ; qu’ils ont fait ces rôles félon
Dieu 8c en leur confcience, n’ayant égard qu’à la
doârine, & fans aucunes brigues ni ftipulations ;
que ce ferment fait, les rôles feront tirés du chapeau
en préfence du chancelier ; que de ces rôles particuliers
fera fait le rôle général * auquel feront mis les
licentiandes en leur ordre à la pluralité des voix des
doâeurs ; qu’en cas de partage des fuffrages, le droit
de gratifier appartiendra au chancelier, qui pourra
préférer celui des licentiandes qu’il jugera à-propos,
comme il peut faire en la faculté de Théologie : que
li au jour alîigné le chancelier a quelque empêchement
légitime, pu eft hors de Paris, on fera tenu de l’attendre
trois jours ; paffé lequel tems, la faculté pourra
faire fon rôle commun félon l’ancienne coûtume ;
& la cour fit défenfes, tant aux chanceliers qu’aux doâeurs
, de rien prendre ni exiger, etiam ab uliro ojfe-
rentibuSé
Pour ce qui eft de la faculté de Droit civil 8c canon
, dans laquelle il donno.it aufli la bénédiâion de
licence & le bonnet de doâeur, comme il n’y a point
de cours de licence dans cette faculté, & qu’il étoit
incommode de venir préfenter au chancelier chaque
licentié l’un après l’autre ; par un ancien accord fait
entre le chancelier 8c la faculté de D roit, le chancelier
a donné à la faculté le pouvoir de conférer en fon lieu
& place le degré de licence 8c le.doâorat ; en recon-
noiffance dequoi, le quefteur de la faculté paye au
chancelier deux livres pour chaque licentié*
Le chancelier de Notre-Dame jouit encore de plu-
lieufs autres droits, dont nous remarquerons ici les
plus cônfidérables.
II a droit de vifite dans les collèges de Sainte-Barb
e , Cambrai, Bourgogne, Boiffi 8c Autun, concurremment
avec l’univerfité' ; mais il fait fa vifite
féparément.
Il a en outre l’infpeâion fur toutes les prinçipali-
tés , chapelles, bourfes 8c régences des collèges,
moeurs & difciplines fcholaftiques, & tout ce qui en
dépend. II a la difpofition des places de tous les collèges
; & s’il s’élève des conteftations à ce fiijet, elles
font dévolues à fa jurifdiâion contentieufe. Il peut
rendre des fentences & ordonnances ; il peut même
en procédant à la réformatiôn d’un collège, informer
8c décréter.
Suivant un réglement fait par le parlement le 6
'Août 1538, l’éleâion du reâeur de l’univerfité doit
être faite par le chancelier de Notre-Dame & les doc-
teurs-régens, en préfence de deux de Meilleurs.
Il a droit d’induit, de joyeux avènement, & de
ferment de fidélité : il eft de plus un des exécuteurs
de l’induit.
Il ne peut point donner d’abfolutions ad cautelam,
ni de provifions au refus de l’ordinaire; l’ufage eft
de renvoyer l’impétrant au fupérieur du collateur
ordinaire : mais s’il n’en a point dans le royaume,
ou qu’il fôit dans un pays fort éloigné, ou qu’il y
ait quelque autre motif légitime pour ne pas renvoyer
devant lui, on renvoyé ordinairement devant
le chancelier de Vuniverjitè , pour obtenir de lui des
provifions.
Mais en matière de joyeux avènement 8c de ferment
de fidélité, il a feul le droit de donner des
provifions au refus des ordinaires, dans toute l’étendue
du royaume.
Il a un fous-chancelier. Voyez cap. preefentata extra
de tefiib. fpecul. tic. de probat. fol. voG. n°. 14. Aufre-
rius, in quæfi. Tholof. 13. Tr. de academid Parijîenji,
aut Claud. Hemerao, de cancellario Parijîenji, & ejus
joffic, aut Rob, de S or bond, (gçonomo pçenitcntiarum
D . Ludov. Franc, reg. Traîlat. de cotifcuntid, tom. V il
Bibliot.fancl.patrum. Du Boulay, hijl. de l'univtrfiiè.
Bouchel, bibliot. du droit françois, aux mots Chancelier
3 Abus , Univerfitè ; 8c dans fon recueil de plaidoyers
8c arrêts notables, les plaidoyers & arrêts touchant
la confirmation des droits du chancelier de l'uni-
verfité de Paris, le z o Mai i5qS. Le recueil de Decomj
bes, greffier de l’official, part. I I . ch. vj. pag. 318.
Journal des audiences , tome I. ch. xcjx. & tome VI.
liv. V. ch. xxvij. Les mém. du clergé, édit, de 1716$
tome I. pag. ÿZÿ» Plaidoyers & arrêts notables , imprimés
en 1645. Lardet, tome I I . liv. I . chap. iijl
Fuet, des mat. bénéf. liv. IV. ch. x .
C hancelier de l’Eglise de sainte Genev
iè v e e t de l’Un iv e r s it é , eft un chanoine régulier
de l’abbaye royale de fainte Genevieve de
Paris, qui donne dans la faculté des arts la bénédiâion
de licence de l’autorité apoftolique, 8c le pou-'
voir d’enfeigner à Paris 8c par-tout ailleurs.
L ’inftitution de cet office de chancelier eft fort ancienne;
elle tire fon origine des écoles publiques qui
fe tenoient à Paris dès le commencement de la troi-
fieme race, fur la montagne 8c proche l’églife de
fainte Genevieve, appellée alors Y églife de S. Pierre
& de S . Paul.
Sous le régné de Louis VII. on fubftitua aux chanoines
féculiers, qui defferVoiént alors l’églife de S.
Pierre 8c S. Paul, douze chanoines tirés de l’abbaye
de S. V iâ o r , qui étoit alors une école célébré. Et
Philippe-Augufte ayant en 1190 fait commencer une
nouvelle clôture de murailles autour de la ville de
Paris, l’églife de S. Pierre & S. Paul s’y trouva renfermée.
Et Pafquier, dans fes recherches de la France 3.
dit que quelque tems après on donna à cette églife
un chancelier , comme étant Une nouvelle peuplade
de cejle de S. V iâ o r , laquelle pourtant ne fut point
honorée de cette dignité, parce qu’elle fe trouvât
hors la nouvelle enceinte.
Cette création, dit Pafquier, caufa de la jaloufie
entre le chancelier de l’églife de Paris 8e celui de l ’é-
glife de S. Pierre & S. Paul ; le premier ne Voulant
point avoir de compagnon, 8c l’autre ne voulant
point avoir de fupérieur.
Les écoles qui fe tenoient fous l’autorité de l ’abbé
de fainte Genevieve, s’étant multipliées par la
permiffion du chapitre de cette églife, (oix chancelier
fut chargé de faire obferver les ordonnances du
chapitre, 8c d’expédier fes lettres de permiffion pour*
enfeigner. Il avoit l’intendance fur les écoles ; exami-
noit ceux qui fe préfentoient pour profeffer, 8c en-
fuite leur donnoit pouvoir d’enfeignér.
Lorfque les différentes écoles de Paris Commencèrent
à former un corps fous le nom à?univerfitè, ce
qui ne commença qu’en 1 zo o , le chancelier deTéglife
de fainte Genevieve prit auffi le titre de chancelier do
l'univerjitè, 8e en fit feul les fondions jufqu’au tems
de Benoît X I. comme l’obferve André Duchefne.
Ce que dit cet auteur eft juftifié par la célébré
difpute qui s’éleva en 1240 entre le chancelier de fainte
Genevieve 8c celui de Notre-Dame. Les écoles de
Théologie de Notre - Dame n’étant pas alors de l ’u-’
niverfité, le chancelier de cette églife ne devOit'point
étendre fa jurifdiâion au-delà du cloître de fon chapitre
, oîi étoient ces écoles de Théologie de l’évêque
de Paris. Il entreprit néanmoins d’étendre fon>
autorité fur les écoles de l’univerfité, lefquelles
étant toutes en-deçà du petit pont, étoient'appel-
lées les écoles de la montagne. L’abbé 8c le chanctlièi-
de fainte Genevieve portèrent au pape Grégoire IX.'
leurs plaintes de cette entreprife ; 8c ce pape, par
deux bulles expreffes de 1227, maintint la :jürifdic~
tion de l’abbé 8e du chancelier de fainte Genevieve fur
toutes les facultés, 8e défendit au chancelier de No-»
tre-Darae de. les troubler dans çette jurifdi&on 8e
• dans leurs fondions : il ajoute que perfonne n’a droit
d’enfeigner dans le territoire de fainte Génevieve
fans la permiffion de l’abbé.
Les prérogatives de l’abbé 8c du chancelier de fainte
Génevieve furent encore confirmées par la bulle d’Alexandre
IV. qui défend au chancelier de fainte Génevieve
de donner le pouvoir d’énfeigner dans aucune fa-
• culte à aucun licentié, qu’il n’ait juré d’obferver les
ftatitts faits par les papés.Ce qui fait voir que le chancelier
de fainte Génevieve étoit alors regardé comme
ayant la principale autorité dans l’univerfité, puif-
que les papes lui àdreffoient les bulles 8c les ordonnances
qui concernoiént l’univerfité. C ’eft à lui qu-
Alexandre IV. adreffe line bulle, par laquelle il enjoint
l’obférvafion des réglemens qu’il avoit faits
pour rétablir le bon ordre dans l’univerfité de Paris.
Grégoire X . en 1271, délégua l’abbé de S. Jean
des Vignès 8e l’archidiacre de Soiffons, pour regler
les differèndS des deux chanceliers.
Lé chancelier de fainte Génevieve fut le feul chancelier
de l’univèrfité jüfqu’èn 1334, que Benoît X I .
ayant uni l’école de Théologie de i’evêque de Paris
à l’univerfité dont jûfqu’alors elle n’étoit point membre
, le chancelier de l’églife. de Paris reçut alors le
pouvoir de donner la benédiôion de licence de l’autorité
du faint fiége, de même que celui de fainte .
Génevieve, 8c prit àitffi depuis cè tems le titre de
chancelier de Vuniverjitè, concurremment avec celui
de fainte. Génevieve.
Alors le chancelier de l’églife de Paris donnoit la
bénédiâion aux lîcentiés des écoles de fainte Génevieve
, 8e le chancelier de fainte Génevieve -donnoit la
benédiâion aux licentiés des écoles dépendantes de
révêqué de Paris. Enfüitè ôn eut le choix de s’a-
dreffer à l’un ou à l’autre ; mais par fuccéffion de tems
l ’ufage a introduit que le chancelier de fainte Génevieve
ne donne plus la benédiâion de licence que dans la
faculté desArts ; c’èft pourquoi on l’appelle quelquefois
chancelier des arts, quoiqu’il ne foit pas le feul qui
donne la bénédiâion de licence dans cette faculté.
Dans le xij. 8c le xiij. fiecles jufqu’en 1230, le
chancelier de fainte Génevieve recevoit fans lè concours
d’aucun examinateur les candidats qui fè préfentoient
pour être membres_de l’univerfité. Ce fait
eft appuyé fur l’autorité d’Alexandre III. au ritr'e de
magiflris} 8c fur le”témoignage d’Etienne, évêque de
Tournai , èpître 133 .
En 1289, le pape Nicolas III. accorda à l’univèrfi-
té de Paris, que tous ceux qui auroiertt été liceritiés
par les chanceliers dans les facultés de Théologie ,
de D roit canon, ou des Arts, pourro'ient enfeigner
par-tout ailleurs dans les autres ünivérfités, fans
avoir befoin d’autre examen ni approbation, & qu’ils
y feroient reçus fur le pie de doâeurs. Voyt{ du Bou-
.lay dans fon fécond tome de Vhijloire latine de Vuniverfitè
de Paris , p. 449.
Depuis le xiij. fiecle, pour s’aflïirer de la capacité
des récipiendaires, le chancelier de fainte Génevieve a
bien voulu , à la recjuïfitiôn de l ’univeffite , choifir
quatre examinateurs, un de chaque nation, lefquels
conjointement avec lui examinent ies candidats
avant que de leur accorder la licence.
L’univerfité ayant contefté au chancelier dé fainte
Génevieve le droit de choifir des examinâteüfs , l’affaire
fut portée au confeil du roi .Charles VI.lequel
par arrêt ée 1381 confirma le chancelier de faint'e Génevieve
dans le droit 8t poîfeffion où il étoit a & où il
€ft encore, de choifir chaque année quatre examinateurs
, un de chaque nation ; droit qu’il exerce au-
jourd’hui, 8c reconnu par l’univerfité.
Par une tranfaâion.paîfée entre les chanceliers de
Notre-Dame & de fainte Génevieve, homologuée par
arrêt du mois de Mars 1687 > les deux chanceliers ont
fait deux lots de tous les collèges de l’unîvèrfîfé dé
Tome I I I ,
Paris ; ils fdrtt convenus que les écoliers des collèges
iroient, favoir ceux au premier lot , pendant
deux ans, fe préfenter au chancelier de Notre-Dame,
pour être examines & recevoir le bonnet de maître-
es-arts ; 8e ceux des colléges du fécond lo t, au chancelier
de fainte Génevieve; qu’après les deux ans , les
écoliers du premier lot fe préfenteroient à fainte
Genevieve, & ceux du fécond lot à Notre Dame,
8e ainfi alternativement de deux en deux ans ; ce
qui s’eft toujours pratiqué depuis fans aucune difficulté.;
Voici l ’ordre & la maniéré dont les chanceliers de
Notre-Dame 8c de fainte Génevieve ont coûtume de
procéder aujourd’hui dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorfqueles candidats fepréfententàl’examend’un
des chanceliers , le bedeau de la nation des candidats
lui remet le certificat de leur cours entier de philo-
fophiè , ligné de leur profeffeur, avec les attefta-
tions du principal du collége où ils ont étudié , du
greffier de l’univerfité , du reâeur, auquel ils ont
prêté ferment, 8e l’aâ e de leur promotion au degré
de baccalauréat ès arts. Le chancelier les examine
avec fes quatre examinateurs. Quand ils ont été reçus
à la pluralité des fuffrages , il leur fait prêter les
fer mens accoûtumés, dont le premier 8c le principal
eft d’obferver fidèlement les ftatuts de l’univer-
fite ; après quoi il leur conféré ce que l’on appelloit
autrefois le degré de licence dans la faculté des Arts, en
leur donnant, au nom 8c de l’autorité du pape , la
benédiâ'.on apoftolique, 8c il couronne le nouveau
maître-ès-arts jftr l’impofition du bonnet.
Un bachelier ès arts d’un lot ne peut s’adreffer au
chancelier qui a aâuellement l’autre lot, fans un licet
de l’autre.
Il y a botirfe commune entre les deux chanceliers
pour les droits de réception des maîtres-ès-arts.
En 1668, le P. Lallemant, chancelier de l'abbaye de
fainte Génevieve, obtint du cardinal de Vendôme%
légat en France, un a â e en forme qui confirme le
chancelier de fainte Génevieve dans les droits qu’ il prétend
avoir été accordés par les fouverains pontifes
aux chanceliers fes prédéceffeurs ; de nommer aux
bourfes 8c aux régences des collèges, lorfque les nominations
font nulles , 8c qu’elles ne font pas conformes
aux ftatuts de l’univerfité. On voit dans cet
aâ e beaucoup d’autres prérogatives prétendues par
le chancelier de fainte Génevieve, 8c confirmées par le
cardinal légat, que le chancelier ne fait pas valoir.
Le chancelier de fainte Génevieve prête ferment dans
l’affemblée générale de l ’univerfité.
^ Suivant Y article z y des Jiatuts de Vuniverfitè de Paris
, le chancelier de fainte Génevieve doit être maître-
ès-arts ; ou s’il n’eft pas de cette qualité, il eft tenu
d’élire un fouchancelier qui foit maître, c’eft-à-dirè
doâeur en Théologie. Les chanceliers font dans l’u-
fage de choifir toujours un doâeur en Théologie.'
Voye{ la bibliothèque canonique & celle de droit français
de Bouchel, au mot chancelier.
C hancelier de l’Église r om a in e , étoit un
eccléfiaftique qui avoit la garde du fceau de cette
églife, dont il lcelloit les aâes qui en étoient émanés
: c’étoit le chef des notaires ou feribes.
Quelques auteurs prétendent que la chancellerie
de l’églife romaine ne fut établie qu’après Innocent
III. qui fiégeoit vers la fin du xij. fiecle ; mais cet
office paroit beaucoup plus ancien, puifque dans le
fixieme concile oecuménique tenu en 680, il eft parlé
d’Ëtienne, diacre 8c chancelier. Sigebert fait mention
de Jeatî, chancelier de Véglife romaine, qui fut depuis
élevé à la papauté fous le nom de Gelafe I I .
8c fuccéda en 1118 au pape Pafchal II. Quelques-
uns le nomment cancellarius ecclejice ; fur fon épita-
phe il eft dit qu’il avoit été cancellarius urbis. S. Ber«
N