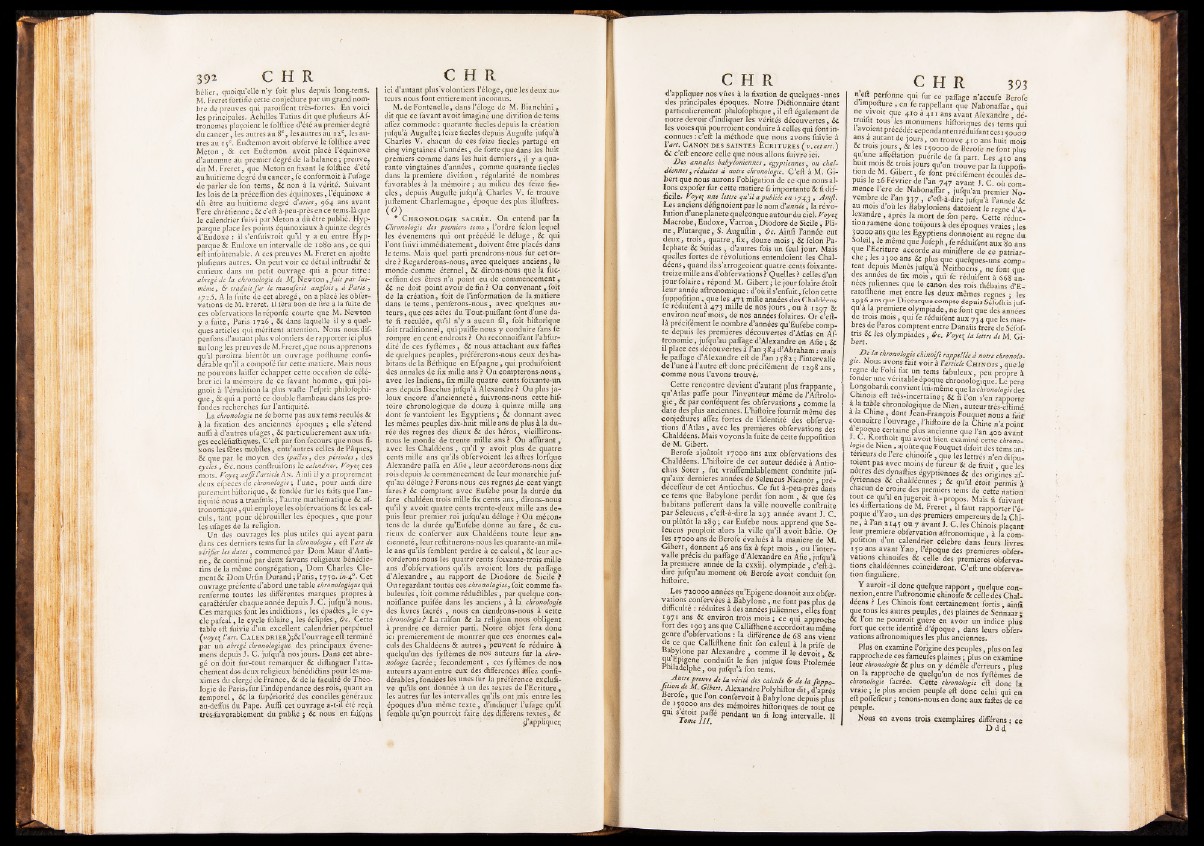
bélier, quoiqu’elle n’y (bit plus depuis long-tems,
M. Freret fortifie cette conjecture par un grand nombre
de preuves qui parodient très-fortes» En voici
les principales. Achilles Tatius cfit que plufieurs Af-
tronomes plaçoient le folftice d’été au premier degre
du cancer, les autres au 8e, les autres au 12e, les autres
au 15e. Euûemon avoit obfervé le folftice avec
Meton , & cet Euûemon avoit placé l’équinoxe
d’automne au premier degré de la balance ; preuve,
dit M. Freret, que Meton en fixant le folftice d’été
au huitième degré du cancer, fe conformoit à l’ufage
de parler de fon teins, ôc non à la vérité. Suivant
les lois de la préceflion des équinoxes, l’équinoxe a
dû être au huitième degré aaries, 964 ans avant
l ’ere chrétienne ; & c’eft à-peu-pres en ce tems-la que
le calendrier fuivi par Meton a dû être publié. Hyp-
parquë place les points équinoxiaux à quinze degrés
d’Eudoxe : il s’enfuivroit qu’il y a eu entre Hyp-
parque & Eudoxe un intervalle de 1080 ans, ce qui
eft infoûtenable. A ces preuves M. Freret en ajoùte
plufieurs autres. On peut voir ce détail inftruâif &
curieux dans un petit ouvrage qui a pour titre:
abrégé de la chronologie de M. Newton y fait par lui-
même , 6* traduit fur le manufcrit anglois, à Paris ,
A la fuite de cet abrégé, on a placé les obfervations
de M. Freret. 11 fera bon de lire à la fuite de
ces obfervations laréponfe courte que M. Newton
y a faite, Paris 1 7 2 6 , 6c dans laquelle il y a quelques
articles qui méritent attention. Nous nous dif-
penfons d’autant plus volontiers de rapporter ici plus
au long les preuves de M.Freret,que nous apprenons
qu’il paraîtra bientôt un ouvrage pofthuine confi-
dérable qu’il a compofé fur cette matière. Mais nous
ne pouvons laiffer échapper cette occafion de célébrer
ici la mémoire de ce favant homme, qui joi-
gnoit à l’érudition la plus vafte l’efprit philosophique
, 8c qui a porté ce double flambeau dans fes profondes
recherches fur l’antiquité.
La chronologie ne fe borne pas aux tems reculés &
à la fixation des anciennes époques ; elle s’étend
aufli à d’autres ufages, 6c particulièrement aux ufa-
ges eccléfiaftiques. C ’eft par fon fecours que nous fixons
les fêtes mobiles, entr’autres celles de Pâques,
6c que par le moyen des épacles> des périodes, des
cycles y &c. nous conftruifons le calendrier. F>ye^ ces
mots. Voye{ au (Ji C article An. Ainfi il y a proprement
deux efpeces de chronologie ; l’une, pour ainfi dire
purement hiftorique, 8c fondée fur les faits que l’antiquité
nous a tranfmis ; l’autre mathématique 6c af-
tronomique ,qui employé les obfervations 6c les calculs
, tant pour débrouiller les époques, que pour
les ufages de la religion.
Un des ouvrages les plus utiles qui ayent paru
dans ces derniers tems fur la chronologie , eft ¥ art de
vérifier les dates , commencé par Dom Maur d’Anti-
n e , 6c continué par deux favans religieux bénédictins
de la même congrégation, Dom Charles Clément
6c Dom Urfin Durand ; Paris, 1750. in-40. Cet
ouvrage préfente d’abord une table chronologique qui
renferme toutes les différentes marques propres à
çaraâérifer chaque année depuis J. C . jufqu’à nous.
Ces marques font les indi&ions , les épa&es , le cycle
p afcal, le cycle folaire, les éclipfes, &c. Cette
table eft fuivie d’un excellent calendrier perpétuel
(voye{ l ’art. C alendrier) ;8cl’ouvrage eft terminé
par un abrégé chronologique des principaux évene-
mens depuis J. C. jufqu’à nos jours. Dans cet abrégé
on doit fur-tout remarquer 6c diftinguer rattachement
des deux religieux bénédiftins pour lés maximes
du clergé de France, & delà faculté de Théologie
de Paris, fur l’indépendance des rois, quant au
temporel, 6c la fupériorité des conciles généraux
au-deffus du Pape. Aufli cet ouvrage a-t-il été reçû
trèfcfavorablement du public ; 8c nous en faifons
ici d’autant plus'volontiers l’éloge, que les deux au«
teurs nous font entièrement inconnus.
M. de Fontenelle, dans l’éloge de M. Bianchini ,
dit que ce favant avoit imaginé une divifion de tems
affez commode : quarante fiecles depuis la création
jufqu’à Augufte ; feize fiecles depuis Augufte jufqu’à
Charles V . chacun de ces feize fiecles partagé en
cinq vingtaines d’années, de forte que dans les huit
premiers comme dans les huit derniers, il y a quarante
vingtaines d’années, comme quarante fiecles
dans la première divifion, régularité de nombres
favorables à la mémoire ; au milieu des feize fiecles
, depuis Augufte jufqu’à Charles V . fe trouve
juftement Charlemagne, époque des plus illuftres.
Chronologie des premiers tems, l’ordre félon lequel
les évenemens qui ont précédé le déluge , 6c qui
l’ont fuivi immédiatement, doivent être placés dans
le tems. Mais quel parti prendrons-nous fur cet ordre
? Regarderons-nous, avec quelques anciens, le
monde comme éternel, 6c dirons-nous que la fuc-
ceflron des êtres n’a point eu de commencement,
6c ne doit point avoir de fin ? Ou convenant, foit
de la création, foit de l’information de la mâtiere
dans le tems , penferons-nous, avec quelques auteurs
, que ces attes du Tout-puiffant font d’une date
fi reculée, qu’il n’y a aucun fil, foit hiftorique
foit traditionnel, qui puiffe nous y conduire fans fe
rompre en cent endroits ? Ou reconnoiffant l’abfur-
dité de ces fyftèmes , 6c nous attachant aux faites
de quelques peuples, préférerons-nous ceux desha-
bitans de la B éthique en Efpagne, qui produifoient
des annales de fix mille ans ? Ou compterons-nous,
avec les Indiens, fix mille quatre cents foixante-un,
ans depuis Bacchus jufqu’à Alexandre ? Ou plus jaloux
encore d’ancienneté, fuivrpns-nous cette hif-
toire chronologique de douze à quinze mille ans
dont fe vantoient les Egyptiens ; 8c donnant avec
les mêmes peuples dix-huit mille ans de plus à la du-,
rée des régnés des dieux 6c des héros, vieillirons-
nous le monde de trente mille ans? Ou affûrant
avec les ChaldéenS , qü’il ÿ aVoit plus de quatre
cents mille ans’ qu’ils obferVoient les aftres lorfque
Alexandre paffa en Afie, leur accorderons-nous dix
rois depuis le commencement de leur monarchie juf-
qu’au déluge ? Ferons-nous ces régnés 4e cent vingt
fares ? 8c comptant avec Eufebe pour la durée du
fare chaldéen trois mille fix cents ans, dirons-nous
qu’il y avoit quatre cents trente-deux mille ans de-,
puis leur premier roi jufqu’au déluge ? Ou mécon-
tens de la durée qu’Eufebe donne au fare, 6c curieux
de conferver aux Chaldéens toute leur ancienneté
, leur reftituerpns-nous les quarante-un mille
ans qu’ils femblent perdre à ce calcul, 8c leur accorderons
nous les quatre-'cents foixante-trois mille
ans d’obfervations qu’ils avoient lors du paffage
d’Alexandre, au rapport de Diodore de Sicile ?
Ou regardant toutes ces chronologiesy foit comme fa-,
buleufes, foit comme rédu&ibles, par quelque con-t
noiffance puifée dans les anciens , à la chronologie
des livres facrés , nous en tiendrons-nous à cette
chronologie? La raifon 8c la religion nous obligent
à prendre ce dernier parti. Notre objet fera donu
ici premièrement de montrer que ces énormes calculs
des Chaldéens 8c autres, peuvent fe réduire à
quelqu’un des fyftèmes de nos auteurs fur la chronologie
facrée ; fecondement , ces fyftèmes de nos
auteurs ayant entre eux des différences affez confi-
dérables, fondées les unes fur la préférence exclufi-
v e qu’ils ont donnée à un des textes de l’Ecriture,
les autres fur les intervalles qu’ils, ont mis entre les
époques d’un même texte, d’indiquer l’ufage qu’il
I fenible qu’çn pourrait faire des différens textes, 6c V " * ^’appliquer
d’appliquer nos vûes à la fixation de quelques-unes
des principales époques. Notre Diéhonnaire étant
particulièrement philofophique, il eft également de
notre devoir d’indiquer les vérités découvertes, 6c
les voies qui pourraient conduire à celles qui font inconnues
: c ’eft la méthode que nous avons fuivie à
Vare. C ànon des saintes É critures (v . cet art.)
6c c’eft encore celle que nous allons fuivre ici.
Des annales babyloniennes, égyptiennes, ou chab-
déennes, réduites à notre chronologie. C ’eft à M. Gi-
bert que nous aurons l’obligation de ce que nous allons
expofer fur cette matière fi importante & fi difficile.
Voye{ une lettre qu'il a publiée en ij4 $ , Amfi.
Les anciens défignoient par le nom Üannée, la révolution
d’une planete quelconque autour du ciel. Voye%_
Macrobe, Eudoxe, Varron, Diodore de S icile, Plin
e , Plutarque, S. Auguftin , &c. Ainfi l’année eut
deux, trois, quatre, fix, douze mois ; 8c félon Pa-
lephate 6c Suidas , d’autres fois un feul jour. Mais
quelles fortes de révolutions entendoient les Chaldéens
, quand ils s ’arrogeoient quatre cents foixante-
treize mille ans d’obfervations ? Quelles ? celles d’un
jour-folaire, répond M. Gibert ; le jour folaire étoit
leur année aftronomique : d’où il s’enfuit, félon cette
fuppofition, que les 473 mille années des Chaldéens
fe réduifent à 473 mille de nos jours, ou à 1197 &
environ neuf mois, de nos années folaires. Or c’eft-
là précifément le nombre d’années qu’Eufebe compte
depuis les premières découvertes d’Atlas en Af-
tronomie, jufqu’au paffage d’Alexandre en Afie ; 8c
il place ces découvertes à l’an 384 d’Abraham : mais
le paffage d’Alexandre eft de l’an 1581; l’intervalle
de l’une à l’autre eft donc précifément de 1298 ans,
comme nous l’avons trouvé.
Cette rencontre devient d’autant plus frappante,
qu’Atlas paffe pour l’inventeur même de l’Aftrolo-
g ie , 6c par conféquent fes obfervations , comme la
date des plus anciennes. L ’hiftoire fournit même des
conjeûures affez fortes de l’identité des obfervations
d’Atlas, avec les premières obfervations des
Chaldéens. Mais voyons la fuite de cette fuppofition
de M, Gibert.
Berofe ajoûtoit 17000 ans aux obfervations des
Chaldéens. L’hiftoire de cet auteur dédiée à Antio-
chus Soter , fiit vraiffemblablement conduite juf-
qu’aux dernieres années de Seleucus Nicanor, pré-
déceffeur de cet Antiochus. Ce fut à-peu-près dans
ce tems que Babylone perdit fon nom , & que fes
habitans pafferent dans la ville nouvelle conftruite
par Seleucus, c’eft-à-dire la 193 année avant J. C.
ou plûtôt la 289 ; car Eufebe nous apprend que Seleucus
peuploit alors la ville qu’il avoit bâtie. Or
les 17000 ans de Berofe évalués à la maniéré de M.
Gibert, donnent 46 ans fix à fept mois , ou l’intervalle
précis du paffage d’Alexandre en Afie, jufqu’à
la première année de la cxxiij. olympiade , c’eft-à-
dire jufqu’au moment où Berofe avoit conduit fon
hiftoire.
Les 720000 années qu’Epigene donnoit aux obfervations
confervées à Babylone , ne font pas plus de
difficulté : réduites à des années juliennes, elles font
1971 ans 6c environ trois mois ; ce qui approche
fort des 1903 ans que Callifthene accordoitaumême
genre d’obfervations : la différence de 68 ans vient
de ce que Callifthene finit fon calcul à la prife de
Babylone par Alexandre , comme il le devoit 8c
qu’Epigene conduifit le lien jufque fous Ptolemée
rniladelphe, ou jufqu’à fon tems.
Autre preuve de la vérité des calculs & de la fuppo-
Jitiondt M. Gibert. Alexandre Polyhiftor dit, d’après
Jieroie, que l’on confervoit à Babylone depuis plus
de 150000 ans des mémoires hilloriques de tout ce
qur s étoit paiïé pendant un fi long intervalle. Il
n eft perfonne qui fur ce paffage n’accufe Berofe
d împofture, en fe rappellant que Nabonaffar, qui
ne yivort que 410 3-411 ans avant Alexandre , dé-
truifit tous les monumens hiftoriques des tems qui
1 avoient précédé; cependantenréduifanteesi 50000
ans à autant de jours, on trouve 410 ans huit mois
& trois jours, & les 150000 de Berofe ne font plus
qu une affeâation puérile de fa part. Les 410 ans
huit mois & trois jours qu’on trouve par la fuppofition
de M. Gibert, fe font précifément écoulés depuis
le 26 Février de l’an 747 avant J. G. oli commence
1 ere de Nabonaffar , jufqu’au premier Novembre
de 1 an 337 , c’eft-à-dire jufqu’à l’année &
au mois d ou les Babyloniens datoient le régné d’A lexandre
, après la mort de fon pere. Cette réduction
ramene donc toûjours à des époques vraies ; le»
30000 ans que les Egyptiens donnoient au régné* du
boleil le meme que Jofeph, fe réduifent aux 80 ans
que 1 Ecriture accorde au miniftere de ce patriarche
; les 1300 ans 6c plus que quelques-uns comptent
depuis Menés jufqu’à Neithocris, ne font que
des années de fix mois , qui fe réduifent à 668 années
juliennes que le canon des rois thébains d’E-
ratoftherie met entre les deux mêmes régnés ; les
2936 ans que Dicearque compte depuis Séfoftris juf-
qu à la première olympiade, ne font que des années
de trois mois, qui fe réduifent aux 734 que les marbres
de Paras comptent entre Danaüs frere de Séfof-
tris ôc lés olympiades, &c. Foyer la lettre de M Gibert.
D e là chronologie chinoife rappellée à notre chronologie.
Nous avons fait voir à l'article C hin ois que le
régné de Fohi fut un tems fabuleux, peu propre à
fonder une véritable époque chronologique. L e pere
Longobardi convient lui-même que la 'chronologie des
Chinois eft très-incertaine ; 8c fi l’on s’en rapporte
à la table chronologique de N ien, auteur très-eftimé.
a la Chine , dont Jean-François Fouquet nous a fair
connoitre 1 ouvrage, l ’hiftoire de la Chine n’a point
t éJ?°$Ue c®rtaine. plus ancienne que l’an 400 avant
m . , ?5. ^ fcPy av° it bien examiné czxxz chronologie
de Nien , ajoute que Fouquet difoit des tems an-
teneurs de l’ere chinoife, que les lettrés n’en difpu-
; toient pas avec moins de fureur ôc de fruit I que les
nôtres des dynaffies égyptiennes 8c des origines af-
lynennes 8c chaldéennes ; 8c qu’il étoit permis à
chacun de croire des premiers tems de cette nation-
tout w qu’il en jugerait à-propos» Mais fi fuivant
les differtations de M. Freret, il faut rapporter l’époque
d’Y a o , un des premiers empereurs de la Chin
e, à 1 an 2145 ou 7 avant J. C. les Chinois plaçant
leur première obfervation aftronomique, à la com-
pofition d’un calendrier, célébré dans leurs livres
150 ans avant Y a o , l’époque des premières obfer-
yations chinoifes 8c celle des premières obfervations
chaldéennes coïncideront. C ’eft une obfervation
finguliere.
Y aurait-il donc quelque rapport, quelque connexion,
entre l’aftronomie chinoife 8c celle des Chaldéens
? Les Chinois font certainement fortis, ainfi
que tous les autres peuples, des plaines de Sennaar;
6c l’on ne pourroit guere en avoir un indice plus
fort que cette identité d’époque , dans leurs obfervations
aftronomiques les plus anciennes.
Plus on examine Porigine des peuples, plus on les
rapproche de ces fameufes plaines ; plus on examine
leur chronologie 8c plus on y démêle d’erreurs , plus
on la rapproche de quelqu’un de nos fyftèmes de
chronologie facrée. Cette chronologie eft donc la
vraie ; le plus ancien peuple eft donc celui qui en
eft poffeffeur ; tenons-nous en donc aux faftes de ce
peuple.
Nous en avons trois exemplaires différens : ce
Ddd