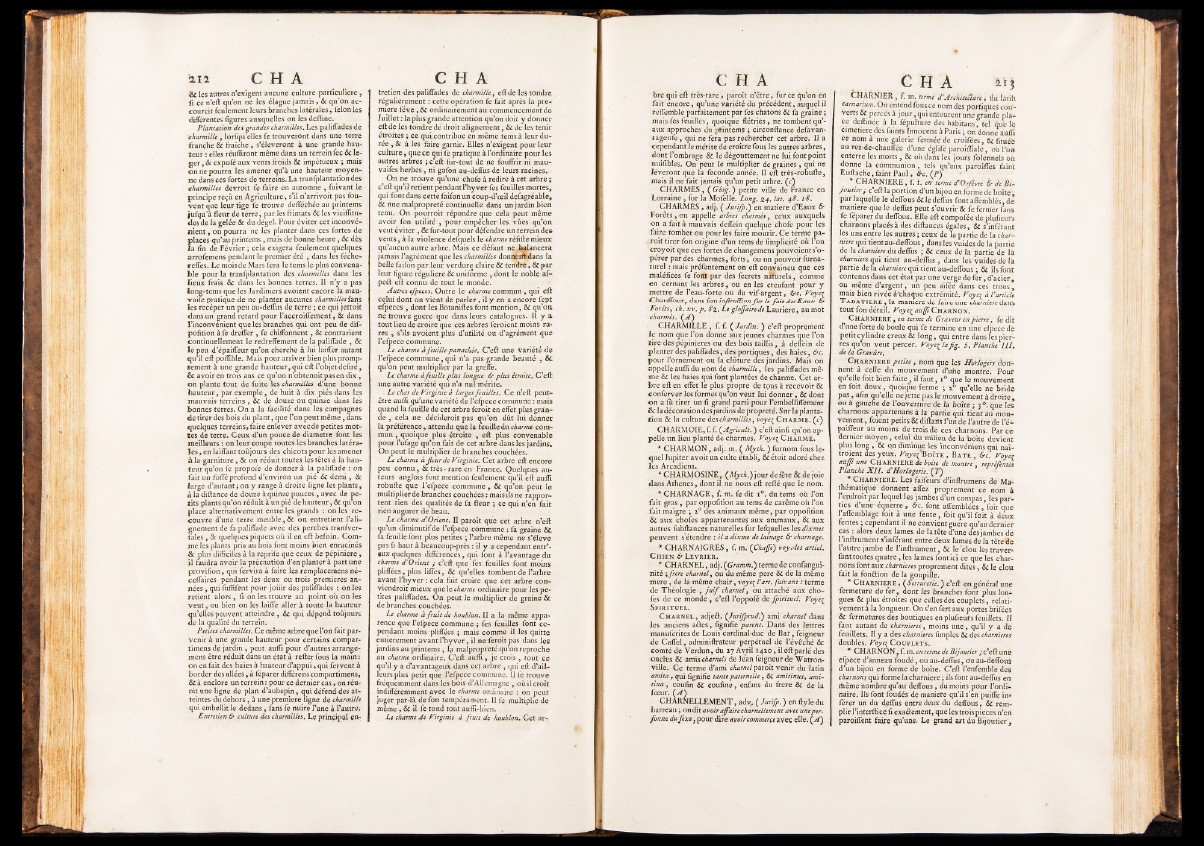
& les autres n’exigent aucune culture particulière-,
ü ce n’eft qu’on ne les élague jamais, & qu’on ac-
courcit feulement leurs branches latérales, félon les
différentes figures auxquelles on les deftine.
Plantation des grandes charmilles. Les paliffades de
charmille , lorfqu’elles fe trouveront dans une terre
franche & fraîche , s’élèveront à une grande hauteur
: elles réufliront même dans un terrein fec 8c léger
, & expofé aux vents froids & impétueux ; mais
on ne pourra les amener qu’à une hauteur moyenne
dans ces fortes de terreins. La tranfplantation des
charmilles devroit fe faire en automne , fuivant le
principe reçu en Agriculture, s’il n’arrivoit pas fou-
vent que leur tige fe trouve defféchée au printems
|ufqu’à fleur de terre, par les frimats 8c les yiciflitu-
desde la gelée & du dégel. Pour éviter cet inconvénient
, on pourra ne les planter dans ces fortes de
places qu’au printems, mais de bonne heure, 8c dès
la fin de Février ; cela exigera feulement quelques
arrofemens pendant le premier été j dans les féche-
reffes. Le mois de Mars fera le tems le plus convenable
pour la tranfplantation des charmilles dans les
lieux frais 8c dans les bonnes terres. Il n’y a pas
long-tems que les Jardiniers avoient encore la mauvaise
pratique de ne planter aucunes charmilles fans
les recéper un peu au-deffus de terre ; ce qui jettoit
dans un prand retard pour l’accroiffement, & dans
ï ’inconvenient que les branches qui ont peu de dif-
pofition à fe dreffer , fe chiffonnent, & contrarient
continuellement le redreffement de la paliffade , &
le peu d’épaiffeur qu’on cherche à lui laiffer autant
qu’il eft poflible. Mais pour arriver bien plus promptement
à une grande hauteur, qui eft l’objet déliré,
& avoir en trois ans ce qu’on n’obtenoitpasen d ix,
on plante tout de fuite les charmilles d’une bonne
hauteur, par exemple, de huit à dix pies dans les
mauvais terreins , & de douze ou quinze dans les
bonnes terres. On a la facilité dans les campagnes
de tirer des bois du plant, que l’on peut même, dans
quelques terreins, faire enlever avec de petites mottes
de terre. Ceux d’un pouce de diamètre font les
meilleurs : on leur coupe toutes les branches latérales
, en laiffant toûjours des chicots pour les amener
à la garniture, & on réduit toutes les têtes à la hauteur
qu’on fe propofe de donner à la paliffade : on
fait un folTe profond d’environ un pié & demi, &
large d’autant ; on y range à droite ligne les plants,
à la diftance de douze à quinze pouces, avec de petits
plants qu’on réduit à un pié de hauteur, & qu’on
place alternativement entre les grands : on les recouvre
d’une terre meuble, 8c on entretient l’alignement
de fa paliffade avec des perches tranfver-
fales , & quelques piquets où il en eft befoin. Comme
les plants pris au bois font moins bien enracinés
& plus difficiles à la reprife que ceux de pépinière,
il faudra avoir la précaution d’en planter à part une
provifion, qui fervira à faire les remplaceraens né-
ceffaires pendant les deux ou trois premières années
, qui fuffifent pour jouir des paliffades : on les
retient alors , fi on les trouve au point où on les
v e u t , ou bien on les laiffe aller à toute la hauteur
qu’elles peuvent atteindre, 8c qui dépend toûjours
de la qualité du terrein.
Petites charmilles. Ce même arbre que l’on fait parvenir
à une grande hauteur pour certains compar-
timens de jardin, peut aufli pour d’autres arrange-
mens être réduit dans un état à refter fous la main :
on en fait des haies à hauteur d’appui, qui fervent à
border des allées, à féparer différens compartimens,
& à enclore un terrein : pour ce dernier cas, on réunit
une ligne de plan d’aubepin, qui défend des atteintes
du dehors, à une première ligne de charmille
qui embellit le dedans, fans fe nuire l’une à l’autre.
Entretien & culture des charmilles. Le principal entretien
des paliffades de charmille, eft de les tondre
régulièrement : cette opération fe fait après la première
féve , 8c ordinairement au commencement de
Juillet : la plus,grande attention qu’on doit y donner
eft de les tondre de* droit alignement, & de les tenir
étroites ; ce qui, contribue en même tems à leur durée
, & à les faire garnir. Elles n’exigent pour leur
culture, que ce qui fe pratique à l’ordinaire pour les
autres arbres ; c’eft fur-tout de ne fouffrir ni mau-
vaifes herbes, ni gafon au-deffus de leurs racines.
On ne trouve qu’une chofe à redire à cet arbre ;
c’eft qu’il retient pendant l’hyver les feuilles mortes,
qui font dans cette faifonun coup-d’oeil defagréable,
8c une malpropreté continuelle dans un jardin bien
tenu. On pourroit répondre que cela peut même
avoir fon utilité , pour empêcher les vues qu’on
veut éviter, 8c fur-tout pour défendre un terrein de»
vents, à la violence delquels le charme réfifte mieux
qu’aucun autre arbre. Mais ce défaut ne Jaalancera
jamais l’agrément que les charmilles donnéifèdans la
belle faifon par leur verdure claire & tendre, 8c par
leur figure régulière 8c uniforme , dont le noble af-
peCt eft connu de tout le monde.
Autres efpeces. Outre le charme commun , qui eft
celui dont on vient de parler, il y en a encore fept
efpeces , dont les Botaniftes font mention, 8c qu’on
ne trouve guere que dans leurs catalogues. Il y a
tout lieu de croire que ces arbres feroient moins rares
, s’ils avoient plus d’utilité ou d’agrément que
l’efpece commune.
Le charme à feuille panachée, C’eft une Variété de
l’efpece commune, qui n’a pas grande beauté , 8c
qu’on peut multiplier par la greffe.
Le charme à feuille plus longue & plus étroite. C ’eft
une autre variété qui n’a nul mérite.
Le char de Virginie à larges feuilles. Ce n’eft peut-
être aufli qu’une variété de l’efpece commune : mais
quand la feuille de cet arbre feroit en effet plus grande
, cela ne décideroit pas qu’on dût lui donner
la préférence, attendu que la feuille du charme commun
, quoique plus étroite , eft plus convenable
pour l’ufage qu’on fait de cet arbre dans les jardins.
On peut le multiplier de branches couchées.
Le charme à fleur de Virginie. Cet arbre eft encore
peu connu, & très - rare en France. Quelques auteurs
anglois font mention feulement qu’il eft aufli
robufte que l ’efpece commune, 8c qu’on peut le
multiplier de branches couchées : mais ils ne rapportent
rien des qualités de fa fleur ; ce qui n’en fait
rien augurer de beau.
Le charme d'Orient. Il paroît que cet arbre n’eft
qu’un diminutif de l’efpece commune : fa graine 8c
fa feuille font plus petites ; l’arbre même ne s’élève
pas fi haut à beaucoup-près : il y a cependant entr’-
eux quelques différences, qui font à l’avantage du
charme d'Orient ; c’eft que fes feuilles font moins
pliffées, plus liffes, 8c qu’elles tombent de l’arbre
avant l’hy ver : cela fait croire que cet arbre con-
viendroit mieux que le charme ordinaire pour les petites
paliffades. On peut le multiplier de graine &
de branches couchées.
Le charme à fruit de houblon. Il a la même apparence
que l’efpece commune. ; fes feuilles font cependant
moins pliffées ; mais comme il les quitte
entièrement avant l’hy v e r , il ne feroit pas dans les
jardins au printems , la malpropreté qu’on reproche
au charme ordinaire. C ’eft aufli, je crois , tout ce
qu’il y a d’avantageux dans cet arbre , qui eft d’ailleurs
plus petit que l’efpece commune. Il fe trouve
fréquemment dans les bois d’Allemagne , où il croît
indifféremment avec le charme ordinaire : on peut
juger par-là de fon tempérament. Il fe multiplie de
même , & il fe tond tout aufli-bien.
Le charme 4 e Virginie à fruit de houblon. Çet arbréqùi
eft très-rare, paroît n’être, force qu’on èrt
fait encore, qu’une variété du précédent, auquel il
reffemble parfaitement par fes chatons 8c fa graine ;
mais fes feuilles, quoique flétries , ne tombent qu’aux
approches du pfintems ; circonftance defavan-
tageufe, qui ne fera pas rechercher cet arbre. Il a
cependant le mérite de croître fous les autres arbres,
dont l’ombrage & le dégouttement ne lui font point
nuifibles. On peut le multiplier de graines , qui ne
lèveront que la fécondé année. Il eft très-robufte,
mais il ne fait jamais qu’un petit arbre, (c)
CHARMES , ( Géog. ) petite ville de France en
Lorraine , for la Mofelle. Long. 24. lat. 48. 18.
CHARMÉS, àdj. ( Jurifp.) en matière d’Eaux &
Forêts , On appelle arbres charmés, cetix auxquels
on a fait à mauvais deffein quelque chofe pour les
faire tomber ou pour les faire mourir. C e terme pa-
«roît tirer fon origine d’un tems de fimplicité où l’on
croyoit que ces lortes de changemefts pouvoient s’opérer
par des charmes, forts, ou un pouvoir furna-
lurel : mais préfentement on eft convaincu que ces
maléfices fe foiît par des fecréts naturels, comme
en cernant les arbres, ou en les creufant pour y
mettre de l’eau-forte.oû du vif-argent, &c. Voye£
Chauffour, dans fon injlrutüon fur le fait des Eaux &
Forêts^ ch. xv. p. 82. Le gloffairede Lauriere, au mot
charmés. (A )
CHARMILLE , f. f. ( Jardin. ) c’eft proprement
le nom que l’on donne aux jeunes charmes que l’on
ïire des pépinières ou des bois taillis, . à deffein de
planter des paliffades, des portiques, des haies, &c.
pour l’ornement ou la clôture des jardins. Mais on
appelle aufli du nom de charmille, les paliffades même
8c les haies qui font plantées de charme. Çet arbre
eft en effet le plus propre de tpus à recevoir 8c
conferver les formes qu’on veut lui donner, & dont
on a fû tirer un fi grand parti pour I’embelliffement
8c la décoration des jardins de propreté. Sur la plantation
& la culture dès charmilles, voye^ C haRME.(c)
CHARMOIE, f. f. (Agricult. ) c’eft ainfi qu’on appelle
un lieu planté de Charmes. Voye^ C harme.
* CHARMON, adj. m. ( Myth. ) furnom fous lequel
Jupiter avoitun culte établi, 8c étoit adoré chez
les Arcadiens.
* CHARMOSiNË, (Myth!) jour de fête & de joie
.dans Athènes, dont il ne nous eft refté que le nom.
* CH ARN AG E, f. m. fe dit i° . du tems où l’on
fait gras, par oppofition au tems de carême où l’on
fait maigre ; 20 des animaux même, par oppofition
& aux chofes appartenantes aux animaux, 8c aux
autres fubftances naturelles fur lefquelles lesdixmes
•peuvent s’étendre : il a dixme de lainage & charnage.
* CHARNAIGRES, f. m. ( Chaffe) voy.des articl.
C hien & Levrier.
* CHARNEL, adj. (Gramm.) terme de confangui-
nité yfrere charnel, ou du même pere & de la même
mere, de la même chair, voye{ Vart. fuivant : terme
de Théologie , ju i f charnel > ou attaché aux chofes
de ce monde , c’eft l’oppofé de fpirituel. Voyeç
Spirituel.
C harnel , adjeét. (Jutifprud.) ami charnel dans
les anciens aCtes,. lignifie parent. Dans des lettres
manuferites de Louis cardinal-duc de Bar, feigneur
de Caffel, adminiftrateur perpétuel de l’évêché &
comté de Verdun, du 17 Avril Î410 , il eft parlé des
oncles 8c amis charnels de Jean feigneur de Watron-
ville. Ce terme d’ami charnel paroît venir du latin
amita , qui fignifie tante paternelle , & amitinus, ami-
tina, coufin 8c coufine, enfans du frere 8c de la
foeùr. ( A )
CHARNELLEMENT, adv,. ( Jurifp. ) eft ftyle du
barreau ; on dit avoir affaire charnellement avec une per ~
fonne du f ix e , pour dire avoir commerce avec elle. (A )
CHARNIER, f. m. iermè d'Architcûüte, dii làtih
carnarium. On entend fous cé nom des portiqiies couverts
& percés à jour, qui entourent une grande plà-
cp deftinée à la fépulture des habitans, tel due 1$
cimetiere des faints Innocens à Paris ; on donne aufli
cè nom à une galerie fermée de croifées, 8c fituéfe
au rez-de-chaufl’eé d’une églife paroifliale, où l’oii
enterre les morts, 8c où daiis les jours folennels on
donne la communion, tels qu’aux paroifleS faiht
Euftache,fàint Paiil> &c. (P)
CHARNIERE, f. f. ert terme d'O rfévre 6* de Bi—
joutier ; c’eft la portion d’un bijou en forme de boîte i
par laquelle le deffous & le deffus font affemblés, de
manière que le deffus peut s’ouvrir & fe fermer fans
fe féparer du deffous. Elle eft compofée de plufièürs
charnons placés à des diftances égales, & s’ihféf ant
les uns entre les autres ; ceux de la partie de la charnière
qui tient au-deffouS, dans les vuidesde la partie
de la charnière du deffus ; & ceux de la partie de là
charnière qui tient au-deffus , dans les vuides de la
partie de la charnière qui tiént au-deffous ; & ils font
contenus dans cet état par une verge de fe r , d’acier,
ou même d’argent j un pfeu âifée dans ces trous,
mais biefi rivée à’Chaque extrémité. Voye{ à l'article
T a b a t iè r e , la maniéré de faire une charnière dan&
tout fon détail. Voyeç aufî C h a rbo n.
• C harnière , en terme de Graveur in pierre, fë dit
d’une forte de boule qui fe termine en une efpece dé
petit cylindre creux & long, qui entre dans les pierres
qu’on veut percer. Voye(lafig. S. Planche I l h
de la Gravure,
C harnière petite, honi que les Horlogers dofl-
hent à celle du mouvement d’uhe montre. Pouf
qu ellefoit bien faite^ il faut, i ô que le mouvement
en foit doux, quoique ferme ; x° qu’elle ne bride
pas, afin qu’elle ne jette pas le mouvement à droite ,
ou à gauche de l’ouverture de ïa boité ; que les
charnons appàrtenans à la partie qui tient aii mou-*
vement, foient petits 8C diftarts l’un de l’autre de l’é -
paiffeur au moins de trois de ces charnons. Par ce
dernier m oyen, celui dû milieu dé la boîte devient
plus long , 8c o.ii diminue les inconvéniens qui naî-
troient des yeux. Voye^B oîte , Bâ t e , &c. Voye{
aujji une C h aRNÎÈRÉ de bout de montre , représentée
Planche X I I . d!Horlogerie. (T)
* Charnière. Les faifeurs d’inftrumens dé Mathématique
donnent affez proprement ce nom à
l’endroit par lequel les jambes d’un compas, les parties
d’une-équerre , &c. font affemblées , foit que
l’affemblage foit à une fente, foit qu’il foit à deux
fentes ; cependant il ne convient guere qu’au dernier
cas : alors deux lames de la tête d’une des jambes dé
Finftrument s’inférant entre deux lames de la tête€e
l’autre jambe de l’inftrument, 8c le'clou lès traver-»
fant toutes quatre, les lames font ici ce que les char*
nons font aux charnières proprement dites ÿ & le clou
fait la fonction de la goupille.
* CHARNIERE, (Serrurerie. ) c’eft eft général unô
fermeture de fe r , dont les branches font plus longues
& plus étroites que celles des couplets, relativement
à la longueur. On s’en fert aux portes brifées
& fermetures des boutiques en plufieufs feuillets. Il
faut autant de charnières, moins une, qu’il y a de
feuillets. Il y a des charnières fimples 8c des charnières
doubles. Voye( C ouplet s.
* CHARNON, f. m. en terme de Bijoutier ; c’eft unô
efpece d’anneau foudé, ou au-deffus, Ou au-deffouS
d ’un bijou en forme de boîte. C ’eft l’enfemble des
tharnons, qui forme la charnière ; ils font au-deffus en
même nombre qu’au deffous, du moins pour l’ordinaire.
Ils font foudés de maniéré qu’il s’en puiffe in*
férer un du deffus entre deux du deffous, 8c remplir
l’interfticé fi exactement, que les trois pièces n’en
paroiffent faire qu’une. Le grand art du Bijoutier,