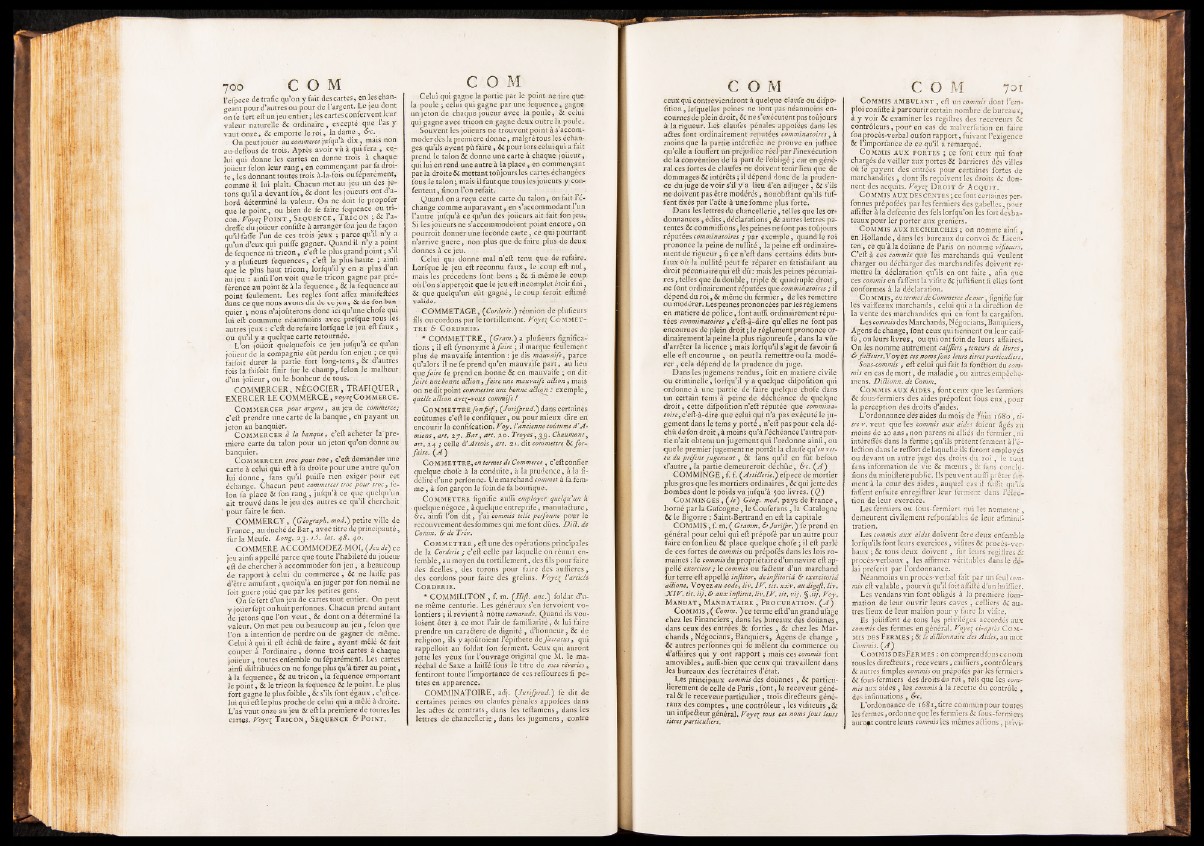
l’efpece de trafic qu’on y fait des cartes, en les changeant
pour d’autres ou pour de l ’argent. Le jeu dont
on fe fert eft un jeu entier ; les cartes confiervent leur
valeur naturelle Sc ordinaire, excepté que l’as y
vaut onze, & emporte le ro i, la dame , &c.
On peut jouer au co/wnerce jufqu’à d ix, mais non
au-deffous de trois. Après avoir vû à qui fera , ce,-',
lui qui donne les cartes en donne trois à chaque
joueur félon leur rang, en commençant par fa droit
e , les donnant toutes trois à-la-fois quféparement,
comme il lui plaît. Chacun met au jeu un des jetons
qu’il a devant foi, Sc dont les joueurs ont d a-
bord déterminé la valeur. On ne doit fe propofer
que le point, ou bien de fe faire fequence ou tri-
con. Foyei Point , Sequence, T ricon ; Sc l’a-
drefle du joueur confiée à arranger fon jeu de façon
qu’il faffe l’un de ces trois jeux ; parce qu’il n’y a
qu’un d’eux qui puiffe gagner. Quand il n’y a point
de fequence ni tricon, c’eft le plus grand point ; s il.
y a plufieurs fequences, c’eft la plus haute ; ainfi
que le plus haut tricon, lorfqu’il y en a plus d’un
au jeu : ainfi l’on voit que le tricon gagne par préférence
au point Sc à la fequence, Sc la fequence au
point feulement. Les réglés font affez manifeftées
dans ce que nous avons dit de ce jeu, & de fon banquier
; nous n’ajoûteions donc ici qu’une chofe qui
lui eft commune néanmoins avec prefque tous les
autres jeux : c’eft derefaire lorfque le jeu eft faux,
ou qu’il y a quelque carte retournée.
L ’on joiioit quelquefois ce jeu- jufqu’à ce qu’un
joiieur de la compagnie eût perdu fon enjeu.; ce qui i
faifoit durer la partie fort long*tems, & . d’autres
fois la faifoit finir fur le champ,, félon le malheur,
d’un joueur, ou le bonheur de tous. .: .
COMMERCER, NÉGOCIER, TRAFIQUER *
EXERCER LE COMMERCE, vo^ C ommerce.
COMMERCER pour argent, au jeu de commerce;
c’ eft prendre une carte de la banque, en payant un
jeton au banquier. '
C ommercer à la banque, c’eft acheter la'première
carte du talon pour un jeton qu’on donne au
banquier.
C ommercer trie pour troc, c’ eft demander une
carte à celui qui eft à fa droite pour une autre qu’on
lui donne, fans qu’il puiffe rien exiger pour cet
échange. Chacun peut commercer troc pour troc, félon
fa place & fon rang, jufqu’à ce que quelqu’un
ait trouvé dans le jeu des autres ce qu’il cherchoit
pour faire le fien.
COMMERCY, (Geograph. mod.') petite ville de
France, au duché de Bar, avec titre de principauté,
furlaMeufe. Long. 23 . ,/i. lat. 48. 40.
COMMERE ACCOMMODEZ-MOI, {Jeudi) ce
jeu ainfi appellé parce que toute l’habileté du joueur
eft de chercher à accommoder fon jeu, a beaucoup
de rapport à celui du commerce, & ne laiffe pas
d’être amufant, quoiqu’à en juger par fon nom il ne
foit guere joiié que par les petites gens.
On fe fert d’un jeu de cartes tout entier. On peut
y jouer fiept ou huit perfionnes. Chacun prend autant
de jetons que l’on veu t, Sc dont on a déterminé la*
valeur. On met peu ou beaucoup au jeu , félon que
l ’on a intention de perdre ou de gagner de même.
Celui à qui il eft échû de faire , ayant mêlé & fait
couper à l’ordinaire , donne trois cartes à chaque
joiieur , toutes enfemble ou féparément. Les cartes
ainfi diftribuées on ne fonge plus qu’à tirer au point,
à la fequence, & au tricon, la fequence emportant
le point, & le tricon la fequence Sc le point. Le plus
fort gagne le plus foible, Sc s’ils font égaux , c’eft celui
qui eft le plus proche de celui qui a mêlé à droite.
L’as vaut onze au jeu & eft la première de toutes les
cartes. Voyei Tricon, Sequence & Point.
Celui qui gagne la partie par le point ne tire que
la poule ; celui qui gagne par une fequence, gagne
un jeton de chaque joiieur avec la poule, & celui
qui gagne avec tricon en gagne deux outre la poule.
Souvent les joueurs ne trouvent point à s’accommoder
dès la première donne, malgré tous les échanges
qu’ils ayent pu faire, Sc pour lors celui qui a fait
prend le talon Sc donne une carte à chaque; joueur,
qui lui eni rend une autre à la p lace, en commençant
par la droite & mettant toûjours les caftes échangées
fous le talon; mais> il faut que tous les-.joueurs y con-,
fentent, finon l’on refait.
Quand on a reçu cette carte du talon,. on fait l’échange
comme auparavant, en s’accommodant l’un
l’autre jufqu’à ce qu’un des joueurs ait fait fon jeu..
Si les joueurs ne s’accommodoient point encore , on
pourroit donner une fécondé carte, ce qui pourtant
n’arrive guere, non plus que de .faire, plus de deux
donnes à ce jeu.
Celui qui donne mal n’eft tenu que de refaire.
Lorfque le jeu eft reconnu faux, le.coup eft. nul,
mais les précedens font bons ; ôt fLmêrôe le coup;
où l’on s’apperçoit que le jeu eft incomplet étoit fini,
& que quelqu’un eût gagné, le coup feroit eftimé
valide.
COMMETAGE, ([Corderie.) réunion de plufieu rs
fils Ou co rd on s p a r le tortillem en t. Voye^ C o m m e t t
r e & C o r d e r i e : -'
* COMMETTRE, (Gram.') a plufieurs lignifications
; il eft fynonÿme à faire ; il marque feulement
plus de mauvaife intention : je dis mauvaife, parce
qü’alors il ne fe prend qu’en mauvaife part, au lieu
que faire fe prend en bonne & en mauvaife ; on dit
faire une bonne action, faire une mauvaife action , mais
on nedit pointcommettre une bonne action : exemple,
quelle action ave^-vous commife !
C o m m e t t r e fon fie f, (Jurifprud.) dans certaines
coûtumes c’eft le confifquer, ou pour mieux dire en
encourir la confifcation. Voy. l'ancienne coutume d'A-
miens, art. i j . Bar, art. 20. Troyes Chaumont,
art. 24 ; celle à'Artois, art. 21. dit commettre Sc for-
faire. (.A )
C o m m e t t r e , en termes de Commerce , c’eftconfîer
quelque chofe à la conduite, à la prudence, à la fidélité
d’une perfonne. Un marchand commet à fa femme
, à fon garçon le foin de fa boutique.
COMMETTRE fignifie aufli employer quelqu'un à
• quelqu e n é g o c e , à qu elqu e en tre p rife , m an u fa c tu r e ,
&c. ainfi l’on d i t , j’ a i commis telle perfonne p o u r le
re co u v rem en t d e sfom m e s qu i m e fon t d û e s. D i ci. de
Comm. & de Trév.
C o m m e t t r e , eft une d e s op é ra tion s prin cip a le s
de la Corderie ; c ’eft ce lle p a r laq u e lle on réun it enfemble
, a u m oyen du tor tillem en t, d e s fils p o ur fa ire
des fic e lle s , d e s to ro n s p o u r fa ir e des a u flie r e s,
d e s cord ons p o u r fa ire d e s g re lin s. Voye^ l'article
C o r d e r i e .
* COMMILITON , f. m. (U fi. anc.) foldat d’une
même centurie. Les généraux s’en fervoient volontiers
; il revient à notre camarade. Quand ils vou-
loient ôter à ce mot l’air de familiarité, & lui faire
prendre un caraCtere de dignité , d’honneur, & de
religion, ils y ajoûtoient l’epithete de facratus, qui
rappelloit au foldat fon ferment. Ceux qui auront
jetté les yeux fur l’ouvrage original que M. le maréchal
de Saxe a laiffé fous le titre de mes rêveries,
fentiront toute l’importance de ces reffources fi petites
en apparence.
COMMINATOIRE, adj. (Jurifprud.) fe dit de
certaines peines ou claufes pénales appofées dans
les aCtes Sc contrats, dans les teftamens, dans les
lettres de chancellerie, dans les jugemens, contre
ceux qui contreviendront à quelque claufe du difpo-
fition, lefquelles peines ne lont pas néanmoins encourues
de plein droit, Sc ne s’exécutent pas toûjours
à la rigueur. Lefc claufes pénales appofées dans les
aCtes lont ordinairement réputées comminatoires, à
moins que la partie intéreflée ne prouve en juftice
qu’elle a fouffert un préjudice réel par l’inexécution
de la convention de' la part de l’obligé ; car en général
ces fortes de claufes ne doivent tenir lieu que de
dommages & intérêts ; il dépend donc de la prudence
du juge de voir s’il y a liëù d’en adjuger , Sc s’ils
ne doivent pas être modëfés , nonôbftant qu’ils fuf-
lent fixés par l’aCte à unefomme plus forte.
Dans les lettres de, chancellerie, telles que les or*
donnances , édits, déclarations, & autrès lettres patentes
& commilfions, lès peines ne font pas toûjours
réputées cdmminatoires ; par exemple, quand le roi
prononce la peiné de nullité, la peine eft ordinairement
de rigueur j fi ce n’eft dans certains édits bur-
iaux où la nullité péuf’fe réparer en fatisfaifant au
droit pécuniaire qui eft dû : mais les peines pécuniaires
, telles que du double, triple & quadruple droit,
ne font ordinairement réputées que comminatoires ; il
dépend du roi, & même du fermier, de les remettre
ou modérer. Les peines prononcées par les réglemens
en matière de police, font aufli ordinairement réputées
comminatoires , c’eft-à-dire qu’elles ne font pas
encourues de plein droit ; le réglement prononce ordinairement
la peine la plus rigoureufe, dans la vûe
d’arrêter la licence ; mais lorfqu’il s’agit de favoir fi
elle eft encourue , on peut la remettre ou la modérer
, cela dépend' de la prudence du juge.
Dans les jugëmens rendus, foit en matière civile
ou criminelle l'lorfqu’il y a quelque difpofition qui
ordonne à une partie; de faire quelque chofe dans
un certain temsrà peine de déchéance de quelque
droit, cette difpofition n’eft réputée que comminatoire,
c’eft-à-dire que celui qui n’a pas exécuté le jugement
dans le tems y porté, n’eft pas pour cela dé-
chû de fon d roit, à moins qu’à l’échéance l’autre partie
n’ait obtenu un jugement qui l’ordonne ainfi, ou
que le premier jugement ne portât la claufe qu’c« vertu
du préfent jugement, 8c fans qu’il en fût befoin
d’autre, la partie demeureroit dechûe, &c. ( A ) ’ ;
COMMINGE, f. f. (Artillerie.) efpece de mortier
plus gros que les mortiers ordinaires, & qui jette des
bombes dont le poids va jufqu’à 500 livres. (Q)
C o m m i n g e s , ( le ) Géog. mod. pays de France ,
borné par la Gafcogne, le Couferans, la Catalogne
Sc le Bigorre : Saint-Bertrand en eft la capitale
COMMIS, f. m. ( Gramm. & Jurifpr. ) fe prend en
général pour celui qui eft prépofé par un autre pour
faire en fon lieu & place quelque chofe ; il eft parlé
de ces fortes de commis ou prépofés dans les lois romaines
: le commis du propriétaire d’unnavire eft appellé
exercitor ; le commis ou faCteur d’un marchand
fur terre eft appellé infiitor, deinfiitôrid & exercitoria
actione. Voyez au code, liv. I l ‘r. tit. xxv. au digejt. liv.
X IV . tit. iij. & auxinflitut.liv.IV. tit.vij. %.iij. Voy.
M a n d a t , M a n d a t a i r e , P r o c u r a t i o n . (A )
C o m m i s , ( Comm. ) ce terme eftd’un grand ufage
chez les Financiers, dans les bureaux des douanes,
dans ceux des entrées, & forties , & chez les Marchands
, Négocians, Banquiers, Agens de change ,
Sc autres perfonnës qui fe mêlent du commerce ou
d’affaires qui y ont rapport ; mais ces commis font
amovibles, aufli-bien que ceux qui travaillent dans
les bureaux des fecrétaires d’état.
Les principaux commis des doüanes , & particulièrement
de celle de Paris, font, le receveur général
& le receveur particulier, trois directeurs généraux
des comptes, une contrôleur, les vifiteurs , &
un infpeCteur général. Voye{ tous ces noms fous leurs
titres particuliers.
C ommis ambu lant , eft itn commis dont l’emploi
confifte à parcourir certain nombre de bureaux,
à y voir Sc examiner les regiftres des receveurs Sc
contrôleurs, pour en cas de malverfation en faire
fon procès-verbal oufon rapport, fuivant l’exigence
& l’importance de ce qu’il a remarqué.
C ommis au x portes ; ce font ceux qui font
chargés de veiller aux portes Sc barrières des villes
où fe payent des entrées pour certaines fortes de
marchandifes , dont ils reçoivent les droits Sc donnent
des acquits,. Voye^ D ro it 6* A c q u it .
C ommis au x des centes ; ce font certaines per-
fonnes prépofées par les fermiers des gabelles, pour
affilier à là defeen te des fels Iorfqu’on les fort des bateaux
pour 1er porter aux greniers.
C ommis a ux rech erch es ; on nomme ainfi ,
en Hollande, dans les bureaux du convoi Sc Licen-
ten , ce qu’à la douane de Paris on nomme vifiteurs.
C ’eft à ces commis qu'é lés marchands qui veulent
charger ou décharger des marchandifes doivent re-
'mettre la déclaration qu’ils en ont faite , afin que
ces Commis en faffent la vifite Sc juftifient.fi elles font
conformes à la déclaration.
. 'C om m is , en termes de Commerce demer, fignifiefur
lès vaîffeaux marchands, celui qui a la direftion de
la vente des marchandifes qui en font la cargaifon.
Les commis des Marchands, Négocians, Banquiers,
Àgeris de change, font ceux qui tiennent ou leur caif-
f e , ou leurs livres, ou qui ont foin de leurs affaires.
On les nomme autrement caijjîers, teneurs dé livres,
'& facteurs. Voyez ces noms fous leurs titres particuliers.
Sous-commis , eft celui qui fait la fonction du commis
en cas de mort, de maladie, ou autres empêche-
mens. Diclionn. de Comm,
C ommis aux Aides , fontccitx que les fermiers
Sc fous-fermiers'des aides prépofent fotis eu x, pour
la perception des droits d’aides.
L ’ordonnancé des aides du mois de Jiiin 1680 titre
v. veut que lès'commis aux aides fbiènt âgés au
moins de 20 ans, non parens ni alliés du fermier, ni
intéreffés dans la ferme ; qu’ils prêtent ferment â l’é-
le&ion dans le reffort de laquelle ils feront employés
ou devant un autre juge des droits du r o i , le tout
fans information de vie Sc moeurs , & fans conclu*
fions du miniftere public. Ilspeuvent aufli prêter ferment
à la cour des aides, auquel cas il fuffit qu’ils
faffent enfuite enregiftrer leur ferment dans l’élection
de leur exercice.
Les fermiers ou fous-fermiers qui les nomment,
demeurent civilement refponfâblcs de leur adminif-
tration.
Les commis aux aides doivent être deux enfemble
lorfqu’ils font leurs exercices, yifites & procès-verbaux
; Sc tous deux doivent, fur leurs regiftres &
procès-verbaux , les affirmer véritables dans le délai
preferit par l’ordonnance.
Néanmoins un procès-verbal fait par un feulco«z-
mis eft valable, pourvû qu’il foit affilié d’un huiflîer.
Les vendans vin font obligés à la première fom-
mation de leur ouvrir leurs caves , celliers Sc autres
lieux de leur maifon pour y faire la vifite.
Ils joiiifl'ent de tous les privilèges accordés aux
commis des fermes en général. Voye£ ci-après C ommis
DES Fermes ; 8c le diclionnaire des Aides, au mot
Commis. (A )
C ommis des Fermes : on comprendfouscenom
tous les directeurs, receveurs, caifliers, contrôleurs
& autres fimples commis ou prépofés par les fermiers
8c fous-fermiers des droits du ro i, tels que les commis
aux aides , les commis à là recette du contrôle ,
des infinuations, &c.
L’ordonnance de 1681, titre commun pour toutes
les fermes, ordonne queles fermiers Sc fous-fermiers
aurojpt contre leurs commis les mêmes a étions, privi