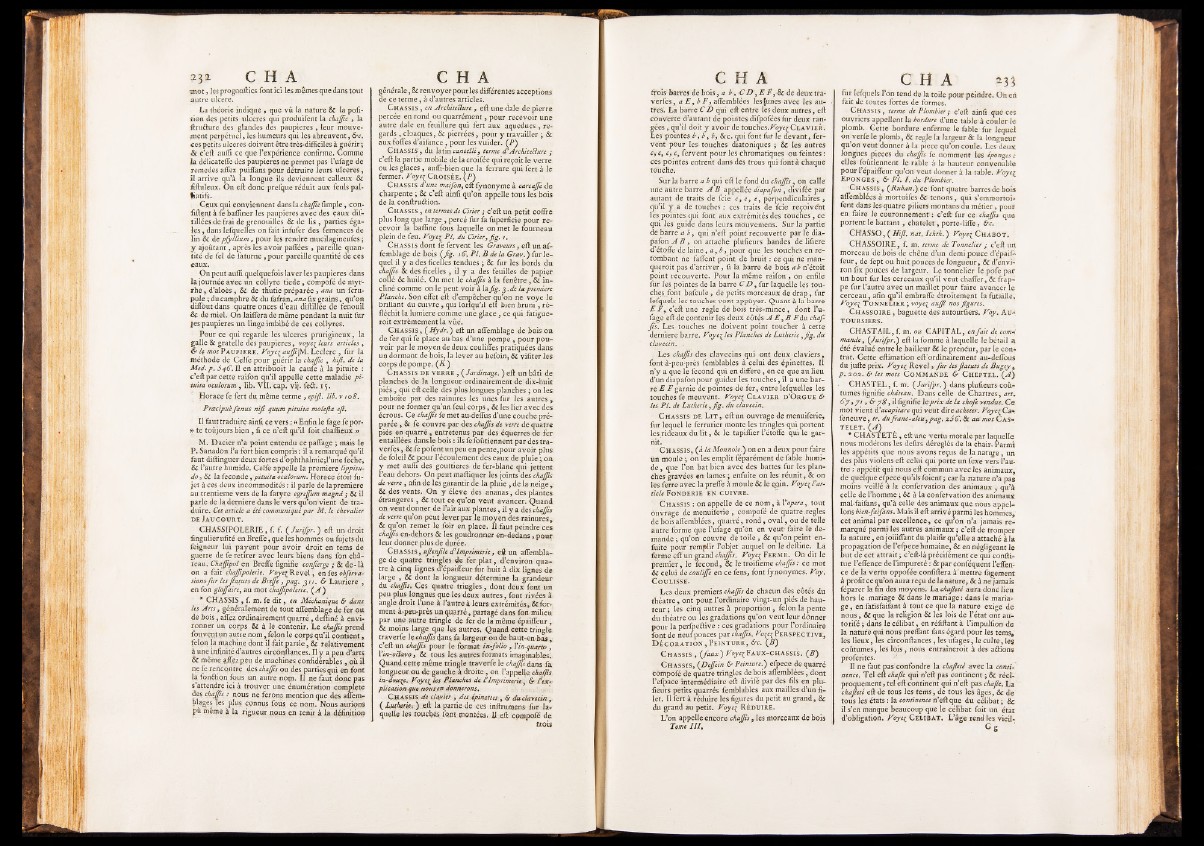
griot j les prognctfics font ici les mêmes que dans tout
autre ulcéré.
La théorie indique , que vit la nature & la poli*
îion des petits ulcérés qui produisent la chajjie , la
ftrutture des glandes des paupières , leur mouvement
perpétuel, les humeurs qui les abreuvent, &c.
ce s petits ulcérés doivent être très-difficiles à guérir ;
& c’eft auffi ce que l’expérience confirme. Comme
la délicatefîe des paupières ne permet pas l’ufage de
remedes a fiez puiffans pour détruire leurs ulcérés,
il arrive qu’à la longue ils deviennent calleux 6c
fiftuleux. On ell donc prefque réduit aux Seuls palliatifs.
Ceux qui conviennent dans la chajjie fimple, con-
üften,t à fe baffiner les paupières avec des çaux distillées
de frai de grenouilles & de lis , parties égales
, dans lefquelles on fait infiifer des femences de
lin & de pfyIlium , pour les rendre mucilagineufes ;
y ajoûtant, après les avoir paffées , pareille quantité
de fel de Saturne, pour pareille quantité de ces
eaux.
On peut auffi quelquefois laver les paupières dans
la journée avec un collyre tiede, compofé de myrrhe
, d’aloès , 6c de thutie préparée , ana un Scrupule
; du camphre 6c du Safran, ana fix grains, qu’on
diffout dans quatre onces d’eau diftillée de fenouil
& de miel. On laiffiera de même pendant la nuit fur
jes paupières un linge imbibé de ces collyres.
Pour ce qui regarde les ulcérés prurigineux, la
galle & gratelle dès paupières, voye[ leurs articles ,
G» h mot Paupière. Voye{ aujJi^A. Leclerc , Sur la
méthode de Celfe pour guérir la chaßie , hiß. de la
Med. p. S46. Il en attribuoit la caufe à la pituite :
c ’eft par cette raifon qu’il appelle cette maladie pi-
tuita oculorum , lib. VII. cap. vij. fett. 15.
Horace fe Sert du même terme , epiß. lib. v 108.
Pràcipué Janus nifi quum pituita moleßa eß.
Il faut traduire ainli ce vers : « Enfin le Sage fe por-
» te toujours b içn , li ce n’eft qu’il Soit chaffieux »
M. D acier n’ a point entendu ce paffage ; mais le
P. Sanadon l’a Sort bien compris : il a remarqué qu’il
faut diftinguer deux fortes d’ophthalmiejl’une Seche,
6c l’autre humide. Celfe appelle la première lippitu-
do, 6c la Seconde, pituita oculorum. Horace étoit Sujet
à ces deux incommodités : il parle de la première
au trentième vers de la Satyre egrejfum magna ; 6c il
parle de la derniere dans le vers qu’on vient de traduire.
Cet article a été communiqué par M. le chevalier
EXE JAUCOURT.
CHA5SIPOLERIE, S. f. ( Jurifpr. ) eft un droit
Singulier ufité en Breffe, que les hommes ou Sujets du
feigneur lui payent pour avoir droit en tems de
guerre de fe retirer avec leurs biens dans. Son château.
Chajßpol en Breffe lignifie conßerge ; & de-là
on a fait çhajjipolerie. Voye{ R e v e l, en Ses obferva-
tionsfur lesjlatuts de Breffe , pag, 3 ij . & Lauriere ,
en Son glofjaire, au mot chajfipolerie. { A )
* CHASSIS , f. m. fe d it , en Méçhaniquç & dans
les A n s , généralement de tout affemblage de fer ou
de bois, affez ordinairement quarré, deftiné à envi?
ronner un corps & à le contenir. Le chajjis prend
Souvent un autre nom, Selon le corps qu’il contient,
Selon |a machine dont il fait partie, & relativement
à une infinité d’autres eircQrçftances. Il y a peu d’arts
& même affez peu de machines conlidérables , oii il
ne fe rencontre des chajjis ou des parties qui en font
la fpnttion fous un autre nom* Il ne faut donc pas
s’attendre ici à trouver une énumération complète
des chajßs : nous ne ferons, mention que des affem?
blases les plus, çpnmis fous. ce. nom. Nous auripns
pû même à la rigueur nous en tenir à la définition
générale, 8c renvoyer pour les différentes acceptions
de ce terme, à d’autres articles.
Châssis , en Architecture , eft une dale de pierre
percée en rond ou quarrément, pour recevoir une
autre dale en feuillure qui Sert aux aqueducs., regards
, cloaques, 6c pierrées, pour y travailler ; &
aux foffes d’aifance, pour les vuider. (P)
CHASSIS', du latincancelli, terme d'Architecture ;
c’eft la partie mobile de la croifée qui reçoit le verre
ou les glaces, auffi-bien que la ferrure qui Sert à le
fermer. Voye^ Croisée. {P)
C hâssis d'une maifon, eft Synonyme à carcajfe de
charpente ; 6c c’eft ainli qu’on appelle tous les bois
de la çonftruttion.
C hâssis , en termes de Cirier ; c’eft un petit coffre
plus long que large , percé fur fa Superficie pour recevoir
la baffine fous laquelle on met le fourneau
plein de feu. Voye^ PI. du Cirier, fig. 1.
C hâssis dont Se fervent les Graveurs, eft un affemblage
de bois {fig. iC. PI. B de la Grav.') fur lequel
il y a des ficelles tendues ; 6c fur les bords du
chajjis & des ficelles , il y a des feuilles de papier
collé 6c huilé. On met le chajjis à la fenêtre, & incliné
comme on le peut voir à la fig. 3 . de la première
Planche. Son effet eft d’empêcher qu’on ne voye le
brillant du cuivre, qui lorfqu’il eft bien b runi, réfléchit
la lumière comme une glace, ce qui fatigue-
roit extrêmement la vue.
Châssis , ( Hydr. ) eft un affemblage de bois ou
de fer qui fe place au bas d’une pompe , pour pouvoir
par le moyen de deux couliffes pratiquées dans
un dormant de bois, la lever au befoin, & vifiter les
corps de pompe. {K- )
C hâssis Dp; verrè , ( Jardinage. ) eft un bâti de
planches de la longueur ordinairement de dix-huit
pié s, qui eft celle des plus longues planches ; on les
emboîte par des rainures les unes fur les autres ,
pour ne former qu’un feul corps, 6c les lier avec des
écrous. Ce chajjis fe met au-deffus d’une couche préparée
, & fe couvre par des chajjis de verre de quatre
piés en quarré , entretenus par des équerres de fer
entaillées dans le bois : ils fefoûtiennent par des tra-
verfçs., Ôç fepofent un peu en pente,pour avoir plus
de foleil 6c pour l’écoulement des eaux de pluie ; on
y met auffi des gouttières de fer-blanc qui jettent
l’eau dehors. On peut maftiquer les joints des chajjis
de verre , afin de les garantir de la pluie , de la neige,
& «des yentSi On y éleve des ananas, des plantes
étrangères , & tout ce qu’on veut avancer. Quand
oii veut donner de l’air aux plantes, il y a des chajjis
de verre qu’on peut lever par le moyen des rainures,
& qu’on remet le foir en place. Il faut peindre ces.
chajjis en-dehors 6c les goudronner en-dedans, pour
leur donner plus de dyrée.
Châssis , ufienjile 4'Imprimerie, e£ un affemhla-
ge de quatre tringles de fer p la t, d’environ quatre
à cinq lignes d’épaiffeur fur huit à dix lignes de
large , & dont la longueur détermine la grandeur
d>u chajjis. Ççs quatre tringles, dont deux font un
peu plus longues, que les deux autres, font rivées à
angle droit l’une à l’autre à leurs extrémités, & for?
ment à-peu-près un quarré, partagé dans fon milieu
par une autre tringle de fer de la même épàiffeur,
& moins large que les autres. Quand cette tringle
traverfe le chajjis dans, fa largeur ou de haut-en-bas
c’eft un chajjis pour le format in-folio , Y in-quarto ,
Yin-octayo , 6c tous, les autres formats imaginables!
Quand cette même tringle traverfe le chajfts dans fa
longueur ou de gauche à droite, on l’appelle chajjis
in-dou^e. Voyt{ les Planches de. C Imprimerie, & ifex-
plication que nous.en donnerons.
C.HA.SSIS. de clapier , dcs.épinettes., & du clavecin ,
( Lutkerif, ) èft la partie de ces inflruijens jfur la.
quelle les touchés fom oiontées, JJ .ell compofé de
trois
frois barres de bois^ a b , C D , E P , 6c de deux tra-
verfes, a E , b F ,affemblées les (Unes avec les au-
tfrës-'. Là barre C D qui eft entre les deux autres, eft
couverte d’autant de pointes difpofées fur deux rangées
, qu’il doit y avoir de touches. Fbyrç C l a v ie r .
Les pointes b , b, b, &c. qui font fur le devant, fervent
pour les- touches diatoniques ; & les autres
cyc, c, c, fervent pour les chromatiques ou feintes :
ces pointes entrent dans des trous qui font à chaque
touché.
Sur la barre a b qui eft le fond du chajjis, on calle
une autre barre A B appellée diapafon , divifée par
autant de traits de feiè e , e, e, perpendiculaires -,
qu’il y a dé touches : cés traits dé feie reçoive’nt
lés pointés qui font aux extrémités des touches , ce
qui les guide dans leurs môuvemens. Sur la partie
dé barre a b, qui n’eft point recouverte par le diapafon
A B , on attache plüfieurs bandes de lifiere
d’étoffe de laine, a , b, pour que les touches en retombant
lie faflent point de bruit : ce' qui ne man-
queroit pas d’arriver, fi la barre de bois a b n’étoit
point recouverte. Pour'la même raifon, ôn enfile
fur les pointes de la barre C D , fur laquelle'lés touches
font bafcule, de petits morceaux de drap, fur
lefquels les touches vont appûyer. Quant à la barre
E F , c’eft une réglé de bois très-mince, dont l’ufage
eft de contenir les deux côtés ^ E , B F du chafi
fis . Les- touches ne doivent point toucher à cette
derniere barre. Voyelles Planches de Lutherie ,fig. du
clavecin. .
Les chajjis des clavecins qui ont deiix claviers,
font à-peu:près femblables à celui des épinettes. Il
n’y a que le fécond qui en différé, en ce que au lieu
d’un diapafon pour guider les touches, il a une barré
E .F garnie de pointes de fer, entre lefquelles les
touches fe meuvent. Voye^ C la v ie r d’Orgue &
les PI. de Lutherie, fig. du clavecin.
C hâssis de L it , eft un ouvrage de menuiferie,
fur lequel le ferrurier monte les tringles qui portent
les rideaux du l i t , & le tapiffier l’étoffe qui le garnit
.C
HASSIS, {a la Monnoiej on en a deux pour faire
un moule ; on les emplit féparément de fable humide
, que l’on bat bien avec des battes fur les plan-
éhes gravées «n lames ; enfuite on les réunit, & on
lés ferre avec la preffe à moule 6c le epin. Vye^ l'article
Fonderie en cu ivr e .
C hâssis : on appelle de ce nom, à Y opéra, tout
ouvrage de menuiferie , compofé de quatre.réglés
de bois affemblées, quarré, rond, o v a l, ou de telle
autre forme que l’ufage qu’on en veut* faire le demande
; qu’on couvre de toile , & qu’on peint en-
fuite pour t'emplir l’objet auquel on le deftine. La
ferme eft un grand chajjis. Voyeç Ferme. On dit le
premier, le fécond, & letroifieme chajjis: ce mot
6c celui de coulijfit en ce fens, font fynonymes. Voy.
C oulisse.
Les deux premiers chajjis de chacun des côtés du
théâtre, ont pour i’ordinaire vingt-un piés de hauteur
; les cinq autres à proportion, félon la pente
du théâtre ou les gradations qu’on veut leur donner
pour la perfpettive : ces gradations pour Fordinaire
font de neuf pouces par chajjis. Vo^i Perspec tiv e,
D é c o r a t io n , Pein ture, &c. (F )
C hâssis , {faux') Voye^Faux - ch a s s is . (B)
C h â s s is , {DeJJein & Peinture.) efpece de quarré
compofé de quatre tringles de bois affemblées, dont
l’efpace intermédiaire eft divifé par des fils en plu-
fieurs petits quarrés femblables aux mailles d’un filet.
Il fert à réduire les figures du petit au grand, &
du grand au petit. Voye%_ Réduire.
L’on appelle encore chajjis, les morceaux de bois
Tome I I I .
fur lefquels l’on tend de la toile pour peindre. Oh eii
fait de toutes fortes de formes.
C hâssis , terme de Plombier $ c’eft ainfi que ces
ouvriers appellent la bordure d’une table à couler le
plomb. Cette bordure enferme le fable fur lequel
on verfe le plomb, 6c regle la largeur & la longueur
qu’on veut donner à la piece qu’on coule. Les deux
longues pièces du chajjis fe nomment les éponges :
elles-foutiennent le rable à la hauteur convenable
pour l’épàiffeur qu’on veut donner à la table. Voyei
Eponges , & PI. I. du Plombier.
C hassis , («&wz.)i ce; font quatre barres de bois
affemblées à mortoifes 6c tenons, qui s’emmortoi*
fent dans les quatre piliers montans du métier, pour
en faire le couronnement : c’eft'fur ce chajjis que
portent le battant, châtelet, porte-liffe, &c.
CHASSO, ( Hiß. nat. Ichth. ) Voyeç C h a b o t .
CHASSOIRE, f. m. terme de Tonnelier ; c’eft uit
morceau de bois de chêne d’un demi pouce d’épaife
feur, de fept ou huit pouces de longueur, & d’environ
fix pouces de largeur. Lç tonnelier le pofe par
un bout fur les cerceaux qu’il veut chaffer, 6c frappe
fur l’autre avec un maillet pour faire avancer le
cerceau, afin qu’il embrafle étroitement la futaille.
Voye£ T onnelier ; voye[ aujji nos figures.
C hassoire , baguette des autourfiers. Voy, Au**
TOURSIERS.
CHASTAIL, f. m. ou CAPITAL, en fait de com4
mande, {Jurifpr.) eft la fomme à laquelle le bétail a
été évalué entre le bailleur & le preneur, par le contrat.
Cette eftimation eft'ordinairement au-deffous
du jufte prix. Voye[ Re ve l, fur lesJlatuts de Bugey,
p. 202. & les mots C ommande & C heptel. {A )
CHASTEL, f. m. {Jurifpr.) dans plufieurs coû-
tumes fignifie château. Dans celle de Chartres, art.
Gy ,y i , & y 8 , il lignifie le prix de la chofe vendue. Cô
mot vient à'acapitare qui veut dire acheter. Voye£ Ca**
feneuve, tr. du franc-aleu, pag. x56. 6l au mot C as-,
t e l e t . {A )
* CH ASTETÉ, eft Une vertu morale pat laquelle
nous modérons les defirs déréglés de la chair. Parmi
les appétits que nous avons reçus de la nature, un
des plus violens eft celui qui porte un fexe vers l’autre
: appétit qui nous eft commun avec les animaux,
de quelque efpecé qu’ils foient ; car la nature n’a pas
moins veillé à la coiifervation des animaux , qu’à
celle de l’homme ; 6c à la confervation des animaux
mal-faifans, qu’à celle des animaux que nous appelions
bienfaifans. Mais il eft arrivé parmi les hommes*
cet animal par excellence-, ce qu’on n’a jamais remarqué
parmi les autres animaux ; c’eft de tromper
la nature, en joüiffant du plaifir qu’elle a attaché à la
propagation de l’efpece humaine, 6c en négligeant le
but de cet attrait ; c’eft-là précifément ce qui confti-
tue l’effence de l’impureté : & par conféquent l’effen-
ce de la vertu oppoféë eonfiftera à mettre fagement
à profit ce qu’on aura reçu dé la nature, & à ne jamais
féparer la fin des moyens. La chajteté aura donc lieu
hors le mariage & dans le mariage : dans le mariage
, en fatisfaifant à tout ce que la nature exige dè
nous, & que la religion 6c les lois de l’état ont au-
torifé ; dans le célibat, en réfiftant à l’impulfion de
la nature qui nous preffant fans égard pour les tems,
les lieux, les circonftances, les ufages, le culte, le$
coutumes, les lo is, nous entraîneroit à des attions
proferites.
Il ne faut pas' confondre la chajtèté avec la contU
nence. Tel eft chafte qui n’eft pas continent ; & réciproquement,
tel eft continent qui n’eft pas chafte. La
chajteté eft de tous les tems, de tous les âges, 6c de
tous les états : la continence n’eft que du célibat ; &
il s’en manque beaucoup que le célibat foit un état
d’obligation. Voye^ C é l ib a t . L’âge rend les vieil-
G S