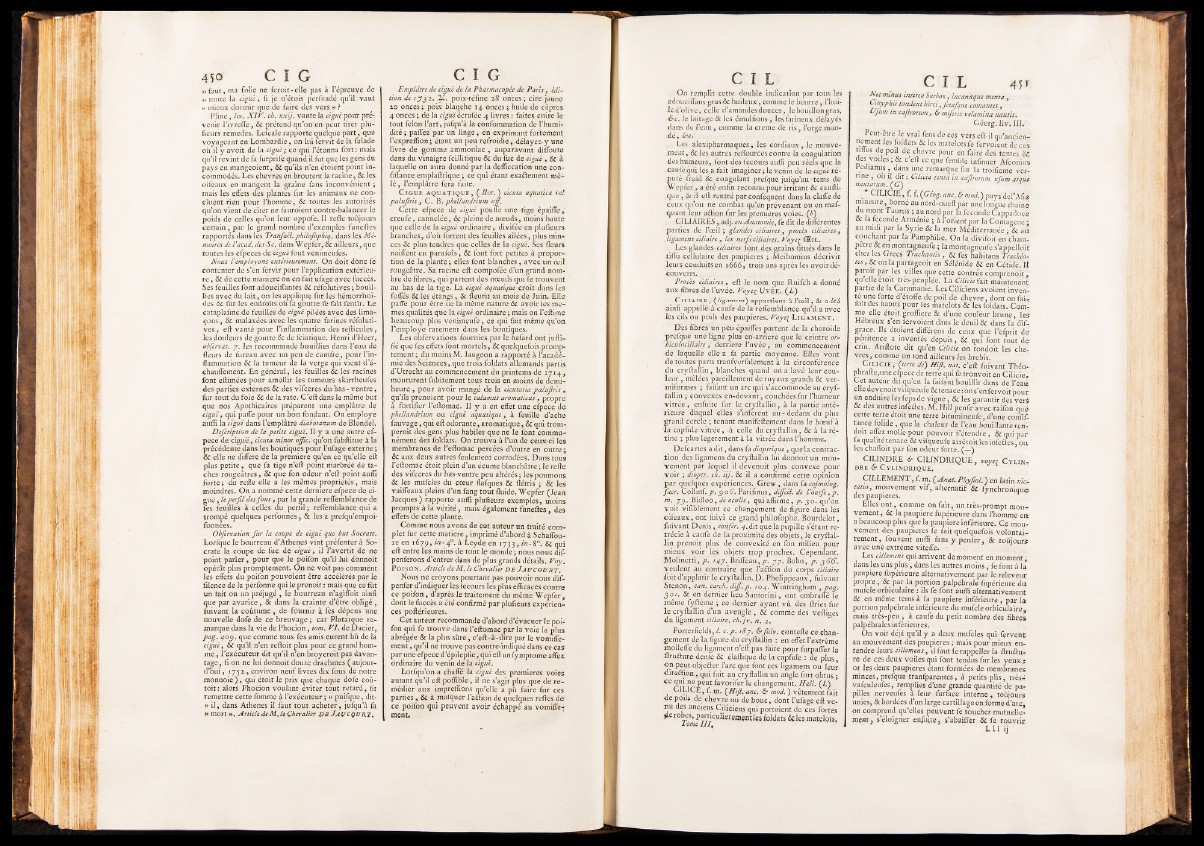
» faut, ma folie ne feroit-elle pas à l’épreuve de
» toute la ciguë, fi je n’étois perfuadé qu’il vaut
„ mieux dormir que de faire des vers » ?
Pline, liv. X IV . ch. xxij,. vante la ciguë pour prévenir
l’ivreffe, & prétend qu’on en peut tirer plu-
lieurs remedes. Lel'cale rapporte quelque part, que
voyageant en Lombardie, on lui lervit de la falade
où il y avoit de la ciguë; ce qui.l’étonna fort: mais
qu’il revint de fa furprife quand il fut que les gens du
pays en mangeoient, 8c qu’ils n’en étoient point incommodés.
Les chevres en broutent la racine, & les
oifeaux en mangent la graine fans inconvénient ;
mais les effets des plantes fur les animaux ne concluent
rien pour l’homme, 8c toutes les autorités
qu’on vient de citer ne fauroient contrc-balauccr le
poids de celles qu’on leur oppofe. Il fefte toujours
certain, par le grand nombre d’exemples funeftes
rapportés dans les Tranfack philofophiq. dans les Mémoires
de l'acad. des Sc. dans Wepfer, 8c ailleurs, que
toutes les efpeces de ciguë font venimeufes.
Nous L'employons extérieurement. On doit donc fe
contenter de s’en fervir pour l’application extérieur
r e , & de cette maniéré on en fait ufage avec fuccès.
Ses feuilles font adouciflantes 8c réfolutives ; bouillies
avec du lait, on les applique fur les hémorrhoï-
des 8c fur les endroits ou la goutte fe fait fentir. Le
cataplafme de feuilles de ciguë pilées avec des limaçons
, 8c malaxées avec lés quatre farines réfolutiv
e s , eft vanté pour l’inflammation des tefticules,
les douleurs de goutte 8c de fciatique. Henri d’Heer,
obfervat. y. les recommande bouillies dans l’eau de
fleurs de fureau avec un peu de camfre, pour l’inflammation
8c la tumeur de la verge qui vient d’é-
chauffement. En général, les feuilles & les racines
font eftimées pour amollir les tumeurs skirrheufes'
des parties externes 8c des vifceres du bas - ventre,
fur-tout du foie 8c de la rate. C ’eft dans le même but
que nos Apothicaires préparent une emplâtre de
ciguë t qui paffe pour un bon fondant. On employé
aufli la ciguë dans l’emplâtre diabotanum de Blondel.
Defcription de la petite ciguë. Il y a une autre ef-
pece de ciguë., cicuta minor offic. qu’on fubftitue à la
précédente dans les boutiques pour l’ufage externe ;
8c elle ne différé de la première qu’en ce qu’elle eft
plus petite, que fa tige n’eft point marbrée de taches
rougeâtres, & que fon odeur n’eft point aufli
forte ; du refte elle a les mêmes propriétés, mais
moindres. On a nommé cette derniere efpece de ciguë
, leperfil des fous , par la grande reffemblance de
fos feuilles à celles du perfil; reffemblance qui a.
trompé quelques perfonnes, & les a prefqu’empoi-
fonnees.
Obfervation fur la coupe de ciguë que but Socrate.
Lorfque le bourreau d’Athènes vint préfenter à Socrate
la coupe de fuc de ciguë, il l’avertit de ne
point parier, pour que le poifon qu’il lui donnoit
opérât plus promptement. On ne voit pas comment
les effets du poifon pouvoient être accélérés par le
ülence de la perfbnne qui le prenoit : mais que ce fût
un fait ou un préjugé , le bourreau n’agiffoit ainfi
que par avarice, & dans la crainte d’être obligé ,
luivant la coutume, de fournir à fes dépens une
nouvelle dofe de ce breuvage ; car Plutarque remarque
dans la vie de Phocion, tom. VI. deDacier,
pag. 4 °9 ' que comme tous fes amis eurent bû de la
ciguë y 8c qu’il n’en reftoit plus pour ce grand homme,
l ’exécuteur dit qu’il n’en broyeroit pas davantage,
fi on ne lui donnoit douze drachmes (aujourd’hui
, 1752, environ neuf livres dix fous de notre
monnoie ) , qui étoit le prix que chaque dofe coû-
toit : alors Phocion voulant éviter tout retard, fit
remettre cette fomme à l’exécuteur ; « puifque, dit-
» i l , dans Athènes il faut tout acheter, jufqu’à fa
» mort ». Article deM, leChevalier d e Ja v c q u r t ,
’Emplâtre de ciguë de la Pharmacopée de Paris y édition
de iy 32. 'If-, poix-réfine 28 onces ; cire jaune
20 onces; poix blanche 14 onces ; huile de câpres
4 onces ; de la ciguë écrafée 4 livres : faites cuire le
tout félon l ’art , jufqu’à la confommation de l’humidité
; paffez par un linge, en exprimant fortement
fexpreflion ; étant un peu refroidie, délayez-y uné
livre de gômme ammoniac , auparavant diffouté
dans du vinaigre fcillitique & du fuc de ciguë , 8c à
laquelle on aura donné par la defliccation une con-
fiftance emplaftrique ; ce qui étant exa&ement mêl
é , l’emplâtre fera faite.
C igu ë a q u a t iq u e , ( Bot. ) cicuta aquaticà vet
palujlris , Ci B.phellandrium off.
Cette efpece de ciguë pouffe une tige épaiffe
creufe, cannelée, & pleine de noeuds, moins haute
que celle de la ciguë ordinaire, divifée en plufieurs
branches, d’oii fortent des feuilles ailées, plus minces
8c plus tendres que celles de la ciguë. Ses fleurs
naiffent en parafols, 8c font fort petites à proportion
de la plante ; elles font blanches, avec un oeil
rougeâtre. Sa racine eft Compofée d’un grand nombre
de fibres , qui partent des noeuds qui fe trouvent
au bas de la tige. La ciguë aquatique croît dans les
fofles 8c les étangs, & fleurit au mois de Juin. Elle
paffe pour être de la même nature 8c avoir les mêmes
qualités, que la ciguë ordinaire ; mais on l’eftimé
beaucoup plus venimeufe, ce qui fait même qu’on
l’employe rarement dans les boutiques.
Les obfervations fournies par le hafard ont jufti-
fié que fes effets font mortels, 8c quelquefois promptement
; du moins M. Jaugeon a rapporté à l’académie
des Sciences, que trois foldats allemands partis
d’Utrecht au commencement du printems de 1 7 14 ,
moururent fubitement tous trois en moins de demi-
heure , pour avoir mangé de la cicutaria palujlris *
qu’ils prenoient pour le calamus aromaticus , propre-
à fortifier l’eftomac. Il y a en effet une efpece de
phellandrium ou ciguë aquatique, à feuille d’ache
fauvage, qui eft odorante, aromatique, 8c qui trom-.
peroit des gens plus habiles que ne le font communément
des foldats. On trouva à l’un de ceux-ci le9
membranes de l’eftomac percées d’outre en outre;
& aux deux autres feulement corrodées. Dans tous
l’eftomac étoit plein d’un écume blanchâtre; le refte
des vifceres du bas-ventre peu altérés ; le9 poumons
& les mufcles du coeur flafques 8c flétris ; & les
vaiffeaux pleins d’un fang tout fluide. Wepfer (Jean
Jacques ) rapporte aufli plufieurs exemples, moins
prompts à la vérité, mais également funeftes, des
effets de cette plante.
Comme nous avons de cet auteur un traité complet
fur cette matière, imprimé d’abord à Schaffou-
ze en 1679, à Leyde en 1733, in-S°. 8c qui
eft entre les mains de tout le monde ; nous nous di£
penferons d’entrer dans de plus grands détails. Voyé
POISON. Article de M. le Chevalier d e J a u c o u r t .
Nous ne croyons pourtant pas pouvoir nous dif-
penfer d’indiquer les fecours les plus efficaces contre
ce poifon, d’après le traitement du même Wepfér ,
dont le fuccès a été confirmé par plufieurs expériences
poftérieures.
Cet auteur recommande d’abord d’évacuer le poifon
qui fe trouve dans l ’eftomac par la voie la plus
abrégée & la plus sûre, c’eft-à-dire par le vomiffe-
ment, qu’il ne trouve pas contre-indiqué dans ce cas
par une efpece d epilepfie., qui eft un fymptome affez
ordinaire du venin de la ciguë.
Lorfqu’on a chaffe la ciguë des premières voies
autant qu’il eft poflibîe, il ne s’agit plus que de remédier
aux imprefllons qu’elle a pu faire fur ces
parties, & à malquer l’aûion de quelques reftes de
ce poifon qui peuvent avoir échappé au Yomiffe-
ment.
On remplit cette doublé indication par tous les
adouciffans gras & huileux, comme le beurre, l’huile
d’olive, Celle d’amandesdouces, le bouillon gras,
&c. le laitage & les émulfions ; les farineux délayés
dans de l’eau, comme la creme de ris, l’orge mon-
-dé, &c.'
«j Les alexipharmaques, les cordiaux, le mouvement,
8c les autres reffources contre la coagulation
des humeurs , font.des fecours aufli peu réels que la
caufe-qui lçs a-fait imaginer ; le venin de .la ciguë réputé
froid 8c .coagulant prefque jufqu’au tems de
‘Wepfer.,Ia été enfin reconnu pour irritant 8c çaufti-
q ue , & il e ll rentré parconféquent dans la claffe de
ceux qu’ou ne combat qu’en prévenant Ou en maf-
quant leur a'&ion fur les; premières.voies.; (JJ)
. CILIAIRES ,.adj. en Anatomie ^ fe dit de différentes
parties de l’oe il; glandes ciliaires, procès ciliaires 9
Jigarnent çiliaj.re,y les nerfs'ciliaires. Voye[ OEil .
Les glandes; ciliaires font des grains utiles dans le
tiffu. cellulaire des paupières, ; Meibomius décrivit
leurs conduits en ié ô é , trois ans après les avoir découverts..
. ;
Procès ciliaires, eft le nom,que Ruifch a donné
aux fibres dé,l’uvée. Voye^lJvÉe. (L ) ,
C iliaire y ( ligament) appartient à l’oeil a été
-ainfi appellé'à caufe de la reffemblance qu’il a avec
les cils ou poils des paupières;'Voye^ Lig am e n t .
Des fibres un peu épaiffes partent de la choroïde
prefque une ligne plus en-arriere que le ceintre 0?-
'bicülocïliaire, derrière l’u vé e , au commencement
de laquelle elle a fa partie moyenne. Elles vont
de toutes parts tranfverfalement à la circonférence
- du cryftallin, blanches quand on a lavé leur couleur
, mêlées pareillement de tuyaux grands & ver-
miformes ; faifant un arc qui s’accommode au cryftallin
; convexes en-devant, couchées fur l’humeur
v itré e , enfuite fur le cryftallin, à la partie anterieure
duquel elles s’inferent au - dedans du plus
grand cercle ; tenant manifeftement dans le boeuf à
la capfule vitrée, à celle du cryftallin, Sc à la rétine
; plus legerement à la vitrée dans l’homme,
Defcartes a d it, dans fa dioptrique, que la contracr
.îion des ligamens du cryftallin lui donnoit un mou-
vemènf par lequel il devenoit plus convexe pour
.voir ; dioptr. ch. üj. & il a confirmé cette opinion
par quelques expériences. Grew , dans fa cojmôlog.
facr. Collinf. p. yoÇ. Parifinus, dijfecl. de l'ourfeyp.
m. y y , Bidloo, de oculis, qui affirme, p. go. qu’on
Voit vifiElement ce changement de figure dans les
oifeaux, ont fuivi ce grand philofophe. Bourdelot,
.luivant Denis, confér. 4. dit que la pupille s’étant rétrécie
à caufe de la proximité des objets, le cryftallin
prenoit plus de convexité en fon milieu pour
mieux voir les objets trop proches. Cependant.
Molinetti, p. i4y. Briffeau, p. y y: Bohn, ,p. g G6.
veulent au contraire que l’a&ion du corps ciliaire
foit d’applatir le cryftallin. D . Phelippeaux, fuivant
Stenon, can. car ch. diff. p. 104. Wintringham , pag.
g o i. & en dernier lieu Santorini, ont embraffé lé
même fyftème ; ce dernier ayant vû des ftries fur
le cryftallin d’un aveugle , & comme des veftiges
du ligament ciliaire, ch.jv. n. z.
Porterfields, l. c.p. 18y. &fuiv. contefte ce chan-
.gement de la figure du cryftallin : en effet l’extrême
molleffe du ligament n’eft pas faite pour furpaffer la
ftru&ure denlè & élaftique de la capfule : de plus
on peut obje&er l’arc que font ces ligamens ou leur
dire&ion, qui fait au cryftallin un angle fort obtus *
ce qui ne peut favorifer le changement. Hall. (Z,)
C 1LICÊ, f. m. (Hift. anc. & mod. ) vêtement fait
de poils de chevre ou de bouc, dont l’ufage eft v enu
des anciens Çiliciens qui portoient de ces fortês
dérobés, pamculieremçntles foldats & le$ matefots, .1 ome I I I .
Nec minus interea barbas, incanaque ment a ,
Cinyphii tondent kirci, fetafque cornantes ,
Vfum in caftrorum3 & miferis. velamina nantis.
Géorg. liv. III.
Peut-êtrede vrai Cens de ces vers eft-il qu’ancien-
nement les foldats &les matelots fe fervoient de ces
tilius de poil de chevre pour en faire des tentes 8c
des1 voiles; & c eft ce que femble infinuer Afconius
Fedianüs , dans une remarque fur la troifieme ver-
rme , oit il dit : Cilicia tenta in cafirorum ufum atque
nautarum. (G)
* CILICIE, f. f. (Géog.anc.&mod.) pays del’Afi«
mineure, borné au nord-oüeft par une longue chaîne
du mont Taurus ; au nord par la fécondé Cappadoce
& la fécondé Arriiénie ; à I’oriëntpar la Comagene ;
au midi par la Syrie & la mer Méditerranée ; & aii
couchant par la Pamphilie. On la divifoit en chanv
petre & en möntagneufe ; la mohtagneufe s’appelldit
chez les Grées Trachoeotis& fes habitans Trachéo-
tesy & on la partageoit en Sélériide & en Cétidè. Il
paroît par les villes que cette contrée comprenoit,
qu’elle étoit très-peuplée. La Cilicie fait maintenant
partie de la Caramanie. Les Çiliciens avoient invente
une forte d’etoffe de poil de chevre, dont on fair
foit des habits pour les matelots & les foldats. Comr
me elle étoit groflïere & d’une couleur brune, les
Hébreux s’en fervoient dans le deuil & dans la dif-.
• grâce. Ils etoient différens de ceux que l’efprit de
pénitence a inventés depuis , & qui font tout de
crin. Ariftote dit qu’en Cilicie on tondoit les chevres,
comme on tond ailleurs les brebis.
C il ic ie , (terre de') Hiß. nat. c’eft fuivant Théo-
phrafte,une efpece de terre qui fe trouvoit en C ilicie,
Cet auteur dit qu en la faifant bouillir dans de l’ eaix
elle de v enoit vifqùeufe ôctenace : on s’en fer voit pour
en enduire les feps de vigne, & les garantir des vers
& des autres mfé&es. M. Hill penfe avec raifon que
cette terre étoit une terre bitumineufe , d’une confif-
tance folide , que la chaleur de l’eau bouillante reri-
doit affez molle pour pouvoir s’étendre, 8c qui par
fa qualité tenace 8c vifqueufe arrêtoit les infeftes, ou
les chaffoit par fon odeur forte. (—)
CILINDRE & CILINDRI^UE, voyer C y l in^
dre & C yl ind riq ue.
CILLEMENT, f. m. ( Anat..Phyfiol. ) en latin nic±
tatioy mouvement v if, alternatif 8c fynchroniqu©
des paupières.
Elles o n t, comme on fait , un très-prompt mouvement,
8c la paupière fupérieure dans l’homme en
a beaucoup plus que la paupière inférieure. Ce"mouvement
des paupières fe fait quelquefois volontairement,
fou vent aufli fans y penfer, & toûiours
avec une extrême vîteffe.. ; ;
Les cillemens qui arrivent de moment en moment ,
dans les uns plus, dans les autres moins, fe font à la
paupière fupérieure alternativement par le releveur
propre, 8c par la portion palpébrale fupérieure du
mulcle orbiculaire : ils fe font aufli alternativement
8c en même tems à la paupière inférieure, par la
portion palpébrale inférieure du mufcle orbiculaire,
mais très-peu, à caufe du petit nombre des fibres
palpébrales inférieures.
On voit déjà qu’il y a deux mufcles qui fervent
au mouvement des paupières ; mais pour mieux entendre
leurs cillemens y il faut fe rappeller la ftruôu-
re de ces deux voiles qui font tendus fur les y e u x ;
or les deux paupières étant formées de membranes
minces, prefque tranfparentes, à petits plis, très-
vafculeufes, remplies d’une grande quantité de papilles
nerveufes à leur furface interne, toujours
unies, & bordées d’un large çartillage en forme d’arc ;
on comprend qu’elles peuvent fe toucher mutuelle-
s’éloigner enfuite, s’abaiffer 8c fe rouvrir
L l l ij