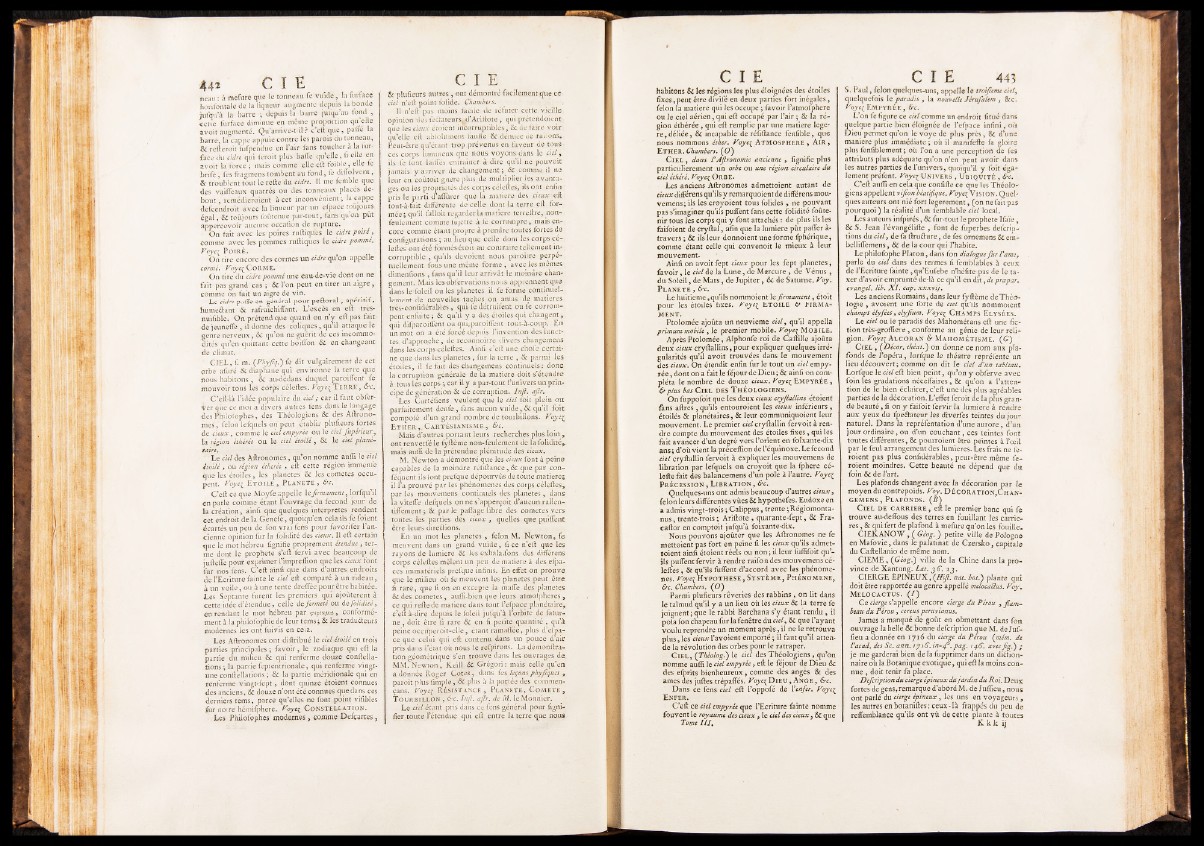
442 C I E
neau : à mefure que le tonneau fe vuide, la furface
horifontale de la liqueur augmente depuis la bonde
jufqu’à la barre ; depuis la barre jufqu’au fond ,
•cerie furface diminue en même proportion qu’elle
avoit augmenté. Qu’arrive-t-il ? c’eft que, pallé la
barre, la cappe appuie contre les parois du tonneau,
& relierait fufpendue en l’air fans toucher à la lur-
face du cidre qui leroit plus baffe qu’elle, fi elle en
avoit la force ; mais comme elle eft foible, elle fe
brife, fes fragmens tombent au fond, le diffolvent, j
& troublent tout le relie du cidre. Il me femble que j des vaiffeaux quarrés ou des tonneaux placés de- i
b ou t, remédieraient à cet inconvénient; la cappe
defeendroit avec la liqueur par un efpace toujours
ég a l, & toujours foutenue par-tout, fans quon put
appercevoir aucune occalion de rupture. #
On fait avec les poires ruftiqùes le cidre poire,
comme avec les pommes rultiques le cidre pomme,
Vcye{ Poiré.
On tire encore des cormes un cidre qu’on appelle
corme. Voye£ CORME.
On tire du cidre pomme une eau-de-vie dont on ne
fait pas grand cas ; & l’on peut en tirer un aigre,
comme on fait un aigre de vin.
Le cidfe p.iffe en général pour peâoral, apéritif,
humeétant & rafraîchiffant. L’excès en ell très-
nuifible. On prétend que quand on n’y ell pas fait'
de jeuneffe , il donne des coliques, qu’il attaque le
genre nerveux, & qu’on ne guérit de ces incommodités
qu’en quittant cette boiflon & en changeant
de climat.
CIEL, f. m. (Phyjiq.) fe dit vulgairement de cet
orbe afuré & diaphane qui environne la terre que
nous habitons , & au-dedans duquel paroiffenr fe
mouvoir tous les corps céleftes. Voye\ T erre, & c.
C ’eft-là l’idée populaire du ciel ; car il faut ôbfer-
ver que ce mot a divers autres lens dans le langage
des Philofophes, des Théologiens & des Aftrono-
mes, félon lefquels on peut établir plulieurs fortes
de deux , comme le ciel empyrée ou le ciel fuperieur,
la région éthérée ou le ciel étoile , & le ciel planétaire.
Le ciel des Allronomes, qu’on nomme aufli le ciel
ito ilé , ou région étherée , ell cette région immenfe
que les étoiles, les planètes & les cômetes occupent.
Voye^ Etoile, Planete, & c.
C ’ell ce que Moyfe appelle le firmament, lorfqu’il
en parle comme étant l’ouvrage du fécond jour de
la création, am i que quelques interprètes rendent
cet endroit de la Genefe, quoiqu’en cela ils fe foient
écartés un peu de fon vrai fens pour favorifer l’ancienne
opinion fur la folidité des deux. Il ell certain
que le mot hébreu fignifie proprement étendue, terme
dont le prophète s’ell fervi avec beaucoup de
julleffe pour exprimer l’impreflion que les deux font
fur nos fens. C’ell ainli que dans d’autres endroits
de l’Ecriture fainte le ciel ell comparé à un rideau,
à un voile, ou à une tente dreffée pour être habitée.
Les Septante furent les premiers qui ajoûterent à
cette idée d’étendue, celle de fermeté ou de folidité,
en rendant le mot hébreu par ç-iptaput, conformément
à la philofophie de leur tems ; & les traducteurs
modernes les ont fuivis en cela.
Les Allronomes ont diltribué le ciel étoilé en trois
parties principales ; favoir, le zodiaque qui eft la
partie du milieu & qui renferme douze conftella-
tions ; la partie feptentrionale, qui renferme vingt-
une conftellations ; & la partie méridionale qui en
renferme vingt-fept, dont quinze étoient connues
des anciens, & douze n’ont été connues que dans ces
derniers tems, parce qu’elles ne font point vilibles
fur noire hémifphere. Voye^ Constellation.
Les Philofophes modernes, comme P e fç a rte s,
& plulieurs autres, ont démontré facilement que ce
ciel n’eft point folide. Chambers.
Il n’eft pas moins facile de réfuter cette vieille
opinion xles l'eCtateurs^d’Ariftote , qui prétendoient
que les deux étoient incorruptibles, 6c de faire voir
qu’elle eft ablolument faufie & dénuée de râlions.
Peut-être qu’étant trop prévenus en faveur de tous-
ces corps lumineux que nous'voyons dans le ciel,
ils fe font laillés entraîner à dire qu’il ne pouvoit
jamais y arriver de changement ; & comme il ne
leur en coûtoit guère plus de multiplier les avantages
bu les propriétés des corps celeftes, ils ont enfin
pris le parti d’affûrer que la matière des deux eft
tout-à-fait différente de celle dont la terre eft formée;
qu’il falloir regarder la matière terreftre, non-
feulement comme iujette à fe corrompre, mais encore
comme étant propre à prendre toutes fortes de
configurations ; au lieu que celle dont les corps celeftes
ont été formés étoit au contraire tellement incorruptible
, qu’ils dévoient nous paraître perpétuellement
fous une même forme , avec les mêmes
dimenfions , fans qu’il leur arrivât le moindre changement.
Mais les obfervations nous apprennent que
dans lefoleil ou les planètes il fe forme continuellement
de nouvelles taches ou amas de matières
très-confidér ables, qui fe détruifent ou fe corrompent
enfuite ; & qu’il y a des étoiles qui changent,
qiii difparoiffent ou qui,paroiffent tout-à-coup. En
un mot on a été forcé depuis l’invention des lunettes
d’approche, de reconnoître divers changemens
dans les corps céleftes. Ainli c’eft une chofe certaine
que dans les planètes , fur la terre , & parmi les
étoiles, il fe fait des changemens continuels: donc
la corruption générale de la matière doit s’étendre
à tous les corps ; car il y a par-tout l’univers un principe
de génération & de corruption. Injl. ajlr.
Les Cartéfiens veulent que le ciel Ibit plein ou
parfaitement denfe , fans aucun vuide, & qu’il foit
compolé d’un grand nombre de tourbillons. Voye£
E t h e r » .C a r t é s i a n i s m e , & c.
Mais d’autres portant leurs recherches plus loin ,
ont renverfé le fyftème non-feulement de la folidité,.
mais aufli de la prétendue plénitude des deux.
M. Newton a démontré que les deux font à peine
capables de la moindre réfiftance, & que par con-
féquent ils font prefque dépourvûs de toute matière;
il l’a prouvé par les phénomènes des corps céleftes,
par les mouvemens continuels des planètes, dans
la vîtefle defquels on ne s’apperçoit d’aucun rallen-
tiflement ; & par le paffage libre des cometes vers
toutes les parties des deux , quelles que puiffent
être leurs directions.
En un mot les planètes, félon M. Newton, fe
meuvent dans un grand vuide, fi ce n’eft que les
rayons de lumière & les exhalaifons des différens
corps céleftes mêlent un peu de matière à des efpa-
ces immatériels prefque infinis. En effet on prouve
que le milieu où fe meuvent les planètes peut être
fi rare, que fi on en excepte la maffe des planètes
& des cometes, aufli-bien que leurs atmofpheres ,
ce qui reftede matière dans tout l’éfpace planétaire,
c’eft à-dire depuis le loleil jufqu’à l’orbite de fatur-
n e , doit être fi rare & en fi petite quantité , qu’à
peine occiîperoit-elle, étant ramaffée, plus d’efpa-
çe que celui qui eft contenu dans un pouce d’air
pris dans l’état où nous le refpirons. La démonftra-
tion géométrique's’en trouve dans les ouvrages de,
MM. Newton , Keill & Grégori : mais celle qu’en
a donnée Roger Cotes, dans fes leçons phyfiques ,
paroît plus fimple, & plus à la portée des commen-
çans. Voye{ R é s i s t a n c e , P l a n e t e , C o m e t e ,
T o u r b i l l o n , &c. I n j l . ajlr. de M. le Monnier.
Le ciel étant pris dans ce fens général pour figni-
fier toute l’étendue qui eft entre la terre que nous
habitons & les régions les plus éloignées des étoiles
fixes,peut être divifé en deux parties fort inégales,
félon la matière qui les occupe ; favoir l’atmofphere
ou le ciel aérien, qui eft occupé par l’air ; & la région
éthérée, qui eft remplie par une matière légère
, déliée, & incapable de réfiftance fenfible, que
nous nommons éther. Voye^ A tm o s ph è r e , A ir ,
Eth er. Chambers. (O )
C iel , dans VAfironomie ancienne , fignifie plus
particulièrement-.un orbe ou une région circulaire du
ciel éthéré. Voye[ O rbe.
Les anciens Allronomes admettoient autant de
deux différens qu’ils y remarquoient de différens mouvemens;
ils les croyoient tous folides , ne pouvant
pas s’imaginer qu’ils puffent fans cette folidité foûte-
nir tous les corps qui y font attachés : de plus ils les
faifoient de cryftal, afin que la lumière put paffer à-
travers ; & ils leur donnoient une forme fphérique ;
comme étant celle qui convenoit le mieux à leur
mouvement.
Ainfi on avoit fept deux pour les fept planètes,
favoir, le ciel de la Lune, de Mercure , de Vénus ,
du Soleil, de Mars, de Jupiter, & de Saturne. Voy.
Plane te , &c.
Le huitième, qu’ils nommoient le firmament, étoit
pour les étoiles fixes. Voye^ Eto ile & Firm a m
e n t .
Ptolomée ajoûta un neuvième ciel, qu’il appella
primum mobile , le premier mobile. Voye^ Mo b ile .
Après Ptolomée, Alphonfe roi de Caftille ajoûta
deux deux cryftallins, pour expliquer quelques irrégularités
qu’il avoit trouvées dans le mouvement
des deux. On étendit enfin fur le tout un ciel empyrée
, dont on a fait le féjour de Dieu ; & ainfi on compléta
le nombre de douze deux. Voye{ Empyrée ,
& plus bas C iel des T héo lo gien s.
On fuppofoit que les deux deux cryfiallins étoient
fans aftres , qu’ils entouroient les deux inférieurs ,
étoilés & planétaires, & leur communiquoient leur
mouvement. Le premier ciel cryftallin fervoit à rendre
compte $lu mouvement des étoiles fixes, qui les
fait avancer d’un degré vers l’orient en foîxante-dix
ans ; d’où vient la préceflion de l’équinoxe. Le fécond
ciel cryftallin fervoit à expliquer les mouvemens de
libration par lefquels on croyoit que la fphere cé-
lefte fait des balancemens d’un pôle à l’autre. Voye^
Précession , L ib r at io n , &c.
Quelques-uns ont admis beaucoup d’autres deux,
félon leurs différentes vues & hypothefes. Eudoxe en a admis vingt-trois ; Calippus, trente ;Régiomonta-
nus, trente-trois; Ariftote , quarante-fept, & Fra-
caftor en comptoit jufqu’ à foixante-dix.
Nous pouvons ajoûter -que les Allronomes ne fe
mettoientpas fort en peine fi les deux qu’ils admettoient
ainfi étoient réels ou non ; il leur luffifoit qu’ils
puffent fervir à rendre raifondes mouvemens céleftes
, & qu’ils fuffent d’accord avec les phénomènes.
Vqye{ Hypo th èse , S y s t èm e , Phénomène,
&c. Chambers. (O )
Parmi plulieurs rêveries des rabbins , on lit dans
le talmud qu’il y a un lieu où les deux & la terre fe
joignent ; que le rabbi Barchana s’y étant rendu, il
pola fon chapeau fur la fenêtre du ciel, & que l’ayant
voulu reprendre un moment après, il ne le retrouva
plus, les deux l’avoient emporté ; il faut qu’il attende
la révolution des orbes pour le ratraper.
C ie l , ( Théolog.) le ciel des Théologiens, qu’on
nomme aufli le ciel empyrée, eft le féjour de Dieu &
des efprits bienheureux, comme des angës & des
âmes des juftes trépaffés. Voye{ D ieu , Ange , &c.
Dans ce fens ciel eft l’oppofé de l’enfer. Voye{
Enfer.
C ’eft ce ciel empyrée que l’Ecriture fainte nomme
fouvent le royaume des deux , le del des deux, & que
Tome I I I ,
S. Paul, félon quelques-uns, appelle le troifieme ciel,
quelquefois le paradis , la nouvelle Jérufalem , &c.
Voye^ Empyré e , &c.
L’on fe figure ce ciel comme un endroit fitué dans
quelque partie bien éloignée de l’efpace infini, où
Dieu permet qu’on le voye de plus près, & d’une
maniéré plus immédiate ; où il manifefte fa gloire
plus fenfiblement ; où l’on a une perception de fes
attributs plus adéquate qu’on n’en peut avoir dans
les autres parties de l’univers, quoiqu’il y foit également
préfent. Voye^ Univers , Ubiq u ité , &c.
C ’eft aufli en cela que confifte ce que les Théolo^
giens appellent vifion béatifique. Voye^ V ision. Quelques
auteurs ont nié fort legerement, (on ne fait pas
pourquoi ) la réalité d’un femblable ciel local.
Les auteurs infpirés, & fur-tout le prophète Ifaie,
& S. Jean l’évangélifte , font de fuperbes deferip-
tions du ciel, de fa ftruèlure, de fes omemens & era-
belliffemens, & de ia cour qui l’habite.
Le philofophe P laton, dans fon dialogue fur Tame,
parle du del dans des termes fi femblables à ceux
de l’Ecriture fainte, qu’Eufebe n’héfite pas de le taxer
d’avoir emprunté de-là ce qu’il en dit, de protpar.
evangel. lib. X I . cap. xxxvij.
Les anciens Romains, dans leur fyftème de Théologie
, avoient une forte de ciel qu’ils nommoient
champs élyfées, elyjium. Voyeç CHAMPS ELYSÉES.
Le ciel ou le paradis des Mahométans eft une fiction
très-grofliere, conforme au génie de leur religion.
A lco r an & Ma h om é t ism e . (G)
C iel , (Décor, tkéat.') on donne ce nom aux plafonds
de l’opéra, lorlque le théâtre repréfente un
lieu découvert ; comme on dit le ciel d'un tableau.
Lorfque le ciel eft bien peint, qu’on y obferve avec
foin les gradations néceffaires, & qu’on a l’attention
de le bien éclairer, c’ eft une des plus agréables
parties de la décoration. L’effet feroit de la plus grande
beauté, fi on y faifoit fervir la lumière à rendre
aux yeux du fpe&ateur les diverfes teintes du jour
naturel. Dans la repréfentation d’une aurore, d’un
jour ordinaire, ou d’un couchant, ces teintes font
toutes différentes, & pourroient être peintes à l’oeil
par le feul arrangement des lumières. Les frais ne fe-
roient pas plus confidérables, peut-être même feraient
moindres. Cette beauté ne dépend que du
foin & de l’art.
Les plafonds changent avec la décoration par le
moyen du contrepoids. Voy. D é c o r a t io n ,C hangemens
, Plafonds. (5)
C iel de carrière , eft le premier banc qui le
trouve au-deffous des terres en fouillant les carrières
, & qui fert de plafond à mefure qu’on les fouille.
CIEK.ANOW, ( Géog. ) petite ville de Pologne
en Mafovie, dans le palatinat de Czerslco, capitale
du Caftellanio de même nom.
CIEME, (Géog.) ville de la Chine dans la province
de Xantung. Lat. ^C. Z7.
CIERGE ÉPINEUX, (Hijl. nat. bot.) plante qui
i doit être rapportée au genre appellé melocaclus. Voy,
| Me lo c a c t u s . ( / )
Ce cierge s’appelle encore cierge du Pérou , flambeau
du Pérou y cereus peruvianus.
James a manqué de goût en obmettant dans fon
ouvrage la belle & bonne defeription que M. de Juf-
fieu a donnée en 1716 du cierge du Pérou (mém. de
Vacad. des Sc. ann. tyiS. in-40. pag. 14C. avecfig.) ;
je me garderai bien de la fupprimer dans un dictionnaire
où la Botanique exotique, qui eft la moins connue
, doit tenir fa place.
Defeription du cierge épineux du jardin du Roi. Deux
fortes de gens,remarque d’abord M. de Juflieu, nous
ont parlé du cierge épineux, les uns en voyageurs ,
les autres en botaniftes: ceux-là frappés du peu de
reffemblance qu’ils ont vû de cette plante à toutes
K k k ij