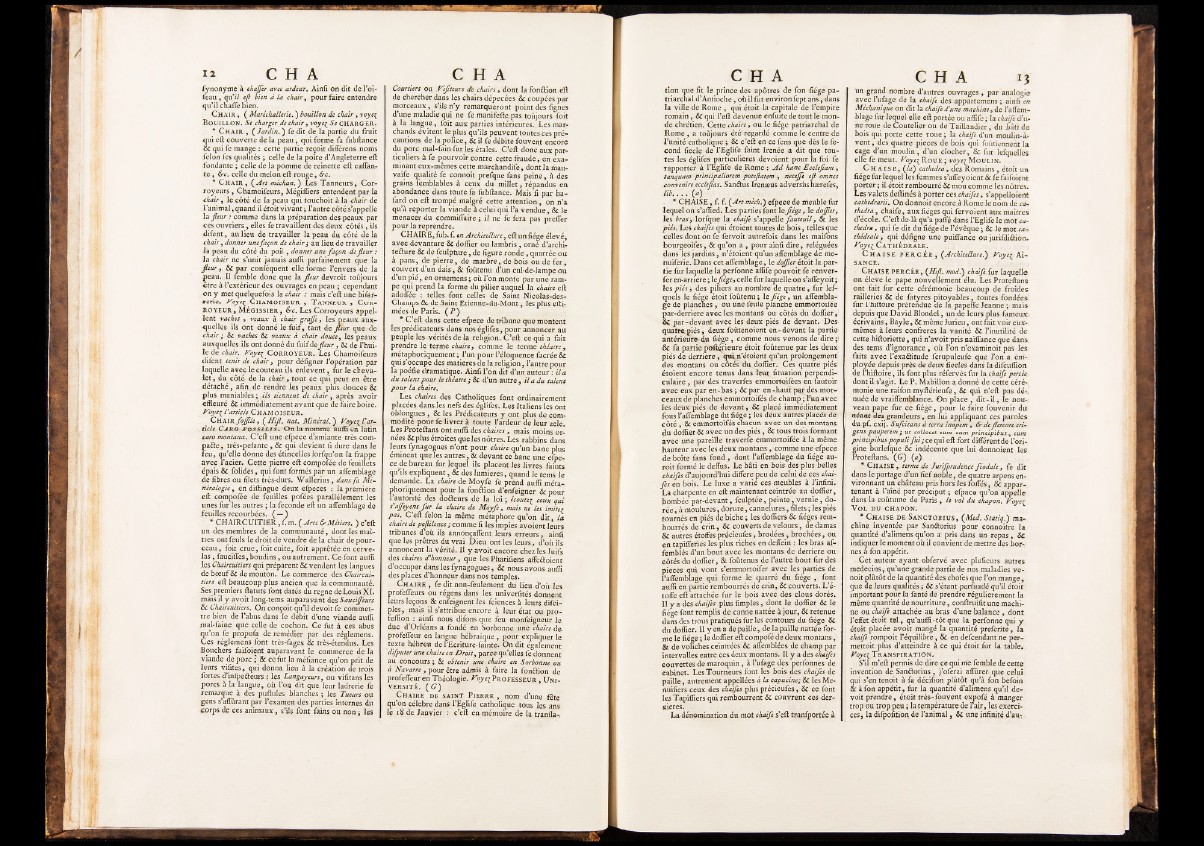
fynonytne à ckafler avec ardeur. Ainfi on dit de l’oi-
ie au , qu’i/ efi bien à la chair, pour faire entendre
qu’ il chafle bien.
C hair , ( Maréchallerie. ) bouillon de chair , voyez
Bouillon. Se charger de chair, voyeç Se CHARGER.
* C ha ir , ( Jardin. ) fe dit de la partie du fruit
qui eft couverte de la peau, qui forme fa fubftance
6c qui fe mange : cette partie reçoit différens noms
félon fes qualités ; celle de la poire d’Angleterre eft
fondante ; celle de la pomme de reinette eft caftante
, &c. celle du melon eft rouge, &c.
* C h a ir , { A m méckan.') Les Tanneurs, Cor-
royeurs, Chamoifeurs, Mégifliers entendent par la
chair, le côté de la peau qui touchoit à la chair de
l’animal, quand il étoit vivant ; l’autre côté s’appelle
la fleur : comme dans la préparation des peaux par
ces ouvriers, elles fe travaillent des deux côtés, ils
difent, au lieu de travailler la peau du côté de la
chair, donner une façon de chair ; au lieu de travailler
la peau du côté du p o il, donner une façon de fleur :
la chair ne s’unit jamais aufli parfaitement que la
fleur, & par conséquent elle forme l’envers de la
peau. Il lemble donc que la fleur devroit toujours
ôtre à l’extérieur des ouvrages en peau ; cependant
on y met quelquefois la chair : mais c’eft une bifar-
t-erie. Voyez Ç h am o iseur , T anneur , C or-
ro yeu r ., Mé g is s ie r , & c. Les Corroyeurs appellent
vaches , veaux à chair grajfe, les peaux auxquelles
ils ont donné le fuif, tant de fleur que de
chair ; & vaches & veaux à chair douce, les peaux
auxquelles ils ont donné du fuif de fleur , & de i’hui-
Ie de chair. Voyez C o rroyeur. Les Chamoifeurs
difent tenir de chair , pour défigner l’opération par
laquelle avec le couteau ils enlevent, fur le chevalet
, du côçé de la chair , tout ce qui peut en être
détaché , afin de rendre les peaüx plus douces &
plus maniables ; ils tiennent de chair, après avoir
effleuré & immédiatement avant que de faire boire.
Voye[ l'article Ç ham o iseur.
C hair fofliLe , ( Hifl. nat. Minéral. ) Voyez Varr
ticle C a k o j f o s s z l z s . On la nomme auflien latin
caro montana. C ’eft une efpece d’amiante très-comp
a re , très-pelante , & qui devient fi dure dans le
feu, qu’elle donne des étincelles lorfqu’on la frappe
avec l’acier. Cette pierre eft compofée de feuillets
épais & folides, qui font formés par un aflemblage
de fibres ou filets très-durs. Wallerius, dans fa Minéralogie
, en diftingue deux efpeces : la première
eft compofée de feuilles pofées parallèlement les
unes fur les autres ; la fécondé eft un aflemblage de
feuilles recourbées. ( — )
* CHAIRCUITIER, f. m. ( Arts & Métiers. ) c’eft
un des membres de la communauté, dont les maîtres
ont feuls le droit de vendre de la chair de pourceau
, foit crue, foit cuite, foit apprêtée en cervelas
, faucilles, boudins, ou autrement. Ce font aufli
les Chaircuitiers qui préparent & vendent les langues
de boeuf & de mouton. Le commerce des Chair cui-
tiets eft beaucoup plus ancien que la communauté.
.Ses premiers ftatuts font datés du régné de Louis XI.
mais il y avoit long-tems auparavant des Saucifleurs
& Chaircuitiers. On conçoit qu’il devoit fe commettre
bien de l’abus dans le débit d’une viande aufli
mal-faine que celle de cochon. Ce fut à ces abus
qu’on fe prqpofa de remédier par des réglemens.
Ces réglemens font très-fages & très-étendus. Les
Bouchers faifoient auparavant le commerce de la
viande de porc ; & ce fut la méfiance qu’on prit de
leurs vifites, qui donna lieu à la création de trois
fortes d’infpefteurs ; les Langayeurs, ou vifitans les
porcs à la langue, où l’on dit que leur ladrerie fe
remarque à des puftules blanches ; les Tueurs ou
gens s’aflurant par l’examen des parties internes du
•corps de ces animaux, s’ils font fains ou non ; les
Courtiers ou Vifiteurs de chairs , dont la fonâion eft
de chercher dans les chairs dépecées & coupées par
morceaux, s’ils n’y remarqueront point des lignes
d’une maladie’qui ne fe manifcfte pas toujours foit
à la langue, foit aux parties intérieures. Les marchands
évitent le plus qu’ils peuvent toutes ces précautions
de la police, & il fe débite fouvent encore
du porc mal-fain fur les étales. .C’eft donc aux particuliers
à fe pourvoir contre cette fraude, en exar
minant eux-mêmes cette marchandise, dont la mauvaise
qualité fe connoît prefque fans peine, à des
grains femblables à ceux du millet, répandus en
abondance dans toute fa fubftance. Mais fi par ha-
fard on eft trompé malgré cette attention, on n’a
qu’à reporter la viande à celui qui l’a vendue, & le
menacer du commiflaire ; il ne fe fera pas prefler
pour la reprendre.
CHAIRE, fub. f. en Architecture, eft un fiége élevé,'
avec devanture & doflier ou lambris, orne d’archi-
tefture & de fculpture, de figure ronde, quarrée ou
à pans, de pierre, de marbre, de bois ou de fe r ,
couvert d’un dais, & foûtenu d’un cul-de-lampe ou
d’un p ié, en ornemens ; où l’on monte par une rampe
qui prend la forme du pilier auquel la chaire eft
adoffée : telles font celles de Saint Nicolas-des-
Champs & de Saint Etienne-du-Mont, les plus efti-
méesde Paris. ( P )
* C ’eft dans cette efpece de tribune que montent
les prédicateurs dans nos églifes, pour annoncer au
peuple les vérités de la religion. C ’eft ce qui a fait
prendre le terme chaire, comme le terme théâtre,
métaphoriquement ; l’un pour l’éloquence facrée &
qui s’occupe des matières de la religion, l’autre pour
la poéfie dramatique. Ainfi l’on dit d’un auteur : il a
du talent pour le théâtre ; & d’un autre , i l a du talent
pour la chaire.
Les chaires des Catholiques font ordinairement
placées dans les nefs des églifes. Les Italiens les ont
oblongues , & les Prédicateurs y ont plus de commodité
pour fe livrer à toute l’ardeur de leur zele.
Les Proteftans ont aufli des chaires , mais moins ornées
& plus étroites que les nôtres. Les rabbins dans
leurs fynagogues n’ont pour chaire qu’un banc plus
éminent que les autres, & devant ce banc une efpece
de bureau fur lequel ils placent les livres faints
qu’ils expliquent, & des lumières, quand le tems le
demande. La chaire de Moyfe fe prend aufli métaphoriquement
pour la fonction d’enfeigner & pour
l’autorité des do&eurs de la loi ; écoutez ceux qui
s'ajfeyent fur la chaire de Moyfe , mais ne les imiter
pas. C ’eft félon la même métaphore qu’on dit, la
chaire de peftilence ; comme fi les impies avoient leurs
tribunes d’où ils annonçaflfent leurs erreurs, ainfi
que les prêtres du vrai Dieu ont les leurs, d’où ils
annoncent la vérité. Il y avoit encore chez les Juifs
des chaires d'honneur, que les Pharifiens affb&oient
d’occuper dans les fynagogues, & nous avons aufli
des places d’honneur dans nos temples.
C h a ir e , fe dit non-feulement du lieu d’où Ios
profeffeurs ou régens dans les univerfités donnent
leurs leçons & enseignent les fciences à leurs difei-
ples, mais il s’attribue encore à leur état ou pro-
feflion : ainfi nous difons que feu monfeigneur le
duc d’Orléans a fondé en Sorbonne une chaire de.
profefleur en langue hébraïque , pour expliquer le
texte hébreu de l’Ecriture-fainte. On dit également
difputer une chaire en Droit, parce qu’elles fe donnent
au concours ; & obtenir une chaire en Sorbonne ou
à Navarre , pour être admis à faire la fonftion de
profefleur en Théologie. Voyez Professeur , Univ
e r s it é . ( G )
C haire de sa in t Pierre , nom d’une fête
qu’on célébré dans l’Eglife catholique tous les ans
le 18 de Janvier : c’eft en mémoire 4e la tranfla-*
tion que fit le prince des apôtres de fon fiége pa-
triarchal d’Antioche, où il fut environ fept ans y dans
la ville de Rome , qui étoit la capitale de l’empire
romain, & qui l’eft devenue enfuite de tout le monde
chrétien. Cette chaire , ou le fiége patriarchal de
Rome , a toujours été regardé comme le centre de
l’unité catholique ; & c ’eft en ce fens que dès le fécond
fiecle de l’Eglife faint Irenée a dit que toutes
les églifes particulières dévoient pour la foi fe
rapporter à l’Eglife de Rome : A d hanc. Ecclefiam ,
tanquam principaliorem potcjlaum , neceffc efl omnes
convenue ecclefias. S an élus Irenæus adversùs hærefes,
ü b .. . . (a)
* CHAISE, f. f. {Art méché) efpece de meuble fur
lequel on s’aflîed. Les parties font le fiége, le doflier,
les bras;-lorfque la chaife s’appelle fauteuil, & les
fliés. Les ckaifes qui étoient toutes de bois, telles que
celles dont on fe fervoit autrefois dans les maifons
botirgeoîfes, & qu’on a , pour ainfi dire, reléguées
dans les jardins, n’étoient qu’un aflemblage de me-
nuiferie. Dans cet affemblage, le doflier étoit la partie
fur laquelle la perfonne aflife pouvoit fe renver-
fer en-arriere ; lefiége, celle fur laquelle on s’afleyoit ;
les piés ', des piliers au nombre de quatre, fur lesquels
le fiége étoit foûtenu ; le fiége, un aflemblage
de planches , ou une feule planche emmortoifée
par-derriere avec les montans ou côtés du doflier,
& par-devant avec les deux piés de devant. Des
quatre.piés, deux foûtenoient en-devant la partie
antérieure* du fiége, comme noiis venons de dire ;t
& fa partie poftmieure étoit foûtenue par les deux
piés de derrière , qui .n’étoient qu’un prolongement'
des montans ou cotés du doflier. Ces quatre piés
étoient encore tenus dans leur fituation perpendiculaire
, par des traverfes emmortoifée s en lautoir
avec eux par en-bas ; & par en -»haut par des morceaux
de planches emmortoifés de champ ; Fun avec
lés deux piés de devant, Sc placé immédiatement
fous l’aflemblage du fiége ; les deux autres placés de
côté , & emmortoifés chacun avec un des montans
du doflier & avec un des p iés, & tous trois formant
avec une pareille traverle emmortoifée à la même
hauteur avec les deux montans , comme une efpece
de boîte fans fon d, dont l’aflemblage du fiége au-
roit formé le deflus. Le bâti en bois des plus belles
chaifes d’aujourd’hui différé peu de celui de ces chai-
fes en bois. Le luxe a varie ces meubles à l’infini.
La charpente en eft maintenant ceintrée au doflier,
bombée par-devant, fculptée, peinte, vernie, dorée
, à moulures, dorure, cannelures, filets ; les piés
tournés en piés de biche ; les dofliers & fiéges rembourrés
de crin, & couverts de velours, de damas
& autres étoffes précieufes, brodées, brochées, ou
en tapifferiës les plus riches en deffein : les bras af-
femblés d’un bout avec les montans de derrière ou
côtés du doflier, & foûtenus de l’autre bout fur des
pièces qui vont s’emmortoifer avec les parties de
l’aflemblage qui forme le quarré du fiége , font
aufli en partie rembourrés de crin, & couverts. L’étoffe
eft attachée fur le bois avec des clous dorés.
Il y a des chaifes plus fimples, dont le doflier & le
fiége font remplis de canne nattée à jour, & retenue
dans des trous pratiqués fur les contours du fiége &
du doflier. Il y en a de paille, de la paille nattée forme
le fiége ; le doflier eft compofé de deux montans,
& de voliches ceintrées & afl’emblées de champ par
intervalles entre ces deux montans. Il y a des chaifes ;
couvertes de maroquin, à l’ufage des perfonnes de
cabinet. Les Tourneurs font les bois des chaifes de
paille, autrement appellées à la capucine; & les Me-
nuifiers ceux des chaifes plus précieufes, & ce font
les Tapifliers qui rembourrent & couvrent ces dernières.
La dénomination du mot chaife s’eft tranfportée à
un grand nombre d’autres ouvrages , par analogie
avec l’ufage de la chaife des appartemens ; ainfi en
Mechanique on dit la chaife d'une machine, de l’aflemblage
fur lequel elle eft portée ou aflife ; la chaife d’une
roue de Coutelier ou de Taillandier, du bâti de
bois qui porte cette roue ; la chaife d’un mouiin-àr
v en t, des quatre pièces de bois qui foûtiennent la
cage d’un moulin, d’un clocher, & fur lefquelles
elle fe meut. Voye^ R oue ; voye[ M oulin.
. C h a i s e , {là) cathedra, des Romains, étoit un
fiége fur lequel les femmes s’affeyoient & fe faifoient
porter ; il étoit rembourré & mou comme les nôtres.
Les valets deftinés à porter ces chaifes, s’appelloiertt
cathedrarii.. On donnoit encore,.à Rome le nom dé cathedra,
chaife, aux fiéges qui fervoient aux maîtres
d’école. C ’eft de-là qu’a paflip dans l’Eglife le mot cathedra,
qui fe dit du fiége de l’évêque ; & le mot cathédrale
, qui défigne une puiffance ou jurifdiôion.
Voye{ C a th éd r al e .
C HA i s E P ER C É E , {.Architecture.) Voyeç. Ai -
san c e .
C haise p e r c é e , (’Hifl. modé) chaife fur laquelle
on éleve le pape nouvellement élu. Les Proteftans
ont fait fur cette cérémonie beaucoup de froides
railleries & de fatyres pitoyables, toutes fondées
fur l ’hiftoire prétendue de la papeffe Jeanne ; mais
depuis que David Blondel, un de leurs plus fameux
écrivains, Bayle, & même Jurieu, ont fait voir eux-
mêmes à leurs confrères la vanité & l’inutilité de
cette hiftoriette, qui n’avoit pris naiflance que dans
des tems d’ignorance , où l’on n’examinoit pas les
faits avec l’exaâitude fcrupuleufe que l’on a employée
depuis près de deux fiecles dans la difeufflon
de l’hiftoire, ils font plus réfervés fur la chaife percée
dont il s’agit. Le P . Mabillon a donné de cette cérémonie
une raifbn m yftérieufe, & qui n’eft pas dé-,
nuée de vraiffemblance. On place , d i t - il, I.e nou-r
veau pape fur ce fiégè, pour le faire fouvenir du
néant des grandeurs, en lui appliquant ces paroles
du. pf. exij. Sufcitans à terra inopem , & de flercore eri-
gens pauperem i ut collocct eum cum principibus , cum
principibus populi fu i; ce qui eft fort différent de l’origine
burlefque & indécente que lui donnoient les
Proteftans. (G) {à)
* C haise , terme de Jurifprudençe féodale , fe dit
dans le partage d’un fief noble, de quatre arpens environnant
un château pris hors les tofles, & appartenant
à l’aîné par préciput ; efpace qu’on appelle
dans la coutume de Paris , le vol du chapon. Voyez
V o l du ch apo n .
* C haise de Sa n c t o r iu s , {Med. Statiq.) machine
inventée par San&orius pour connoître la
quantité d’alimens qu’on a pris dans un repas , &
indiquer le moment où il convient de mettre des bornes
a fon appétit.
Cet auteur ayant obfervé avec plufieurs autres
médecins, qu’une grande partie de nos maladies ve-
noit plutôt de la quantité des chofesque l’on mange,
que de leurs qualités ; & s’étant perliiadé qu’il étoit
important pour la fanté de prendre régulièrement la
même quantité de nourriture, conftruifit une machine
ou chaife attachée au bras d’une balance , dont
l’effet étoit t e l, qu’aufli-tôtque la perfonne qui y
étoit placée avoit mangé la quantité preferite, la
chaife rompoit l’équilibre, & en defeendant ne per-
mettoit plus d’atteindre à ce qui étoit fur la table.
Voyez. T ran sp ira t io n .
S’il m’eft permis de dire ce qui me femble de cette
invention de Sanftorius , j’oferai aflurer que celui
qui s’en tenoit à fa décifion plutôt qu’à fon befoin
& à fon appétit, fur la quantité d’alimens qu’il de-
yoit prendre, étoit très-fouvent expofé à manger
trop ou trop peu ; la température de l’air, les exercices,
la difpoûtion de l’animal, & une infinité d’au