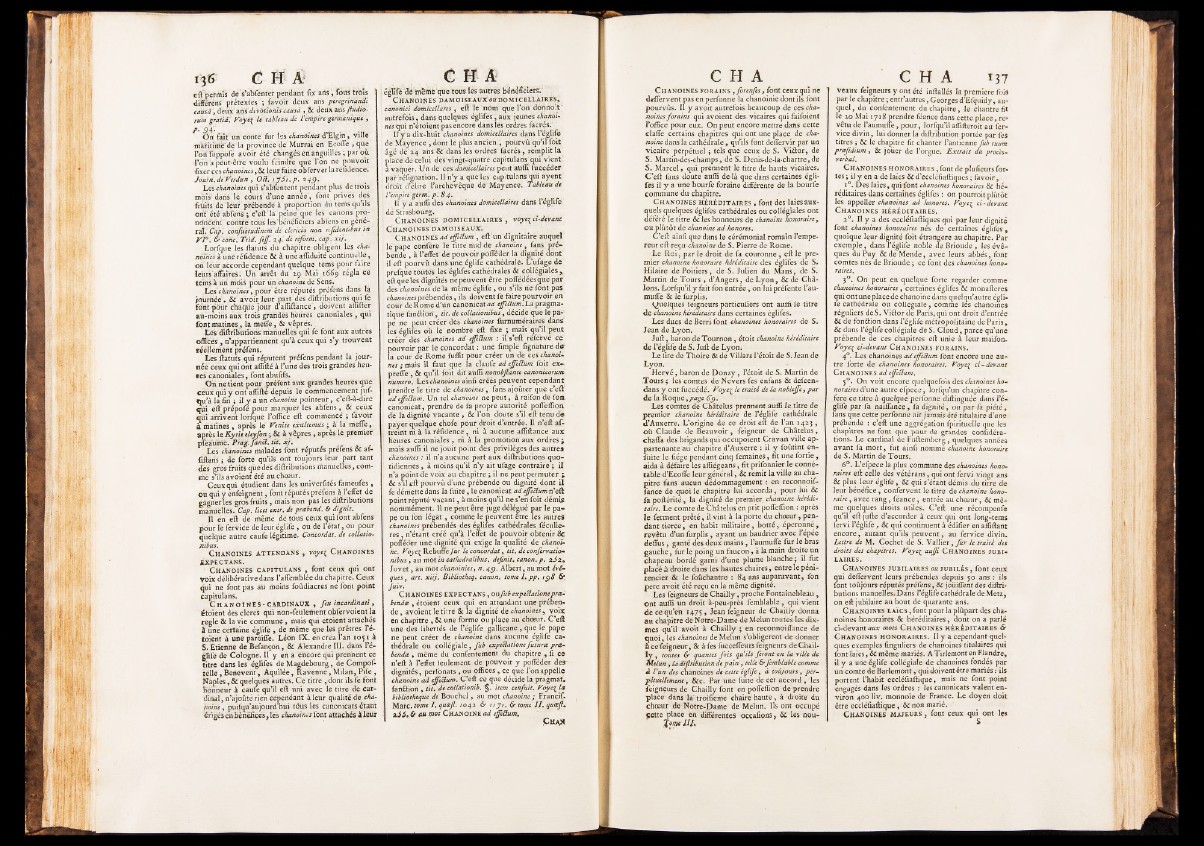
e fl permis de1 s’abfenter pendant lix arts, fous trois
■ difterénS prétextes ; fa voir deux ans ptrigfiriàniî
causa, deux' ans dtvoiîoriîs causa , & deux ans Jtudio-
jum gratta. Voyc{ le tableau de l empire germanique ,
p. cfj.
On fait un conte fur les chanoines d’EIgin, ville
màritimë'de la province de Murrai en Eco Aie ,<jue
l?on* ftippofé avoir été changés en angüiliés ; par où
l’on a peut-être voulu feindre que l’on ne pouvoit
üxer ces chanoines, & leur faire obferver larélidence.
Jouiri.dt ’ Vcrditn , O cl. l'ySi.p . 2 4p.
Les chanoines qui s’abfentent pendant plus de trois
mois'dans, lè cours d’une année, font privés des
früits de leur' prébende à proportion du téms qu’ils
o n fé te abfens ; c’eft1 la peine '.que les canons prononcent
contre toiïs les bénéficiers abfens en général."
Cap ', corifuetüdiném de cléricis non réfidentibus in
V l° . & coric: fridl Jejf. 24. de r'eform. cap', xi/.
Lorfque les ftatuts du chapitre, obligent lès chanoines
à une rélidence & à une affiduité continuelle,
oiï leur accorde cependant quelque tems pour faire
leùrsaffâirès. Uni arrêt dû 19 tàâi 1669 régla ce
temsà un mois pour ùnckanoine deSëns.
Les’chanoines, pouf être réputés preféns dans la
journée , & . avoir leur part des diftribùtions qui fe
font pour chaque jour d’affiftknce, doivent afliftër
au-moins aux trois grandes heures canoniales , qui
font matines,, la me d e , & vêpres.
Lésdiftribütions mànüélles qUi fe font aüx autres
offîfcës , n’appartiennent qu’à ceux qui s’y trouvent
réellement' préfens.
Les ftatuts qui réputent préfens pendant la journée
ceux qui ont affilié à l’une des trois grandes heures
canoniales, font abufifs.
On ne tient pour préfeht aux grandes heures qüe
ceux qui y ont affidé depuis le commencement juf-
tqu’à la lin ; il y a un chanoine pointeur, c’eft-à-dire
qui eft prépofe pour marquer les abfèns , & ceux
qui arrivent lorlque l’office ell commencé ; fàvoir
à matines , après le Venite exultemûs ; à la melfe,
après le Kyrie eleyfon ; & à vêpres , apres lé premier
pfeàumé. Prag.Janci. tit. x j. #
Les cfiarioines malades font réputés preféns & af-
lîllâris ; de forte qu’ils ont toujours leur part tant
dés gros fruits que des diftribùtions manuelles, comme
s’ils avoient été auchoe'ur.
Ceux qui étudient dans les univerfités fameufes ,
ou qui y enfeignënt, font réputés préfens à,l’effet de
gagner les gros fruits, mais non pas lés distributions
mânuëlles. Cap. licei extr. de prabend. & digriit.
Il en ell de même dé tous ceux qui font abfens
pour le fervice de leur églife , ou de 1 é tat, ou pour
quelque autre caufe légitime. Concordat, de collatio-
Jllbus.
C hanoines a t t e n d a is , voyei C hanô iNes
EXPEC T ANS.
C hanoines cap itü lans , font cëux qui ont
voix délibérative dans l’affemblée du chapitre. Ceux
qui ne font pas aii moins foûdiacres ne font point
capitülans.
C h a n o in e s - cardin au x , feu incàrdinati,
étoient des clercs qui non-feulement obier voient la
réglé & la vie commune, mais qui étoient attachés
à une certaine églife , de même que les prêtres l’é-
toient à une parôiffe. Léon IX. en créa l’an 1051 à
S. Etienne de Befànçôri, & Alexandre III. dans l’é-
gtifé de Cologne. 11 y eh a encore qui prennent ce
titre dans les églifes de Magdebourg, de Compof-
té lle , Benevent, Aquilée, Ravenne, Milan, Pife ,
Naples, & quelques autres. C e titre , dont ils fe font
honneur à caule qu’il ell uni avec le titre de cardinal,
n’ajoûté rien cependant à leur qualité de chanoine
, puifqu’àujourd’hu» fous les canonicats étant
érigés en bénéfices,les chanoines (ont attachés à leur
égbîè de même que tous les autres bénéficiers'/
C hanoiHes3jamo iseauxW d om icèl là ires,
cahonici domicdlares , ell le nom que l’ôh dohnôit
autrefois, dans quelques églifes, aux jeunes chanoines
qui n’étoient pas encore dans lés ordres facrés.'
Il' y a dix-huit chanoines domicellaites dans l’églife
de MàyënCe , dont lé plus ancien , pourvu qu’il fôit
âge dé 14 ans & dans les ordres "facrés, remplit la
tecé'de celui dés vingt-qùatré capitülans qui vient'
Vaquer. Un de çes domicellàires peut auffi luccéder
par'réfignatiôh. l ln ’y a qiié'les capitülans qui ayent
droit d’élire l’archevêque de" Mâyence. Tableau de
l'empire gertri. p . 84.
H ÿ a auffi des chanoines domiciliaires dans l’églife
dé Strasbourg.
C hanoines d oMïCellaiRês , voye( ci-devant
C hanoines dam oise au x '.
C hanoines ad effeclüm , ell un dignitaire auquel
le pape conféré le titre riud de chanoine, fans prébende
, à l’effet de pouvoir poffédèr là dignité dont
ile lt pourvu dans u n e églife cathédrale. L’ufage de
prefque toutes les églifes cathédrales & collégiales ,
ell que les dignités ne peuvent être poffédéêsque par
des chanoines de la même églife , ou s’ils rie1 font pas
chanoines prébendes, ils doivent fe faire pourvoir en
cour de Rome d’un canonicat ad cjfeclum.La pragmatique
fanâiori, tit. de cOllationibus, décide cjile le pa^
pe ne peut créer dès chanoines fürriuméfaires dans
les églifes où le nombre ell fixe ; mais qu’il peut
créer dés chanoines ad cjfeclum : il s’eft réfervé ce
pouvoir par le concordat : une fimple lignaturé delà
cour de Rome fuffit pour créer un dé ces chanoines
; mais il faut que la claufe ad effeclüm foit ex-
prelfe , & qu’il foit dit auffi nonobjlante canonicorurrt
numéro. Les chanoines ainli crées peuvent cependant
préndrë lé titre de chanoines, fans ajouter que c’ell1
àdeffeclüm. Un tel chanoine ne peut, à raifon de fott-
canonicat, prendre de fa propre autorité pofleffion
dé la dignité vacante , &' l’on douté s’il ell tenu de
payer quelque çhofe pour droit d’entrée. Il n’ell af-
treirit ni à la rélidence , ni à aucune affillance aux
heures canoniales , ni à la promotion aux ordres ÿ
màiS auffi il ne jouit point des privilèges des autres
chanoines : i l n’a auCurie part aux dillnbutions quotidiennes
, à moins qu’il n’y ait ufage contraire ; il
n’a point de voix au chapitre ; il ne peut permuter j
& s’il ell pourvu d’une prébende ou dignité dont il
fe démette dans la fuite, le canonicat ad effeclüm n’ell
point réputé vacant, à moins qu’il ne s’en foit démis
nommément. 11 ne peut être juge délégué par le pape
oit foii lég a t , comme le peuvent être les autres'
chanoines prébendés des églifes cathédrales féculie-
r'es, n’étant créé qü’à l’effet de pouvoir obtenir &
poffédèr une dignité qui exige la qualité de chanoine.
Voye{ Rebuffe fur le concordat, tit. de confervatio»
nibus , au mot in cathedralibus, définit. canon, p. 262-
jo v e t , au mot chanoinics, n. 4g. Albert, au mot évêques
, art. xiij. Bibliotheq. canon. tomel. pp. ig8 &.
fuiv.
CHANOINES EXPECTANS, oufub expeclationeproe-
bendee , étoient ceux qui en attendant une preben*
d e , avoient le titre & la dignité dé chanoines, voix
en chapitre , & une forme ou place au choeur. C ’eft
une des libertés de l’églife gallicane , que le pape
ne peut créer de chanoine dans aucune églife ca-
" thédrale ou collégiale, fub expeclatione futurce proe-
benda , même du eonfentettient du chapitre , fi ce
n’ell à l’effet feulement de pouvoir y poffédèr desdignités
, perfonats , ou offices, ce que l’on appelle
chanoine ad effeclüm. C’ell ce que décide la pragmat.
fanûion , tit. de collaiionib. § . item cenfuit. Voye^ la
bibliothèque de Bouchel, au mot chanoine ; Francîf.
Marc, tome 1. quaft. 1.042 & 11 J i . & tome I I . queefi.
(/ au mot C hanoine ad effeclüm,
Çhan
C hanoines forains ,forenfes, font ceux qui ne
deffervent pas en perfonne la chanoinie dont ils font
pourvus. Il y avoit autrefois beaucoup de ces chanoines
forains qui avoient des vicaires qui faifoient
l’office pour eux. On peut encore mettre dans cette
da lle certains chapitres qui ont une place de chanoine
dans la cathédrale, qu’ils font deffervir par un
vicaire perpétuel ; tels que ceux de S. Viélor, de
S. Martimdes-champs, de S. Denis-de-la-chartre,de
S. Marcel, qui prennent le titre de hauts vicaires.
C ’ell fans doute auffi de là que dans certaines églifes
il y a une bourfe foraine différente de la bourfe
commune du chapitre.
C hanoines héréditaires , font des laïcs auxquels
quelques églifes cathédrales ou collégiales ont
déféré le titre & les honneurs de chanoine honoraire,
ou plutôt de chanoine ad honores.
C ’ell ainli que dans le cérémonial romain l’empereur
ell reçu chanoine de S. Pierre de Rome.
Le R o i, par le droit de fa couronne, ell le premier
chanoine honoraire héréditaire des églifes de S.
Hilaire de Poitiers, de S. Julien du Mans, de S.
Martin de Tours , d’Angers, de L y on , & de Châ-
lons. Lorfqu’il y fait fon entrée, on lui préfente l’au-
muffe & le furplis.
Quelques feigneurs particuliers ont auffi le titre
de chanoine héréditaire dans certaines églifes.
Les ducs de Berri font chanoines honoraires de S.
Jean de Lyon.
Jull, baron de Tournon, étoit chanoine héréditaire
de l’églife de S. Jull de Lyon.
Le lire de Thoire & de Villars l ’étoit de S. Jean de
Lyon.
Hervé, baron de D o n zy , l’étoit de S. Martin de
Tours ; les comtes de Nevers fes enfans & defeen-
dans y ont fuccédé. Voye£ le traité de la nobleffe} par
de la Roque ,page 6$.
Les comtes de Châtelus prennent auffi le titre de
premier chanoine héréditaire de l’églife cathédrale
d’Auxerre. L’origine de ce droite« de l’an 1423,
où Claude de Beauvoir, feigneur de Châtelus,
chaffa des brigands qui occupoient Cravan v ille appartenante
au chapitre d’Auxerre : il y foûtint en-
fuite le liège pendant cinq femaines, fit une fortie,
aida à défaire les affiégeans, fit prifonnier le connétable
d’Ecofle leur général, & remit la ville au chapitre
fans aucun dédommagement : en reconnoif-
fance de quoi le chapitre lui accorda, pour lui &
fa pofférité, la dignité de premier chanoine héréditaire.
Le comte de Châtelus en prit pofleffion : après
le ferment prêté, il vint à la porte du choeur, pendant
tierce, en habit militaire, botté, éperonne ,
revêtu d’un furplis , ayant un baudrier avec l’épée
deflus, ganté des deux mains, l’aumuffe fur le bras
gauche, fur le poing un faucon, à la main droite un
chapeau bordé garni d’une plume blanche; il fut
placé à droite dans les hautes chaires, entre le pénitencier
& le foûchantre ; 84 ans auparavant, fon
pere avoit été reçu en la même dignité.
Les feigneurs de C hailly, proche Fontainebleau,
ont auffi un droit à-peu-près femblable, qui vient
de oe qu’en 1475 » Jean feigneur de Chailly donna
au chapitre dé Notre-Dame de Melun toutes les dix-
mes qu’il avoit à Chailly ; en reconnoiffance de
quoi, les chanoines de Melun s’obligèrent d e donner
â ce feigneur, & à fes fucceffeurs feigneurs de Chaill
y , toutes & quantes fois qu'ils feront en la ville de
Melun, ladifinbution de pain , telle & Jèmblable comme
à l'un des chanoines de cette églife, à toujours, perpétuellement
, & c . Par une fuite de cet accord , les
feigneurs de Chailly font en pofleffion de prendre
place dans la troifieme chaire haute, à droite du
choeur de Notre-Dame de Melun. Ils ont occupé
cette place en différentes occafions, & les nou-
fomc I I I .
veaux feigneurs y ont été inflallés la première fois
par le chapitre ; entr’autres, Georges d’Efquidy, auquel
, du confentement du chapitre, le chantre fit
le xo Mai 1718 prendre féance dans cette place, re*
vêtu de Paumuue, pour, lorfqu’il aflifteroit au fer-
vice d ivin, lui donner la diflribution portée par fes
titres ; & le chapitre fit chanter l’antienne fub tuum
præfidium, & joüer de l’orgue. Extrait du procès-
verbal.
C hanoines honoraires , font de plufieurs fortes;
il y en a de laïcs & d’eccléfiaftiques ; fa voir,
i° . Des laïcs, qui font chanoines honoraires & héréditaires
dans certaines églifes : on pourroit plutôt
les appeller chanoines ad honores. Voyer ci-devant
C hanoines h ér éd ita ire s.
2°. Il y a des eccléfiafliques qui par leur dignité
font chanoines honoraires nés de certaines églifes ,
quoique leur dignité foit étrangère au chapitre. Par
exemple, dans l’églife noble de Brioude, les évêques
duPuy & de Mende, avec leurs abbés, font
comtes nés de Brioude ; ce font des chanoines honoraires,
3°. On peut en quelque forte regarder comme
chanoines honoraires, certaines églifes & monafleres
qui ontuneplacede chanoine dans quelqu’autre églife
cathédrale ou collégiale, comme les chanoines
réguliers de S. Vi&or de Paris, qui ont droit d’entrée
& de fon&ion dans l’églife métropolitaine de Paris,
& dans l’églife collégiale de S. Cloud, parce qu’une
prébende de ces chapitres ell unie à leur maifon.
Voye{ ci-devant CHANOINES FORAINS.
40. Les chanoines ad effeclüm font encore une autre
forte de chanoines honoraires. Voye£ ci-devant
C hanoines ad effeclüm.
5°. On voit encore quelquefois des chanoines honoraires
d’une autre efpece, lorfqu’un chapitre conféré
ce titre à quelque perfonne diflinguée dans l ’églife
par fa naiflance, fa dignité, ou par fa piété ,
ians que cette perfonne ait jamais été titulaire d’une
prébende : c’eft une aggrégation fpirituelle que les
chapitres ne font que pour de grandes confidéra-
tions. Le cardinal de Fuftemberg, quelques années
avant fa mort, fut ainfi nommé chanoine honoraire
de S. Martin de Tours.
6°. L’efpece la plus commune des chanoines honoraires
eft celle des vétérans, qui ont fervi vingt ans
& plus leur églife, & qui s’étant démis du titre de
leur bénéfice, confervent le titre de chanoine honoraire
, avec rang, féance, entrée au choeur, & même
quelques droits utiles. C ’eft une récompenfe
qu’il eft jufte d’accorder à ceux qui ont long-tems
fervi l’églife, & qui continuent à édifier en affiftant
encore, autant qu’ils peuvent, au fervice divin.
Lettre de M. Cochet de S. Vallier, fur le traité des
droits des chapitres. Voye{ auffi CHANOINES JUBILAIRES.
C hanoines jubilaires ou jubilés , font ceux
qui deffervent leurs prébendes depuis 50 ans : ils
font toûjours réputés préfens, & joiiiffent des diftri-
butions manuelles. Dans l’églife cathédrale de Metz,
on eft jubilaire au bout de quarante ans.
C hanoines laïcs , font pour la plûpart des chanoines
honoraires & héréditaires, dont on a parlé
ci-devant aux mots C hanoines héréditaires &
C hanoines honoraires. Il y a cependant quelques
exemples finguliers de chanoines titulaires qui
font laïcs, & même mariés. A Tirlemont en Flandre,
il y a une églife collégiale de chanoines fondés par
un comte de Barlemont, qui doivent être mariés : ils
portent l’habit eccléfiaftique, mais ne font point
engagés dans les ordres : les canonicats valent environ
400 liv. monnoie de France. Le doyen doit
être eccléfiaftique, & non marié.
C hanoines majeurs , font ceux qui ont lçs