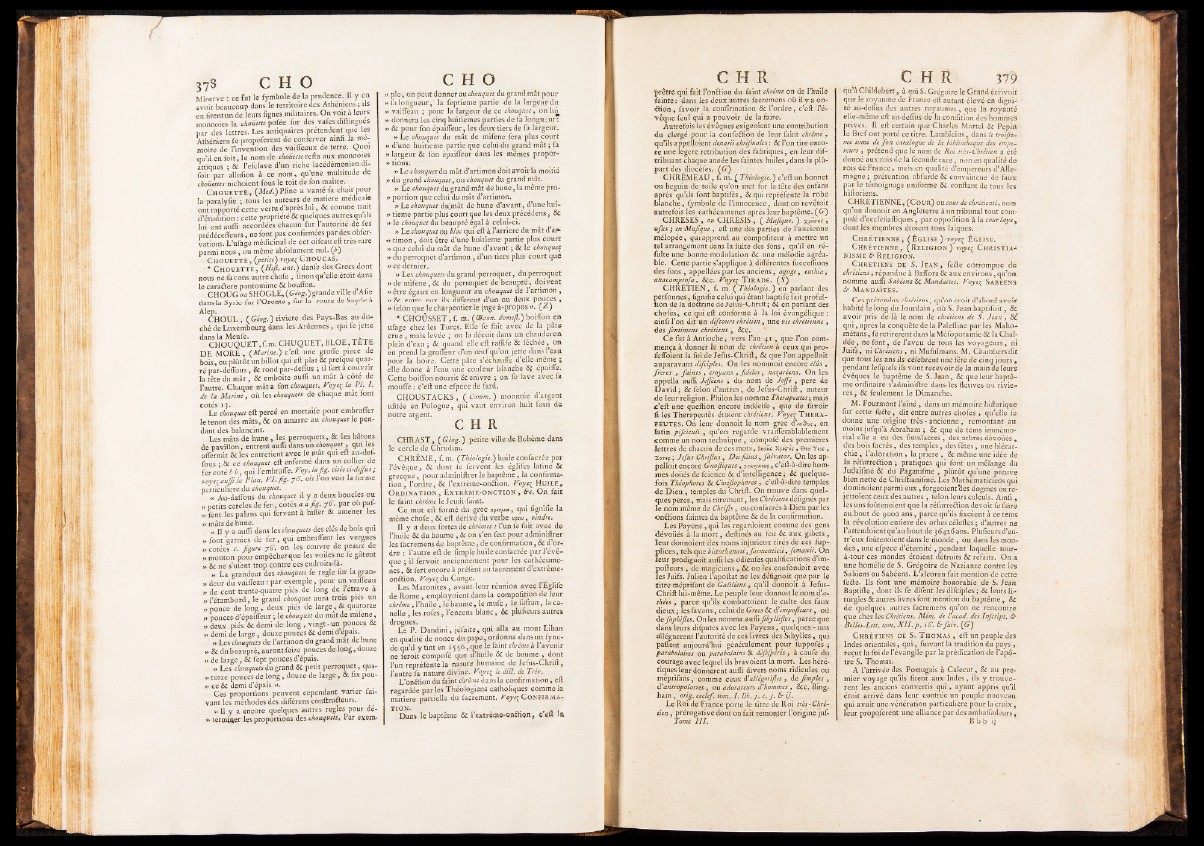
Minerve * ce fin le fymbole de la prudence. II. y en
avoir beaucoup dans le territoire des Athéniens ; ils |
en firent un de leurs fignes .militaires. On voi t à leurs
montioies là choiicuc pofée fur des vafes diftmgués
par des lettres. Les antiquaires prétendent que les
A th é n ie n s fepropoferent de çonterver ainfi lame-
moire de l’invention- des vaifieaux de terre. Quoi
qu’ile n fo it ;le nom.de■ chouettere&i aux monnoies
attiques ; & l’efciave d’un riche lacédémonien dl-
foitnpar allufion à ce nom, qu’une miiltitude de
chouettes nichoient faits lé toit de fon maître.
C h o u e t t e , {M e d .)Pline a vanté fa chair pour
la-paralyfie ;,tous les auteurside matière médicale
ont rapportéicette vertu d’après lu i , & comme trait
d’érudition : cette propriété & quelques antres qu ils
lui ohtauffi accordées chacun fur l’autorité de fes.
prédéceffeurs, ne font pas confirmées par-des obier.;
vàtions. L’ufage médicinal de cet.oifeau eft très-rare
parmi nous jUit même abfolument nul. 0 ,
i iC ho ue tte , {petite) v e y e id n o v c a s . ■
» C h o u e t t e , {H ijl.,a n ç .)danfe.des Grecs;dont
nous ne favons autre chofe , iinon qu eilc.etoir dans
le caraftere pantomime & bouffon.
CHOUG ou SHÔGLE, {Géog.) grande ville d Afie
dans la Syrie fur l’Oronte , fur la route de Sayde à
Alep. ,
CHOUL , { Géog. ) riviere des Pays-Bas au duché
de Luxembourg dans les.Ardennes, qui fe jette
dans la Meufe.
i i CHOUQUET, f. m. CHUQUET, BLOE, TÊTE
D E M OR E , {Marine.) c ’efi.aine greffe, piece de
bois. ou plûtôt un billot qui cil plat fie prefque quar-
ré par-dèffous, & rond par-deffus ; il fert à couvrir
la tête du mât, & emboîte auffi un mât A-côté de
l’autre. Chaque mat a (oa clunequee. Voye{ la t l . 1.
de la Marine , où les chouquet? de chaque mat font
cotés 13. ... ,
Le choùqua eft percé en mortaife pour embrafler
lé tenon des mâts, & on amarre au chouquet le pen-
dant des balancins.
Les mâts de hune ,.les perroquets, & les butons
de pavillon, entrent aufli dans un chouquet, qui les
affermit & le s entretient avec le mât qui eft au-def-
fous ; & ce chouquet eft enfermé dans un collier de
fer coté b b , qui l’embraffe. Voy. lafig. citée ci-dejfus;
voyci aujfila Plan. VLfig. 7 6' oil 1>on volt la forme ,
particulière du chouquet. .
« Au-deffous du chouquet il y a deux boucles ou
» petits cercles de fe r , cotés « afig. 76, par où paf-
» fent les palans qui fervent à hiffer & amener les
» mâts dehune. , , , , .
» Il y a aufli dans les chouquets des clés de bois qui
„ font garnies de fe r , qui embraffent les vergues
» cotées r. figure 7 6 . on les couvre de peaux de
>> mouton pour empêcher que les voiles ne fe gâtent
» 6c ne s’ufent trop contre ces endroits-là.
» La grandeur des chouquets fe réglé fur la gran-
» deur du vaifleau : par exemple, pour un vaifleau
» de cent trente-quatre pies de long de 1 etrave à
» l’étambord, le grand chouquet aura trois pies un
» pouce de long, deux piés de large, & quatorze
» pouces d’épailfeur ; le chouquet du mat de mifene,
» deux piés 6c demi de long , vingt-un pouces 6c
» demi de large, douze pouces 6c demi d épais.
» Les chouquets de l’artimon du grand mât de hune
» 6c du beaupré, auront feize pouces de long, douze
» de large,, 6c fept pouces d’épais.
„ Les chouquets du grand & petit perroquet, qua-
» torze pouces de long, douze de large, & fix pou-
» ce 6c demi d’épais ». - :'r v .
Ces proportions peuvent cependant varier fui-
vant les méthodes des différens conftruôeurs. ^
« Il y a encore quelques autres réglés pour de-
» terminer les proportions des chouquets. Par exem-
» pic , on peut donner au chouquet du grand mât pour
»la longueur, la feptieme partie de la largeur du
» vaifleau ; pour la largeur de ce chouquet, on lui
» donnera les cinq huitièmes parties de la longueur :
» 6c pour fon épaiffeur, les deux tiers de fà largeur.
» Le chouquet du mât de mifene fera plus court
» d’une huitième partie que celui du grand mât ; fa
» largeur & fon épailfeur dans les mêmes propor-
»’tions.
» Le chouquet du mât d’artimon doit avoir la moitié
» du grand chouquet, ou chouquet du grand mât.
» Le chouquet du grand mât de hune, la même pro-
» portion que celui du mât d’artimon.
» Le chouquet du mât de hune d’avant, d’une hui-
» tieme partie plus court que les deux précédens, 6c
» le chouquet du beaupré égal à celui-ci.
» Le chouquet ou bloc qui eft à l’arriere du niât d’a>
»> timon, doit être d’une huitième partie plus court
» que celui du mât de hune d’avant ; & le chouquet
» du perroquet d’artimon, d’un tiers plus court que
» ce dernier.
» Les chouquets du grand perroquet, du perroquet
» de mifene, 6c du perroquet de beaupré, doivent
» être égaux en longueur au chouquet de l’artimon ,
» & entre eux ils different d’un ou deux pouces,
»félon que le charpentier le juge à-propos». (Z )
* CHOÛSSET, f. m.((Econ. domefi.) boiffon en
ufage chez les Turcs. Elle fe fait avec de la pâte
: crue , mais levée.;, on la décuit dans un chauderon
plein d’eau ; & quand elle eft ralîife & fechee, on
en prend la groffeur d’un oeuf qu’on jette dans l’eau
pour la boire. Cette pâte s’échauffe d’elle-même ;
elle donne à I’èau une couleur blanche 6ç épaiffe.
; Cette boiffon nourrit 6c enivre ; on fe lave avec fa
moufle : c’eft une efpece de fard.
CHOUSTACKS , ( Comm. ) monnoie d’argent
ufitée en Pologne, qui vaut environ huit fous de
notre argent.
C H R
CHRAST, ( Géog, ) petite ville de Bohème dans
le cercle de Chrudim.
CHRÊME, f. m. (Théologie.')huile confacrée par
l’évêque, 6c dont le fervent les églifes latine &
grecque, pour adminiftrer le baptême, la confirmation,
l’ordre, 6c l’extrème-onéHon. Voye^ Hu il e ,
O rd in at ion , Extrême-o n c t io n , &c. On fait
le faint chrême le Jeudi-faint.
Ce mot eft formé du grec qui lignifie la
même chofe, 6c eft dérivé du verbe xpia, oindre.
Il y a deux fortes de chrêmes : l’un fe fait avec de
l’huile 6c du baume, & on s’en fert pour adminiftrer
les facremens de baptême, de confirmation, 6c d’ordre
: l’autre eft de Ample huile confacrée par l’évêque
; il fervoit anciennement pour les cathécume-
nes, & fert encore à préfent au facrement d’extrême-
onûion. Voye{ du Cange. •
Les Maronites, avant leur réunion avec l’Eglife
de Rome , employoient dans la composition de leur
chrême, l’huile , le baume, le mufe, le fafran, la ca-
nelle , les rofes, l ’encens blanc, & plufieurs autres
drogues.
Le P. Dandini, jéfuite, qui alla au mont Liban
en qualité de nonce du pape, ordonna dans un fyno-
de qu’il y tint en 1556, que le faint chrême à l ’avenir
ne lèroit compofé que d’huile & de baume , dont
l’un repréfente la nature humaine de Jefus-Chrift,
l’autre fa nature divine. Vjyei le dicl. de Trév,
L’on&ion du faint çhrême dans la confirmation, eft
regardée parles Théologiens catholiques comme la
matière partielle du facrement. Poye^ C onfie ma-
t ïo n . ,
Dans le baptême & l’extrème-onchçn, ce ft la
piètre qui fâit l’onftion du faint chrême ôu de l’huile
iainte: dans les deux antres facremens où il y a on-
û io n , favoir la confirmation & l’ordre, e’eft l’évêque
feul qui a pouvoir de la faire.
Autrefois les évêques exigeoient une contribution
du clergé pour la confe&ion de leur faint chrême ,
qu’ils appelloient dejiarii chrifmales : & l’on tire enco-,
re une legere rétribution des fabriques, en leur distribuant
chaque année les faintes huiles, dans la plû-
,part des diocèfes. (G)
CHRÉMEAU, f. m. £ "théologie. ) c’eft un bonnet
ou béguin de toile qu’on met fur la tête des enfans
-après qu’ils font baptifés, & qui repféfente la robe
ÎAanche, fymbole de l ’innocence, dont on revêtoit
■ autrefois les cathécumenes après leur baptême. (G)
CHRESES, ou CHRESIS , ( Mufique. ) ,
■ ttfius ^ en Mufique , eft une des parties de l’ancienne
mélopée* qui apprend au compofiteur à mettre, un
tel arrangement dans la fuite des fons, qu’il en réduite
une bonne modulation &c une mélodie agréable.
Cette partie s’applique à différentes fucceflions
des fons , appellées par fes anciens, agoge, euthia,
■ anacamptofa, & c . Voye^ T irade. (S)
CHRÉTIEN, f. ni (Théologie.) en parlant des
perfonnes, fignifie celui qui étant baptifé fait profef-
fion de la doctrine de Jefus-Chrift; 6c en parlant des
chofes, ce qui eft conforme à la loi évangélique :
ainfi l’on dit un difeours chrétien, une vie chrétienne ,
des fentimens chrétiens , & c .
Çe fut à Antioche -, vers l’an 41 , que l’on commença
à donner le nom de chrétien à ceux qui pro-
feffoient la foi de Jefus-Chrift, & que l’on appelloit
auparavant difciples. On les nommoit encore élus ,
freres , fiaints , croyans , fideles, nazaréens. On les
appella aufli Jejféens ', du* nom de Jejfé , pere de
David ; & félon d’autres, de Jefus-Chrift , auteur
de leur religion. Philon les nomme Thérapeutes ; mais
c ’eft une queftion encore indécife , que de favoir
f i les Thérapeutes étoient chrétiens. Voye% THERAPEUTES.
On leur donnoit le nom grec d’ikSuç, en
latin pijciculi , qu’on regarde vraiffemblablement
comme un nom technique , compofé des premières
lettres de chacun de ces mots, i»<r*ç Xpiç-oç, ©*« Tioç ,
2ottp ; Je fus Chrifius, Dei filius, falvator. On les appelloit
encore Gnofiiques, yvuç-iKuç, c’eft-à-dire hommes
doiiésde fcience & d’intelligence; & quelquefois
Théophores & Chriflophores , ,ç’eft-à-dire temples
de Dieu , temples du Chrift. On trouve dans quelques
peres, mais rarement, les Chrétiens défignés par
le nom même de Ch'rifis, ou confacrés à-Dieu par les
onfïions faintes du baptême & de la confirmation.
Les Payens , qui les regardoient comme des gens
dévoiiés à la mort, deftinés au feu 6c aux gibets ,
leur donnoient des noms injurieux tirés de ces fup-
•plices, tels que bioeothanati ,farmenticii, femaxii. On
leur prodiguoit aufli les odieufes qualifications d’im-
pofteurs , de magiciens , 6c on les confondoit avec
les Juifs. Julien l’apoftat ne les défignoit que par le
titre méprifant de Galiléens, qu’il donnoit à Jefus-
Chrift lui-même. Le peuple leur donnoit le nom d\z-
thées , parce qu’ils combattoient le culte des faux
dieux ; les favans, celui de Grecs 6c d’impofieurs, oii
de fophifies. On les nomma aufli fibyllifles, parce que
dans leurs difputes avec les Payens, quelques - uns
alléguèrent l’autorité de ces livres des Sibylles , qui
paffent aujourd’hui généralement pour fuppofés ;
f arabolaires ou parabolains & défefpérés , à caufe du
courage avec lequel ils bravoient la mort. Les hérétiques
leur donnèrent aufli divers noms ridicules ou
méprifans, comme ceux à’allégorijïes , de fimples ,
d’antropolatres , ou adorateurs d'hommes , 6cc. Bing-
,ham, orig. ecclef. tom. I. lib .j. c. j . & ij.
Le Roi de France porte le titre de Roi très-Chrétien
, prérogative dont on fait remonter l’origine juf-
Jorne I I I .
qu’à Childebërt, à qui S. Grégoire le Grand écrivoit
que le royaume de France eft autant élevé en dignité
au-deffus des autres royaumes, que la royauté
elle-même eft au-deffus de la condition des hommes
privés. Il eft certain que Charles Martel 6c Pepiri
le Bref ont porté ce titre; Lambicius, dans le troifie-
me tome de fon catalogue de la bibliothèque des empereurs
, prétend que le nom de Roi très- Chrétien a été
donné aux rois de la fécondé race ; non en qualité de
rois de France, mais en qualité d’empereurs d’Allemagne
; prétention abfurde 6c convaincue de faux
par le témoignage uniforme & confiant de tous les
hiftoriens.
■ CHRÉTIENNE, (C our) o u cour de chrétienté, nom
qu’on donnoit en Angleterre à un tribunal tout com-
pofé d’eceléfiaftiques, par oppofition à la courlaye^
dont les membres étoient tous laïques;
C h r é t ien n e , ( Église fv o y e^ Église.
C hrétienne, (R e l ig io n ) voye{ C hristian
nisme & Rel igion.'
C hrétiens de S. Je a n , feélé corrompue dé
chrétiens , répandue à Baffora 6c aux environs, qu’on
nomme aufli Sabéens 6c Mandaïtes. T'oyez Sabéens
& Manda'ït è s .
Ces prétendus chrétiens, qu’où croit d’abord avoir
habité le long du Jourdain, où S. Jean baptifoit, 6c
avoir pris de-là le nom de chrétiens de S. Jean, 6d
qui, après la conquête de la Paleftirte par les Maho-
métans, fe retirèrent dans la Méfopotamie êC là Chal-
dé e, ne font ,■ de l’aveu de tous les voyageurs, ni
Juifs, ni Chrétiens, ni Mufulmans. M. Chambers dit
que tous lés ans ils célèbrent une fête de cinq jôùrs ,
pendant lefquels ils vont recevoir de la main de leurs
évêques le baptême de S. J®an, & que leur baptême
ordinaire s’adminiftre'dans-les fleuves.ou rivières
, 6c feulement le Dimanche.
M. FouTmont l’aîné, dans un mémoire hiftorique
fuf cette feéle, dit entre autres chofes , qu’elle fè
donné une origine très-ancienne, remontant au
moins jufqu’à Abraham ; 6c que de tems immémorial
elle a eu des fimulacres, des arbres dévoués ,
des bois facrés, des temples, des fêtes, une hiérarchie
, l’adoration, la priere , 6c même une idée de
la réfurre&ion ; pratiques qui font un mélange du
Judaïfmé 6c du Paganifme , plûtôt qu’une preuve
bien nettè de Chriftianifme*. Les Mathématiciens qui
dominoient parmi eu x , forgeoient clés dogmes ouré-
jettoient ceux des autres , félon leurs calculs. Ainfi ,
lés uns foûtenoient que la réfurre&ion devoit fe fairè
au bout dé 9000 ans, parce qu’ils fixoient à ce tems
lâ révolution entière des orbes céleftes ; d’autres ne
l’attendoientqu’au bout de 36426 ans. Plufieursd’en-
tr’eux foûtenoient dans le inonde , ou dans les mondes
, une efpece d’éternité , pendant laquelle tour-
à-tour ces mondes étoient détruits 6c refaits. On a
une homélie de S. Grégoire de Nazianze contre les
Sabiens ou Sabéens. L ’alcoran fait mention de cette
feâe. Ils font une mémoire honorable de S. Jean
Baptifte, dont ils fe difent les difciples ; & leurs liturgies
& autres livres font mention du baptême, 6c
de quelques autres facremens qu’on ne rencontré
que chez lès Chrétiens. Mém. de Cacad. des Infcript. b
Belles-Lett. tom. X I I . p. TCI & fuiv. (G)
C hrétiens de S. T homas , eft un peuple des
Indes orientales, qui, fuivant lâ tradition du pays ,
reçut la foi de l’évangile par la prédication de l’apôtre
S. Thomas.
A l’arrivée des Portugais à Calecut, & au premier
voyage qu’ils firent aux Indes , ils y trouvèrent
les anciens convertis qui , ayant appris qu’il
étoit arrivé dans leur contrée un peuple nouveau
qui avoit une .vénération particulière pour la croix,
leur propoferent une alliance par des ambaffadeurs,
B b b ij