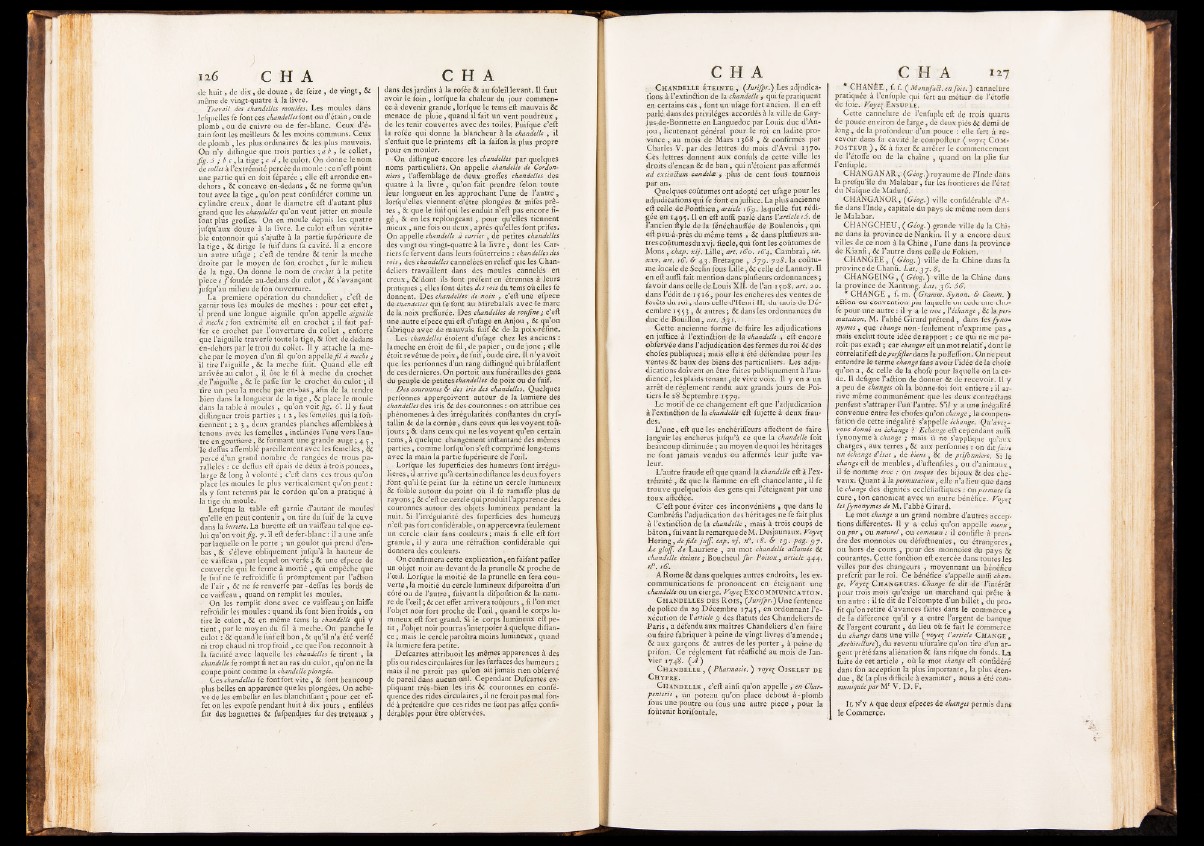
I f g C H A
■ de huit, de d ix , de douze, detfeize , de vingt, 8c
même de vingt-quatre à la livre.
Travail des chandelles moulus. Les moules dans
lefquelles fe font ces chandelles (ont ou d’étain, ou de
plomb , ou de cuivre ou de fer-blanc. Ceux d’é-
.tain font les meilleurs 8c les moins communs. Ceux
de plomb , les plus ordinaires & les plus mauvais.
On n’y diftingue que trois parties ; a b , le collet,
fig. 5 i b c , la tige ; c d , le culot. On donne le nom
de collet à l’extrémité percée du moule : ce n’eft point
.une partie qui en foit féparée ; elle eft arrondie en-
dehors , 8c concave en-dedans, 8c ne forme qu’un
tout avec la tig e, qu’on peut conlidérer comme un
Cylindre creux, dont le diamètre eft d’autant plus
grand que les chandelles qu’on veut jetter en moule
font plus groffes. ' On en moule depuis les quatre
jufqu’aux douze à la livre. Le culot eft un véritable
entonnoir qui s’ajufte à la partieSupérieure de
la tige , & dirige le fuif dans fa cavité. Il a encore
un autre ufage ; c’eft de tendre & tenir la meche
droite par le moyen de fon. crochet, fur le milieu
de la tige. On donne, le nom de crochet à la petite
pièce e f foudée au-dedans du culot, 8c s’avançant
jufqu’au milieu de fon ouverture.
La première opération du chandelier, c’eft de
garnir tous les moules de meches : pour cet effet,
il prend une longue aiguille qu’on appelle aiguille
a meche ; fon extrémité eft en crochet ; il fait paf-
'fer ce crochet par l’ouverture du collet ., enforte
que l’aiguille traverfé toute la tige, & fort .de dedans
"en-dehors par le troii du collet. Il y attache la ^e,-
che par le moyen d’un fil qu’on appelle./?/ à meche ;
il tire l’aiguille , 8c la meche fuit. Quand elle eft
arrivée au culot , il ôte le fil à meche du crochet
de l’aiguille , & le paffe fur le crochet du culot'; il
tire un peu la meche par en-bas , afin de la, tendre
bien dans la longueur de la tige ,8 c place le moulé
dans la table à moules , qu’on voit fig. 6. Il y faut
diftinguer trois parties ; 1 z , les femelles, qui la foû-
tiennent ; z 3 , deux grandes planches affemblées à
tenons avec les femelles , inclinées l’une vers l'autre
èn gouttière, & formant une grande auge ; 4 5 ,
le deffus affemblé pareillement avec les femelles, 8c
percé d’un grand nombre de rangées de trous parallèles
: ce deffus eft épais de déux à trois pouces,
large & long à volonté”; c’eft dans ces trous qu’on
place les moules le plus verticalement qu’on peut :
ils y font retenus par le cordon qu’on a pratiqué à
la tige du moule.
Lorfque la table eft garnie d’autant de moules'
qu’elle en peut contenir , on tire du fuif de la cuve
dans la burette. La burette eft un vaiffeau tel que celui
qu’on voit fig. 7 . il eft de fer-blanc : il a une anfe
par laquelle on le porte ; un goulot qui prend d’en-
bas , & s’élève obliquement jufqu’à la hauteur de
'c e vaiffeau , par lequel on verfe ; & une efpece de
couvercle qui le ferme à moitié , qui empêche que
le fuif ne fe refroidiffe fi promptement par l’aûion
de l’air , & ne fe renverfe par - deffus les bords de
ce vaiffeau, quand on remplit les moules.
- On les remplit donc avec ce vaiffeau ; on laiffe
refroidir les moules quand ils font bien froids, on
tire le culot, 8c er. même tems la chandelle qui y
t ien t, par le moyen du fil à meche. Ort panche le
culot : 8c quand le fuif eft bon, & qu’il n’a été verfé
ni trop chaud ni trop froid , ce que l’on reconnoît à
la facilité avec laquelle les chandelles fe tirent , la
chandelle fe rompt fi net au ras du culot, qu’on ne la
coupe, point comme la chandelle plongée.
; Ces chandelles fe font fort v ite , & font beaucoup
plus belles en apparence que les plongées. On achet
é de les embellir en les blanchitfant ; pour cet effet
on les expofe pendant huit à dix jours , enfilées
fur des baguettes 8c fufpendues fur des tréteaux ,
C H A
dans des jardins à la rofée & au foleil levant. 11 faut
avoir le foin , lorfque la chaleur du jour commence
à devenir grande, lorfque le tems eft mauvais 8c
menace de pluie, quand il fait un vent poudreux,
de les tenir couvertes avec des toiles. Puifque c’eft
la rofée qui donne la blancheur à la chandelle , il
s’enfuit que le printems eft la faifon la plus propre
pour en mouler.
On diftingue encore les chandelles par quelques
noms particuliers. On appelle chandelle de Cordon-
niers Taffemblage de deux .groffes chandelles des
quatre à la liv r e , qu’on fait prendre félon toute
leur longueur en les approchant l’une de l’autre ,
lorfqu’elles viennent d’être plongées & mifes prêtes
, & que le fuif qui les, enduit n’eft pas encore figé
, & en les replongeant , pour qu’elles tiennent
mieux , une fois ou deux, après qu’elles font prifes.
On appelle chandelle à carrier, de petites chandelles
des vingt ou vingt-quatre à la liv re , dont les Carriers
fe fervent dans leurs foûterreins : chandelles des
rois^ des chandelles cannelées en relief que les Chandeliers
travaillent dans des moules cannelés en
creux, & dont ils font préfent en etrennes à leurs
pratiques ;. elles font dites des rois du tems où elles fe
donnent. Des chandelles de noix -, c’eft une efpece
de chandelles qui fefont au Mirebalais avec le marc
delà noix preffurée. Des chandelles de roufine; c’eft
une autre efpece qui eft d’ufage en A njou, 8c qu’on
fabriqué avec de mauvais fu if 8c de la poix-refine.
Les' chandelles étoient d’ufage chez les anciens :
la meche en étoit de f il, de papier, ou de jonc ; elle
étoit revêtue de poix, de fuif, ou de, cire. Il n’y avoit
que les perfonnes d’un rang diftingué qui brûlaffent
de ces dernieres. On portoit aux funérailles des gens,
du peuple de petites chandelles de poix ou de fuif.
Des couronnes & des iris des chandelles. Quelques
perfonnes apperçoivent autour de la lumière des
chandelles des iris 8c des couronnes : on attribue ces
phénomènes à des irrégularités confiantes du cryf-
tallin & de la cornée, dans ceux qui les voyent toujours
; & dans ceux qui ne les voyent qu’en certain
tems, à quelque changement ânftantarté des mêmes
parties, comme lorfqu’on s’eft comprimé Iong-tems
avec la main la partie fupérieure de l’oeil.
... Lorfque les fuperfiçies des humeurs font irrégulières
, il arrive qu’à certaine diflance les deux foyers
font qu’il-fe peint fur la rétine un cercle lumineux
.5c foible autour du point où il fe ramaffe plus de
rayons. ; 5c c’eft ce cercle qui produit l’apparence des
couronnes autour des objets lumineux pendant la
nuit. Si l ’irrégularité des fuperfiçies des humeurs
n’eft pas fort confidérable, on appercevra feulement
un cercle clair fans couleurs ; mais fi elle eft fort
grande, il y aura une réfraction confidérable qui
donnera des couleurs.
On confirmera cette explication, en faifant pafler
un objet noir au-devant de ,1a prunelle 8c proche de
l’oeil. Lorfque la moitié de la prunelle en fera couverte
, la moitié du cercle lumineux difparoîtra d’un
côté ou de l’autre, fuivant la difpofition 8c la- nature
de l’oeil ; 8c cet effet arrivera toujours, fi l’on met
l’objet noir fort proche de l’oe il, quand le corps lumineux
eft fort grand. Si le corps lumineux eft petit
, l’objet noir pourra s’interposer à quelque diftan-
ce ; mais le cercle paroîtra moins lumineux, quand
la lumière fera petite.
Defcartes attribuoit les mêmes apparences à des
plis ou rides circulaires fur les furfaces des humeurs ;
mais il ne paroît pas qu’on ait jamais rien obfervé
de pareil dans aucun oe il. Cependant Defcartes expliquant
très-bien les iris 8c couronnes en confé-
quence des rides circulaires, il ne feroit pas mal fondé
à prétendre que ces rides ne font pas affez confi-
dérables pour être obfervées.
C H A
| C handelle éteinte , (Jurifpr.) Les adjudications
à l’extin&ion de la chandelle , qui fe pratiquent
en. certains ca s , font un ufage fort ancien. Il en eft
parlé, dansdes privilèges accordés à la. ville de C.ay-
lus-_de-Bo.nnette en Languedoc par Louis, duc d’Anjou
, lieutenant général pour, le roi en ladite, province
, au mois de Mars 1368 , 8c confirmés. par
Charles V. par des lettres du mois d’Avril 1370*
Çés lettres'donnent aux confuls de cette ville les
droits, d’encan 8c de ban, qui n’étoient pas. affermés
ad extinçlum candeltz y plus de cent fous tournois
par an.
Quelques coutumes ont adopté cet ufage pour les
adjudications qui fe font en juftice. La plus ancienne
eft celle dePonthieu, article 16$. laquelle fut rédigée
en 14.95. Il en eft auffi parlé dans l’article i5. de
l ’ancien ftyle de la fénéchauffée de Boulenois, qui
eftpeu-à-près du même tems , 8c dans plufieurs autres.
coûtumesdu xvjê fiecle, qui font les coutumes de
Mons x chap. xij. Lille, art. 160. 164. Cambrai, tit.
xxv. art. i6 . & 43. Bretagne , -579. yz8. la coutume
locale de Seclin fous Lille, 8c celle de Lannoy. Il
en eft aufîi fait'mention dans plufieurs ordonnances ;
lavoir dans celle de,Louis XII. de l’an 1508. art. z o.
dans l’édit de 15 i 6 , pour les enchères des ventes de
forêts du roi ; dans celle d’Henri II, du mois de Décembre
15 < 3 ,8c autres ; 8c dans les ordonnances du
duc de Bouillon y art.- 5g < •
Cette ancienne forme de faire les adjudications
en juftice à Pextinttion de Ja chandelle .) eft encore
obfervée dans l’adjudication des fermes du roi 8c des
chofes publiques ; mais elleâ été défendue -pour les
ventes & baux des biens des particuliers. Les adju-
dications doivent en être faites publiquement à Pau*
dience, les plaids tenant, de vive voix. Il y en a un
arrêt de réglement rendu aux grands jours de Poitiers
le z8 Septembre-ryyc).
Le motif de ce changement eft que l’adjudication
à l’extin&ion de la chandelle eft fujette à deux fraudes.
L’une, eft que les enchériffeurs affeftent de faire
languir les enchères jufqu’ à ce que la chandelle foit
beaucoup diminuée ; au moyen de quoi les héritages
ne font jamais vendus ou affermés leur jufte valeur.
L ’autre fraude eft que quand la chandelle eft à l’extrémité
, 8c que la flamme en eft chancelante , il fe
trouve quelquefois des gens qui l’éteignent par une
toux affeftée.
C ’eft pour éviter ces inconvéniens , que dans le
Cambréfis l’adjudication des héritages ne fe fait plus
à l’extinélion de la chandelle , mais à trois coups de
bâton, fuivant la remarque de M. Desjaunaux. Voye1
Hering, de fide jujf. cap. vj. n°. 18. & i£). pag. c» 7 .
Le glojfi. de Lauriere , au mot chandelle allumée 8c
chandelle éteinte ; Boucheul fur Poitou, article 4444
■n°. / (SV
A Rome 8c dans quelques autres endroits, les excommunications
fe prononcent en éteignant une
chandelle ou un cierge. Voye^Excommunication.
C handelles des Rois, (Jurifpr.)\]ne(euienQe
de police du Z9 Décembre 1745, en ordonnant réexécution
de Varticle y des ftatuts des Chandeliers de
Paris, a défendu aux maîtres Chandeliers d’en faire
ou faire fabriquer à peine de vingt livres d’amende ;
8c aux garçons 8c autres de les porter, à peine de
prifon. Ce réglement fut réaffiché au mois de Janvier
1748. ( A )
C handelle , ( Pharmacie. ) voye? Oiselet de
C hypre.
C handelle , c’eft ainfi qu’on appelle , en Charpenterie
, un poteau qu’on place debout à-plomb
fous une poutre ou fous une autre piece , pour la
foûtenir horifontale.
C H A 117
; * CHANÉË, en fàie.} canneltire
pratiquée à l’enfuple qui fert au métier de l’étoffe
de foie. /^«px^ Ensuple.
Cette cannelure de l’enfuple eft de trois quarts
de pouce environ de large, de deux piés 8c demi de
long, de la profondeur d’un pouce : elle fert à recevoir,
dans la cavité le compofteur (yoyeç CÔM-
posteur ) , 8c à fixer 8c arrêter le commencement
de l’étoffe ou de la chaîne , quand ôn la plie fur
l’enfuplei
CHAN•GANAR,■ ('(?^0g,.) royaume de l’Inde dans
la prefqu’île du Malabar, lur les frontières de l’état
du Naïque de Maduré.- |
GHANGANOR., ( Géog.) ville confidérable d’A-
fie dans l’Inde, capitale du pays de même nom dans
le Malabar.
CHANGCHEU, ( Géog.') grande ville de la Chine
dans la province de Nankin. Il y à encore deux
villes de ce nom à la C hine, l’une dans la province
de Kianfi, 8c l’autre dans celle de Fokien.
CHANGÉE, ( Géog. ) ville de la Chine dans la
province de Chanfi. Lat. 3 7. 8.
CHANGEING, (Géog-.) ville de la Chine dans
la province de Xantung. Lat. 364 56.
* CHANGE , f. m. ( Gramm. Synon. 6 Cortitn. )
aâion ou convention par laquelle on cede une cho-
fe pour une autre : il y a le troc, l’échange , 8c la permutation.
M. l’abbé Girard prétend, dans fes jyno-
nymes , que change non-feulement n’exprime pas ,
mais exclut toute idée de rapport : ce qui ne me paroît
pas exa£l ; car changer un mot relatif, dont le
corrélatif eft àeperjîfierà ans la poffeffion. On ne peut
entendre le terme changé fans avoir l’idée de la chofe
qu’on a , 8c celle de la chofe pour laquelle on la cédé.
Il defigne l’a&ion de donner 8c de recevoir. Il y
a peu de changes où la bonne-foi foit entière.: il arrive
même communément que les deux contraélans
penfent s’attraper l’ufl l’autre. S’il y a une inégalité
convenue entre les chofes qu’on change, la coimpen-
fation de cette inégalité s’appelle échange. Qu’aveç-
vous donné en échange ? ’ Echange eft cependant auffi
fynonyme à change ; mais il ne s’applique qu’aux
charges, aux terres , 8c aux perfonnes : on dit faire
un échange d’état , de biens , 8c de prifonniers. Si le
change eft de meubles , d’uftenfiles , ou d’animaux,
il fe nomme troc : on troque dés bijoux & des chevaux.
Quant à la permutation, elle n’a lieu que dans
le change des dignités eccléfiaftiques : ôn permute fa
cure, fon canonicat avec un autre bénéfice. Voyei
les Jy no nymes de M. l’abbé Girard 4
Le mot change a un grand nombre d’autres acceptions
différentes. Il y a celui qu’on appelle menu,
ou pur, ou naturel, ou commun : il Confifte à prendre
des monnoies ou défeftueufès, ou étrangères,
ou hors de cours , pour des monnoies du pays &
courantes. Cette fonction eft exercée dans toutes les
villes par des changeurs , moyennant un bénéfice
prefcrit par le roi. Ce bénéfice s’appelle aufîi change.
Voye\[ C hangeurs. Change fe dit de l’intérêt
pour trois mois qu’exige un marchand qui prête à
un autre : il fe dit de l’efcompte d’uft billet, du profit
qu’on retire d’avances faites dans le commerce *
de la différence qu’il y a entre l’argent de banque
8c l’argent courant, du lieu où fe fait le Commerce
du change dans une ville (voye{ l ’article C hange ,
Architecture"), du revenu ufuraire qu’on tire d’un argent
prété fans aliénation 8c fans rifque du fonds. L a
fuite de cet article , où le mot change eft confidéré
dans fon acception la plus importante, la plus éten«
due, 8c la plus difficile à examiner , nous a été com-
muniquéepar Mr V . D . F*
Ïl n’y a que deux efpeces dé changes permis dans
le Commerce«