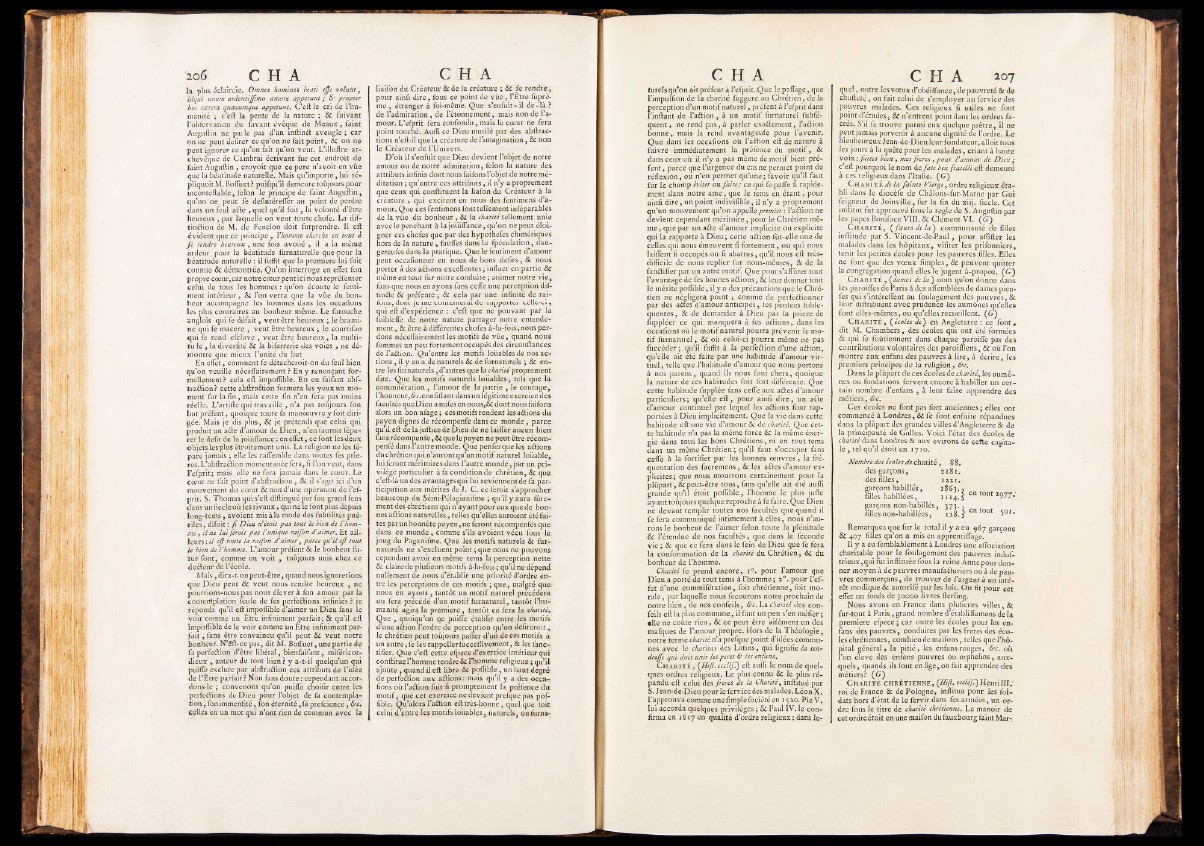
la plus éclaircie. Omnes homïncs beciti tjje voluht,
idqub unum ardentifjimo amore appetunt ; 6* propttr
hoc ccctera quacumque appetunt. C’eft le cri de l’humanité
; c’eft la pente de la nature ; Sc l'uivant
l’obfervation du favant évêque de Meaux, faint
Auguftin ne parle pas d’un inftinll aveugle ; car
on ne peut defirer ce qu’on ne fait point, & on ne
peut ignorer ce qu’on lait qu’on veut. L’illuftre archevêque
de Cambrai écrivant fur cet endroit de
faint Auguftin , croyoit que ce pere n’avoit en vue
que la béatitude naturelle. Mais qu’importe, lui ré-
pliquoitM.Boffuet? puifqu’il demeure toûjours pour
inconteftabie, félon le principe de faint Auguftin,
qu’on ne peut fe defintéreffer au point de perdre
dans un feul aile , quel qu’il foit, la volonté d’être
heureux, par laquelle on veut toute chofe. La dif-
îinllion de M. de Fenelon doit furprendre. Il eft
évident que ce principe , l'homme cherche en tout à
fe rendre heureux, une fois avoué , il a la même
ardeur pour la béatitude furnaturelle que pour la
béatitude naturelle : il fuffit que la première lui foit
connue Sc démontrée. Qu’on interroge en effet fon
propre coeur,car notre coeur peut ici nous repréfenter
celui de tous les hommes : qu’on écoute le fenti-
ment intérieur , Se l’on verra que la vue du bonheur
accompagne les hommes dans les occafions
les plus contraires au bonheur même. Le farouche
anglois qui fe défait, veut être heureux ; le brami-
ne qui fe macéré , veut être heureux ; le courtifan
qui fe rend efclave , veut être heureux, la multitude
, la diverlïté Sc la bifarrerie des voies , ne démontre
que mieux l ’unité du but
En effet, comment fe détacheroit-on du feul bien
qu’on veuille néceffairement ? En y renonçant formellement?
cela eft impoffible. En en faifant abf-
traftion? cette abftraûion fermera les yeux un moment
fur la fin , mais cette fin n’en fera pas moins
réelle. L’artifte qui travaille , n’a pas toûjours fon
but préfent, quoique toute fa manoeuvre y foit dirigée.
Mais je dis plus, & je prétends que celui qui
produit un aile d’amour de D ieu , n’en l'aurait fépa-
rer le defir de la joïùffance : en effet, ce font les deux
•objets les plus étroitement unis. La religion ne les fé-
pare jamais ; elle les raflémble dans toutes fes prières.
L’abftraltion momentanée fera, fi l’on veut, dans
l ’efprit; mais elle ne fera jamais dans le coeur. Le
coeur ne fait point d’abftrallion, Sc il s’agit ici d’un
mouvement du coeur & non d’une opération de l’efprit.
S. Thomas qui s’eft diftingué par fon grand fens
dans un fiecle où fes rivaux, qui ne le font plus depuis
long-tems, a voient mis à la mode des fubtilités puériles
, difoit : f i Dieu ri étoit pas tout le bien de l ’homme
, il ne lui feroit pas l'unique raifon d'aimer. Et ailleurs
: il eft toute la raifon d’aimer, parce qu’i l eft tout
le bien de l ’homme. L’amour préfent & le bonheur futur
font, comme on voit , toûjours unis chez ce
do&eur de l’école.
Mais, dira-t-on peut-être, quand nous ignorerions
que Dieu peut Sc veut nous rendre heureux , ne
pourrions-nous pas nous élever à fon amour par la
contemplation feule de fes perfections infinies ? je
réponds qu’il eft impoffible d’aimer un Dieu fans le
voir comme un Être infiniment parfait ; & qu’il eft
impoffible de le voir comme un Être infiniment parfait
, fans être convaincu qu’il peut Sc veut notre
bonheur. N’éft-ce pas, dit M. Boffuet, une partie de
fa perfeCHon d’être libéral, bienfaifant, miféricor-
dieux , auteur de tout bien ?. y a-t-il quelqu’un qui
puiffe exclure par abftra&ion ces attributs de l’idée
de l ’Être parfait ? Non fans doute : cependant accor-
dons-le ; convenons qu’on puiffe choifir entre les
perfections de Dieu pour l’objet de fa contemplation
, fonimmenlité, fon éternité ,fa prefcience, &c.
Celles en un mot qui n’ont rien de commun avec la
liaifon dit Créateur & de la créature ; Sc fe rendre,
pour ainfi dire, fous ce point de v u e , l’Être fuprè-
me , étranger à foi-même. Que s’enfuit-il de-là ?
de l’admiration, de l’étonnement, mais non de l’amour.
L’efprit fera confondu, mais le coeur ne fera
point touché. Auffi ce Dieu mutilé par des abftrac-
tions n’eft-il que la créature de l’imagination , Sc non
le Créateur de l’Univers.
D ’où il s’enfuit que Dieu devient l’objet de notre
amour ou de notre admiration, félon la nature des
attributs infinis dont nous faifons l’objet de notre méditation
; qu’entre ces attributs, il n’y a proprement
que ceux qui conftituent la liafon du Créateur à la
créature , qui excitent en nous des fentimens d’amour.
Que ces fentimens font tellement inféparables
de la vûe du bonheur , & la charité tellement unie
avec le penchant à la joiiiffance, qu’on ne peut éloigner
ces chofes que par des hypothefes chimériques
hors de la nature , fauffes dans la fpéculation, dan-?
gereufes dans la pratique. Que le fentiment d’amour
peut occafionner en nous de bons delirs, & nous
porter à des allions excellentes ; influer en partie Sc
même en tout fur notre conduite ; animer notre v ie ,
fans que nous en ayons fans ceffe une perception dif-
tin&e Sc préfente ; & cela par une infinité de rai-
fons,dont je me contenterai de rapporter celle-ci,
qui eft d’expérience : c’eft que ne pouvant par la
foiblefle de notre nature partager notre entendement
, & être à différentes chofes à-la-fois,nous perdons
néceffairement les motifs de vû e , quand nous
fommes un peu fortement occupés des circonftances:
de l’allion. Qu’entre les motifs loiiables de nos actions
, il y en a de naturels Sc de furnaturels ; & entre
les furnaturels, d’autres que la charité proprement
dite. Que les motifs naturels loiiables, tels que la
commifération , l’amour de la patrie , le courage,
l’honneur,d’c.confiftant dans un légitime exercice des
facultés queDieu a mifes en nous,oc dont nous faifons
alors un bon ufage ; ces motifs rendent les allions du
payen dignes de récompenfe dans ce monde, parce
qu’il eft de la juftice de Dieu de ne laiffer aucun bien
fans récompenfe, & que le payen ne peut être récom-
penfé dans l’autre monde. Que penferqueles allions
du chrétien qui n’auront qu’un motif naturel louable,
lui feront méritoires dans l’autre monde, par un privilège
particulier à fa condition de chrétien, Sc que
c’eft-làun des avantages qui lui reviennent de fa participation
aux mérites de J. C. ce feroit s’approcher
beaucoup du Sémi-Pélagianifme ; qu’il y aura fûre-
ment des chrétiens qui n’ayant pour eux que de bonnes
allions naturelles, telles qu’elles auraient été faites
par un honnête payen, ne feront récompenfés que
dans ce monde , comme s’ils avoient vécu fous le
joug du Paganifme. Que les motifs naturels & fur-
naturels ne s’excluent point ; que nous ne pouvons
cependant avoir en même tems la perception nette
Sc claire de plufieurs motifs à-la-fois ; qu’il ne dépend
nullement de nous d’établir une priorité d’ordre entre
les perceptions de ces motifs ; que, malgré que
nous en ayons , tantôt un motif naturel précédera,
ou fera précédé d’un motif furnaturel, tantôt l’humanité
agira la première, tantôt ce fera la charité.
Que , quoiqu’on qe puiffe établir entre les motifs
d’une allion l’ordre de perception qu’on defireroit,
le chrétien peut toûjours paffer d’un de ces motifs à
un autre,fe les rappellerfucceffivement, &les fanc->
tifier. Que c’eft cette efpece d’çxercice intérieur qui
conftituel’homme tendre Sc l’homme religieux ; qu’il
ajoûte , quand il eft libre & poffible, un haut degré
de perfeûion aux allions: mais qu’il y a des occafions
o ù l’aUion fuit fi promptement la. préfenee du
motif, que cet exercice ne devient prefque pas poffible.
Qu’alors l’allion eft très-bonne , quel que foit
celui d ’entre les motifs loiiables, naturels, ou fumaturels
qu’on ait préfent à l’efprit. Que le paffage, que
l’impulfion de la charité fuggere au Chrétien, de la
perception d’un motif naturel, préfent à l’efprit dans
l ’inftant de l’a llion , à un motif furnaturel fubfé-
quent, ne rend pas, à parler exallement, l’allion
bonne, mais la rend avantageufe pour l’avenir.
Que dans les occafions où l’allion eft de nature à
fuivre immédiatement la préfenee du motif, &
dans ceux où il n’y a pas même de motif bien préfent
, parce que l’urgence du cas ne permet point de
réflexion, ou n’en permet qu’une ; favoir qu’il faut
fur le champ éviter ou faire: cequi fe paffe fi rapidement
dans notre ame, que le tems en étant, pour
ainfi dire, un point indivifible, il n’y a proprement
qu’un mouvement qu’on appelle premier : l’allion ne
devient cependant méritoire, pour le Chrétien même,
que par un aile d’amour implicite ou explicite
qui la rapporte à Dieu ; cette allion fût-elle une de
celles qui nous émeuvent fi fortement, ou qui nous
laiffent fi occupés ou fi abattus, qu’il nous eft très-
difficile de nous replier fur nous-mêmes, & de la
fanÛifier par un autre motif. Que pour s’affûrer tout
l’avantage de fes bonnes allions, Sc leur donner tout
le mérite poffible, il y a des précautions que le Chrétien
ne négligera point ; comme de perfellionner
par des ailes d’amour anticipés, fes penfées fubfé-
quentes, & de demander à Dieu par la priere de
fuppléer ce qui manquera à fes allions, dans les
occafions où le motif naturel pourra prévenir le mot
if furnaturel, & où celui-ci pourra même ne pas
fuccéder ; qu’il fuffit à la perfellion d’une allion,
qu’elle ait été faite par une habitude d’amour virtuel,
telle que l’habitude d’amour que nous portons
à nos païens, quand ils npus font chers, quoique
la nature de ces habitudes foit fort différente. Que
cette habitude fupplée fans ceffe aux ailes d’amour
particuliers; qu’elle e f t , pour ainfi dire, un allé
d’amour continuel par lequel les allions font rapportées
à D ieu implicitement. Que la vie dans cette
habitude eft une vie d’amour Sc de charité. Que cette
habitude n’a pas la même force Sc la même énergie
dans tous les bons Chrétiens, ni en tout tems
dans un mêmé Chrétien ; qu’il faut s’occuper fans
ceffe à la fortifier par les bonnes oeuvres, la fréquentation
des facremens, & les ailes d’amour explicites;
que nous mourrons certainement pour la
plûpart, Sc peut-être tous, fans qu’elle ait été auffi
grande qu’il étoit poffible, l’homme le plus jufte
ayant toûjours quelque reproche à fe faire. Que Dieu
ne devant remplir toutes nos facultés que quand il
fe fera communiqué intimement à elles, nous n’aurons
le bonheur de l’aimer félon toute la plénitude
Sc l’étendue de nos. facultés, que dans la fécondé
vie ; & que ce fera dans le fein de D ieu que fe fera
la confommation de la charité du Chrétien , Sc du
bonheur de l’homme.
Charité fe prend encore, i° . pour l’amour que
Dieu a porté de tout tems à l’homme ; 2°. pour l’effet
d’une commifération, foit chrétienne, foit morale
, par laquelle nous fecourons notre prochain de
notre bien, de nos confeils., &c. La charité des con-
feils eft la plus commune, il faut un peu s’en méfier ;
«lie ne coûte rien, Sc ce peut être aifément un des
mafques de l’amour propre. Hors de la Théologie,
notre terme charité n’a prefque point d’idées communes
avec le charitas des Latins, qui fignifie la ten-
dreffe qui doit unir les per es & les enfans.
C h a r it é , {Hifl. eccléf.) eft auffi le nom de quelques
ordres religieux. Le plus connu Sc le plus répandu
eft celui des freres de la Charité, inftitué par
S. Jean-de-Dieu pour le fervice des malades. Léon X .
l ’approuva comme une fimple fociété en 1 5 20. Pie V.
lui accorda quelques privilèges ; Sc Paul IV. le confirma
en 1617 en qualité d’ordre religieux : dans lequel,
outre les voeux d’obéiffance,de pauvreté & de
chaftcté, on fait celui de s’employer au fervice des
pauvres malades. Ces religieux fi utiles ne font
point d’études, Sc n’entrent point dans les ordres fa-
cres. S’il fe trouve parmi eux quelque prêtre, il ne
peut jamais parvenir à aucune dignité de l’ordre. Le
bienheureux Jean-de-Dieu leur fondateur, alloit tous
les jours à la quête pour les malades, criant à haute
voix: faites bien, mes freres , pour l'amour de Dieu ;
c’eft pourquoi le nom de fate ben fratelli eft demeuré
à ces religieux dans l’Italie. ( G)
C h a r it é de la fainte Vierge, ordre religieux.établi
dans le diocèfe de Châlons-fur-Marne par Gui
feigneur de Joinville, fur la fin du xiij. fiecle. Cet
inftitut fut approuvé fous la réglé de S. Auguftin par
les papes Boniface VIII. Sc Clément V I. (G )
C h a r it é , {foturs de la} communauté de filles
inftituée par S. Vincent-de-Paul, pour affifter les
malades dans les hôpitaux, vifiter les prifonniers,
tenir les petites écoles pour les pauvres filles. Elles
ne font que des voeux fimples, Sc peuvent quitter
la congrégation quand elles le jugent à-propos. ÇG')
C h a r it é , (dames de la') nom qu’on donne dans
les paroiffes de Paris à des affemblées de dames pieu-
fes qui s’intéreffent au foulagement des pauvres, &
leur diftribuent avec prudence les aumônes qu’elles
font elles-mêmes, ou qu’elles recueillent. (G)
C h a r it é , {écoles de) en Angleterre: ce fo n t ,
dit M. Chambers, des écoles qui ont été formées
& qui fe foûtiennent dans chaque paroiffe par des
.contributions volontaires des paroiffiens, Sc où l’on
montre aux enfans des pauvres à lire, à écrire, les
premiers principes de la religion , &c.
Dans la plûpart de ces écoles de charité, les aumônes
ou fondations fervent encore à habiller un certain
nombre d’enfans , à leur faire apprendre des
métiers, &c.
Ces écoles ne font pas fort anciennes ; elles ont
commencé à Londres, Sc fe font enfuite répandues
dans la plûpart des grandes villes d’Angleterre & de
la principauté de Galles. Voici l’état des écoles de
charité dans Londres & aux evirons de cette capitale
, tel qu’il étoit en 1710.
Nombre des écoles de charité , 88.
des garçons, 2181.
des filles, 1221.
garçons habillés, 1863. ^
filles habillées, 1114.5
garçons non-habillés, 3 7 3. ,
filles non-habillées, 128.5
en tout 2977.’
en tout 501.'
Remarquez que fur le total il y a eu 967 garçons
Sc 407 filles qu’on a mis en apprentiffage.
Il y a eu femblablement à Londres une affociation
charitable pour le foulagement des pauvres induf-
trieux,qui fut inftituée fous la reine Anne pour donner
moyen à de pauvres manufaâuriers ou à de pauvres
commerçans, de trouver de l’argent à un intérêt
modique Sc autorifé par les lois. On fit pour cet
effet un fonds de 30000 livres fterling.
Nous avons en France dans plufieurs villes &
fur-tout à Paris, grand nombre d’établiffemens de la
première efpece ; car outre les écoles pour les enfans
des pauvres, conduites par les freres des écoles
chrétiennes, combien de maifons, telles que l’hôpital
général, la pitié, les enfans-rouges, &c. où
l’on éleve des enfans pauvres ou orphelins, auxquels
, quands ils font en âge, on fait apprendre des
métier^? (G )
C h a r it é ch r é t ien n e , (Hifl. eccléf.) HenriIII;
roi de France & de Pologne, inftitua pour les fol-
dats hors d’état de le fervir dans fes armées, un ordre
fous le titre de charité chrétienne. Le manoir de
cet ordre étoit en une maifon du fauxbourg faint Mar-,